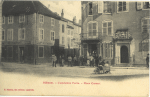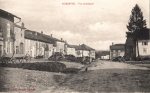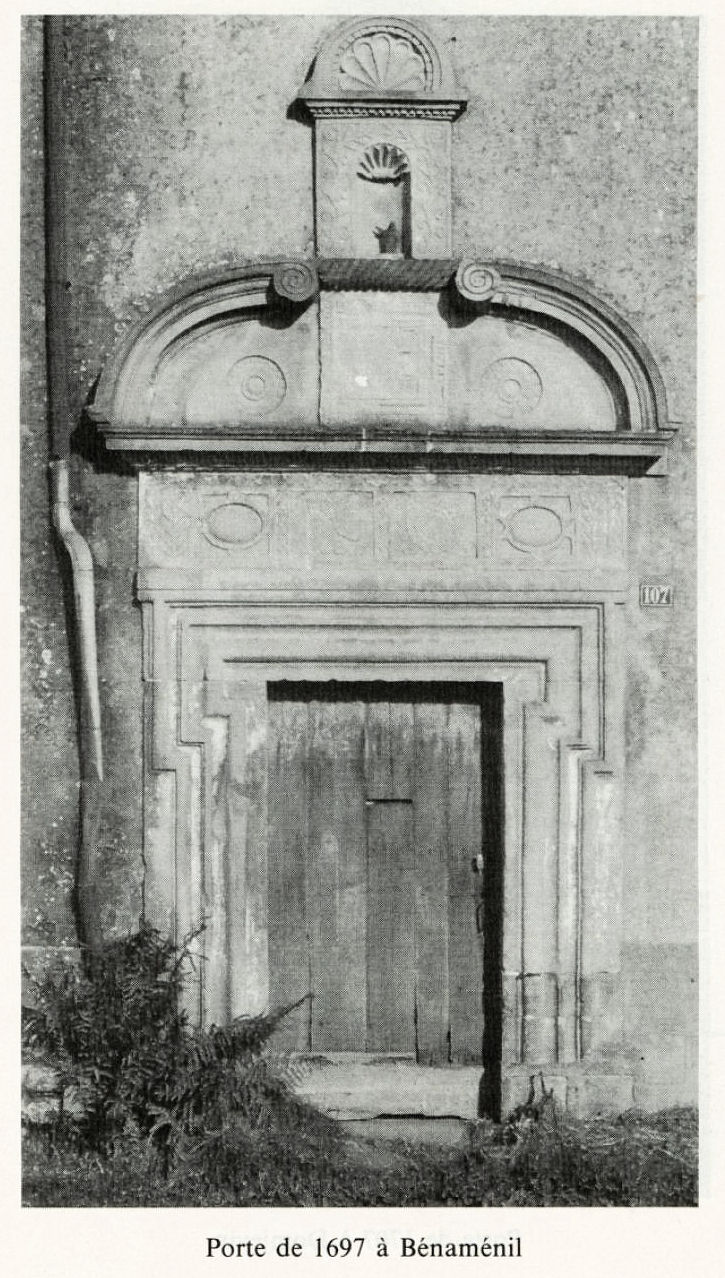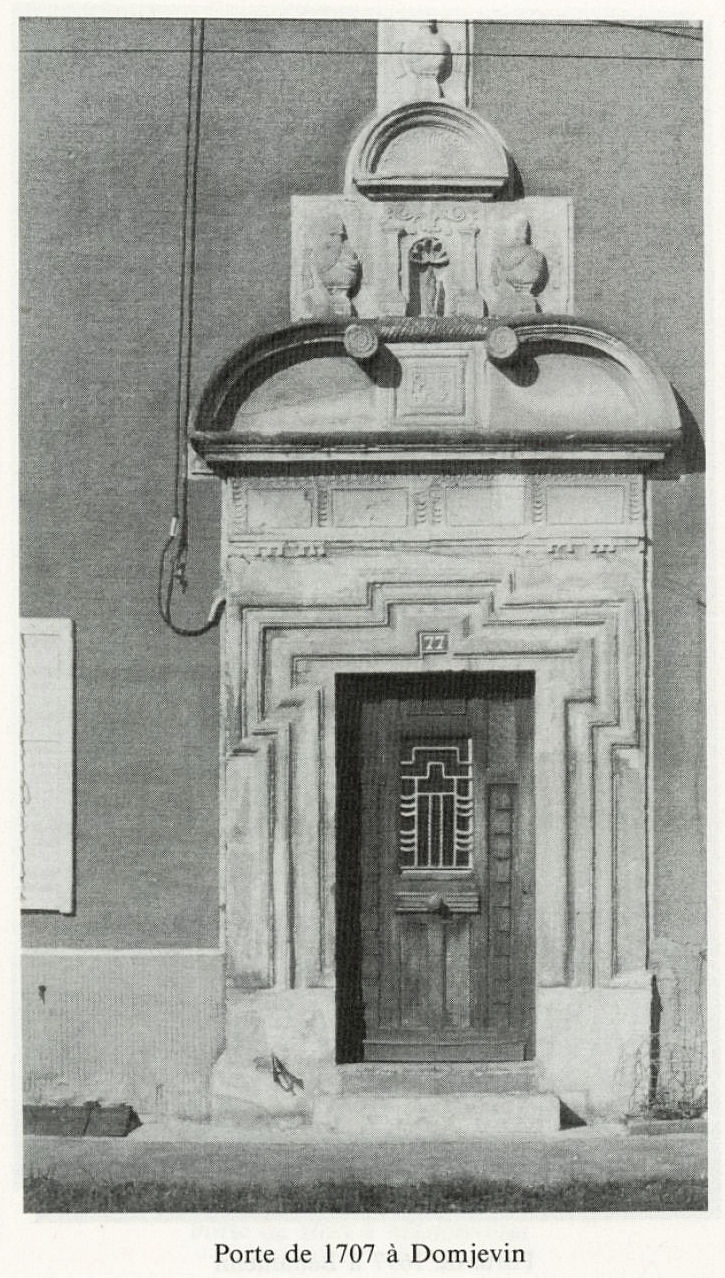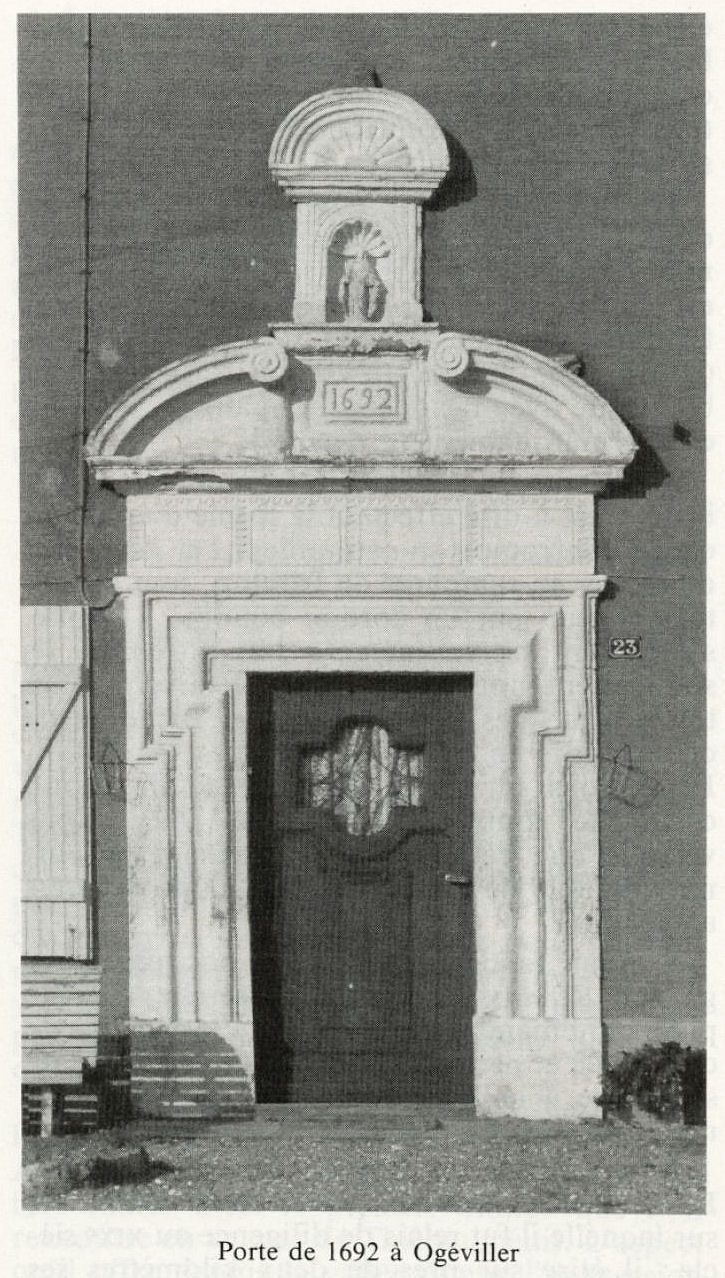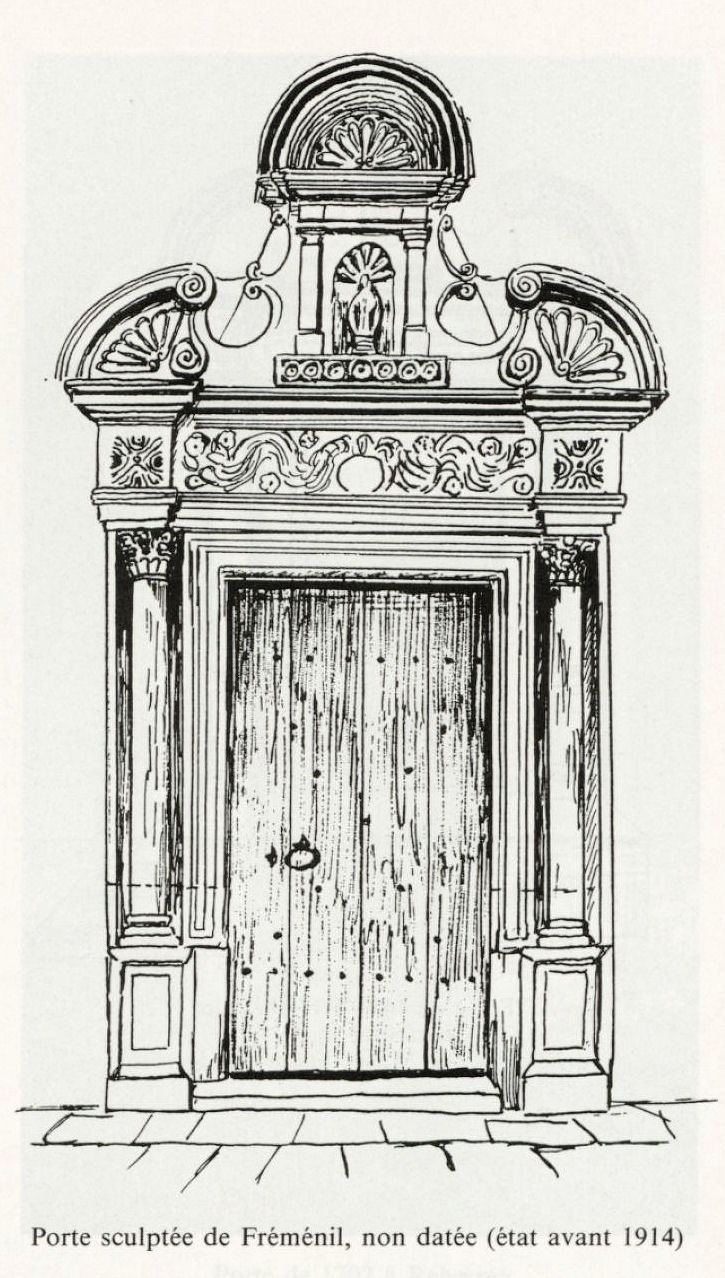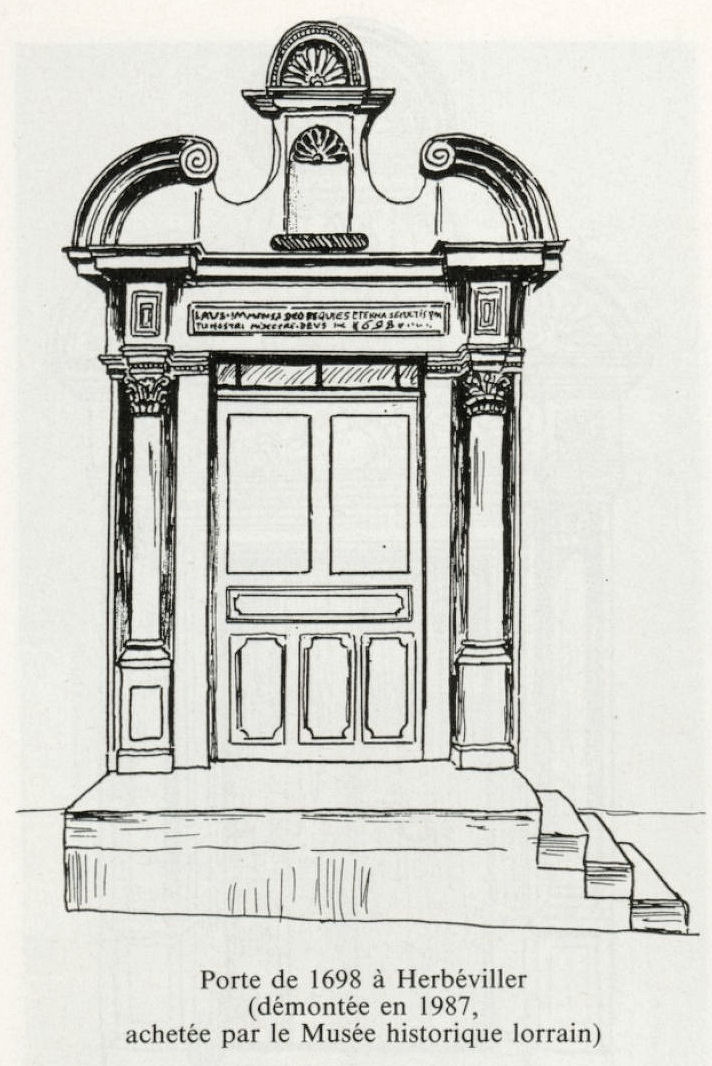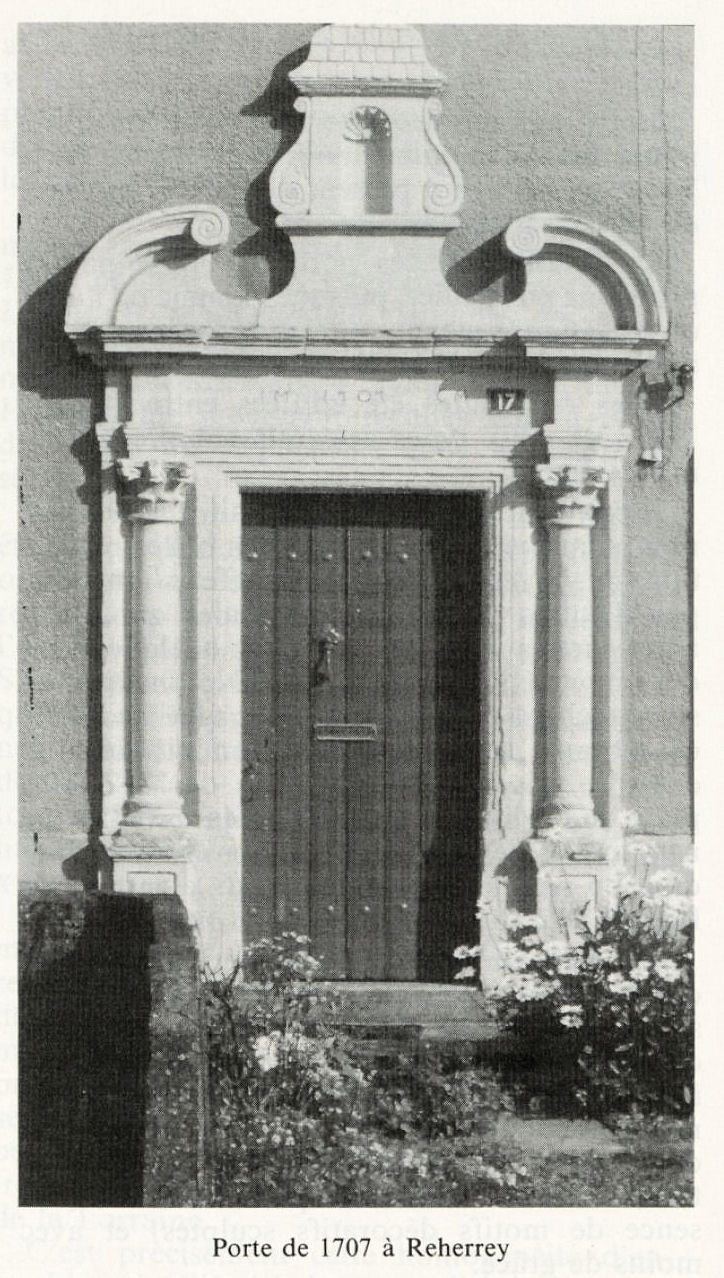|
Le Pays Lorrain
1988
Les portes monumentales de maisons rurales dans la moyenne vallée de la
Vezouze
Michel Berna On demeure confondu de
voir, dès le dernier quart du XVIIe siècle, des constructions neuves
respirant l'aisance, et même une certaine recherche de l'art, s'élever dans
tout le canton de Blâmont, y laissant un type d'architecture très
particulier, très intéressant, et qui mériterait de ne pas rester totalement
ignoré.
Emile Ambroise
La vallée de la Vezouze, cruellement éprouvée à maintes reprises au cours de
l'histoire (que l'on songe aux dévastations occasionnées par les guerres du
XVIIe siècle, et, tout dernièrement encore, par les deux guerres mondiales),
n'a conservé que peu de traces d'un passé pourtant prestigieux.
Val-et-Chatillon, Blâmont, Herbéviller, Ogéviller, Croismare, Chanteheux
avaient leur château; Saint-Sauveur, Cirey, Domèvre leur abbaye. Qu'en
reste-t-il ? Au mieux quelques pans de murailles; le plus souvent, des
pierres ou des objets disséminés ici et là, dans des musées ou chez des
particuliers. Aussi ne pouvons-nous appréhender la splendeur passée de ces
modestes villages qu'au prix de gros efforts de lecture... et d'imagination!
Si tous les villages de la Vezouze ont perdu à jamais les grands édifices -
guerriers, religieux ou d'apparat - qui, à un moment ou à un autre, avaient
fait leur gloire, certains d'entre eux ont néanmoins conservé jusqu'à nos
jours une richesse architecturale qui, pour être plus modeste assurément,
n'en suffit pas moins à les faire briller d'un éclat tout particulier. Il
s'agit, suivant l'expression de M. l'abbé Choux, des « portes monumentales »
que présentent certaines maisons d'habitation.
Le village lorrain traditionnel n'est pas spécialement réputé pour sa
coquetterie. L'austérité y est de rigueur, tant en ce qui concerne
l'agencement général des constructions que l'aspect de chacune d'elles. La
comparaison avec l'Alsace voisine est, à cet égard, tout à fait édifiante.
Cet état de fait semble tenir à deux causes essentielles. Le regroupement de
l'habitat en « villages-rue », où les maisons, d'un type uniforme, sont
accolées les unes aux autres le long d'une large rue principale, a été dicté
en grande partie par le mode d'exploitation des terres, basé sur une étroite
solidarité entre les membres de la communauté villageoise. Quant à
l'économie de moyens dont témoigne l'aspect extérieur de la maison
d'habitation, c'est bien là l'exact reflet du tempérament du paysan lorrain,
lequel, confronté aux rigueurs du climat et à l'ingratitude du sol, dut de
tout temps consacrer toutes ses ressources aux « menus soins de la vie
pratique », pour reprendre l'expression employée par Maurice Barrès.
Nous disons bien : « économie de moyens », car, si le paysan lorrain n'avait
que peu de temps et d'argent à consacrer à l'ornementation de sa demeure, le
souci de réaliser cette ornementation ne lui était nullement étranger. Aussi
s'est-il, le plus souvent, contenté de faire porter son effort sur la seule
porte d'entrée du logis. De fait, il n'est pas rare que celle-ci reçoive un
linteau sculpté où figurent la date de construction de l'édifice ainsi que
le nom ou les initiales de ses premiers propriétaires, parfois même des
motifs décoratifs tels qu'emblèmes religieux ou attributs professionnels
(représentation d'outils en relation avec le métier exercé par le premier
propriétaire).
Or, dans l'est de la Lorraine, cette habitude de décorer la porte d'entrée
des maisons d'habitation a pris une importance considérable, se

Porte de 1693 à Manonviller
traduisant, bien au-delà de la simple sculpture du linteau, par celle du
chambranle, ainsi que par l'adjonction d'un fronton avec tympan sculpté.
Bien plus, dans la région comprise entre Lunéville et Blâmont, elle s'est
manifestée avec un goût et une opulence tels qu'elle a donné naissance à de
véritables chefs-d'oeuvre.
La quasi-totalité de ces portes monumentales peuvent être observées dans la
moyenne vallée de la Vezouze, c'est-à-dire dans les villages de la zone qui
s'étend entre Domèvre et Marainviller. Nous passerons en revue les
différentes portes qu'il est permis d'observer, puis, les envisageant dans
leur ensemble, nous tenterons de dégager quelques enseignements d'ordre
historique et architectural.
I. LES DEUX TYPES DE PORTES MONUMENTALES
Un rapide survol de l'ensemble des portes monumentales de la vallée de la
Vezouze permet de les répartir en deux groupes qui, bien que voisins par
leur inspiration et leur aspect général, se distinguent cependant par la
manière dont a été réalisée l'ornementation du chambranle. Le plus souvent,
celle-ci affecte l'aspect d'une forte mouluration; mais certaines portes
présentent une ouverture encadrée par deux colonnes. Nous envisagerons
successivement ces deux types de portes.
Les portes à chambranle mouluré
Le voyageur qui, venant de Lunéville, entreprend de remonter le cours de la
Vezouze, ne peut manquer de noter, à Marainviller, le changement qui affecte
la configuration de la vallée. Jusqu'alors bien ouverte, celle-ci se
resserre aussitôt après le village, à la hauteur de Thiébauménil. Les vastes
étendues agricoles cèdent alors la place à un riant paysage de prairies et
de boqueteaux, où la rivière affirme davantage sa présence. Laissons pour
l'instant de côté le gros village de Marainviller - nous y reviendrons au
terme de notre étude -, et pénétrons plus avant à l'intérieur de notre champ
d'investigations.
Etabli sur la rive droite de la Vezouze, à l'écart des grandes voies de
communications, Manonviller semble sommeiller au pied de son fort ruiné.
C'est le premier village que l'on rencontre en venant de Thiébauménil.
L'aspect qu'il offre depuis la vallée donne l'impression d'un assez
important ensemble de constructions bien regroupées autour de l'église,
laquelle, bâtie sur un tertre, élève son clocher massif et d'un beau type
lorrain bien au-dessus des maisons d'habitation.
Aussitôt après le pont qui enjambe la rivière, on pénètre dans le village,
et, remontant la rue principale, on ne tarde pas à y découvrir, au n° 8, une
belle porte à chambranle mouluré. Malgré la destruction, en 1944, de la
maison dont elle faisait partie à l'origine, cette porte a fort heureusement
pu être sauvée et réinsérée dans la nouvelle construction.
Ce qui frappe tout d'abord, c'est la splendide ornementation du chambranle;
nulle part ailleurs nous n'en retrouverons d'aussi magnifiquement réalisée.
Elle se présente sous la forme d'une triple moulure au relief vigoureux. Ce
dernier est remarquablement accentué par trois
élégantes crossettes (les deux premières, dédoublées, sont situées à chacun
des angles du chambranle, la troisième au milieu de sa partie transversale)
qui contribuent à donner à l'ensemble l'aspect d'une croix de taille
humaine.
Le linteau est, lui aussi, somptueusement orné. Un cartouche rectangulaire,
contenant le nom du premier propriétaire (Jean Mangenat), est encadré de
deux paires de motifs décoratifs figurant, de manière très stylisée, des
fleurs (côté gauche) et des astres (côté droit). L'ensemble, traité avec
beaucoup de maîtrise, est d'un effet remarquablement décoratif.
Au-dessus du linteau, le fronton est en arc brisé, c'est-à-dire affectant la
forme d'un demi- cercle interrompu en son milieu. Les deux arcs de cercle,
ou rampants du fronton, sont constitués chacun par un cordon boudiné à
volute, s'enroulant sur lui-même à son extrémité. Ils soutiennent une petite
niche recouverte d'un toit sculpté des plus élégants et encadrée de deux
motifs en forme de consoles renversées. En dessous, au centre du tympan, un
second cartouche contient la date de 1693. Nous verrons que cette porte,
assurément la plus remarquable de toutes, est aussi l'une des plus
anciennes.
Il nous faudra revenir sur nos pas pour gagner Bénaménil, car la passerelle
n'existe plus, qui enjambait la Vezouze à la hauteur de ce village, et
permettait ainsi à ses habitants de se rendre à la Bonne-Fontaine, le
pèlerinage marial le plus fréquenté de la vallée.
A l'inverse de son proche voisin Manonviller, Bénaménil est traversé par la
route nationale, sur laquelle il fut relais de diligence au XIXe siècle : il
étire sur près de deux kilomètres ses grosses maisons d'exploitation et
conserve aussi une porte monumentale, étroitement apparentée à celle que
nous venons de décrire, encore que d'une facture plus sobre et d'une
apparence moins somptueuse, un peu après l'église, vers la sortie Est du
village, au n° 107 de la grande rue.
D'emblée, nous reconnaissons, dans l'imposant chambranle à triple moulure,
le lien de parenté qui unit cette porte à celle de Manonviller. Moins
travaillé, il ne comporte toutefois que deux crossettes.
Le linteau, bordé de palmettes à chaque extrémité, est divisé en quatre
compartiments égaux. Les deux compartiments latéraux sont ornés d'oves; ceux
du centre présentent des rosaces voisines de celles du linteau de
Manonviller (quatre coeurs disposés en croix et un soleil). Deux motifs
similaires ornent le tympan, plus vaste que celui de Manonviller; ils
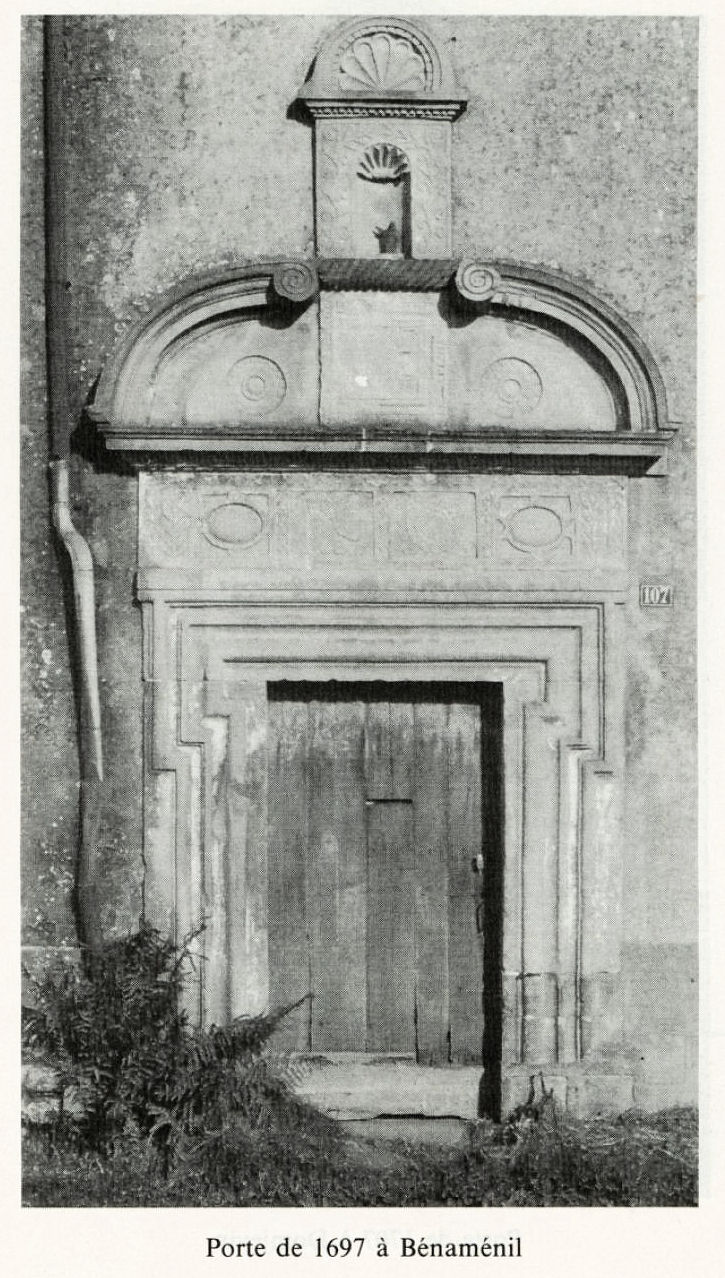
Porte de 1697 à Bénaménil encadrent
un cartouche de forme carrée portant la date de 1697. Au-dessus, la niche,
entourée de rinceaux d'un bel effet décoratif, est surmontée d'un petit
fronton curviligne à coquille. Cette porte frappe par son aspect massif et
la haute qualité de son ornementation.
Imposant, majestueux, Domjevin est installé sur le flanc de l'une des
collines qui constituent la bordure septentrionale de la vallée. Comment
résister au plaisir de suivre la petite route qui, traversant la grande
prairie de la Vezouze, conduit à ce beau village en passant par-dessus
plusieurs petits ponts dont les plus anciens auraient été construits sur
l'ordre du duc Stanislas ?
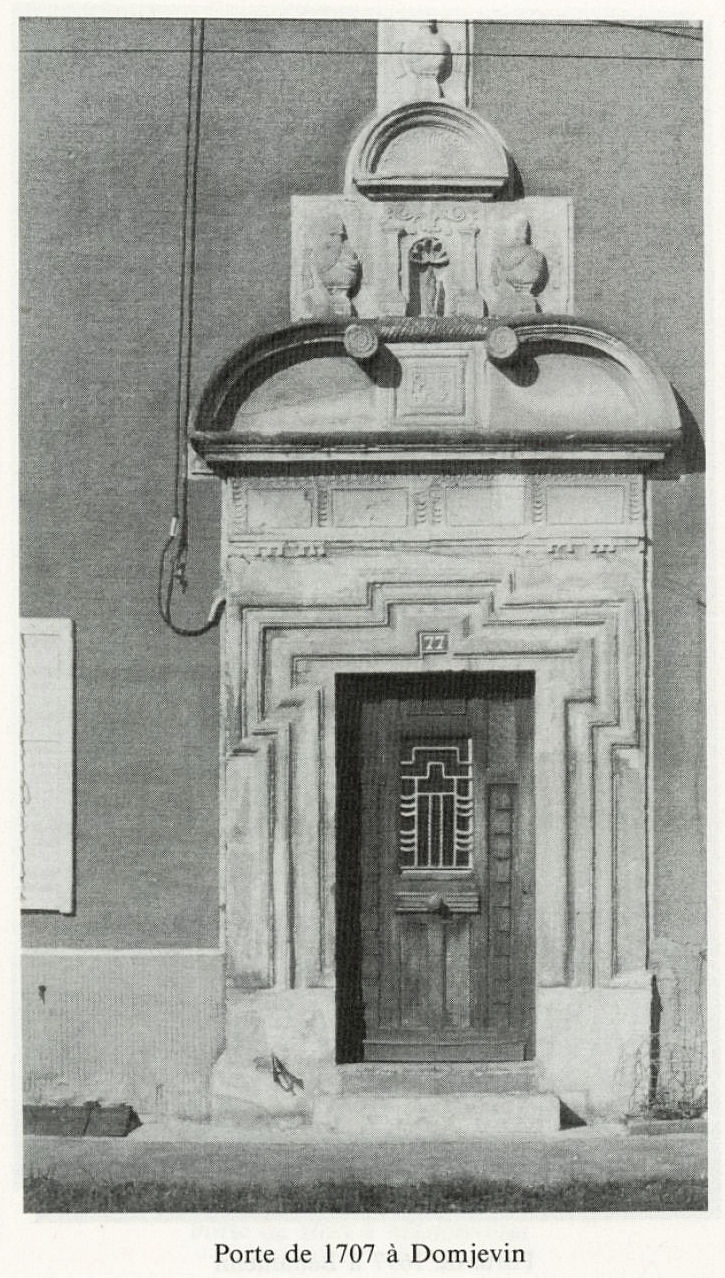
Porte de 1707 à Domjevin
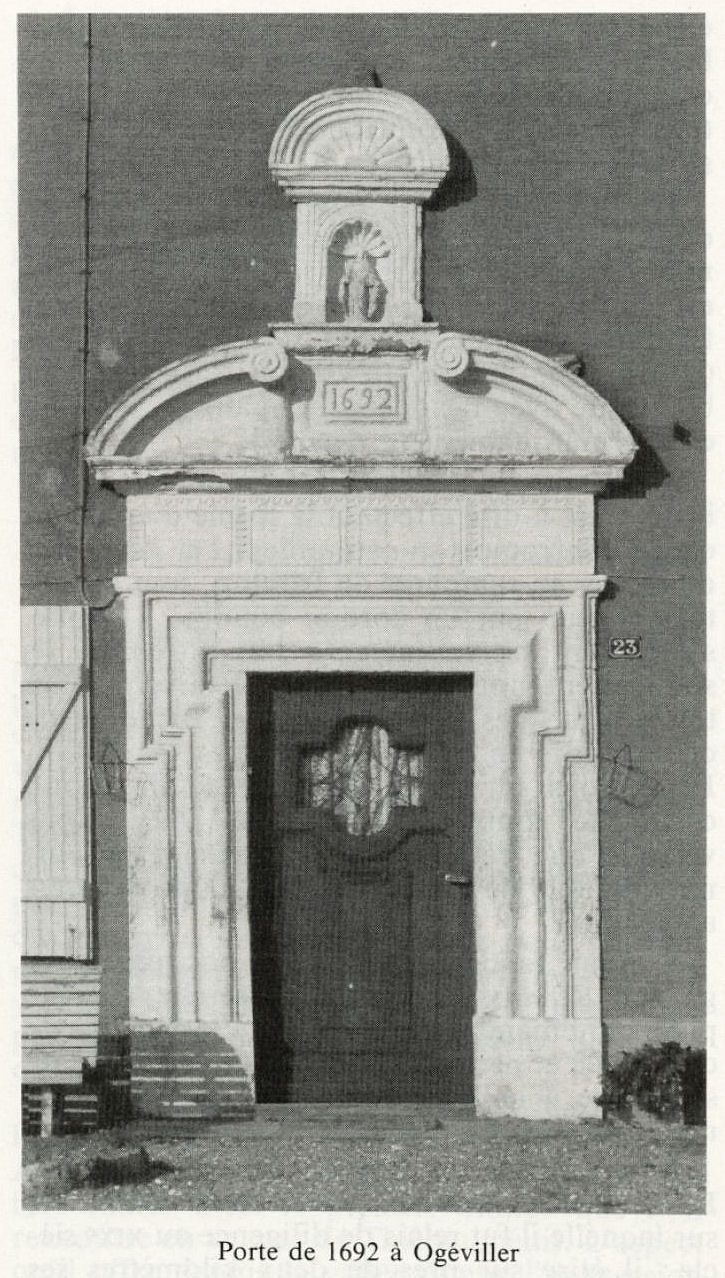
Porte de 1692 à Ogéviller Delorme
nous dit que Domjevin dépendait autrefois de deux seigneurs : le comte d'Haussonville
possédait la partie basse du village, alors que la partie haute appartenait
au duc de Lorraine. C'est dans cette partie haute que nous pouvons voir
plusieurs portes monumentales, dont l'une, située au n° 77 de la rue Haute,
à l'amorce de la petite route qui conduit à Manonviller, est tout
particulièrement intéressante.
Au-dessus du chambranle dont la triple moulure manque un peu de vigueur,
bien qu'elle soit soulignée par trois crossettes, le linteau ne comporte
aucun motif décoratif, cette fois, mais de simples motifs géométriques :
quatre rectangles bordés d'entailles en forme de croissant de lune. Tout
l'effort d'ornementation a été porté sur le fronton. Ses deux rampants en
forme de cordon boudiné à volute, entre lesquels s'insère un cartouche de
forme carrée portant la date de 1707 et les initiales des premiers
propriétaires, soutiennent une petite niche au décor véritablement
exubérant. Elle est en effet encadrée de deux petits pilastres sommés chacun
d'une croix de Lorraine. Entre les deux croix de Lorraine, juste au-dessus
de la niche, nous croyons reconnaître le motif décoratif lorrain
traditionnel : un panier d'où retombent des guirlandes de fleurs. Enfin, de
part et d'autre des pilastres, ainsi qu'au-dessus du toit de la niche, on
voit, trois fois répété et sculpté avec art, un motif décoratif dit « vase
fumant ».
L'ensemble est du plus bel effet, et lorsque, après avoir remonté la rue
Haute, on découvre le vaste panorama qu'offre la route de Manonviller
aussitôt après les dernières maisons d'habitation, on ne peut manquer d'être
frappé par l'éclat de ce beau village, l'un des phares de la vallée.
A Ogeviller, au no 23 de la rue du Château, on peut voir une dernière belle
porte à chambranle mouluré. Les simples sculptures géométriques du linteau,
en tout point semblables à celles du linteau de Domjevin, mettent en valeur
la force du chambranle à triple moulure. Un cartouche rectangulaire, placé
au centre du tympan, contient la date de 1692, et fait donc de cette porte
une contemporaine de celle de Manonviller.
Les portes à colonnes
La partie de la vallée qui s'étend en amont de Domjevin semble avoir
constitué le domaine d'élection des portes à colonnes. Moins bien représenté
que le précédent, ce second type de portes monumentales est aussi d'un
aspect plus recherché, « un peu prétentieux » a même écrit Emile Ambroise.
On peut discuter ce jugement de valeur. Quoi qu'il en soit, la réalisation
des portes à colonnes devait être passablement difficile ou onéreuse, car le
type fut définitivement abandonné peu de temps après son éclosion,
contrairement au premier qui, passé la prestigieuse période des débuts,
connut, on le verra, une dégénérescence progressive.
Bâti sur un escarpement de la rive gauche de la Vezouze, Fréménil n'est
distant de Domjevin que d'un peu plus d'un kilomètre à vol d'oiseau. Pour
s'y rendre, le mieux est encore d'emprunter le chemin qui, longeant le cours
d'eau sur sa rive gauche, conduit, à travers prés et oseraies, au pied du
promontoire où s'est établi le village.
Il suffit alors de remonter la rue qui débouche directement sur la prairie,
pour parvenir sur la place de l'église. On y voit les restes d'une porte à
colonnes datant vraisemblablement des toutes premières années du XVIIIe
siècle, et dont nous pouvons deviner, grâce à une carte postale éditée vers
1900 par la librairie Bastien de Lunéville, combien elle devait être
remarquable. C'était sans doute la plus belle du genre. Malheureusement,
cette porte a été presque entièrement détruite lors de la Première Guerre
mondiale; il n'en subsiste que la niche.
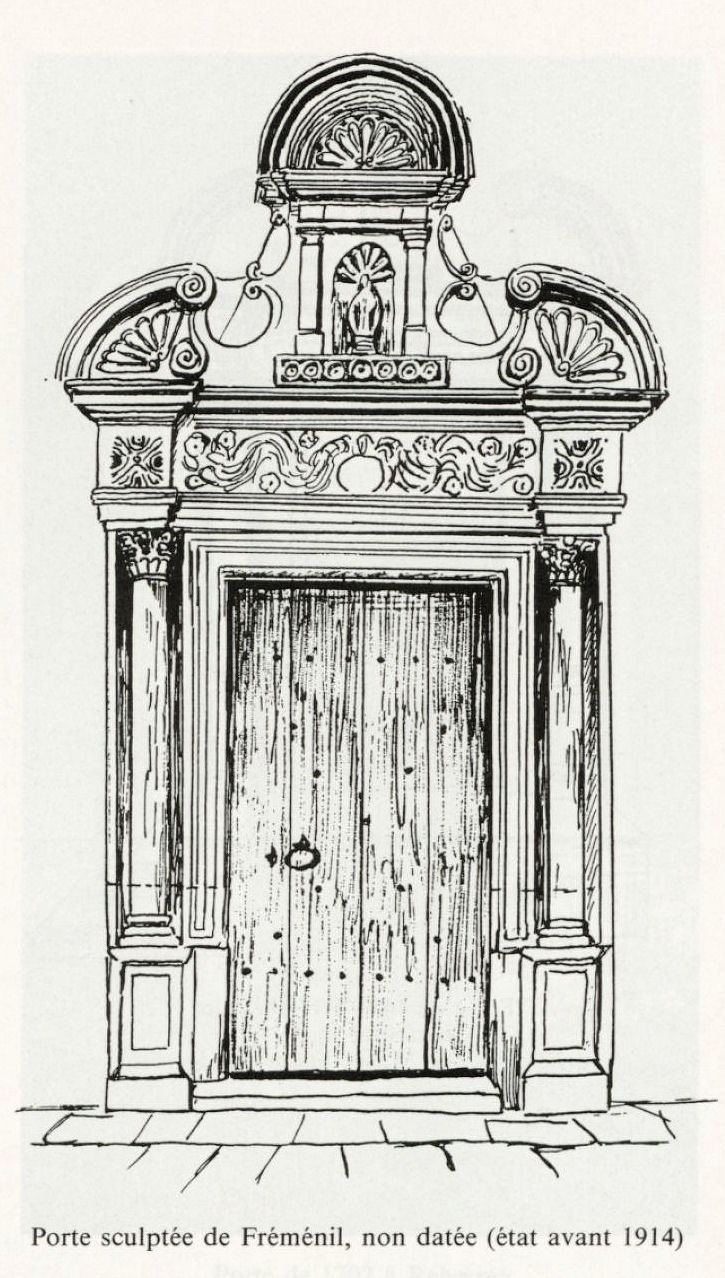
Porte sculptée de Fréménil, non datée (état avant 1914)
Par son allure générale, la porte de Fréménil
s'apparentait étroitement à celles que nous venons de décrire, à ceci près
qu'à la mouluration du chambranle avaient été préférées deux colonnes
corinthiennes soutenant le fronton par l'intermédiaire de deux ressauts de
la corniche d'entablement et du linteau. Ce dernier présentait d'élégantes
sculptures affectant l'aspect de guirlandes de fleurs, d'une inspiration
relativement moderne, car traitées de manière réaliste, à l'opposé des
décors floraux stylisés que nous avons pu observer sur certaines portes à
chambranle mouluré. A chacune des extrémités du linteau, sur les ressauts
coiffant les colonnes, on voyait en outre un motif astral.
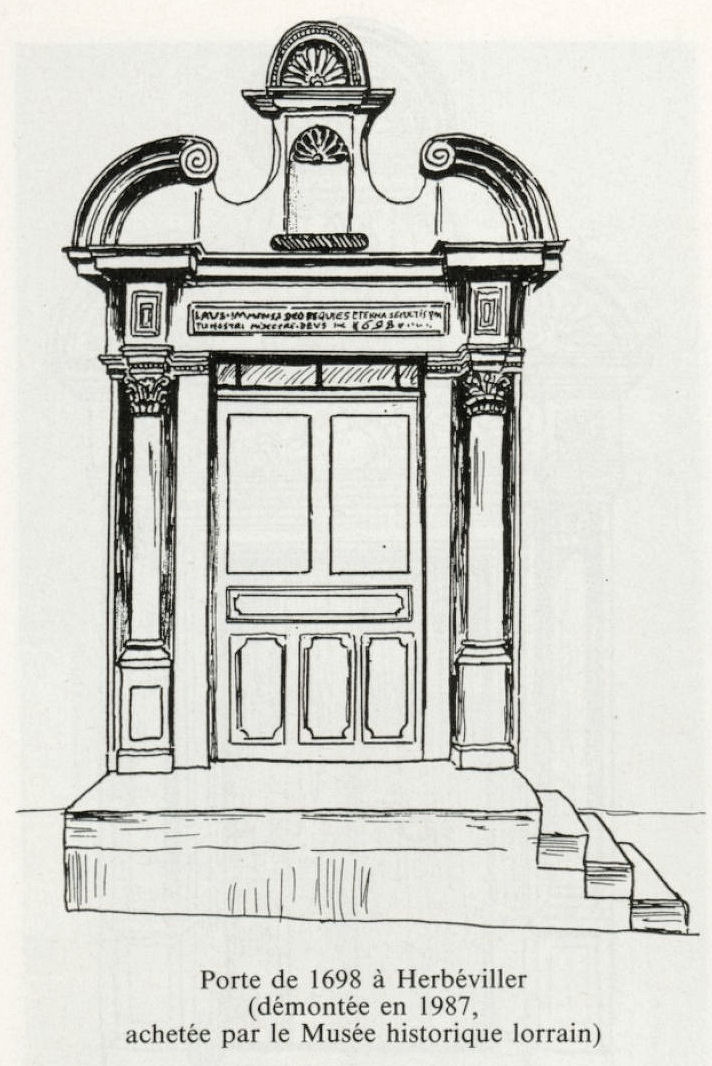
Porte de 1698 à Herbéviller
(démontée en 1987, achetée par le Musée historique lorrain)
Les rampants du fronton, plus courts que ceux des portes
à chambranle mouluré, ne soutiennent plus, mais encadrent la niche, qui, de
ce fait, occupe à elle seule la majeure partie du tympan. Insérée, comme à
Domjevin, entre deux petits pilastres, et reposant sur un soubassement
décoré de cercles accolés, elle est encadrée par deux motifs affectant
l'aspect d'une accolade à volutes. Ici encore, un petit fronton curviligne à
coquille fait office de toit. Une coquille occupait également l'espace
triangulaire délimité par chacun des rampants du fronton, espace qui était,
en outre, fermé, du côté de la niche, par un motif en forme de console
renversée.
Assurément, l'ensemble devait être très élégant, et l'on ne peut que
déplorer la disparition de cette belle porte monumentale.
En amont, à Herbéviller, on pouvait voir, naguère encore, au n° 15 de la rue
principale, non loin des ruines du château de Lannoy, une autre porte à
colonnes qui, sans avoir la beauté de celle de Fréménil, n'en était pas
moins digne du plus grand intérêt.
Le parti adopté par l'architecte était exactement le même qu'à Fréménil :
ouverture flanquée de deux colonnes corinthiennes, niche abaissée au niveau
du tympan et encadrée par les deux courts rampants du fronton. Mais
l'ornementation était ici beaucoup plus sobre. Hormis le petit fronton à
coquille qui coiffait la niche, elle ne se manifestait qu'au niveau du
linteau, de manière très originale, il est vrai. Ce dernier comportait en
effet une longue inscription incisée, disposée sur deux lignes et dont voici
le texte : LAUS IMMENSA DEO, REQUIES AETERNA SEPULTIS, PAX VIVIS, TU NOSTRI
MISERERE DEUS (Dieu soit loué infiniment, qu'aux défunts soit accordé le
repos éternel et la paix aux vivants; Seigneur Dieu ayez pitié de nous).
Comme le relevait fort justement M. l'abbé Choux, si l'on ne trouvait pas, à
la suite de ce texte, avec la date de 1698, deux paires d'initiales qui
indiquent un ménage, on penserait plutôt à la demeure d'un curé qu'à celle
d'un cultivateur!
Voici donc, là encore, une belle oeuvre de la fin du XVIIe siècle. La maison
ornée de cette porte a été incendiée en avril 1987 et la porte démontée par
son acquéreur vient d'entrer, par achat, dans les collections du Musée
lorrain où elle trouvera place dans la seconde partie du Musée des arts et
traditions populaires des Cordeliers, lorsque l'aménagement complet sera
enfin achevé.
L'ancienne église d'Herbéviller, qui avait été construite au début du XVIIIe
siècle, possédait un portail à colonnes et fronton brisé d'une inspiration
très voisine de celle de la porte que nous venons d'étudier, au point qu'on
a émis l'hypothèse qu'ils étaient tous deux l'oeuvre d'un même artiste. Ce
portail a disparu en 1914 dans les ruines de l'ancienne église.
Notons enfin la présence, non loin de l'église, au n° 2 de la rue de
Saint-Martin, d'une petite porte à chambranle mouluré, datée de 1703. Il
semble que cette porte ait été réinsérée dans une construction moderne après
que la maison dont elle faisait partie à l'origine eut été détruite,
vraisemblablement lors du premier conflit mondial. Les rampants du fronton,
abîmés, n'ont pas été repris. Cette porte est surtout intéressante par les
élégants rinceaux qui ornent son linteau.
Plus haut, Saint-Martin, Domèvre, presque entièrement détruits lors de la
Première Guerre mondiale, n'ont conservé que peu de maisons anciennes;
celles qui subsistent ne présentent aucun intérêt pour notre étude. Nous
quitterons donc la vallée de la Vezouze pour gagner Reherrey.
Ce petit village est situé dans la vallée de la Verdurette, à quelque cinq
kilomètres en amont d'Ogéviller. A cet endroit, la vallée est bien ouverte,
et offre un reposant paysage de prés et de boqueteaux, doucement animé de
molles et amples ondulations. Aussi, contrairement à ses proches voisins,
Vaxainville et Pettonville, Reherrey a-t-il pu adopter une position moins
ingrate, en s'établissant sur le versant exposé au midi.
Outre une très belle croix ancienne, on peut voir à Reherrey une porte à
colonnes, dans la façade de la maison sise au n° 17 de la Grande rue.
Rigoureusement identique, dans sa partie inférieure, à celle de Fréménil,
cette porte s'en distingue toutefois par la position et l'ornementation de
sa niche. Cette dernière, étroitement apparentée à la niche de Manonviller
(toit sculpté, ornements en forme de consoles renversées), est en effet
placée au-dessus du tympan, comme dans les portes à chambranle mouluré, bien
que la présence du fronton à courts rampants eût, ici encore, autorisé
l'adoption d'une disposition différente. Il en résulte un meilleur équilibre
dans les proportions, et, croyons-nous, plus de grâce que dans les autres
réalisations du même type.
La porte de Reherrey marque cependant un net recul par rapport aux autres
portes monumentales, et annonce déjà la décadence. C'est ainsi que,
au-dessus des colonnes au fût un peu grêle, le linteau présente, pour toute
ornementation, deux paires d'initiales et la date de 1707, sommairement
gravées.
Avec cette incursion dans la vallée de la Verdurette, s'achève la promenade
qui nous a conduits à visiter la quasi-totalité des villages du cours moyen
de la Vezouze. Sur le chemin du retour vers Lunéville, nous pourrons
cependant nous arrêter quelques instants à Marainviller. Dans le petit
groupe de maisons anciennes que la route nationale sépare du reste du
village, au n° 9 de la rue Charles Chatton, nous trouvons en effet une
dernière porte à colonnes.
Par l'agencement de son chambranle, cette porte est, à quelques détails
près, l'exacte réplique des autres réalisations du même type. Par
l'ornementation de son tympan, elle s'apparente étroitement à la porte de
Fréménil (coquil-
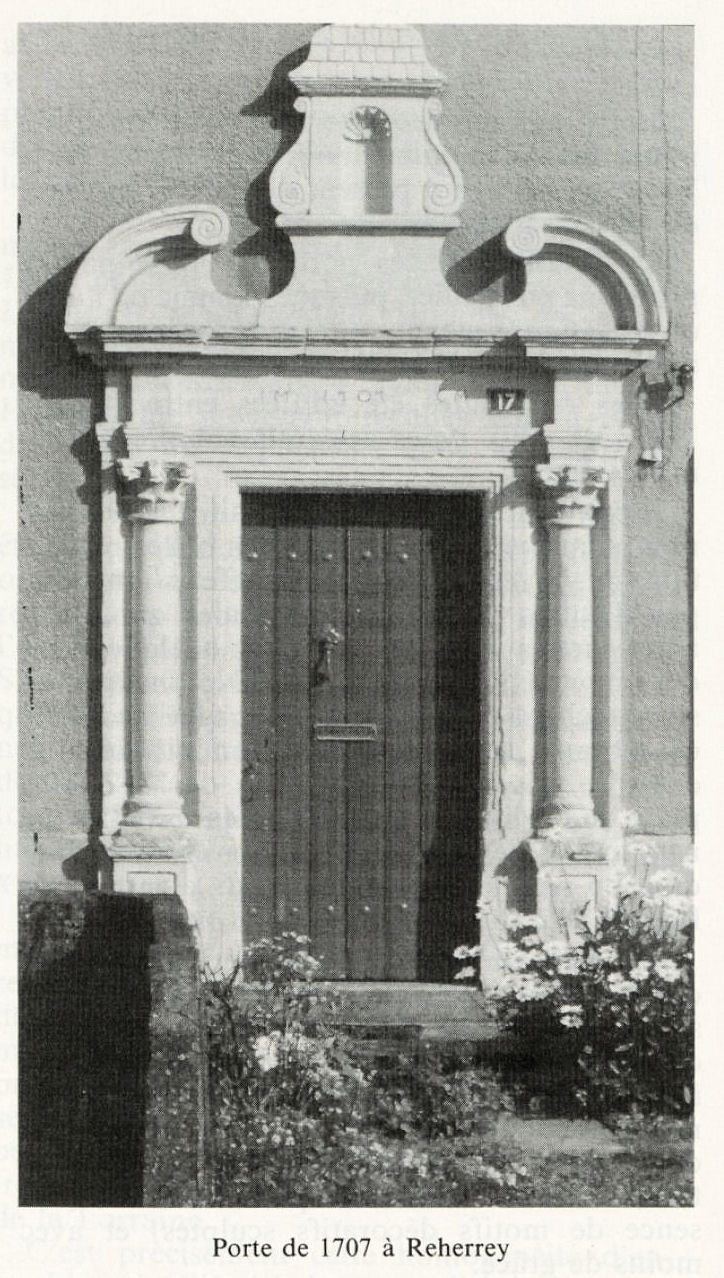
Porte de 1707 à Reherrey les
occupant l'espace délimité par les deux rampants du fronton, soubassement de
la niche décoré d'une rangée de cercles accolés). La seule particularité de
la porte de Marainviller réside dans le fait que sa niche est dépourvue de
toit. La présence d'une fenêtre, immédiatement au-dessus de l'entrée du
logis, interdisait en effet que l'on reproduisît ici ce couronnement
traditionnel.
Il convient de souligner, à propos de cette porte, la relative pauvreté de
son ornementation; le linteau, en particulier, n'offre aux regards qu'une
surface uniformément lisse. Cette circonstance, jointe à l'absence de
millésime, rend difficile la datation du monument. Néanmoins, son étroite
parenté avec la porte de Fréménil permet de faire remonter son érection aux
années 1700-1710.
Eléments d'histoire et d'architecture
Nous venons de passer en revue les différentes portes monumentales de la
vallée de la Vezouze; il s'agit à présent de faire la synthèse de nos
observations.
La datation de ces portes ne pose pas de problème particulier, puisque,
comme on l'a vu, on trouve presque toujours un millésime sculpté au niveau
du linteau ou du tympan.
Elles ont toutes été édifiées entre 1692 et 1707, les deux types
apparaissant presque simultanément.
Il convient d'insister sur le fait que nous ne nous sommes arrêté qu'aux
plus belles réalisations de l'un et l'autre type. En effet, s'il n'existe
pas d'autres portes monumentales qui soient antérieures à 1692, on en trouve
quelques-unes qui ont été édifiées après 1710. Notons qu'elles se rattachent
toutes au premier type (portes à chambranle mouluré). Nous en citerons un
exemple pris à Domjevin, daté de 1717 (105, place de l'église), et un autre
à Manonviller (au n° 11 de la rue principale), non millésimé, mais dont on
peut situer l'érection aux alentours de l'année 1720.
Ces réalisations tardives ne méritent pas plus qu'une simple mention. Ce
n'est pas qu'elles soient dépourvues d'intérêt, mais on constate chez elles
un affaiblissement des caractères qui font la beauté des portes de la
première période : réduction des dimensions et diminution de la vigueur de
la mouluration du chambranle, fronton traité de manière plus sommaire
(absence de motifs décoratifs sculptés) et avec moins de grâce.
L'exemple constitué par la porte de 1717 à Domjevin est, à cet égard, tout à
fait significatif. Suppression de la moulure intermédiaire et simplification
à l'extrême du dessin de la moulure extérieure du chambranle, absence de
volutes aux rampants du fronton, réduction à deux larges coquilles de la
décoration du tympan, font que cette porte, d'aspect pourtant encore
monumental, se situe nettement en retrait par rapport aux chefs-d'oeuvre de
la charnière XVIIe-XVIIIe siècles.
Notons, en tout cas, que l'apparition de nos premières portes monumentales,
vers 1690, coïncide très exactement avec la mort de Charles V et l'accession
de son fils Léopold à la tête de la Maison de Lorraine. Une tâche immense
attendait le nouveau souverain : la nécessaire reconstruction de nos
villages, dévastés par les guerres entreprises contre la France, pendant
une bonne partie du XVIIe siècle, par son grand-oncle, le duc Charles IV. Et
de fait, il s'y attela avec ardeur dès qu'il se trouva investi du pouvoir
ducal.
Tout au long de son règne, le duc Léopold manifesta un goût prononcé pour
les belles constructions. Aussi pourrait-on être tenté de voir, dans la mode
des portes monumentales qui a touché les villages de la Vezouze dans les
toutes dernières années du XVIIe siècle, une manifestation de la politique
d'embellissement de la Lorraine, conduite par Léopold.
Mais ce serait oublier que, de 1670 à 1697, la Lorraine, occupée par les
troupes du roi de France, fut administrée par ce dernier, et que ce n'est
qu'en 1698 que Léopold quitta Vienne, où il vivait réfugié avec sa famille,
pour rentrer en Lorraine et prendre effectivement possession de ses Etats,
conformément aux dispositions du traité de Ryswick, signé un an plus tôt.
Force est donc d'admettre, avec Emile Ambroise, que l'apparition des portes
monumentales « s'est produite spontanément, et a devancé l'ère de rénovation
et de paix qui a rendu cher aux Lorrains le règne de Léopold ».
Quels pouvaient donc bien être les premiers propriétaires de ces belles
maisons d'habitation, ornées de portes monumentales ? Ces portails d'apparat
avaient-ils été réalisés pour le compte de riches marchands, de bourgeois
fortunés ?
Nous avons déjà répondu implicitement dans notre introduction. Il ne s'agit
ici que de maisons paysannes; la présence systématique, à côté de
l'ouverture du logis, d'une vaste porte de grange, l'atteste suffisamment.
C'est donc bien, en définitive, à un rapide accroissement de la richesse de
nos campagnes dans le dernier quart du XVIIe siècle qu'il faut imputer
l'éclosion de la mode des portes monumentales.
Phénomène bien singulier, en vérité, que ce brusque passage de la misère la
plus noire à l'opulence la plus raffinée! Il semble que l'occupation
française et la véritable révolution agricole qui en résulta, avec
l'introduction de cultures et de procédés culturaux jusque-là inconnus en
Lorraine, aient joué ici un rôle déterminant.
Si nous cherchons à caractériser nos portes monumentales du point de vue
architectural, nous nous trouvons placés dans l'embarras.
Elles se rattachent incontestablement au style baroque, qui fit son
apparition en Italie à la fin du XVIe siècle et se maintint jusque vers
1730, en diffusant largement en France. En effet, le fronton brisé à
rampants terminés par une volute et soutenant ou encadrant un petit
tabernacle, dont nous avons relevé la présence de manière constante, est un
élément caractéristique du style baroque.
De même, les moulures à crossettes et les colonnes à chapiteau corinthien
sommé d'un ressaut de l'entablement, dont nous avons vu qu'elles encadraient
tour à tour l'ouverture de nos portes monumentales, se rencontrent
fréquemment dans les édifices de la période baroque. De ce point de vue, ces
portes s'inscrivent donc dans le droit fil de la mode architecturale de la
période où elles ont été édifiées.
En revanche, le détail de leur ornementation fait davantage penser au style
Renaissance. Cartouches rectangulaires, frontons curvilignes à coquille,
rinceaux et dessins géométriques sont en effet des motifs décoratifs
traditionnels de ce style d'architecture, né dans l'Italie du XVe siècle et
qui puisait son inspiration dans l'art de la Grèce et de la Rome antiques.
On peut, à juste titre, s'étonner de voir le style Renaissance faire ainsi
son apparition dans l'architecture rurale de la Lorraine des années 1700,
alors qu'il avait pénétré en France au début du XVIe siècle et y avait cédé
la place au style baroque dès le début du siècle suivant. C'est ici qu'il
faut s'interroger sur l'origine des artistes qui ont participé à l'érection
de nos belles portes monumentales.
Aucune étude systématique n'a encore été entreprise sur ce sujet. Quelques
recherches ont cependant permis de dégager un certain nombre de données qui
sont de nature à nous fournir des indications intéressantes. Les registres
paroissiaux de Herbéviller mentionnent, à la date de 1699, le baptême de
Pierre, fils de Pierre Auchard, maître-sculpteur, et, en 1700, le décès, à
l'âge de soixante ans, de Jean-Jacques Gras, suisse italien et maçon de son
état, dont on sait qu'il avait alors avec lui un neveu prénommé Jacques. A
Domjevin, on relève, à la date de 1733, le nom de Christophe Philibert,
architecte originaire d'Yverdon, en Suisse.
Ainsi donc, il est établi que, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe
siècle, il se trouvait, à Herbéviller et Domjevin, les deux villages où l'on
peut voir le plus grand nombre de portes monumentales, et qui sont situés au
centre de l'aire de diffusion de ce type de constructions, des architectes,
maçons et sculpteurs originaires de Suisse ou d'Italie du Nord. On ne
saurait affirmer que ces hommes sont précisément les auteurs de nos portes
monumentales, mais de fortes présomptions inclinent à le penser. En effet,
on ne retrouve plus leur nom dans les
actes ultérieurs; il s'agirait donc bien d'artistes venus spécialement dans
notre région pour y prendre part à la reconstruction des villages détruits,
et qui seraient ensuite retournés dans leur pays d'origine.
Plus intéressante encore, et toujours dans le même sens : l'indication
fournie à Edmond Delorme par l'abbé Hatton, ancien curé de Domjevin, selon
laquelle certaines des portes monumentales de ce village seraient dues à des
maîtres-maçons italiens ayant nom Dulci et Haléguo, qui se seraient
installés dans la région du début du XVIIIe siècle et y auraient fait
souche.
Dès lors, on peut penser que ces artistes étrangers, principalement
originaires d'Italie, ont voulu recréer dans notre région les belles
réalisations architecturales qu'ils avaient eu l'occasion d'admirer dans
leur pays d'origine. S'inspirant à la fois des constructions de l'époque (de
style baroque) et d'autres plus anciennes (constructions Renaissance), ils
ont alors donné naissance à un style d'architecture rurale tout à fait
original, que d'aucuns n'ont pas hésité à baptiser « style italo-lorrain du
XVIIIe siècle » (Delorme).
Cette attitude nous semble d'ailleurs parfaitement justifiée. Force nous
est, en effet, de reconnaître que, en dépit de la coexistence de deux types
dont nous avons parlé, les portes monumentales de la vallée de la Vezouze
présentent une remarquable homogénéité d'ensemble, et se distinguent très
nettement des belles réalisations contemporaines que l'on trouve, isolées,
en divers autres points de l'est de la Lorraine.
C'est précisément cette homogénéité d'ensemble qui, alliée à la haute
qualité de l'inspiration et au soin apporté à la réalisation, fait tout
l'attrait de nos belles portes monumentales.
Puissent-elles, dans un proche avenir, susciter un regain d'intérêt au sein
de la population locale, et bénéficier, de la part des pouvoirs publics,
d'une protection bien légitime et qui leur fait encore si cruellement
défaut !
Ouvrages et articles consultés :
Emile Ambroise, Les vieux châteaux de la Vezouze, dans Le Pays Lorrain,
1908-1909.
Jacques Choux, Portes de maisons rurales à fronton monumental dans l'est de
la Lorraine, dans Art populaire de France, Strasbourg, 1960, pp. 37-47.
Edmond Delorme, Lunéville et son arrondissement, Luné- ville, 1927, 2 vol.;
réimpress. Marseille, 1977.
Claude Gérard, L'architecture rurale française, vol. 5 (Lorraine), Paris,
1981.
|