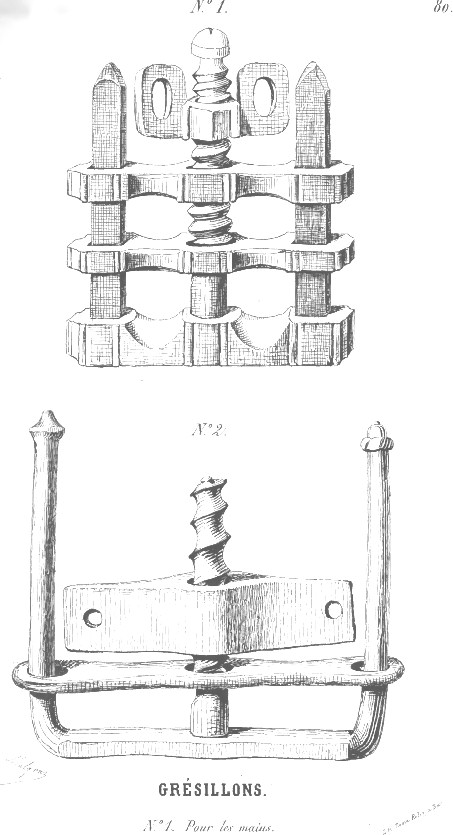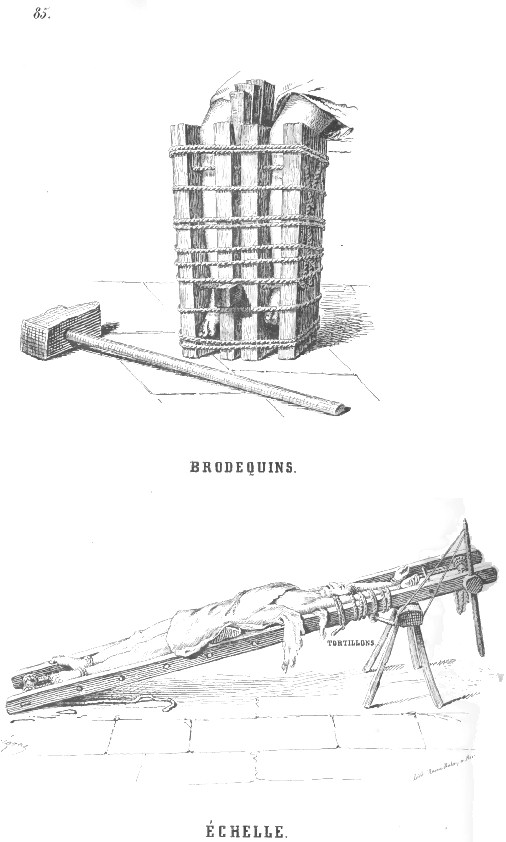BAILLI.
Ainsi que l'explique l'étymologie du mot, le bailli était l'homme à qui le prince avait baillé ses droits à garder ; c'était un autre lui-même pendant son absence ou pendant qu'il vaquait à d'autres soins. Nous disons le prince, parce que la dignité de bailli ne nous paraît pas avoir été conférée en Lorraine et dans le Barrois par d'autres que par les ducs. Les autres seigneurs, plus ou moins indépendants, relevants ou non de ces princes, ne nous paraissent avoir eu que des prévôts.
En effet, le bailli était le gouverneur général d'une province, et à l'exception de ces grands souverains, aucun autre en Lorraine n'eut un domaine d'une importance aussi grande, à l'exception cependant du comte de Vaudémont, et encore en sa qualité de prince du sang ducal.
Choisi dans les familles les plus titrées et parmi les militaires les plus anciens et les plus élevés en grade, le bailli avait moins pour mission de rendre la justice que de la surveiller et de la diriger. La force publique de la province était à ses ordres, il ne se faisait pas un mouvement de troupes qu'il n'y participât. Les prévôts étaient sous sa surveillance. Dans la ville où il demeurait, comme dans celles de son ressort où il entrait, les clés des portes de la cité lui étaient remises, et personne autre que lui, en sa présence, ne pouvait, sans sa permission, commander aux bourgeois, dès que ceux-ci, sortis de leurs maisons à son appel, avaient l'arquebuse sur le col et la mèche emprinse. Il était à la fois le général et l'intendant de sa circonscription ; on l'appelait monseigneur, le duc seul y était au-dessus de lui.
Ses fonctions judiciaires n'avaient pas partout les mêmes attributions. En matière criminelle, à l'exception des personnes nobles, il était sans autorité dans la Lorraine, où les prévôts et les communautés jugeaient en dernier ressort. Dans le Barrois, il connaissait au contraire en cette matière des sentences des prévôts, comme nous l'établirons plus tard.
Mais dans l'un et l'autre duché il avait, en matière civile, une même mission judiciaire, celle de présider les Assises, tribunal composé des gentilshommes de l'ancienne chevalerie, qui l'avaient maintenu à l'instar de l'ancien mallum des hommes francs ou de celui des sagibarons, et qu'ils défendirent toujours comme un de leurs plus précieux privilèges. Ces gentilshommes étaient ceux dont le nom, les titres et l'origine étaient réputés se perdre dans la nuit des temps, ce qui les distinguait des nobles plus modernes et encore bien mieux des anoblis, ces deux classes étant par eux placées à part et fort au-dessous de la leur. Bien entendu que plus tard, et peut-cire déjà au temps dont nous parlons, les droits à se dire de l'ancienne chevalerie étaient usurpés par beaucoup ; mais quels que fussent les titres des hommes, l'institution se maintenait florissante.
A des époques à peu près périodiques, tous les mois ou toutes les six semaines en Lorraine, tous les trois mois à Saint-Mihiel pour le Barrois, les assises avaient lieu. Les sentences des prévôts et autres juges de la province, dont les parties avaient interjeté appel, leur étaient soumises ; ils les jugeaient en dernier ressort, après avoir entendu les officiers qui les avaient rendues, lesquels étaient tenus de se présenter pour soutenir le bien fondé de leurs décisions. Mais cette juridiction toute civile n'étant point du ressort de notre sujet, nous devons éviter d'entrer dans les détails qui la concernent. Disons seulement que le bailli n'y jugeait pas et qu'il se retirait pendant le délibéré ; sa mission était de diriger les débats et de faire respecter les ordonnances du prince.
Comme on le voit, le bailli, à cette époque, n'était pas ce qu'on l'a fait depuis. C'était le gouverneur général de la province, et non ce magistrat de village, travesti en bouffon sur le théâtre.
Dans l'origine, les Trois-Évêchés n'avaient pas de baillis, ces fonctions étaient dévolues à des Comtes, qui étaient également les seigneurs les plus puissants du pays. Chargés de l'administration temporelle, ayant en main la justice et la force publique, ils avaient beaucoup plus de facilité d'en abuser contre les évêques, rarement guerriers, que les baillis ne pouvaient le faire contre les ducs, toujours militaires. Aussi ces gouverneurs furent-ils moins les subordonnés de leurs maîtres que leurs rivaux, ce qui fit que les évêques s'attachèrent à les faire disparaître pour les remplacer par des officiers moins puissants et plus dévoués. En même temps, ils confièrent l'administration de la justice séculière à des baillis dont ils adoptèrent l'institution à ce point de vue.
PRÉVÔT.
Le prévôt, qui était au bailli ce qu'un capitaine est à son général, avait à la fois dans son ressort les fonctions de juge, de commandant militaire et de receveur des deniers du prince ou du seigneur. On dit qu'il fut créé dans le but de garantir le peuple de l'oppression des grands, mais on ne dit pas en quoi cette institution pouvait être une barrière à leurs vexations, d'autant mieux que, privé du droit de juridiction sur eux, il était souvent pris dans leur classe privilégiée. Cette assertion ne peut s'expliquer que vis-à-vis des grands, étrangers au pays des opprimés ; on conçoit qu'alors, à la moindre alerte d'un voisin tracassier, l'impulsion donnée par le prévôt à la force publique de la localité procurait à celle-ci tout l'avantage qui peut résulter d'une direction expérimentée.
La nomination à l'emploi de prévôt avait lieu directement par le prince ou le seigneur, qui y plaçait d'ordinaire les officiers de son armée dont le grade correspondait à celui de nos lieutenants-colonels; il trouvait là tout naturellement un moyen de leur donner une récompense proportionnée à leurs services. Nulle part, pour cette époque, on ne voit qu'en Lorraine ces places aient été vénales comme en France et accordées à celui qui offrait le plus de rentes en retour des deniers qu'il espérait enlever aux justiciables. Cet usage n'eut lieu que plus tard, ainsi que nous le dirons. Ils ne recevaient pas même alors de brevet écrit de leur nomination, la possession faisait leur titre ; le prévôt qui commandait au siège de la prévôté était censé en avoir reçu la mission officielle de la bouche de son maître : c'est du moins ce que l'on trouve attesté par Nicquelot de Nidange, prévôt de Sancy en 1420.
Dans les communes affranchies, gratifiées du droit de justice sur les habitants, le rôle du prévôt était réduit à la recette des deniers et au commandement militaire, qui le plus souvent néanmoins entraînait le droit d'exécution ; c'est-à-dire que dès que la justice avait prononcé contre un accusé une peine corporelle, c'était au prévôt, représentant le souverain, à poursuivre et à surveiller l'exécution de la sentence (2)
Mais il n'en était pas partout de même ; à Toul et à Metz, nous verrons les magistrats municipaux investis de ces droits.
Dans les autres communes, notamment celles régies par la loi du duc, le prévôt était tout. Il jugeait au civil et au criminel, et connaissait même en appel des sentences des maires et échevins dans les petites matières de police départies à ces magistrats. Comme chef de police, il faisait des règlements ; comme juge, il fixait le taux de la contravention, et comme capitaine, il poursuivait jusqu'à exécution le paiement qu'il avait commandé. Au criminel, il arrêtait le prévenu, instruisait son procès, le jugeait, le condamnait et lui faisait subir sa peine, sans autre contrôle que celui de sa conscience. Ce redoutable cumul de fonctions explique suffisamment combien les chartes qui accordaient aux habitants le privilège d'être jugés par leurs pairs devaient paraître dignes d'envie. La noblesse faisait en cela cause à part de la roture, le prévôt n'avait au criminel aucune juridiction sur elle, mais bien le bailli.
MAIRIES ET COMMUNAUTÉS.
Pour appliquer le principe du jugement par les pairs des accusés au détriment de la justice du prince, la loi de Beaumont avait créé une mairie composée d'un maire et de jurés à élire par les habitants, et décidé que ce qu'ils jugeraient serait stable. Cette énonciation, fort incomplète dans ses termes, notamment en ce qui concerne les matières criminelles, fut sans doute interprétée largement dans le sens le plus favorable, car les chartes qui suivirent, adoptant les mêmes usages, donnèrent à leur rédaction une extension qui ne laisse plus aucun doute.
Celle de Commercy, qui peut servir d'exemple, porte :
« Ly maire et ly échevins tanront la justice de tous plais et de toutes querelles qui seront entre leurs bourgeois et leurs menans, et devront jugier de tout ce qui en droit sera mis sur eulx celont les anciennes coustumes et celont les anciens huissaiges dou chastel et de la ville de Comarcy. »
« Item, de tous cas dont nous vourons suere et demandeir à nos bourgeois, ly mares et ly escheuins en » auront la court et la cognissance et en jugeront ly escheuins dou lieu, sauf ceu se cestoit pour cas de crime nous scriens saisi dou corps dou malfaiteur tant que a ceux qu'il fust delivreis ou encombreis par le jugement des eschevins (3). »
Voilà bien la justice criminelle conférée à la mairie sous la seule réserve de l'exécution au seigneur, qui confiait ce soin à son prévôt.
Les mairies n'étaient pas partout organisées de même. Dans le plus grand nombre, le maire avait avec lui des échevins, dans d'autres c'étaient des jurés, comme à Beaumont, à Pont-à-Mousson, le Val-de-Lièvre, SainteCroix, Sainte-Marie. Leur nombre variait presque arbitrairement ; dans l'ofiice de Saint-Nabor, ils étaient vingt-quatre ; mais en général, dans les petits villages, ils se réduisaient à deux. Dans les villes importantes, telles que Metz, Nancy, Verdun, le maire prenait le titre de maître-échevin. A Raon, à Toul et dans d'autres cités, il y avait à la fois un maire et un maitre-échevin.
Ces mairies avaient différentes manières de procéder, en ce qui concerne la justice criminelle.
Dans quelques localités, le maire jugeait tout seul, comme à Thiaucourt, à Ochey, à Loupy, etc. A Maidières, près Pont-à-Mousson, le maire, dit maire de la centaine, jugeait seul les habitants de son village, ainsi que ceux de Montauville, Morey, le Han et les bans de Saint-Pierre et Saint-Remi. (4)
Dans d'autres, on adjoignait à la mairie tout entière, c'est-à-dire composée du maire et de ses échevins ou ses jurés, un certain nombre de bourgeois. A Beaumont et à Pont-à-Mousson, ils étaient quarante; à Toul, dix, appelés les dix justiciers.
Lorsque la justice appartenait à la fois à plusieurs seigneurs, leurs mairies respectives, quelquefois seulement leurs maires, se réunissaient pour ne former qu'un tribunal. A Essey-les-Nancy, c'étaient les deux maires et les deux échevins des deux seigneurs (5). A Fénétrange, où il y avait quatre seigneurs, il y avait même réunion, et, de même qu'à Essey, la décision appartenait aux échevins, les maires ayant dirigé les poursuites et conservant le caractère d'officiers du ministère public ou déjuges d'instruction (6).
Au Val-de-Lièvre, à Sainte-Croix et Sainte-Marie-aux-Mines, appartenants tous trois au même seigneur pour moitié avec le duc, il y avait deux maires pour les trois et neuf jurés, dont cinq pour le duc et quatre pour le seigneur. Pour composer le tribunal criminel des trois villes, on prenait deux jurés dans chacune; ces six élus délibéraient sous la présidence du maire du seigneur, tandis que le maire du duc remplissait les fonctions de ministère public.
A Broussey-en-Blois, où le roi de France et le comte de Ligny avaient un sixième indivis avec le seigneur local, qui avait (7) les cinq autres sixièmes, un seul maire jugeait pour les deux; de même à Prény (8).
La participation de tous les membres de la communauté était moins ordinaire, mais elle existait, principalement dans les Vosges. A Valfroicourt, les habitants, joints à ceux de Bainville et de Raucourt, composant un même ressort, se réunissaient, à la convocation du prévôt, sur la place publique de Valfroicourt, devant le carcan. Après que le prévôt, qui avait procédé à la capture et à l'information, leur avait donné connaissance des faits qu'il avait recueillis et que l'accusé s'était plus ou moins justifié, l'échevin de la mairie de Valfroicourt recueillait les voix des assistants. Si l'opinion émise par la majorité lui semblait peu convenable, s'il avait des doutes sur le résultat des voix, ou enfin par tout autre motif abandonné à sa discrétion, il pouvait recommencer jusqu'à trois fois de consulter les votants, après quoi il faisait connaître la décision conforme au voeu du plus grand nombre. (9)
A Saint-Dié, à Monthureux-sur-Saône, on procédait de même (10).
Ce qu'il y a de singulier dans cette institution, c'est que malgré l'importance que chacun devait y attacher, il y avait encore des récalcitrants ou des indifférents, car il existait contre les défaillants une peine de 7 fr. 1/2, somme alors considérable.
A Insming, jadis Amange, la justice ordinaire se composait de dix-sept personnes, pour le ressort de la prévôté, savoir : quatre de la justice du duc à Insming, deux du
château de Bitche, trois de la justice de Brombach, trois de celle de Saint-Denys, à cause du prieuré de Dôle, trois de la justice du prieuré d'Insming, enfin le mayeur d'Oligny et celui de Griningen, dit le Schier-Mayer. Ce tribunal, qui était une vraie cour, avait le nom de Mère-Cour ; il jugeait non-seulement au criminel, mais aussi au civil; outre sa juridiction ordinaire, il avait l'appel des justices inférieures et le dernier ressort es cinq cas. Il fallait unanimité pour la sentence ; quand il y avait désaccord, le Schier-Mayer, qui avait la présidence, et le maire deSaint-Denys appelaient les/^e^/fter^ouportériens, c'est-à-dire tous ceux qui possédaient héritages dans le ressort et qui étaient environ trois cents. Après l'appel fait des convoqués et la condamnation à l'amende contre les absents, il était déclaré tout haut que ceux qui, à raison de leur parenté ou de leur amitié, ne se sentaient pas totalement impartiaux, eussent à se retirer. L'affaire était ensuite exposée aux Heyhert, qui pouvaient demander combien l'accusé avait eu de voix pour ou contre lui de la part des juges de la Mère-Cour. Deux sergents, ayant chacun une taille en bois, circulaient ensuite dans l'assemblée pour recueillir les voix et les marquer; le résultat dictait la sentence, qui, en matière civile, coûtait quatre pots de vin et quatre gros pains. Mais si, sur l'appel au buffet du prince, pour vices de forme, elle était cassée, les juges encouraient une amende de chacun un pot de vin, qui appartenait à l'appelant.
MINISTERE PUBLIC.
Les baillis, prévôts et maires étaient les seuls fonctionnaires administrant la justice, sans qu'aucun d'eux fîit chargé de poursuivre directement la répression des faits punissables. L'action publique en matière criminelle, qui aujourd'hui nous paraît, si utilement pour la société, remise aux mains d'un officier spécial, n'était pas alors considérée au même point de vue. Élevés dans d'autres principes, nous comprendrions difficilement qu'il nous fallût demander directement la punition des coupables.
Telles étaient cependant, sinon la vertu et l'austérité de nos aïeux, du moins leurs habitudes, que rarement un crime restait sans accusateur. Et il ne s'agissait pas de lancer une dénonciation dont les conséquences pour son auteur entraînaient seulement la haine et l'inimitié de l'accusé, celles de sa famille et de ses amis, mais le citoyen généreux qui s'immolait ainsi au repos de la société exposait encore sa vie et sa fortune dans cette démarche le plus souvent désintéressée. Comment, quand et pourquoi cet usage a-t-il pris un terme? C'est sur quoi personne ne peut donner de détails authentiques. Faut-il en accuser la corruption des moeurs ou une simple indifférence ? L'une et l'autre n'y ont sans doute eu que trop de part.
Les baillis et les prévôts, militaires avant tout, étaient peu versés dans la marche des affaires, et lorsqu'il s'agissait de discuter les intérêts civils du prince, ils risquaient de les compromettre vis-à-vis d'adversaires praticiens mieux versés dans la chicane. Vers le XIVe siècle, un homme de loi fut dans ce cas chargé de donner son avis et de plaider au besoin. Au lieu de le payer par chaque affaire, on prit l'habitude de lui donner un traitement annuel, et il devint en titre l'avocat ou le procureur de monseigneur. C'est ainsi qu'en 1521, Jean Lafauche est qualifié procureur de M. le comte de Bar, et en 1360, Nicolas Dandelon ; tous deux étaient avocats du siège et continuaient à exercer en même temps leur profession pour le public. Cette clientèle princière leur donnant souvent pour mission de réclamer le paiement des redevances ou des subventions, ils prirent l'habitude de conclure à l'audience, et comme le paiement des amendes entrait pour beaucoup dans ces affaires, on s'habitua de part et d'autre à trouver en eux des accusateurs publics. De la pratique on passa bientôt à la théorie, des fonctions au titre, et l'avocat des intérêts généraux du duc devint le procureur général du duché.
L'époque précise de cette métamorphose n'est pas connue ; ce fut peut-être une imitation de la France, qui, au surplus, n'en fut pas dotée beaucoup plus tôt, et même nous rencontrons cette dignité en Lorraine bien avant 14-93, époque où M. F. Hélie trouve pour la première fois en France la mention officielle d'un procureur général du parlement. Selon Rogéville, qui n'indique pas sa source, le premier procureur du duc remonterait à 1449, et le premier procureur général de ceux dont il donne la liste daterait de 1473. Dans le Barrois, on se serait trouvé plus avancé ; indépendamment des deux procureurs de M. le comte, qui précèdent, on trouve qualifiés procureurs généraux du duché, J. Millet, en 1392; Gillet d'Andernay, en 1420, etc. Ce dernier est même plus tard qualifié procureur de monseigneur, ce qui porterait à penser que Lafauche et Dandelon, qui n'avaient que la même qualification, pouvaient déjà bien avoir des fonctions plus étendues que celles de soutenir les intérêts privés de leur maître.
Les chartes d'affranchissement du commencement du XIVe siècle sont à peu près muettes sur l'existence d'un officier du ministère public. Celle de Commercy démontre qu'alors il n'y en avait pas :
« Sy en cas de crime, ly fait estoit sy notoire et sy manifest que renomée en fust quomune et que plusieurs persones dignes de foi le tesmoignassent, meymes quant partie ne se tireroit avant ou 9 cils qui partie vouroit faire ou deueroit, ne lasseroit entrepanre, par aucune non puissance, nous ou notre lieustenant deuerons enquérir de notre office dou fait deligemment (11). » Ainsi, à défaut d'accusateur qui se dévoue, le seigneur se réserve, par lui ou son lieutenant, de poursuivre d'office. Si ce lieutenant eût été un magistrat permanent, il eût déjà été qualifié d'un autre titre, mais c'était le capitaine ou gouverneur de la seigneurie, plus administrateur civil et militaire qu'officier judiciaire, comme le prouve la suite du texte, où il est dit qu'il aura seul, après le seigneur, le droit de permettre le port-d'armes (12) et celui de statuer sur l'appel de défaut de droit ou de mauvais jugement (13)
fonctions évidemment incompatibles avec celles du ministère public. Au surplus, la poursuite d'office admise par cette charte démontre déjà la tendance à ne plus compter sur le zèle du public pour les accusations directes.
Les attributions du procureur général de Lorraine furent réglées aux états de 1532. Quoique cette époque anticipe sur celle où nous nous trouvons, nous pouvons les indiquer ici comme n'étant que la continuation de ce qui s'était fait auparavant. Indépendamment des soins particuliers à donner en toutes occasions aux affaires intéressant le domaine du duc, il devait, par lui ou un sien commis, exercer les fonctions de procureur fiscal aux journées du change, c'est-à-dire au tribunal des échevins de Nancy. Son devoir était aussi d'assister aux interrogatoires des prévenus, inventorier leurs biens et donner des conclusions dans toutes les phases de leurs procès. Les causes des mineurs lui étaient confiées, et il avait sur tous les grands chemins de la province une surveillance spéciale, non-seulement pour leur police, mais encore pour leur établissement et leur entretien.
Le procureur général de la ville de Toul était en droit de haranguer, au nom de la ville, les têtes couronnées qui passaient dans ses murs.
GREFFIERS ET SERGENTS.
Jusqu'au XIVe siècle, les fonctions de greffier étaient inconnues. Il n'en était pas besoin, tout se passant oralement, depuis l'exposé du fait jusqu'à la sentence ; l'appel n'étant pas admis, on n'avait aucun besoin de tenir note de ce qui avait été fait. Quant au souvenir d'une condamnation qui pouvait entacher un homme ou sa famille, il devait mourir avec la génération, l'importance d'un criminel étant estimée valoir peu.
Les sergents ou doyens étaient en exercice ; en effet, il fallait bien quelqu'un pour appeler les justiciables, pour les contraindre, pour assister le juge et faire respecter la justice.
PROCEDURE.
Quoiqu'il soit très difficile de préciser toutes les manières de procéder d'alors, toujours forcément soumises aux caprices personnels des magistrats ou aux usages de la localité, on peut avancer, sans trop se tromper, que la forme était partout à peu près la même. Cette justice, qui se rendait par un homme seul, bailli ou prévôt, à la fois juge d'instruction et juge du fond, se passait aisément de toute forme protectrice et d'écritures préparatoires.
Devant apprécier seul en dernier ressort la conduite des accusés, sa conviction se formait à mesure qu'il avançait, et il regardait comme superflu d'analyser des faits que personne n'était appelé à peser après lui. Empoigner un homme poursuivi par la clameur publique, l'interroger brusquement, le condamner lestement pour le crime reproché ou ceux qu'il était capable de commettre, et le faire pendre, tout cela était l'affaire de peu d'instants et constituait ce mode expéditif qui prit plus tard le nom de justice prévôtale.
Devant les communautés assemblées, il ne fallait guère plus de préambules. Le prévôt ou le maire qui poursuivait la répression rendait verbalement compte du cas ; tant pis si sa parole avait de l'influence sur son auditoire, l'accusé en subissait la conséquence irréparable, n'ayant de salut que dans la justification qu'il faisait valoir lui-même ou que l'opinion publique imposait, s'il était de la localité.
Nous ne saurons jamais quels sentiments animaient les hommes de ce temps dans l'accomplissement de leurs fonctions judiciaires.
Avaient-ils l'esprit de clémence et de camaraderie, ou cette inflexible sévérité qui ne voit avant tout que le salut public et se croit coupable quand elle pardonne? C'est une leçon qui malheureusement nous manque, ce dont il faut d'autant plus s'affliger que, revenus par le jury à des institutions analogues, nous aurions besoin d'éviter les fautes qui, du temps de nos ancêtres, en ont amené l'abandon.
Contre cette procédure presque violente, l'accusé avait une ressource de même nature, le combat judiciaire, dont l'étrangeté s'explique par la nécessité. Qu'un misérable, sans patrie, sans asile, vivant dans la débauche et la rapine, restât écrasé sous les coups d'une justice arbitraire et dédaigneuse, il pouvait se faire que personne ne fût tenté d'en murmurer; l'accusé lui-même, se trouvant sans excuse, n'avait qu'à courber la tête sous le poids d'une condamnation méritée. Mais un homme loyal et brave, d'un caractère généreux, jeté par l'envie et la délation en pareille situation, qu'avait-il à opposer à un prévôt despote, trop souvent stupide et entêté comme un soldat ignorant? Que dire à des jurés sans expérience, assourdis par la calomnie, aveuglés peut-être par la haine, libres de frapper de mort sans rémission, sans appel en ce monde? Il fallait un frein puissant, capable d'imposer au juge prévaricateur ou aux bourgeois parjures; ce frein, c'était le combat, la vie contre la mort, l'honneur contre la honte ; et l'épée meurtrière dans la main de l'homme indigné était redoutable au lâche que n'animait ni le sentiment du devoir, ni la conscience de l'équité, réduit à soutenir publiquement son parjure secret contre la volonté d'une Providence clairvoyante et vengeresse.
Il est vrai qu'à côté de cette grande ressource, se montrait menaçante l'intimidation du gladiateur, plus brutale encore que la passion. Où trouver des accusateurs, des juges et des témoins toujours prêts à descendre dans l'arène pour échanger leur vie contre un principe plus ou moins salutaire à la société, d'une utilité contestée pour la justice?
Quel danger pour eux de lutter avec loyauté contre ces sacripants vomis par les guerres, couverts de crimes, habiles en trahisons, fortifiés contre le danger de la mort par l'habitude du massacre et l'effusion du sang ! Il fallait entre ces deux écueils un port moins dangereux à l'innocence et à la faiblesse. Pour avoir une justice impartiale et sans dédain, il fallait un juge indépendant, qui ne reconnut d'autre maître qu'une conscience éclairée, qui fût fort devant les hommes et devant Dieu. Sans doute que le prince le comprit et l'exécuta, puisque les moeurs affranchirent le prévôt, son représentant, de cette monstrueuse sujétion, puis bientôt les témoins et encore l'accusateur ; perfectionnements qui annoncent que la vertu plus que la force y remédia par une sérieuse intervention.
Mais en attendant ces progrès de l'instruction et du temps, l'histoire n'oublie pas sa tâche de rappeler des usages qui tinrent une grande place dans les établissements judiciaires de l'époque que nous décrivons.
Déjà fort en vogue au moment de l'affranchissement des communes, le combat judiciaire, qui était lui-même un mode de secouer le joug de l'oppression, reprit un grand essor et fut consacré par les chartes après l'avoir été par la loi de Beaumont.
« Nous établissons, » dit la charte de Commercy, et d'autres après elle,
« que de tous cas qui touchent loueur dou corps qui ne touche la foi et la créance, on se puisse défendre par bataille. » Et il ne s'agissait pas de duels cachés où il suffisait d'une égratignure pour que les parties se crussent autorisées à dire qu'elles avaient satisfait à l'honneur ou aux exigences de l'opinion, mais d'un grand et terrible combat, poussé à outrance, couronné par la mort ou la défaite de l'un des combattants. Le peuple le voulait, la justice y consentait, le prince y présidait. En Lorraine, où le courage militaire est inné, le combat judiciaire avait une si grande importance, même à son origine, que les ducs s'étaient réservé, à l'exclusion de leurs seigneurs fieffés, le droit de régler tous ceux qui auraient lieu entre gentilshommes dans le pays entre la Meuse et le Rhin. Le comte de Bar, animé de cette prétention souveraine, s'y était réservé de présider les combats entre ses vassaux. Le comte de Vaudémont et l'évêque de Verdun étaient convenus, en cas de difficultés, de s'en rapporter au comte de Luxembourg. Tant d'importance accordée à cette épreuve ne pouvait qu'ajouter à celle qu'y attachaient les populations.
Dans l'origine, toute imputation grave donnait lieu au combat ; mais, dès le commencement du XIVe siècle, pour qu'il échût gage de bataille, il fallait que l'accusation portât sur un crime, excepté toutefois celui de vol, que l'évidence du crime fût manifeste, qu'il y eût des indices suffisants contre l'inculpé, qu'on n'eût pas d'autre preuve et que le châtiment de la loi fût la mort.
L'accusation devait être précisée, avec indication, autant que possible, des jour, lieu et heure de la perpétration du crime ; elle ne pouvait être faite en termes vagues et généraux ; c'est alors qu'il n'était pas permis de dire : Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Elle avait lieu à l'audience devant le juge ; il fallait, pour être écouté, que l'accusateur mît toute colère de côté, qu'il fût grave et s'expliquât sans injures. Après avoir formulé sa plainte, il jetait son gage, qui était son gant ou son chapeau, en faisant des réserves pour ses champions, aidants, etc.
Si l'accusé avouait le fait, la justice n'avait qu'à prononcer de suite et l'affaire était terminée. S'il déniait, il demandait à son tour acte de la provocation, en concluant contre son accusateur aux mêmes peines que celui-ci avait réclamées contre lui ; puis il ramassait le gage, en faisant des réserves semblables à celles émises par l'accusateur.
Le juge prenait alors le gage, ordonnait la mise en arrestation des parties, qui n'avaient leur liberté provisoire qu'en donnant caution suffisante, soit en argent, soit par des amis qui répondaient d'eux personnellement. Dans le cas où il était décidé qu'il échéait gage de bataille, le jour et le lieu du combat étaient fixés par le prince, qui nommait un représentant pour y présider; si c'était entre roturiers, c'était le seigneur qui y pourvoyait.
Le lieu du combat, dit champ clos, était un espace de six vingt pas, c'est-à-dire de quarante pas de largeur sur quatre-vingts de longueur, enfermé par des poteaux et landres. A droite du chef du camp était placé le pavillon de l'accusateur; à gauche, celui de l'accusé. Tous deux, dès la sortie de leur maison, se préparaient à l'acte solennel qui allait se passer ; ils tenaient en main un crucifix ou l'image du saint dans lequel ils avaient le plus de confiance.
Leur arrivée était annoncée par un cri du héraut ; ils entraient armés de pied en cap, visière baissée et en faisant le signe de la croix. L'heure était ordinairement fixée par le juge du camp, avant midi pour l'appelant, avant trois heures pour l'appelé. Après la réitération des protestations, les combattants remettaient au juge un écrit contenant leurs griefs respectifs, puis successivement et à l'appel du héraut, ils se présentaient devant lui en présence d'un prêtre, ceux-ci montés sur une estrade, ayant devant eux l'image du Christ. Là, séparément, à genoux, la main droite sur la croix, la gauche sur l'évangile, ils prenaient Dieu à témoin de leur bon droit et juraient qu'ils agissaient selon leur conscience. Une seconde fois ils renouvelaient ce serment en présence l'un de l'autre.
Après un nouveau repos donné pour les réflexions, les combattants repassaient une troisième fois devant le juge du camp, qui leur ôtait le gantelet droit et le plaçait sur chacun des bras de la croix, pendant que le prêtre, leur exposant l'importance de leur conduite et la gravité de leur situation, les engageait à recourir à la grâce du prince plutôt que de se confier à la rage de leurs ennemis ou de s'exposer à mériter la colère de Dieu. S'ils persistaient, ils prêtaient un dernier serment en ajoutant :
« Je n'entens pourter sur moy ne sur mon cheval, paroles, pierres, herbes, charmes, charroiz ne conjurations, invocations d'ennemis, ne nulle autre chose où j'aie espérance qui me puisse ayder ne à lui nuire. » Et comme si ces redoutables formalités avaient pu avoir sur leur courage une injuste influence, le juge du camp, les tenant chacun par la main droite, leur faisait répéter l'accusation qu'ils se portaient, cérémonie bien propre à rappeler dans leur coeur la haine et la passion que le serment avait pu y ébranler.
Après ces préparatifs, ils embrassaient le crucifix et retournaient dans leurs pavillons respectifs pour ne plus songer qu'à vaincre ou à mourir. Le public, accouru en foule, était maintenu dans le silence et le respect par les cinq avertissements suivants, qui avaient été successivement fulminés en grand appareil :
1° Défense de porter des armes, excepté les gardes du camp ou ceux qui en auraient eu permission expresse du prince ou seigneur.
2° Défense d'assister à cheval, à peine contre les gentilshommes de perdre leur cheval et contre les autres de perdre l'oreille.
3° Défense d'entrer dans le champ, sous peine de mort.
4° Défense de rester debout ; ordre à chacun de s'asseoir à terre ou sur un banc, pour permettre aux autres de mieux voir, et ce sous peine de perdre le poing.
5° Défense à tous, sans exception, de parler, se signer, tousser, cracher, crier et faire aucun semblant, quel qu'il fût, durant la bataille, sous peine de mort et de confiscation de biens.
Telles étaient les formes et les lois de cette procédure, en harmonie avec les moeurs de nos ancêtres, qui y avaient recours plus souvent qu'on ne peut se l'imaginer, si l'on en juge par les nombreuses amendes pour batailles refusées, provocations légèrement faites ou refus de relever les gages. Les grands combats à cheval, au sabre et à la hache étaient pour les gentilshommes ; toujours armés, ils ne pouvaient marcher qu'en vrais militaires. Les roturiers, au contraire, combattaient à pied et avec des bâtons ; mais la lutte n'en était pas moins meurtrière et le sort du vaincu sans ressource. Celui-ci, vif ou mort, jeté hors des lices, était désarmé par les gardes, son harnais jeté çà et là et son corps étendu à terre, à la merci de la justice. Ses biens étaient confisqués et ses cautions arrêtées jusqu'à satisfaction.
Quant au vainqueur, il sortait honorablement, tenant en sa main droite l'arme victorieuse et marchant à l'abri de la chose souverainement jugée.
Il n'y avait pas que les gentilshommes et les roturiers qui fussent astreints à se soumettre au jugement de Dieu, les ecclésiastiques devaient aussi en subir l'épreuve ; seulement, ils étaient admis à confier leur cause au bras d'un champion qui, moyennant argent, risquait sa vie à ce jeu. Ainsi fit Pierre d'Italie, évêque de Verdun, dont nous avons déjà parlé (14), qui se justifia de cette manière d'une grave accusation. Les écrivains ecclésiastiques ont eu bien soin de faire remarquer que ce combat ne lui fut pas imposé, mais que ce fut l'évêque qui l'offrit. Le clergé avait une grande répugnance à se soumettre à une coutume dont les conséquences, au moins dispendieuses, étaient toujours fort inquiétantes ; il ne s'y résigna que dans de rares occasions, et finit par s'en affranchir. Cependant je trouve, en 1333 (15), Jean de Saverne, chanoine de Spire, qui s'engage à se trouver à Saint-Dié pour rendre raison à Henri de Fénétrange de ce dont il l'avait accusé, promettant de l'y attendre aussi long-temps qu'un champion y est obligé, sous peine de 200 livres d'argent.
En 1446, Jehan Vinot, de Sorcy, jette son gage de bataille contre messire Guillaume, curé de ce village. En 1491, Jean Boileau, de Noyers-en-Barrois, impute
à messire Demenge, son curé, d'avoir apporté lui-même des cordes pour abattre la maison d'un de ses paroissiens ; il offre d'en jeter son gage et de combattre. Dans ces deux circonstances, les accusations ayant été jugées légèrement faites, les poursuivants payèrent l'amende ; mais elles démontrent que les ecclésiastiques n'étaient pas à l'abri de cet usage.
Il fallait contre le défaillant une peine autre que celle de la honte ; cette peine était une amende pécuniaire proportionnée à la gravité du refus, qui augmentait selon que l'adversaire s'était plus ou moins avancé dans cette procédure. Pour une provocation légère, l'amende était de 60 sous ; en voici quelques exemples pris dans diverses prévôtés.
« 1383. Prévôté de Gondrecourt. Jehan Marchant, de Clarey, pour ce que Marguerite, sa femme, dit à Catherine, femme de Laurent, dudit lieu, qu'elle avait brisé un huis, et lui le voulut maintenir par gage de bataille ; laquelle chose fut mise en conseil et fut trouvé qu'il l'avait follement jeté. Condamné à 60 sous tournois valant 6 francs barrois.
« 1397. Prévôté de Saint-Mihiel. Gerbin, de Jessecourt, pour ce qu'il jeta sans cause son chaperon en manière de gage à Jacquemin Lalleur, de Troyon.
« 1403. Prévôté de Sancy. Jean-le-Diable, pour ce qu'il rua follement son gage.
« 1417. Prévôté de Souilly. Jean Guery, dudit lieu, pour avoir jeté son chaperon en gage de bataille, disant que quiconque voudrait dire qu'il fût traître, il le combattrait.
« 1429. Prévôté de La Chaussée. Richer, de Bouvron, demeurant à Thiaucourt, pour avoir follement jeté son gage contre Jean Huon, dudit lieu.
« 1457. Prévôté de Foug. Robert, de Bousonville, pour avoir follement défié Henri, d'Écrouves.
« 1459. Idem. Jean Culey, de Foug, pour avoir défié un sien voisin.
« Idem. Prévôté de Bouconville. Jacquinot, de Seichepré, pour son gage follement jeté à rencontre d'un bourgeois dudit lieu. »
Une fois le gage jeté, la justice était saisie ; mais, avant qu'elle eût prononcé, l'accusateur qui se repentait incontinent avait droit à quelque indulgence ; l'amende, dans ce cas, n'était que de 20 sous. On trouve les exemples suivants :
« 1377. Prévôté de Lamothe. Jehan Doyen, pour avoir repris son gage et le remis en sa tête, sans licence de justice.
« Idem. Idem. Jean Poulain, pour ce qu'il dit à Jean le Guet et à Rolin le Charpentier que si aucun lui voulait ôter son héritage, il s'en défendrait, qu'il en offrait son gage ; et tantôt incontinent il reprit son chaperon et le mit en sa tête, sans la licence de la justice.
« 1429. Prévôté de La Chaussée. Collignon le Fournier, de Panne, pour, en devisant et causant, avoir jeté son gage de bataille à rencontre de Didier, doyen de La Chaussée, et incontinent le releva, et icelui gage repris et relevé de soi-même. »
Si le gage avait été accepté et le champ de bataille assigné, le refus d'y donner suite ou l'accord des parties entraînait une amende plus forte, en punition de leur irréflexion ; elle était graduée suivant l'importance de l'accusation.
On trouve, en 1530, en la prévôté de Lamothe, Simon, de Damblain, condamné en 12 livres pour retraite d'un champ de bataille contre Thomas Lemasson ; Bradas et
Ninaudel, de Concourt, condamnés chacun en 6 livres pour s'être accordés après assignation d'un champ de bataille ; Quarrei et Pierrot, de Lifou, pour même cause, condamnés, le premier en 40 livres et le second en 52.
En 1417, Oulriet, de Saint-Maurice, en la prévôté d'Étain, condamné en 60 livres, pour avoir depuis longtemps jeté son gage de bataille et ne l'avoir pas exécuté.
Ces amendes appartenaient au seigneur, qui quelquefois les partageait avec ses officiers. A Toul, l'évêque en avait les deux tiers et le voué l'autre tiers. A Saint-Mihiel, le voué de l'abbaye avait, indépendamment de son tiers, un droit fixe de 2 écus. A Metz, le droit était de 7 sous 1/2 ; mais si les parties s'étaient avancées jusqu'au serment, elles ne pouvaient plus s'accorder qu'en payant 32 sous 1/2.
Nous avons dit que l'accusation devait être portée avec une sorte de dignité, sans paroles injurieuses contre l'accusé. Cela était facile dans les cas de crime, où il ne fallait à l'accusateur que l'amour du bien public pour se mettre en avant : la gravité de l'entreprise donnait naturellement de la gravité à ses paroles; mais dans les discussions d'intérêts civils ou dans des affaires de récriminations, il était presque impossible que les parties ne s'abandonnassent pas à des injures et des personnalités offensantes.
Alors ces provocations étaient regardées par le juge moins comme des accusations méritant l'épreuve sévère du jugement de Dieu que comme des infractions à l'ordre public où il n'échéait gage de bataille, et punissables seulement à l'égal de folles plaintes.
Deux exemples nous donneront une idée de la manière dont les choses se passaient.
En 1393, Grosjean, de Blur, en la prévôté de Lamarche, se trouvant à l'audience tenue par le lieutenant du mayeur, imputa à Huguenin Vezart, dudit Blur, d'avoir volé.
Celui-ci, indigné de ce propos lâché dans la chaleur de sa plaidoirie,
« vint incontinent devant ledit lieutenant et ploya son chaperon, disant que si l'autre voulait maintenir lesdites paroles, il disait qu'il mentait parmi sa fausse gorge, li ferait dédire, et en bailla son gaige pour lui combattre. Grosjean répondit : Il ne soi combattrait ja, car il ne se combat qu'il ne veut, ains li mettait en noy (lui déniait) qu'il li eût dit lesdites paroles ; mais le lieutenant lui-même en ayant tesmoigné, il fut condamné à 60 sous. »
En 1438, en la prévôté de La Chaussée, une dispute s'étant élevée entre Michel Patelot et Vautrin Godart, tous deux de Hannonville-au-Passage, Patelot lui dit qu'il avait menti et lui jeta son gage en disant qu'il le combattrait ; à quoi Godart répondit
« que ne se combat qui ne veut et qu'il ne se combattrait pas, que c'était un chien enragé. » Non-seulement le provocateur fut condamné pour folle provocation, mais tous deux encore pour injures réciproques.
Partout nous avons vu la conduite de la bataille appartenir au prince ou au seigneur ; elle était un droit du souverain. Les avoués des églises, qui étaient fort tentés d'usurper dans l'occasion les droits de l'évêque ou de l'abbé confiés à leur garde, essayèrent vainement de confondre ce droit du seigneur avec celui purement militaire qui leur était départi : force leur fut de céder. Ainsi fut fait par le voué du village de Condé, dépendant de l'abbaye de Saint-Mihiel (16).
Le lieu du combat était encore l'objet de grandes difficultés dans un temps où les seigneuries étaient fort rapprochées les unes des autres. Etait-ce sur le territoire du seigneur de l'appelant ou de l'appelé que l'on devait se rendre ? C'était là une question au-dessus de la volonté des combattants, et qui cependant influait grandement sur les règles du combat, le seigneur du lieu du champ étant le maître de les fixer. Le domicile du provoqué semble avoir été la règle suivie, si l'on en juge par l'accord intervenu au mois de juillet de l'an 1200, entre
Thiebaut, comte de Bar, et Gui de Dampierre, seigneur de Saint-Dizier. Ils stipulèrent que le combat aurait lieu à Bar quand l'appelant serait de Saint-Dizier, et vice versa (17).
Il en arriva de même au duel entre Jean de May, gentilhomme barisien, et Robert de Hervilliers ou Hermilliers, sire de Govillers, gentilhomme messin (18). Jean de May ayant accusé Hervilliers de trahison, fut par ce dernier provoqué au combat, qui fut assigné à Ligny, devant la justice du comte de Saint-Pol. C'était le 4 avril 1368. Hervilliers y vint accompagné de 4 à 500 Messins, escorte un peu nombreuse en apparence, mais qui ne le fut pas trop, car les Barisiens, par une trahison que l'histoire n'a pas pris la peine de justifier, se ruèrent sur les Messins, qui n'eurent que le temps de se mettre en garde et se défendirent hardiment comme lions, d'où s'ensuivit une véritable bataille dans laquelle plus de 120 gentilshommes du Barrois furent faits prisonniers, avec le duc lui-même, qui fut emmené à Metz, où ce fut grande joie de sa défaite, qui vengeait la fière cité d'échecs antérieurs.
Mais ce combat, par son issue, doit sortir de la ligne des combats judiciaires, et doit plutôt être regardé comme une rencontre militaire, terminée suivant les lois de la guerre, et un prétexte dont s'aida la politique des belligérants.
Un combat judiciaire célèbre en Lorraine, sinon par ses résultats, du moins par les formalités qu'il consacre, est celui d'entre Bidots et Roquelaure. A la bataille de
Nancy, Jeannot Bidots, pannetier du duc René, avait fait prisonnier Antoine, bâtard de Bourgogne, dont la rançon lui avait été payée 10,000 fr. par le roi Louis XI. Baptiste de Roquelaure, homme d'arme d'ordonnance, vint en réclamer sa part, prétendant qu'il avait été ainsi convenu avant la bataille. Sur la dénégation du premier et l'offre de part et d'autre de soutenir leurs allégations en champ de bataille jusqu'à la mort, le différend fut porté devant le duc en son conseil, où les parties comparurent à Nancy le 17 juillet 1482, puis le 15 août à Vézelise, et enfin le 10 septembre à Nancy. Toute voie de conciliation ayant été inutilement tentée et la déclaration qu'il échéait gage de bataille étant faite, Roquelaure jeta son gant et renouvela sa demande, à quoi Bidots, autorisé à mettre son bonnet, lui répondit qu'il agissait faussement et comme lâche gentilhomme, qu'il était résolu de le combattre, prenant Dieu, Notre-Dame et monseigneur saint Georges, avec son bon droit, à son aide.
Les gages relevés, le duc les fit mettre dans ses coffres, et Roquelaure présenta pour garant Thierri de Lenoncourt, seigneur d'Haroué, qui promit de l'amener mort ou vif et de répondre des dépens et dommages-intérêts s'il était vaincu. Bidots présenta Henri de Ligniville, qui fit les mêmes promesses, et jour fut assigné au 22 septembre pour combattre, d'après l'indication de Bidots, à cheval en harnois de guerre, à palastron, lances, épées, dagues et masses.
Ce jour arrivé, le duc, suivi de sa cour, se rendit devant le champ clos préparé, où la foule attendait impatiente. A midi et demi, Bidots, quoiqu'il fût l'appelé, parut le premier, la lance au poing, la dague et l'épée au côté, la masse à l'arçon de la selle. Hardouin de la Faille, Thomas de Paffenhoffen, bailli de Vaudémont et Simon Désarmoise, bailli de St.-Mihiel, furent députés pour le recevoir. Bidots était accompagné de Jean, comte de Salm, son cousin, du sieur de Citain, d'Achille de Beauvau, du grand Bertrand, de Ligniville, son pleige, et de son avocat. Après les cérémonies d'introduction et les protestations habituelles, Bidots alla dans son pavillon attendre son adversaire.
Mais trois heures étaient sonnées, les trois sommations étaient faites et Roquelaure ne venait pas. Lenoncourt, son pleige, fut appelé pour s'en expliquer, ce qu'il fit après avoir consulté ses amis. Il exposa qu'il ne s'était rendu pleige que par courtoisie envers ce gentilhomme étranger, afin que l'on ne pût pas accuser la Lorraine d'inhospitalité ; que personnellement il n'avait aucun mépris pour Bidots; qu'il tenait néanmoins Roquelaure pour un si parfait chevalier, qu'il était certain qu'il aurait comparu sans un empêchement insurmontable ; qu'il était convenable de prolonger le délai en sa faveur. Le duc ayant consulté son conseil, repoussa cette demande du pleige, le condamna aux dépens et dommages-intérêts envers Bidots, et déclara Roquelaure recréant (vaincu) et déchu de sa prétention.
La ville de Metz offre l'exemple d'un combat où personne ne fut vaincu. C'était le 5 mai 1482, entre un militaire français nommé Broche, engagé au service du comte de Wernembourg, et un Bourguignon, au service de Jehan de Vy, capitaine de Thionville. Pendant deux grandes heures, ces vaillants champions se frappèrent à outrance à coups de dagues, de lances, de poinçons d'acier, masses de fer et de plomb, sans réussir à s'égorger ni à s'assommer. Les chances cependant se déclaraient contre Broche, déjà en partie désarmé, lorsque les juges du camp, satisfaits de leurs efforts, mirent fin au combat et les obligèrent à faire la paix. Cet exemple n'est pas unique sans doute, mais c'est le seul que nous puissions citer.
La surveillance dont la justice s'était investie sur ces combats ne se serait pas accommodée d'une paix faite sans son concours, quelque loyale qu'elle fût ; en cela il y avait peut-être exagération, mais avant tout on ne voulait pas que l'on se fît un jeu d'une chose si grave. En 1485, dans la même cité de Metz, le jeune chevalier Jacques du Châtelet s'avisa d'enlever ou de tenter d'enlever une jeune fille de son hôte et d'imputer le conseil de cette action à un nommé le Grand-Guillaume, soldoyeur de la cité, qui pouvait bien en effet lui avoir promis mainforte. L'affaire venue aux oreilles de la justice, Guillaume nia, et comme il n'y avait de preuve ni pour ni contre une semblable accusation, il fut jugé qu'il échéait gage de bataille. Dans l'intervalle des quarante jours accordés pour vider ce différend par la mort de l'un des deux contestants, ceux-ci prirent le parti le plus sage, celui de faire la paix ; après quoi du Châtelet se mit en route, cherchant autre aventure. Mais la justice ne l'entendit pas ainsi; Guillaume, mandé devant elle, fut sommé de s'avouer convaincu ou de donner suite à sa provocation. Force lui fut donc de faire un appel en règle à du Châtelet, qu'il attendit vainement au jour fixé, avec le même cérémonial que si leur accommodement n'eût pas été sérieux.
En 1349, la Lorraine fut témoin d'un combat qui ne l'intéressait qu'indirectement. Nous voulons parler du duel entre Claude Daguerre, baron de Vienne-le-Châtel, et Jacques de Fontaine, seigneur de Fendille, qui eut lieu à Sedan, terre située entre la Meuse et le Rhin, par conséquent soumise pour les duels à la souveraineté du duc de Lorraine. Christine et Nicolas, régents sous la minorité de Charles III, députèrent à Robert de La Mark, seigneur de Sedan, pour faire valoir leurs droits; mais celui-ci, se sentant fort de l'appui du roi Henri II, qui avait fixé lui-même le lieu du combat, déclara qu'il passerait outre ; de sorte que la Lorraine fut forcée, en cette circonstance, de se contenter d'une protestation.
XVe, XVIe, ET XVIIe SIÈCLES.
Nous trouvons en exercice les officiers dont nous venons de parler et les institutions que nous venons de décrire, les uns et les autres fonctionnant suivant la loi qui a régi leurs devanciers. Mais à mesure qu'ils avancent, la civilisation marche, le crime change de formes, et la répression, pour être efficace, a besoin de les imiter, de suivre le mouvement et de modifier ses allures. La bourgeoisie avait conquis sur son maître la justice en même temps que la liberté ; pendant qu'elle en jouit, qu'elle en abuse et s'en lasse, le maître s'applique à ressaisir lentement ce qu'il s'est laissé prendre, et nous allons la voir ramenée insensiblement vers cette justice d'un seul, dont la destinée est de déplaire aux peuples.
BAILLIS.
Les baillis restèrent ce qu'ils étaient, des intendants militaires plus occupés d'assurer au profit du duc le succès de sa diplomatie vis-à-vis des seigneurs et princes voisins, que de s'immiscer dans la justice civile ou la répression criminelle. On les voit constamment occupés de mouvements militaires, de commandements de troupes, et quoique leur nombre se soit augmenté, ils paraissent à peine suffire à cette occupation. Nous n'avions guère vu jusqu'alors qu'un bailli à Nancy pour la Lorraine, et un à St.-Mihiel pour le Barrois. Chaumont pour le Bassigny, Bar pour le Barrois mouvant, Mirecourt pour les Vosges, Vaudrevanges pour l'Allemagne, Vézelise pour le comté de Vaudémont, etc., eurent chacun le leur. Cette augmentation de leur nombre aurait dû diminuer leur besogne ; mais, d'une part, absorbés par leur service militaire, de l'autre, trop grands seigneurs pour descendre à la pratique des affaires, dans laquelle ils étaient d'ailleurs totalement inexpérimentés, on leur adjoignit des lieutenants, qui en général furent des hommes de loi, qui s'acquittèrent pour eux de toutes leurs attributions judiciaires, et au besoin, en leur absence, les suppléèrent en tous points.
PRÉVÔTS.
Les prévôts, investis de fonctions plus modestes, mais d'une application plus réitérée, continuaient à s'occuper de la répression criminelle qu'ils dirigeaient plus encore qu'ils ne la surveillaient. Dans les ressorts où ils avaient la juridiction, rien ne leur faisait obstacle lorsqu'ils croyaient utile de sévir contre un malfaiteur saisi par eux ; dans celles où les mairies rendaient la justice, ils avaient une grande influence pour forcer au châtiment des coupables, par leur participation exclusive à l'arrestation et
à l'exécution.
Partout considéré comme le représentant du seigneur, le prévôt recevait les honneurs qui étaient le partage du maître. A l'audience, à l'église, aux processions, il avait le pas sur tous, et si les habitants étaient en armes, il marchait à leur tête. Au jeu du papegai, il tirait le premier l'oiseau; le jour du plaid banal, il avait ses pasls et repas (dîner et souper). Le cri des fêtes patronales lui donnait droit aux jeux de quilles et autres qu'il affermait à son profit. Souvent les petites amendes qu'il prononçait lui appartenaient ; à Valfroicourt il pouvait les élever ainsi à son profit jusqu'à 60 sous.
La cérémonie du cri de fête, qui consistait à publier avec grand appareil, dans tous les carrefours de la ville ou du village, que le seigneur promettait sa protection pour la fête patronale, était en même temps pour celui-ci un moyen de faire reconnaître son autorité; c'était une déclaration solennelle de sa prétention au pouvoir suprême.
Si par hasard quelque compétiteur nourrissait le même projet, il ne manquait pas de saisir cette occasion de se déclarer ; de sorte que la possession paisible de faire ce cri était une preuve du droit à la seigneurie, ce qui faisait un devoir au prévôt de tenir la main à son exécution. Celui de Nancy, qui avait cette mission au village de Lay, le jour de la Saint-Christophe, s'y rendait à la tête des jeunes Nancéiens, marchant au pas, enseignes déployées. Après le cri au nom du duc, le seigneur du lieu était dans l'obligation de donner un past où le prévôt invitait qui bon lui semblait, ayant pour désaltérer ses
convives un vireli de vin. A leur tour, les jeunes gens de Lay venaient à Nancy le 15 septembre, jour de la fête de la ville, où ils étaient toutefois reçus avec moins de cérémonies, ne faisant pas, bien entendu, le cri de la fête au nom de leur seigneur, mais ayant droit d'avoir la première danse. En 1390, la réciprocité ayant rencontré quelques abus dans son exercice, la difficulté fut portée au conseil; le cardinal Charles de Lorraine, ayant alors l'administration du duché, la trancha par l'abolition de cet usage ; et pour que le vireli de vin ne fût pas perdu, il ordonna que le seigneur le paierait annuellement à l'hospice
Saint- Julien.
Ces anciennes redevances étaient la représentation d'anciens témoignages de suprématie, qui aurait été mieux maintenue s'ils avaient été imaginés plus sérieux ; mais on semblait s'être étudié à les rendre ridicules. A Remoncourt, village des Vosges appartenant au duc par indivis avec un seigneur particulier, le maire de ces deux maîtres donnait au prévôt, le soir de la Saint-Martin et le soir du dimanche avant Noël, ainsi qu'à son lieutenant et au sergent, un banquet où il était tenu de fournir chandelle de cire et de suif, vin blanc et clairet, feu sans fumée et danse sans riotte (sans bruit), sinon il était amendé de 7 fr. 1/2.
Pendant la foire de Poussay, le prévôt de Mirecourt était dans l'obligation d'y faire la garde depuis la veille à midi jusqu'au lendemain à pareille heure, et de saisir les délinquants. Pour ce service, il recevait 60 sous, du feu, trois chandelles, trois bougies, du vin, du fruit pour sa collation, et 5 sous pour son sergent ; la dame Abbesse du lieu devait lui envoyer par son gouverneur un de ses manteaux pour couverture de lit. De son côté, il était tenu de donner une collation aux Dames du chapitre, hautes-justicières du village, et de faire jouer les violons pendant les deux soirées (19).
Les seigneurs de Sorcy et Saint-Martin, en cédant la dîme de ces lieux aux chanoines de Toul, s'en réservèrent la onzième partie et les chargèrent de fournir à leurs officiers, lorsqu'ils feraient la levée de cette portion, trois pasts ayant feu sans fumée, table d'un seul bois; changer trois fois de nappe et de serviettes sans marques, sans tache ni trou, trois services, trois fois de plats et d'assiettes bien mises, changer trois fois de pain entier, servir du boeuf et du porc rôtis et bouillis, du fromage vieux et nouveau, des pommes et des poires crues et cuites, du vin de trois couleurs, blanc, clairet et rouge, l'hôtesse d'un visage gai et gaillard ; le tout à peine de recommencer en cas d'infraction ainsi que de fautes dans le service, ce qui était laissé au jugement de quatre desdits officiers.
Il n'y avait donc qu'au point de vue judiciaire que l'importance des prévôts n'était plus aussi absolue, les mairies et les communautés ayant réussi en divers lieux
à s'emparer de cette partie de leurs attributions; mais, en revanche, deux classes d'officiers avaient surgi et
grandi : le ministère public et le greffier. L'indifférence des citoyens à signaler les coupables à la justice, jointe aux avantages que le prince et le public trouvaient dans la surveillance permanente d'un fonctionnaire spécial, expliquent suffisamment le succès de la première innovation. Quant au greffier, c'était une nécessité depuis qu'à l'exemple de celle des cours ecclésiastiques, la procédure des tribunaux laïques ne faisait plus un pas sans écritures. Cette formalité devenait indispensable dans le Barrois, parce qu'il y avait lieu à appel ; en Lorraine, parce qu'il fallait prendre l'avis de praticiens ou des
Échevins de Nancy, et que, dans ces divers cas, l'écriture était le seul moyen d'exposer sûrement l'état de l'affaire à la personne consultée ou au juge d'appel. Quelques-uns
y voyaient aussi la garantie d'une bonne justice ; mais les Lorrains de la vieille roche regardaient ces innovations comme dangereuses, principalement à cause du mode nouveau de procéder à l'information hors de la présence de l'accusé, toujours très-déconcerté de trouver, au sortir de son cachot, une instruction toute faite, sur laquelle il lui restait peu d'espoir d'influence, au lieu de débats contradictoires, dans lesquels l'adresse ou l'audace avait quelques chances de succès. Mais ces formes de procéder, venues de France, étant toutes dans l'intérêt de la vérité, introduites d'ailleurs par imitation d'un royaume influent, ne pouvaient être ébranlées par de faibles considérations, la liberté des peuples n'y ayant aucun danger réel à courir.
Tout en abandonnant les vieilles institutions, la tendance générale étant pour les formes protectrices, il ne pouvait y avoir d'erreur que dans le choix.
Un grand événement pour nous signala la fin du XVIe siècle ; il peut servir de point d'arrêt à notre sujet et permettre une description mieux définie de l'état de la justice criminelle. En 1571, le peuple, la noblesse et le clergé, c'est-à-dire les États du pays, se trouvèrent d'accord pour demander la révision des coutumes judiciaires et leur rédaction en un texte précis sur lequel chacun pût compter à l'avenir. Cette tentative ne pouvait mieux réussir que sous un prince comme Charles III ; aussi eut-elle un plein succès, malgré quelques retards causés par des difficultés de détails inutiles à rapporter ici (20). Voici l'ordre dans lequel chacune des divisions de la Lorraine réalisa sa rédaction :
La Bresse 1573
Bar-le-Duc 1579
Le Bassigny 1580
Sainte-Croix, Val-de-Lièvre et Sainte-Marie 1586
Nancy, Vosges et Allemagne 1594
Blâmont 1596
Saint-Mihiel 1598
Évêché de Metz 1601
Épinal 1603
Thionville et le Luxembourg français 1623
Marsal 1627
Ces coutumes ne concernant que le droit civil, ne tranchent pas la difficulté de préciser l'état des institutions criminelles ; mais elles jettent quelque lumière sur ce point, plusieurs d'entre elles ayant effleuré cette matière et consacré des principes dont il n'était plus permis de s'écarter. De leur texte, de celui des chartes, des usages locaux et des monuments écrits conservés jusqu'à nos jours, voici ce que l'on peut rapporter à coup sûr de la marche de la justice criminelle pendant les siècles où nous sommes arrivés.
POURSUITE.
La poursuite appartenait à l'officier chargé des fonctions du ministère public, à l'exclusion de tous intéressés ; il agissait d'office dans les cas de flagrant délit ou en vertu de quelque plainte ou dénonciation, sauf à l'accusé à se pourvoir contre son dénonciateur, dont le nom ne pouvait lui être caché s'il le demandait. Néanmoins, en cas de crimes énormes intéressant l'ordre public, tels que ceux de lèse-majesté, de fausse monnaie, le dénonciateur n'était passible de dommages-intérêts que si l'on reconnaissait qu'il avait agi de mauvaise foi ou par vengeance.
Ainsi avait disparu la plainte directe, présentée et poursuivie par le plaignant, débattue contre lui. Ce vieil usage avait laissé profondément gravé dans les esprits le principe qu'il ne pouvait y avoir de poursuite sans plainte ; aussi était-ce là le premier sujet de contestation, quand le procureur fiscal agissait d'office. En l'an 1500, le maire d'Abainville, outragé dans l'exercice de ses fonctions par un habitant qui était à la corvée, l'avait fait citer directement devant le prévôt de Gondrecourt ; là, le prévenu fit grand bruit du défaut de représentation d'une plainte écrite; mais le prévôt, aidant à la nouvelle jurisprudence, décida que la citation directe au nom du maire en tiendrait lieu.
ARRESTATION PRÉVENTIVE.
S'il y avait flagrant délit, danger de fuite ou mauvaise renommée contre l'accusé, le juge avait le droit de le faire arrêter incontinent ; autrement, il ne le pouvait qu'après l'information. Même règle était suivie contre le dénonciateur, si surtout on le suspectait de calomnie.
INFORMATION PRÉALABLE.
Elle était dirigée par le juge, maire ou échevin, quelquefois par le prévôt, quoiqu'il n'eût pas le droit de juger, comme à Épinal. Le greffier y était présent et transcrivait les dépositions de la même manière et avec les mêmes formalités qu'aujourd'hui. Le ministère public mettait ses conclusions à la suite du cahier quand il était terminé, et, s'il y avait lieu, l'accusé était décrété d'ajournement personnel ou de prise de corps.
ARRESTATION.
L'ajournement personnel avait lieu par simple exploit d'huissier, comme pour nos mandats de comparution, et s'employait dans les cas peu graves ou vis-à-vis des personnes de qualité, considération qui pesait jadis d'un grand poids dans la balance du juge.
Le décret de prise de corps portait ordre à l'huissier de saisir le prévenu s'il était possible de le faire, sinon de l'assigner à comparaître à trois biefs jours, sous peine de bannissement. Dans quelques localités, où les mots se prenaient pour leur valeur, il n'y avait réellement que trois jours de délai ; mais généralement, en Lorraine, on assignait, pour le premier jour, au premier lundi qui suivait, pour le second jour, au lundi suivant, et ainsi de suite. On accordait en outre une autre semaine appelée le quart d'abondant, de sorte qu'en définitive l'accusé avait presque un mois.
S'il faisait défaut, le ministère public mettait ses conclusions à la suite de l'information, sur le même cahier, et l'affaire se trouvait en état. Le juge prononçait après avoir demandé avis, comme nous l'expliquerons plus loin en retraçant les règles de la procédure contradictoire.
Mais il pouvait se faire encore que l'accusé ne comparût pas, qu'il ne fût pas appréhendé, quoique sa retraite fût connue, quoiqu'il fût en quelque sorte sous la main de la justice : c'était lorsqu'il s'était réfugié dans un Asile.
ASILE.
Contre les caprices de la tyrannie, le faible imagina de tout temps un abri qu'il sut rendre inviolable en y faisant intervenir soit la divinité, soit la dignité du tyran lui même. Ces lieux de prédilection furent les églises, les couvents, les cimetières, les palais et les châteaux. Ils ne jouirent pas tous du même degré de protection ; mais, avant que celle-ci fût appréciée, il y avait toujours pour le fugitif la faveur de quelque délai. Les églises avaient,
à cet égard, le privilège le plus sûr, qui s'étendait au choeur, à la nef et même au cloître qui y touchait. Dès qu'un perturbateur quelconque se sentait poursuivi, son premier soin, s'il n'avait pas le temps de franchir les portes de la cité, toujours bien gardées, était de se précipiter dans l'église ou le couvent le plus voisin. Quel que fût son crime, la force publique s'arrêtait sur le seuil de ces demeures, et la justice, suspendue un instant, se trouvait contrainte d'entrer en pourparlers avec le maître du lieu, qui, à la première nouvelle de l'événement, se rendait auprès du réfugié, l'assurait de sa protection, s'informait de son cas et y prenait tout l'intérêt qu'il pouvait inspirer. Si ses parents ou ses amis ne lui apportaient la nourriture et autres choses nécessaires à son existence, il trouvait là, dans l'église ou le couvent, chacun des membres du clergé ou du monastère empressé à y suppléer et à lui adoucir les rigueurs de sa position.
On ne peut guère comprendre aujourd'hui de semblables usages, tolérant le crime au mépris de la justice, parce que la nécessité d'échapper aux mêmes oppressions n'existe plus. D'ailleurs, tous les coupables n'étaient pas également protégés ; les assassins et les violeurs n'étaient pas plus tôt entrés, que défense était publiée de les aider, de les nourrir, sous peine de grande punition, même de mort.
Pris ainsi par famine, il fallait que tôt ou tard ils se rendissent ; car, pour tous les cas, le délinquant comme le grand criminel n'était pas plus tôt entré, que la garde veillait nuit et jour à toutes les issues, sans compter que les portes et murailles des villes étaient aussitôt plus particulièrement gardées.
Ce droit d'asile était-il admis en Lorraine ? Thibault résout cette question négativement (21). Cependant j'en ai trouvé un exemple en faveur du prieuré de Notre-Dame, à Nancy. En 1470, le prévôt de cette ville, Arnould de Monteneto, fut réduit à demander pardon à genoux au prieur Jean de Lambale pour avoir violé l'asile et sauvegarde dont l'église et les environs dudit prieuré avaient toujours joui, en enlevant un coupable, bourgeois de Nancy, qui s'y était réfugié.
Dans le Barrois et dans les Évêchés, l'asile était sans contestation en grand crédit, principalement à Metz, où ce refuge contre la tyrannie était bien conforme à l'esprit démocratique de la cité. Le clergé, loin de s'y refuser, y donnait les mains dans l'occasion. En 1509, deux voleurs demandaient asile, l'un à Saint-Vincent, l'autre aux Cordeliers de Metz ; serrés de près par la garde, ils allaient être pris, lorsque les moines leur vinrent en aide et soutinrent le choc avec eux. La justice, émue d'une telle résistance, s'opiniâtra et finit par arracher le réfugié de
Saint-Vincent au pied même de l'autel, où il cria vainement : Franchise ! franchise ! Mais l'abbé, de retour, s'indigna de cette violation et obtint aussitôt que le prisonnier serait réintégré. L'autorité laïque y attachait d'ailleurs autant d'importance. Vers la même époque,
l'official voulant reprendre un sien justiciable, que l'église cependant repoussait aussi, le chef de la police menaça de reprendre à son tour un réfugié qui s'était évadé de sa prison; de sorte qu'on fut bien forcé de l'y laisser.
A Verdun, l'église de la Madelaine était un lieu d'asile, en considération de ce qu'elle avait été bénite par le pape saint Léon IX. Elle fut une fois violée, et encore ce fut par le clergé: En 1109, l'archidiacre Gui essayait de ramener l'évêque et les chanoines à l'obéissance qu'ils devaient au pape ; déjà battu et traîné par les cheveux, il avait à grand'peine échappé à leur fureur et avait gagné l'asile. Les chanoines, hors de raison, l'en arrachèrent sans respect pour la sainteté du lieu, que des séculiers n'eussent pas violé si impunément; car, en 1445, un nommé Martin Crochet s'étant réfugié dans le choeur de la cathédrale pour éviter les poursuites dont il était l'objet comme suspect de publication d'un libelle, les gouverneurs qui le prirent, sans respect pour son asile, furent condamnés par l'évêque, à qui ils s'en rapportèrent, à payer 4,000 florins aux chanoines, 3,000 aux pauvres, à réparer l'église et à y ramener sain et sauf le réfugié qu'ils avaient incarcéré (22).
La durée de l'asile n'était pas limitée ; un secrétaire infidèle de Philippe de Raigecourt, qui, en 1 500, s'était réfugié dans la grande église de Metz, y demeura jusqu'à la mort de son maître, époque où il fut pardonné par ses héritiers. Il passait son temps près du sonneur, qui, étant décédé dans l'intervalle, le laissa pour successeur.
Dans le Barrois, je trouve, en 1547, un nommé Colas Barbier, de Foug, meurtrier, appréhendé après dix jours et dix nuits de refuge dans l'église de ce village.
Le crime qu'il avait commis était du nombre de ceux où l'asile ne pouvait tout au plus donner qu'un répit de quelques instants.
Dans la ville de Metz, il y eut, en 1488, un grand exemple d'abus de l'asile. Un riche orfèvre, nommé Hainzelin, ayant tué un de ses concitoyens dans une dispute, se sauva dans la grande église, qui fut aussitôt cernée avec un soin extrême. Les amis du défunt étaient si nombreux et si courroucés, que le fugitif s'attendait à chaque instant à être pris de force ou à être tué. De leur côté, les chanoines veillaient sur leur hôte avec une grande sollicitude, prenant même tous les soirs le soin de visiter minutieusement l'église aux flambeaux, dans la crainte que quelqu'un ne s'y cachât. Le même acharnement et la même surveillance duraient ainsi depuis six semaines. Quelle fut la surprise de part et d'autre, lorsque l'on apprit qu'au mépris de toute retenue, le réfugié avait eu, dans l'église même, commerce avec une femme enceinte. A l'instant les offices furent suspendus, les chanoines cessèrent de dire la messe et l'église fut déclarée en interdit. Qui le croirait! malgré cette indignité, malgré les réclamations de la justice, qui démontrait qu'il avait rompu sa franchise, les chanoines, généreux, se refusèrent à le livrer. Mais le mécontentement grossissant, Jean de Landremont, l'un de ses amis, n'eut que le temps de le faire évader à l'aide d'un déguisement.
En 1512, un cordonnier qui avait blessé un homme à mort se réfugia dans un cimetière où il fut gardé nuit et jour pendant six mois ; heureusement pour lui, le blessé ne mourut pas, ce qui fit qu'il fut pardonné.
Les châteaux et autres maisons fortes avaient non-seulement l'asile de fait par la résistance qu'ils favorisaient quand le maître y était consentant, mais quelques-uns avaient aussi un asile de droit. A Arches, la maison de Jacquet de Jussey jouissait ainsi d'une franchise de quarante jours, telle que le criminel était pendant ce temps
à l'abri de toute capture ; et si, étant sorti dans l'intervalle ou à l'expiration, il parvenait à y rentrer, il avait un nouveau et pareil délai qui pouvait ainsi se renouveler indéfiniment (23).
Les maisons canoniales de Metz étaient également franches pour douze membres du chapitre, vivant cléricalement, mais pour eux seuls, suivant accord fait entre l'évêque et la justice de cette ville au XV* siècle.
Presque toutes les coutumes accordaient un droit de franchise pendant les foires et marchés, ainsi que pendant le temps nécessaire pour y arriver et s'en retourner ; ceux qui les fréquentaient ne pouvaient être arrêtés pour dettes autres que celles envers le prince. Par décret du 11 novembre 1479, la même faveur fut accordée à ceux qui se rendaient aux grands jours à Saint-Mihiel, tant en allant qu'en revenant. Dans les droits des habitants de Metz, du temps de l'évêque Bertram, au XIIe siècle, on voit que pendant la huitaine qui précédait la foire de la mi-août, la huitaine de la foire et celle qui la suivait, il y avait trêve pour ceux qui y venaient. La peine contre toute violence qui s'y commettait était la loi du talion, membre pour membre, vie pour vie.
Pour appeler des habitants, la loi de Beaumont promit asile aux malfaiteurs autres que les voleurs et meurtriers : encore accordait-elle à ceux-ci la sauvegarde nécessaire pour qu'ils eussent le temps de se justifier.
L'usage avait encore admis une sorte d'asile qui était accordé par le juge, non plus au coupable, mais à l'innocent. Lorsqu'un individu avait été menacé par un autre, et qu'il ne se sentait pas assez fort pour le braver, il demandait contre lui ce que l'on appelait un Assurement.
A cet effet, il le faisait citer devant le juge, exposait sa crainte et requérait le magistrat de lui faire défense d'user de voies de fait envers lui. S'il y avait lieu, le juge le déclarait en assurément contre le cité, auquel il recommandait de ne l'injurier ni le toucher, lui déclarant que s'il lui arrivait mal, on s'en prendrait à lui.
Pour donner une idée de la manière dont les choses se passaient, on pourrait citer une foule d'exemples; il suffira de quelques-uns. En 1468, Jean Heraudel, de Domgermain, se trouvant devant le prévôt de Foug avec Collot Gillebert, dudit lieu, s'effraya de quelques menaces de ce dernier et demanda assurément contre lui. Heraudel, un peu vif, lui répondit : J'y consens ; et du diable sois-tu sûr ! Cette apostrophe contre l'assuré motiva à l'instant une amende de 60 sous. En 1439, messire Jacques, curé de La Chaussée, avait pris assurément contre un de ses paroissiens nommé Maulry ; l'ayant fait citer un jour devant le prévôt pour le paiement de quelques deniers qu'il lui devait, ce débiteur, pour toute explication, l'envoya faire f... Vous l'entendez, s'écria messire Jacques; et nous sommes en assurément! Je demande qu'on l'amende de 60 sous. Ainsi fut fait.
Cet usage a dû se conserver légalement bien tard dans nos contrées ; car il arrive tous les jours que des habitants des campagnes viennent ingénument demander aux magistrats de les assurer contre des adversaires qui les ont menacés.
COMPÉTENCE.
Si l'accusé se présentait, la procédure avait à subir d'autres phases.
Dès qu'il comparaissait, il lui était enjoint de proposer ses fins déclinatoires. Était-il noble ou franc, en raison de sa demeure dans un fief ? était-il privilégié, justiciable
d'une autre juridiction ; en un mot, le juge saisi était-il compétent ? Telle était la question à résoudre et qu'il devait proposer avant toute défense, sous peine de forclusion.
Cette question était surtout importante quand il s'agissait d'un étranger. Devait-il être jugé par la justice du lieu où le crime avait été commis, ou bien ce droit appartenait-il
à la justice du seigneur sous la loi duquel il vivait ? Comment lui infliger une peine corporelle sans blesser les droits de son maître ? N'était-ce pas consacrer indirectement que le vassal pouvait, à l'aide d'un crime, se soustraire à l'autorité de son seigneur, et n'eût-ce pas été encourager la forfuyance, réprimée elle-même par la loi?
En présence de ce grave résultat, le droit de propriété triompha ; le seigneur demeura le maître de son sujet, qui ne dépendit que de sa justice, quoiqu'il eût porté la perturbation dans un autre ressort et qu'il en eût enfreint la loi. Sur la réclamation du seigneur propriétaire, il était rendu à ce dernier, qui prenait l'engagement tacite de lui infliger la peine due à son forfait. Mais quelle justice espérer dans une seigneurie étrangère, où il pouvait retrouver des amis, loin des témoins, loin des plaignants, devant un juge dont le maître avait intérêt à sauver le coupable? Le lieu scandalisé par le crime ne voyait donc pas le châtiment, et le plus souvent il ignorait à jamais s'il y avait eu expiation.
Les seigneurs n'étaient pas seuls intéressés dans cette question de compétence : les coupables l'étaient non moins qu'eux ; car du lieu où ils étaient jugés dépendait la douceur
ou la sévérité, puisqu'ils devenaient soumis à la loi et aux institutions plus ou moins rigides de cette localité. Ici, c'était un prévôt ; là, des jurés : dans une juridiction, la confiscation était d'usage ; dans l'autre, non : en quelques lieux, le recours en appel était ouvert; dans d'autres, la sentence était en dernier ressort. Et cependant, lorsque les seigneuries étaient si restreintes et si rapprochées, il avait suffi à l'accusé de faire quelques pas de plus ou de moins pour attacher à sa faute des différences si notables. En 1609, un nommé Rleinghen, de Mettloeh (24), qui avait assommé le maire des
Orlyhots, fut poursuivi par la justice de Metzigh, représentée par le gouverneur de Siersperg pour le duc, et par un juge pour l'archevêque de Trêves. Ces officiers, chargés seulement de l'instruction, livrèrent l'accusé, comme ils en étaient tenus, aux échevins de Metzigh, qui, au nombre de trente-cinq, le condamnèrent au supplice de la roue.
Ailleurs la confiscation eût été inséparable de cette peine; cependant, quelques efforts qu'ait pu faire le représentant du duc, il ne put l'obtenir, les échevins invoquant les instituts de l'Empire et s'y retranchant avec obstination (25). Si ce malheureux eût commis son crime à quelques pas plus loin, il eût donc en outre ruiné ses enfants.
L'exemple de la France, qui depuis long-temps déjà réglait sa compétence ratione loci, n'avait pas fait d'impression en Lorraine, et l'usage opposé résista encore à la révision des coutumes.
« Si quelqu'un ayant délinqué sous la haute justice d'autrui, y est arrêté en délit flagrant de ce fait, et quand le délit n'est disposé à peine corporelle ou à bannissement, il y est rendu jurisdiciable, encore qu'autrement il n'y soit sujet ni domicilié. Mais si le délit est sujet à peine corporelle ou à bannissement, en ce cas, étant le délinquant avoué et reconnu homme d'autre justice et requêté par le seigneur d'icelle, il lui doit être rendu chargé de ses charges pour en faire faire la justice, en satisfaisant préalablement aux dépens, tant de la détention du prévenu que confection de son procès auparavant le requêtement (26). »
On se demandera comment le seigneur propriétaire du coupable s'y prenait pour le ravoir, quand le seigneur justicier qui le détenait ne voulait pas le rendre ? En ce cas, la loi du plus fort fut toujours la meilleure. En 1469 (27), Ferry et Olry de Blâmont, seigneurs de
Mandres-aux-Quatre-Tours, s'étant avisés d'enlever un nommé Girart que les gens du roi René avaient arrêté à Gironville, trouvèrent, le matin d'un dimanche suivant, à leur
réveil,
5 à 600 hommes armés et embâtonnés qui campaient devant leur manoir sous la conduite de Collignon le Prélat, prévôt de Saint-Mihiel, de Jean Guinart, prévôt de La Chaussée, de Colet Peuchet, prévôt de Trognon (Heudicourt), et du prévôt de Bouconville. Ces capitaines, ainsi
soutenus, parlant au nom d'un seigneur plus puissant que les châtelains de Mandres, méritaient quelque considération ; aussi à l'instant des parlementaires leur furent octroyés : c'étaient Georges, bâtard d'Apremont ; Robert d'Ourches, prévôt de Mandres; J. Le Clerc, de Rambucourt, et Henry de Marche, écuyer. La reddition du prisonnier et 10,000 fr. d'amende furent les conditions des assiégeants, qui surent les rendre si imposantes que Girart leur fut incontinent remis avec J. Le Clerc et J. Georges, de Broussey, tous deux otages devant garantir l'amende laissée au bon plaisir du roi offensé.
Contre un adversaire moins puissant, les choses ne se passaient pas de même. En 1521 (28) Simon de Jauni, seigneur de Jauni, ayant à se plaindre du nommé Guillaume le Treize, de La Chaussée, le fit prendre par Jeannin le Potier et Jeannot le Parmentier, tous deux ses hommes d'armes, qui l'emmenèrent en son château, où il fut jeté sans pitié avec des criminels et mis à la géhenne. Érard le Dart, sergent de La Chaussée, s'étant présenté pour le réclamer, Simon de Jauni n'eut besoin que de se montrer, la javeline à la main, en jurant, par la vertu Dieu, la mort du téméraire, pour que celui-ci gagnât promptement le large avec sa suite épouvantée.
Le duc, avec ses justices, avait toujours raison contre les seigneurs entourés de ses prévôts, qui, comme on vient de le voir, étaient à tout instant prêts à se donner la
main. Sous Charles III, le maire de Remonville ayant fait enterrer un mort trouvé sur son territoire, après avoir vainement attendu pendant plusieurs jours le prévôt de Chatenoy, celui-ci, quatre mois après, rencontrant ce maire à la foire dudit Chatenoy, le fit jeter en prison, et tenir si rudement, qu'il en sortit hydropique et en mourut peu de jours après sa sortie (29), sans qu'aucune compensation lui ait été accordée.
Indépendamment des difficultés de compétence, qui pouvaient se terminer par l'application de la règle générale ratione loci ou ratione personae, il en survenait beaucoup d'autres, fondées sur des motifs différents, notamment sur la propriété de la juridiction elle-même, ce qui n'était pas si facile à trancher.
Les exemples de discussions de ce genre sont trop nombreux pour être rapportés ; on peut les concevoir aussi réitérés que les débats auxquels ont donné et donneront toujours lieu les questions de propriété en général ; elles n'étaient, le plus souvent, terminées que par des arbitres ou par la force. Heureux les accusés, quand les seigneurs, en attendant le résultat, ne commençaient pas par faire justice, qui alors était d'autant plus rigoureuse, qu'ils avaient besoin d'une protestation plus marquée et plus énergique de leur droit.
En 1447, un Barisien, nommé Thiry Geuxe, gracié par le marquis du Pont pour tous cas antérieurs, s'étant rendu
de Metz, où il demeurait depuis huit ans, dans la ville de Briey, où il avait un procès, le prévôt de ce lieu le fit pendre, sans égard à la grâce obtenue ni à la franchise accordée à ceux qui venaient aux assises. L'autorité messine ayant demandé réparation de cette violation du droit des gens, journée fut accordée par le duc de Bar à la chapelle de Woizaie, près d'Airy. Les torts du prévôt ayant été reconnus, il fut arrêté que Thiry serait dépendu et enterré avec pompe aux frais du prévôt, qui paierait en outre à sa veuve et à ses enfants une rente de vingt-six quartes de blé. C'était une réparation incomplète, mais du moins parvint-on, en cette circonstance, à l'obtenir ; tandis qu'il arriva plus d'une fois que le pendu tombait déjà du gibet, en lambeaux, lorsqu'il était encore douteux que la justice qui en avait disposé eût le droit de le juger.
Dans quelques cas les seigneurs eurent le bon esprit de s'entendre pour que le cours de la justice ne fût pas interrompu. C'est ce qui arriva en 1583 (30) lorsque la souveraineté de Domptail fut contestée entre le duc de Lorraine et l'évêque de Metz. Une femme, accusée de sorcellerie, était à juger : le duc et l'évêque de Verdun, M. de Bousmard, alors administrateur de l'évêché de Metz, convinrent qu'elle serait jugée, et, au besoin, exécutée à Domptaille, sans rien préjudicier à leurs droits respectifs.
A défaut de précautions semblables, le contraire était à redouter, l'impunité ressortait de discussions interminables pendant lesquelles l'accusé parvenait le plus souvent à prendre la fuite, qui était même favorisée par le justicier qui le détenait, s'il entrevoyait un échec dans ses prétentions.
L'émulation entre les officiers de justice était aussi une cause de difficultés relatives à la compétence ; non-seulement leur zèle naturel les y poussait, mais leur intérêt privé les y portait aussi, leurs émoluments étant alors attachés aux affaires. Dans les justices voisines des frontières, ils avaient en ce point une vigilance remarquable ; la saisie du criminel y était pour ainsi dire le prix de la course. Aux confins du Barrois et du Bassigny (31), cet empressement était d'autant plus excessif, qu'il emportait avec lui l'avantage de soustraire ou non les sujets lorrains à la juridiction du parlement de Paris.
La question de compétence en matière d'appel offrait encore de grandes difficultés, quand surtout plusieurs seigneurs prétendaient à la propriété de la même justice.
Il y eut un moment où la France, la Lorraine et la Bourgogne élevèrent en même temps des prétentions à la seigneurie de Monthureux-sur-Saône, si bien que les criminels se trouvèrent dans l'indécision de savoir s'ils avaient droit d'appeler et où il fallait s'adresser. Dans le doute, ils eurent recours aux trois puissances, c'est-à-dire à Paris, à Nancy et à Dole. Survint l'abbé de Luxeuil, prétendant l'emporter sur les autres ; de sorte que quatre arrêts différents
purent successivement donner tort et raison au premier juge, qui n'en restait que plus embarrassé.
INSTRUCTION.
La compétence étant réglée, le juge procédait à l'audition des témoins, hors de la présence de l'accusé, comme nous l'avons rapporté pour l'information préalable, et ensuite il lui faisait subir un interrogatoire, toujours précédé du serment de dire la vérité : formalité bien contraire à une saine morale et à la décision des États de 1519, qui n'en avait excepté que le cas de serment loqué (32). Les témoins entendus étaient rappelés pour répéter leur déposition devant lui, ce que l'on appelait le Récolement ; cette confrontation tenait lieu de tout débat, sans plaidoirie d'aucun défenseur. L'accusé pouvait élever ses reproches, mais avant de connaître les dépositions ; il pouvait réfuter celles-ci seulement après, par tous les moyens en son pouvoir. S'il avait lui-même des témoins
à produire, il pouvait en donner la liste. Devant un juge intègre, ces formes présentaient toutes les garanties désirables; devant un juge passionné ou négligent, il n'y avait aucune sûreté qu'elles seraient suivies, ni aucune voie pour y contraindre. Les écritures communiquées au ministère public, ce dernier mettait ses conclusions à la suite, et, de même que dans les affaires contre les contumaces, la procédure était soumise à un Avis préalable.
AVIS.
L'introduction de juges aussi étrangers à la science du droit que les maires, les échevins et la plupart des prévôts, surtout dans les campagnes, avait entraîné un usage nouveau : c'était, de leur part, de ne prononcer de sentence définitive en matière grave qu'après avoir consulté quelque personne en réputation de savoir et d'expérience.
Ce fut d'abord à tout individu lettré, sans distinction de spécialité, puis aux gens de lois, magistrats et membres du barreau, que l'on s'adressa. Dans les Trois-Évêchés, on eut recours aux avocats des trois villes principales, Metz, Toul et Verdun. Dans le Barrois, ce fut à ceux de Saint-Mihiel ou aux conseillers de la Chambre des comptes de Bar, rarement aux conseillers des hauts-jours : les uns et les autres s'en faisaient un revenu personnel. Dans le Bassigny, on s'adressait au barreau de La Mothe ou de Chaumont et principalement à La Marche. A Fénétrange, il fallait aller à Pont-à-Mousson, comme chef-lieu d'un fief impérial (33) ; à Colmet et Lahayville, on prenait avis de gens lettrés à Luxembourg, conformément au règlement fait à ce sujet par Philippe d'Espagne (34).
Dans un procès de fausse monnaie, qui était un crime de lèse-majesté, intéressant le prince, le prévôt de Bar prit l'avis de Huard de Beffroimont, châtelain de Châtillon ; de Mille de La Mothe, bailli du Bassigny ; du châtelain de
Conflans, du gouverneur de La Mothe et de Geoffroy de Brainville, procureur fiscal à Bar. S'il s'adressait ainsi à des officiers plutôt qu'à des jurisconsultes, c'est que probablement il regardait cette affaire comme intéressant plus l'État que la justice.
En Lorraine, c'est-à-dire dans les bailliages de Nancy, Vosges et Allemagne, les Échevins de Nancy avaient une confiance privilégiée. Cette demande d'avis, originairement facultative, y devint obligatoire; le prince y découvrit un double motif d'utilité, celui de rendre la manière de juger plus uniforme et celui de faire reconnaître sa souveraineté. Ce tribunal des échevins en délibérait en assemblée spéciale, mais sans communication au ministère public, et chacun des membres signait le résultat, comme s'il se fût agi d'un jugement. Toutefois, on n'était tenu de s'y conformer si on ne le jugeait convenable.
Il parut si avantageux pour le duc d'user de ce moyen pour faire reconnaître sa souveraineté, que tous ses agents avaient le mot d'ordre pour y contraindre ; il n'y avait pas jusqu'aux bourreaux de ses justices qui ne prétendissent y aider, refusant leur ministère quand on ne leur justifiait pas de l'avis. Ce fut l'objet de plaintes de la part des seigneurs hauts-justiciers aux États de 1607 (35).
Disons de suite que cet usage de prendre avis donna lieu à plusieurs abus. En Lorraine, ce fut aussitôt que
la mesure, de facultative qu'elle était, fut rendue obligatoire. Ailleurs, les consultés y mettaient l'empressement que commandera toujours l'espoir d'honoraires légitimes ;
à Nancy, au contraire, MM. les échevins sachant qu'il fallait en passer par eux, ne se donnaient aucune peine pour s'acquitter de cette tâche. Tantôt ils exigeaient un salaire excédant le tarif; au lieu de 2 fr., prix fixé pour chaque affaire, ils en demandèrent 4 ; puis, plus tard, autant par accusé. Tantôt ils gardaient les pièces pendant plusieurs semaines, et quelquefois, les ayant égarées, ils ne les renvoyaient pas du tout. Si elles leur étaient portées, comme cela se pratiquait le plus souvent, par un des juges seigneuriaux, les retards que celui-ci avait à subir rendaient les déplacements fort onéreux. Les seigneurs hauts-justiciers, sensiblement froissés par cette formalité, qui déjà ne pesait que trop à leur
amour-propre, firent entendre des plaintes réitérées lors de la tenue des États, tellement qu'en 1578 le duc leur accorda qu'après quatre jours écoulés sans que l'avis ait été donné, ils seraient autorisés à s'en passer. Aux États de 1614, il fallut leur enjoindre d'examiner eux-mêmes les procédures, sans s'en rapporter à un seul d'entre eux, et de rester à l'audience, sans en sortir et y rentrer à tout instant (36). Malheureusement, rien pour l'accusé ne venait en compensation de la négligence de ces magistrats.
Dans les autres parties de la province, l'abus venait de la cause opposée. N'étant obligé de s'adresser exclusivement ici ou là, le juge n'était pas forcé de s'en tenir au premier avis ; mais quand cet avis ne le satisfaisait pas, il était bien tenté d'en prendre un second ; très souvent même, il en prenait successivement plusieurs, ce qui ne manquait pas d'ajouter à ses incertitudes. Dans un procès, en 1364, contre le curé Nicolas Nivard, de La Mothe, accusé de faux, on prit avis à Bar, Saint-Mihiel, Langres et Chaumont. En 1574, on consulta cinq fois sur le procès d'une nommée Didière, servante de J. Simonin, maire de Ranzières.
Ces avis étaient, bien entendu, souvent fort opposés entre eux. En 1584, G. Collinet, d'Issoncourt, condamné pour meurtre de sa femme, fut pendu devant sa maison, après avoir eu le poing coupé. Il avait été jugé complice de son père, qui avait réussi à fuir ; mais celui-ci ayant reparu, il s'agissait de le punir comme auteur principal de ce forfait. La Chambre des comptes de Bar, qui avait donné le premier avis lors de la condamnation du fils, fut naturellement consultée ; son embarras dut être bien grand, car on la voit n'osant rien résoudre et conseiller de s'adresser à Saint-Mihiel. Les avocats de cette ville, Galloys et Gondrecourt, changèrent singulièrement l'état de la cause en opinant pour le renvoi de l'accusé, qui eut lieu effectivement ; mais le prétendu complice ne ressuscita pas.
En cet état où se trouvait la cause au moment de la demande d'avis, il ne s'agissait pas toujours de prononcer une sentence définitive, il y avait souvent une mesure préparatoire à ordonner, un supplément d'information à prescrire, et, en cas de dénégation surtout, il s'agissait de savoir si l'on aurait recours à une voie regardée comme salutaire, celle de la torture, investigation rigoureuse, aussi démesurée en la forme que redoutable dans ses résultats.
QUESTION ou TORTURE.
On appelait ainsi le placement de l'accusé dans un état de gêne calculé de manière à ce qu'il se hâtât d'avouer son crime pour s'affranchir de douleurs intolérables. On distinguait deux sortes de question : celle ordinaire, qui était la moins rigoureuse, et celle extraordinaire, qui était appliquée avec toute l'énergie dont les moyens usités étaient susceptibles. On la divisait encore en préparatoire, qui avait lieu, comme moyen d'instruction, avant le prononcé de la sentence, et en préalable, qui se donnait après la condamnation, avant la mort, pour avoir révélation des complices.
Lorsque la torture prit naissance, elle marcha selon l'inspiration du juge, qui se laissait entraîner à la douceur ou à la sévérité, suivant l'attitude de l'accusé. Mais bientôt cette barbare procédure se réglementa, et, sans que la loi en fît mention écrite, il y eut dans la pratique des usages qui maîtrisèrent ce dangereux moyen de chercher la vérité. On admit, au XVIIe siècle, que l'accusé ne pouvait être appliqué à la question avant toute information, ainsi qu'on le faisait à l'imitation de l'Allemagne ; qu'il fallait que les indices déjà recueillis fussent graves et que le crime entraînât la peine de mort ou celle de la mutilation. Mais ce n'était que l'opinion de la magistrature élevée, de l'Échevinage de Nancy, recevant l'impulsion du duc et de sa cour; la province n'y apportait pas cette modération. A Toul, la torture paraissait une formalité obligée en tout état de cause; du Pasquier nous apprend que, soit que l'accusé avouât ou n'avouât pas, il y était appliqué, afin d'avoir confirmation de ses aveux, et, en tous cas, déclaration de ses complices. Un grand nombre de localités admettaient cet expédient.
Quant au choix du mode de torture, chaque justice avait la sienne, plus ou moins dure selon le génie du tourmenteur. Il semblait logique d'être impitoyable, parce que qui veut la fin veut les moyens. Le chauffement des pieds arrosés d'huile, la pendaison dans la cheminée avec exposition prolongée à la fumée, la selle hérissée de pointes, la privation de sommeil pendant 60 heures étaient fréquemment employés. Mais l'impossibilité physique de les supporter, même pour l'homme le plus innocent, ne permettant aucune conclusion rationnelle contre le coupable, en nécessita l'abandon, pour s'en tenir à quelques autres suffisamment rigoureux. Dans les justices du duc, à partir de Charles III, on employa exclusivement les grésillons, l'échelle, les tortillons et l'estrapade. Dans les justices particulières, l'arbitraire en maintint quelques autres, comme la grue, le frontal, le chapelet, les oeufs, les brodequins, etc.
GRÉSILLONS.
Cet instrument, composé de trois lames de fer se rapprochant à l'aide d'une vis qui les serrait à volonté, servait à presser violemment le bout des doigts du patient, qui étaient introduits entre les lames jusqu'à la racine des ongles. Il suffit d'avoir eu le doigt pincé une fois en sa vie, sous une pierre un peu lourde ou entre deux corps durs, pour se faire une idée de la douleur qui, devait en résulter. Pour la rendre plus intolérable et empêcher en quelque sorte l'accusé de se soulager par le mouvement des autres membres, comme on en a généralement l'habitude, si cette première épreuve n'amenait pas les résultats attendus, on lui plaçait en même temps les doigts des pieds, surtout les orteils, dans un pareil étau, et alors il ne lui restait plus de ressource que celle de se tordre et de crier (37).
ECHELLE.
Une échelle construite dans la forme des autres, mais plus forte et à bâtons anguleux, portant à son extrémité un tourniquet en bois comme les baquets de brasseurs, était placée d'un bout sur un tréteau d'environ un mètre
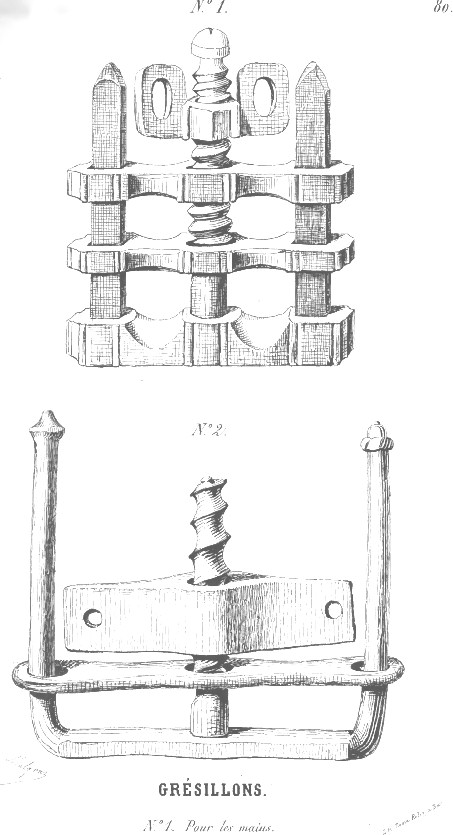
d'élévation, l'autre bout posant à terre. On couchait dessus l'accusé, que l'on y attachait en bas par les pieds, à l'aide d'une corde immobile, en haut par les mains, à l'aide de la corde placée autour du tourniquet. Il y était étendu sans autre vêtement que sa chemise.
Au moyen du tourniquet, on donnait à son corps et à ses membres une extension qui était graduée suivant son crime, ses forces et ses déclarations, en ajoutant à l'effet de la machine par un bois taillé en triangle aigu qu'on lui glissait sous les reins au moment de la plus grande extension. Pour que celle-ci fût satisfaisante, l'accusé devait, avant le placement du bois, se trouver comme suspendu sans que son corps touchât à l'échelle.
En cet état, il subissait différentes épreuves plus saisissantes les unes que les autres. On lui jetait avec violence de l'eau très-froide à la figure ; on lui en laissait tomber goutte à goutte et de fort haut une certaine quantité sur le creux de l'estomac ou entre les deux épaules ; on lâchait subitement le tourniquet, que l'on resserrait aussitôt et plus fort ; enfin, on lui imprimait toutes les secousses les mieux calculées pour qu'elles fussent à peu près intolérables.
S'il devait subir la question de l'eau, un des tourmenteurs, placé au-dessus de lui, par derrière, lui tenait la tête en lui bouchant le nez, pendant que l'autre lui versait de l'eau dans la bouche à l'aide d'une corne servant d'entonnoir ; force lui était de l'avaler ou d'être étouffé. La dose était de 4 pots faisant chacun 2 pintes 1/2, mesure de Paris, pour la question ordinaire, et de 8 pots pour celle extraordinaire ; chaque pot équivalait à 2 litres
1/2. Le résultat, outre la gêne et le dégoût de cette boisson poussée jusqu'à l'impossible, était un ballonnement extraordinaire du corps et le malaise le plus étouffant, bien plus cruel encore quand on substituait à l'eau du vinaigre ou de l'huile.
Bien entendu que dans tout le cours de ces opérations, et entre chacune de leurs phases, le juge interrogeait l'accusé, l'excitait à lui confesser sa culpabilité, sans parler de ceux qui abusaient de ces rigueurs, voulant obtenir à tout prix un aveu. Et ces abus n'arrivaient que trop souvent, peu de justiciers étant disposés à accueillir les rétractations. Dans une plainte des sujets de la seigneurie de Puttelange (38), on voit les officiers du seigneur accusés
« de s'être, au nombre de quatre, emparés de la justice, de faire le procès criminel à tous ceux qui leur déplaisent, d'avoir un greffier et des témoins dévoués, d'appliquer les accusés à la torture, et, s'ils se rétractent, de les menacer de mort en leur disant : Comment, mort Dieu! c'est ainsi que tu l'avais déclaré ! reprends tes premiers propos et persiste, sinon, par la mort, on te remettra à la question, en telle sorte que le sang te sortira de tous côtés. » On verra le bourreau se mêler aussi de faire des menaces et d'effrayer l'accusé, qui, préalablement, avait été contraint de prêter sur l'Évangile serment de dire la vérité.
TORTILLONS.
On donnait ce nom à de petits bâtons d'environ 6 centimètres de grosseur dont on faisait l'usage suivant. L'accusé étant placé sur l'échelle, comme il vient d'être dit, mais sans être tiré, on lui attachait les bras, les cuisses et les jambes de toute leur longueur après les montants de l'échelle, à laide de cordes. Passant ensuite les tortillons entre le membre et la corde, on les tournait autant qu'il était possible, en sorte que la chair, comprimée par les tours de plus en plus serrés de la corde, ressortait de toutes parts en bourrelets meurtrissants (39).
ESTRAPADE.
A la voûte du cabinet de torture était attachée une poulie dans laquelle passait une chaîne ou une corde, comme on en emploie pour tirer l'eau d'un puits ou enlever des objets pesants. L'accusé, toujours sans autre vêtement que sa chemise, avait les mains liées derrière le dos et attachées au crochet fixé au bout de la corde.
Au signal donné, il était enlevé, et restait ainsi plus ou moins long-temps suspendu. Si sa résistance était opiniâtre, après avoir attaché ses jambes ensemble, on y accrochait deux poids de 30 à 40 kilogrammes chacun, ce qui le tirait plus bas et lui faisait remonter les bras en arrière, situation fort douloureuse donnant lieu à des luxations
dont la possibilité n'arrêtait pas la justice, qui, n'appliquant ces rigueurs qu'à des malheureux destinés à périr, se croyait en droit de disposer à l'avance de leur corps. Souvent, pour aggraver, on mettait entre les deux mains du patient, tournées dos contre dos, une grosse clé dont la pression ajoutait singulièrement aux souffrances.
Dans la justice du comté de Vaudémont, à Vézelise, où l'estrapade semblait avoir la préférence exclusive, elle n'était jamais appliquée sans que le chirurgien eût à remettre les membres de l'accusé. Pendant les procédures en sortilège, beaucoup de femmes ainsi disloquées moururent de douleur en prison avant l'instant du dernier supplice.
Tels étaient les moyens usités en Lorraine dans la partie qui prenait avis aux échevins de Nancy ; mais dans les autres justices de la province, l'humanité n'avait pas partout fait les mêmes progrès. A Remiremont, la branlure et les oeufs étaient encore en honneur; dans beaucoup de localités, c'étaient les brodequins; dans d'autres, le frontal et les jarretières.
BRANLURE.
Cette torture se donnait à l'aide du même procédé que l'estrapade qui précède, en y ajoutant néanmoins, ce qui en faisait toute la gravité, que quand l'accusé était élevé le plus haut possible, on le laissait retomber précipitamment, ce qui lui imprimait une secousse qui le brisait.
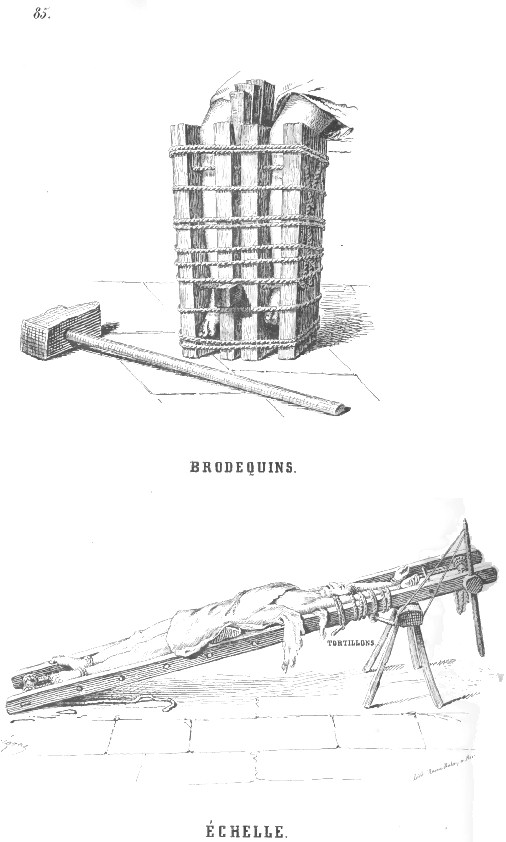
OEUFS.
On faisait cuire des oeufs dans les cendres, et quand ils étaient arrives au degré de chaleur nécessaire pour être cuits bien durs, on les plaçait à l'accusé sous les bras, aux aisselles, ou entre les cuisses, en ayant soin de serrer ces membres l'un contre l'autre, de manière à y concentrer une chaleur dévorante.
BRODEQUINS.
On appelait de ce nom quatre planches de chêne d'environ 60 centimètres de haut, percées de trous (40). L'accusé, mis nu-jambes, était assis devant. On lui plaçait chaque jambe jusqu'au genou entre deux de ces planches, et les quatre étaient paquetées à l'aide de cordes aussi serrées que possible. Sept coins de bois étaient successivement enfoncés par le haut à coups de masse entre les deux planches du milieu, de manière à comprimer les jambes de plus en plus, et enfin un huitième était chassé à la hauteur des chevilles. Une vis n'eût pas opéré avec autant de rigueur. Un auteur, qui décrit ce supplice, dit froidement :
« Les coins serrent les planches de chaque jambe de façon à faire craquer les os. »
Il était difficile, en effet, de n'en pas rester estropié.
Quant à la douleur, il suffisait de poser la main sur le genou comprimé du patient, pour la rendre horrible.
FRONTAL.
On passait une chaîne autour du front, et à l'aide d'un bout de fer servant de tortillon, la tête était serrée tout juste assez pour ne pas être broyée.
JARRETIERES.
C'était, pour les jambes, le même procédé qu'avec le frontal.
Dans la question ordinaire, on appliquait une et souvent plusieurs des tortures qui précèdent, toujours les moins dures et avec quelque modération, cette question étant réservée aux crimes de moindre importance, aux femmes et aux accusés âgés ou d'une faible complexion. Les tortures les plus rigoureuses et infligées dans toute leur dureté étaient pour les crimes énormes et les accusés robustes, montrant une résistance opiniâtre en présence des graves présomptions qui militaient contre eux. Une hernie ou toute autre infirmité qui rendait l'extension dangereuse n'était pas un obstacle, même à la question extraordinaire ; on choisissait parmi les modes qui, étant tout aussi rudes, ne faisaient pas subir au corps de violentes secousses.
La question n'était pas terminée aussitôt que l'accusé déclarait consentir à faire des aveux ; on n'avait garde de se fier à ses promesses, d'autant mieux qu'une fois lâché, la règle était qu'il ne pouvait plus y être replacé.
Il fallait donc qu'il fût déjà entré en confession formelle ; alors seulement on le mettait à délivre et l'on passait aux détails et aux circonstances de la perpétration du crime dont on avait d'abord obtenu l'aveu sur le principal. Soit que l'accusé avouât ou déniât, dès qu'il était mis à délivre, on le plaçait sur un matelas près d'un bon feu, pour reprendre ses sens et se remettre de ses émotions. Malheur à lui s'il n'inspirait pas quelque intérêt aux suppôts subalternes de la justice, alors il était reconduit, plus tôt que ses souffrances ne l'exigeaient, dans l'humidité de son ténébreux cachot, sans autre soulagement ni consolation que l'espoir d'une mort prochaine (41).
Dans certaines affaires où les présomptions n'étaient pas assez fortes pour que le juge osât ordonner la question, il en faisait le simulacre. La sentence prononçait cette peine anticipée, et à la fin se trouvait une phrase que l'on appelait le retentum, portant que l'accusé ne serait que présenté, mais que la question ne lui serait pas donnée. Cette présentation avait lieu avec le même cérémonial, que souvent on exagérait encore pour mieux effrayer le patient, trop heureux s'il devinait que c'était une feinte. Ce que rapporte Claude Bourgeois donne une triste idée de la perspicacité des juges qui la prononçaient. Quelques-uns, dit-il, lisaient le retentum sans en faire la différence d'avec
le reste de la sentence, de sorte que l'accusé, prévenu par cette indiscrétion stupide, se laissait faire sans sourciller.
Une torture par simulacre, et d'un genre particulier, fut appliquée à Metz, en 1450. Un jeune tonnelier de cette ville, accusé d'assassinat, ayant résisté à la question ordinaire et extraordinaire sans faire d'aveux, fut conduit avec l'appareil lugubre au lieu du supplice, où tout était préparé pour l'exécution d'un autre condamné. Quoiqu'il eût, comme toute l'assistance, la ferme persuasion que sa dernière heure était sonnée et que ce ne fût point un semblant, sa contenance y fut si convenable qu'il fut renvoyé absous.
En général, l'accusé était pris à jeun, ordinairement dix heures après son dernier repas, afin d'éviter quelque accident. Sous ce prétexte, des juges inhumains en firent jeûner outre mesure, jusqu'à vingt-quatre heures, afin d'ajouter, par leur état de faiblesse, aux chances qu'ils avaient de les faire succomber.
La persistance de l'accusé à nier son crime semblerait avoir toujours dû le sauver de condamnation, mais des principes exagérés surgirent pour lui enlever ce refuge.
Le premier était de le réappliquer une seconde fois, puis une troisième ; on en a vu aller jusqu'à sept fois. Dans ce cas, ces implacables justiciers expliquaient que continuer n'était pas réitérer : encore avaient-ils la prétention de faire considérer comme une faveur les temps de repos, qui, en réalité, n'étaient que pour eux. Quelle chance alors que la nature ne fût pas domptée ?
Le second subterfuge fut d'imaginer une clause de sans préjudice des preuves déjà acquises ; à son aide, l'investigation sur le chef principal ne produisant aucun aveu, l'accusé restait, pour toute autre peine que la mort, à la merci du juge, qui trouvait facilement dans le reste de la procédure de quoi le châtier assez sévèrement. La question, sans préjudice des preuves, était considérée comme une peine tellement dure, qu'elle était rangée après la peine de mort. En effet, il lui manquait peu de chose pour que, comme la question préalable, elle en fût le prélude. Cette manière de juger existait bien avant que la coutume écrite la sanctionnât ; elle était venue facilement à l'esprit de gens qui n'avaient le plus souvent à juger que des vagabonds dont l'aspect misérable permettait de tout supposer. C'est ainsi qu'en 1354, un nommé Jean Vallès, se disant de Sermaize, ayant été torturé à Gondrecourt, sans qu'on ait pu lui tirer aucun aveu, le conseil des jurés et des bonnes gens du lieu ne se décida à le lâcher qu'après l'avoir condamné à perdre une oreille.
Il y avait donc peu ou point de chances de résister; quelques hommes et même des femmes subirent ces tortures sans faire d'aveu, mais en petit nombre et dans des cas exceptionnels. Les voleurs de profession essayèrent mille moyens d'en paralyser l'action, en mâchant du savon, en prenant des infusions très-fortes, mais sans succès ; leur meilleur préservatif fut de se torturer entre eux pour s'y habituer. D'ailleurs le questionneur ou tourmenteur n'était pas un novice capable de s'y laisser prendre, il en faisait métier. Quelquefois il était en même temps bourreau, mais seulement dans les petites localités, où une seule de ces fonctions n'eût pas suffi pour le faire vivre. Plus souvent il était geôlier ; ce cumul allait assez avec la dureté dont il fallait être affligé pour laisser pourrir en terre des êtres vivants. En 1563, Alexandre, tourier de la Tour-Jurée de Bar, était en même temps questionneur juré de la prévôté.
Inutile de dire que les accusés redoutaient la question à l'égal du dernier supplice; leurs premiers efforts tendaient à l'éviter. Souvent ils lui préféraient la mort par le suicide. Comme il fallait, pour les tirer de prison, les hisser du fond de fosse en les faisant monter à l'échelle, ils réussissaient quelquefois à se précipiter du haut en bas; mais cette ressource désespérée, si elle ne leur brisait pas quelque membre, devenait toujours contre eux un argument qui avait la même force qu'un aveu.
On tomberait dans des déclamations oiseuses et rebattues, si l'on voulait entreprendre de démontrer le danger, la barbarie et l'injustice de la torture. Si elle fut utile pour découvrir quelques coupables, qui, sans elle, fussent demeurés impunis, elle précipita une foule d'innocents dans des aveux mensongers, qui sont la honte de la justice de nos pères.
DÉLIBÉRÉ.
Le procès-verbal de la question, contenant avec détails les souffrances et les cris de l'accusé, écrit par le greffier sous la dictée du juge assisté de deux témoins étrangers aux fonctions judiciaires, était communiqué au ministère public pour donner ses conclusions. De nouveau l'avis était demandé comme nous l'avons expliqué, et alors la sentence était prononcée sans plus entendre l'accusé ni remplir autre formalité. Aucune intervention de tiers, avocat ou ami, pour prendre sa défense, n'était admise ; la loi et les usages excluaient absolument cette ressource, dans la confiance que la vérité n'en avait nul besoin. Si l'on trouve, dans les comptes du domaine public du XVIe siècle, la dépense annuelle de 50 fr. en faveur de Girard de Saint-Thiébaut, dit Loupin, docteur en droit, avocat et conseiller des pauvres on duchié de Lorraine, pour relever es dépens les opprimés et soutenir les personnes misérables en justice, on peut être certain que ce n'était que pour leurs affaires de pur intérêt civil.
La sentence était mise à exécution dès le jour de sa prononciation. Si l'accusé était absous, elle ne le déclarait pas innocent, mais simplement renvoyé jusqu'à rappel, le juge n'ayant pas le droit d'absoudre.
On trouve souvent, dans le dispositif des sentences de cette époque, l'expression véhémentement soupçonné, qui semble placer le soupçon grave au nombre des bases des condamnations. On se tromperait si on le pensait ainsi : ce n'était qu'un moyen de considération à ajouter aux faits prouvés, pour les corroborer au point de vue de la culpabilité. Les vagabonds meurtriers avaient ordinairement, à la suite du principal crime, un luxe de soupçons véhéments d'autres crimes à leur charge, non moins graves que celui pour lequel ils subissaient la mort, qui était tout ce que l'on pouvait exiger d'eux.
Dans ce qui précède, il est facile de remarquer que l'écriture employée pour l'instruction des procès criminels était le principal changement apporté par le temps; de là découlaient toutes les améliorations, par suite de l'examen plus attentif qu'elle entraînait. Mais les justices, surtout celles particulières non soumises au duc, tout en écrivant la procédure, n'en avaient pas moins conservé leurs allures promptes, toujours prônées comme les plus salutaires. Dans un nombre infini de localités, comme à Mirecourt, Sainte-Croix, le Val-de-Lièvre, Sainte-Marie-aux-Mines, l'affaire était terminée en trois jours : le premier pour amener, le deuxième pour interroger, le troisième pour étrangler.
La dépense présentée à la chambre des comptes pour justicier Huguenin Fournot, de Conflans en Bassigny, peut en donner une idée. Le jeudi, examen de l'accusé par le procureur du duc, le maire Jean Mirebel, ses trois échevins, le doyen, le lieutenant du prévôt et le clerc juré, qui y demeurèrent depuis midi jusqu'à la nuit, puis allèrent souper, où ils dépensèrent 7 sous; ledit souper à la charge du duc.
Le mardi suivant, recommencé et dépensé 16 sous.
Mise au net du procès pour le faire consulter, 6 sous.
Pour le porter à Bar, 3 livres 12 sous; au retour, lecture à la justice et vote, 10 sous.
Exécution, etc.
A Raon, le procès se vidait en sept journées, savoir : deux pour informer, une pour ouïr, une pour confronter, une pour donner la question, une pour persévérer, une pour exécuter.
Là où les formes prenaient plus de lenteur et de gravité, c'était donc seulement dans les justices de la Lorraine appartenant au duc, surveillées par ses officiers, baillis et prévôts, dont le nombre s'était augmenté. Voici quels en étaient alors la division, le nombre et le siège, le tout suivant l'ancienne organisation d'un bailli au chef-lieu, qui fit donner à sa juridiction le nom de Bailliage, et d'un prévôt par chaque prévôté du ressort.
1. Bailliage de Nancy. Prévôtés à Nancy, Gondreville, Amance, Château-Salins, Rosières, Einville, Lunéville, Saint-Dié.
2. Bailliage de Vosges. Prévôtés. Mirecourt, Remoncourt, Dompaire, Valfroicourt, Darney, Bruyères, Arches, Charmes, Châtenois.
3. Bailliage de Saint-Mihiel. Prévôtés. Saint-Mihiel, Briey, Longwy, Bouconville, Mandres, Foug, Conflans, Longuyon, Élain, Norroy-le-Sec, Sancy, Stenay, Pont-à-Mousson, La
Chaussée, Marville, Koeurs.
4. Bailliage de Bar. Prévôtés. Bar, Loupy, Souilly, Morley, Pierrefitte.
5. Bailliage d'Épinal. Prévôté. Épinal.
6. Id. d'Allemagne. Pas de prévôtés.
7. Id. du COMTÉ de Vaudémont. Prévôté. Vaudémont.
8. Bailliage de Chatel. Prévôté. Châtel.
9. Id. DE Hattonchatel. Prévôté. Hattonchatel.
10. Id. de Apremont. Prévôté. Apremont.
11. Id. DU Bassigny. Prévôtés. Gondrecourt, La Marche, Conflans, Châtillon-sur-Saône.
12. Bailliage de Clermont. Prévôtés. Varennes, Les Montignons.
En outre, prévôtés à Blâmont et à Deneuvre.
Au total, 12 baillis, 50 prévôts. Chacun des baillis avait un lieutenant pour le substituer en son absence; ceux des cinq premiers étaient appelés lieutenants généraux.
APPEL.
L'infaillibilité du juge était en Lorraine une chose consacrée ; il ne paraissait pas possible qu'une seconde décision changeât l'équité de la première ; l'appel semblait une insulte à la justice autant qu'un danger pour la société.
En cela, elle avait conservé l'usage de l'Empire, ainsi qu'il fut souvent répété aux assemblées des États, à cause que le prince est prince d'empire et que partie de ses états en vient. Un seul recours était permis ; c'était dans le cas de défaute de droit, c'est-à-dire de déni de justice, ou de faux et malvès jugement, c'est-à-dire de récusation.
Le duc, ou à sa place le seigneur haut-justicier seul, était saisi du cas, qu'il examinait dans son conseil : c'est ce qui était connu sous le nom de buffet du prince ou du seigneur. Mais, hors de là, point d'autre recours : il n'y avait pas légalement de mal jugé.
La charte de la ville de Commercy avait aussi consacré cet usage.
« Tout ce qui sera fait par-devant justice et en jugement sera ferme et stable.... et ne pourra nul dire en contre, si ce n'est pour deffaut de droit et de malvaise sentence ou de gries, dont qu'il pourra appeleir par devant nous. »
L'appel au buffet du prince était mal vu par les seigneur hauts-justiciers, qui le regardaient comme un anéantissement de leur privilège. Aux Etats de 1607, ils demandèrent que le duc ne le reçût que quand il avait des raisons de suspecter le premier juge, mais non sa décision, toujours considérée pour être l'expression de la justice et de la vérité. C'était, en effet, l'invocation des principes qui avaient fait introduire ce recours pour faux et malvès jugement, contre un juge prévaricateur plutôt que contre un juge tombé dans l'erreur. Quelques écrivains, admirateurs trop exclusifs du temps passé, ont vanté la juridiction du buffet du prince au-delà de ce qu'elle méritait; il est certain qu'il fallut toujours faire une grande dépense de crédit ou d'argent pour y réussir.
Dans les Trois-Évèchés, où les usages de l'Empire s'étaient aussi en grande partie maintenus, le recours en appel n'était ni entier ni uniforme.
A Toul, il n'existait pas du tout ; les sentences des dix justiciers, présidés par le maître échevin, étaient souveraines.
A Metz, le condamné ne pouvait en appeler au maître échevin, ni par lui ni par ses amis, et celui-ci devait éviter de se trouver sur son passage ; mais si, conduit au supplice par les treize qui l'avaient condamné, le hasard faisait qu'il le rencontrât, il pouvait lui demander verbalement la révision de son procès. On comprend qu'il était facile d'éviter cet incident et que l'on n y avait recours que d'accord et dans des cas exceptionnels.
A Verdun, où l'évêché avait habilement conservé les droits régaliens, l'appel était entier; des sentences des prévôts du ressort, on appelait au bailli, et de celui-ci au tribunal du prélat en la salle épiscopale.
Dans le Barrois et le Bassigny mouvants, d'autres idées, venues de France, dont ces provinces subissaient l'influence, faisaient considérer l'appel comme un droit précieux, comme une sauvegarde tutélaire. C'est devant le bailli, puis devant le parlement de Paris, que les condamnés allaient chercher la réforme de leur condamnation, de telle sorte qu'ils avaient ainsi à loisir trois degrés de juridiction.
Par le traité, dit concordat, intervenu entre le roi Charles IX et le duc Charles III, le 23 janvier 1571, à l'effet d'aplanir les difficultés élevées à l'occasion des droits régaliens, il fut convenu que les appellations des sentences du bailli de Bar et du bailli du Bassigny mouvant ressortiraient immédiatement au parlement de Paris. Cette convention semblerait permettre le doute qu'il en fût de même auparavant : en effet, à quoi bon le stipuler, si c'était pratiqué ? On ne peut l'expliquer qu'en admettant que ce droit, quelque peu contesté, avait besoin, aux yeux du roi, d'être reconnu par écrit, car nous avons trouvé la preuve que les choses se passaient de la même manière avant ce traité. En 1551, une dépense est faite en la prévôté de Bar pour conduire à Paris deux prisonniers appelants d'une condamnation à mort. En 1562, Demenge Rebelle est pendu à Gondrecourt, après dix-neuf jours employés à le conduire à Paris pour la révision de son procès. En 1566, quatre voleurs sont condamnés à mort à La Marche : un seul ayant appelé, est conduit à Paris. En 1569, Nicolas, de Bémont, et Mongeart, de La Marche, sont menés à Paris comme appelants d'une sentence qui les condamne à la torture.
Un procès majeur, qui eut lieu en 1567, celui relatif à l'assassinat du lieutenant-général de Bar, Thiery de La Mothe, vient encore à l'appui de cette manière de procéder antérieurement au concordat. Non-seulement les condamnés appelants furent conduits à Paris, mais le procureur général Marlorat et M. Aurillot, conseiller du duc, s'y rendirent et y demeurèrent pendant tout le temps du procès, afin d'en assurer le succès.
Un fait isolé donnerait à penser que, dans les affaires non capitales, le recours ordinaire au bailli n'était pas autorisé. En 1586, le maire de Rosières-en-Blois ayant condamné un homme à être fustigé, voulait l'exécuter, nonobstant que ce dernier eût interjeté appel au bailli du Bassigny, soutenant qu'il devait appeler au parlement. La difficulté soumise au prévôt de Gondrecourt, celui-ci, pour toute réponse, envoya douze hommes pour prêter
main-forte à l'exécution. Mais, nous le répétons, ce fait est isolé; il a d'autant moins d'importance que l'on n'a pas les motifs de la décision du prévôt, qui ne voyait peut-être dans cette affaire qu'un cas prévôtal et lui en appliquait les règles usitées dans le ressort du parlement.
Pour conduire les accusés à Paris, on faisait marché avec des messagers qui s'en chargeaient moyennant un prix débattu à l'avance, lequel variait suivant l'importance du condamné, suivant les soins et les égards qu'il nécessitait. Ce messager était en même temps porteur, en un paquet clos et cacheté, des pièces de la procédure.
Dans un temps où les routes n'étaient ni faciles ni sûres, il y avait bien du danger à livrer ainsi à un seul homme un criminel avec les preuves de son crime, d'autant plus que l'on ne voit pas qu'ils eussent d'escorte quelque peu imposante, et que la plupart n'avaient dans leur appel d'autre moyen valable que la fuite. A la vérité, ils étaient ferrés et garrottés : le conducteur pouvait se faire accompagner de quelques hommes pour l'aider; mais ces ressources étaient fort insuffisantes contre des amis nombreux et zélés ou contre la corruption.
La providence du malfaiteur ainsi transféré était surtout dans les bandes de voleurs et d'aventuriers, qui alors fourmillaient; pour peu qu'il parlât leur argot, il avait lestement, de leur part, un puissant coup de main. Un nommé Guyot, de Gondrecourt, entre autres, leur dut ainsi une liberté sur laquelle il ne pouvait plus guère compter. On s'apprêtait à le pendre, quand le bourreau de Bar se trouvant malade, il fallut surseoir pour aller chercher celui de Nancy. Déjà ce dernier était arrivé, prêt à fonctionner, mais le retard avait amené la réflexion : le condamné, n'ayant plus sa résignation première, avait déclaré qu'il appelait. On le conduisit donc à Paris ; dans le trajet, arrivé entre Troyes et le Pavillon, une caravane de Bohémiens français, qu'il eut en rencontre, se fit une fête de le délivrer.
Le retour des condamnés déboutés de leur appel et renvoyés pour être exécutés dans leur ressort avait lieu par la même voie, qui offrait encore de plus grands dangers que le départ, car alors ils avaient perdu tout espoir ; ce retour était compris dans le traité fait avec le messager. Le prix d'une conduite ordinaire était de 70 à 100 fr.; celles plus difficiles allaient jusqu'à 2 et 300. En 1648, le transfert d'un nommé Jean Laultry fut adjugé à Michel Porriquet, sergent à Bar, pour 500 fr., à charge de le ramener : c'était un prix élevé.
Dans tous les cas d'appels de sentences interlocutoires, comme celles ordonnant la question préparatoire, on ne conduisait pas toujours les accusés à Paris ; on ne le faisait que pour les accusés importants ou sur lesquels il y avait espoir de récupérer les frais, mais les vagabonds et autres croquants insolvables en attendaient le résultat en prison ; pour eux, on se contentait d'envoyer les pièces.
Cet envoi était encore d'une exécution difficile et peu sûre; il arriva plus d'une fois qu'elles se trouvèrent égarées. En 1631, un nommé Sulpice Balthazard, condamné à Bar pour simple larcin et non incarcéré pour ce fait, fut obligé de revenir de Paris, où il s'était librement rendu, parce que son dossier ne put être retrouvé.
Dans le Barrois et le Bassigny non mouvants, la même latitude d'appel que dans la mouvance était accordée, mais devant des juges différents. C'était devant les baillis de Saint-Mihiel et de Bourmont que l'on appelait des sentences des prévôts et du sénéchal; de cette sentence du bailli, on pouvait encore recourir à la Cour des grands jours de Saint-Mihiel, tribunal composé de personnages éminents qui recevaient à cet effet commission temporaire du duc, et que ce dernier présidait quelquefois lui-même. Ce n'était pas, comme aux assises, exclusivement des gentilshommes plus ou moins versés aux affaires, mais en général des magistrats choisis dans les autres villes du pays (42).
Après les difficultés entre la France et la Lorraine, à l'occasion de la régale sur le Barrois et le Bassigny
mouvants, qui donnèrent lieu au concordat sus rappelé, il ne serait pas étonnant que, pour prévenir plus sûrement toute contestation semblable touchant le Barrois et le Bassigny non mouvants, le duc Charles eût cru prudent de constituer les grands jours en cour souveraine permanente, et que ce fût là, comme on le pense, le motif qui détermina son ordonnance du 8 octobre 1571, qui le dispose ainsi. Les sujets des deux Barrois se trouvèrent alors avec des institutions judiciaires uniformes ; seulement, pour les premiers, il y avait un peu plus de difficulté pour se rendre à Paris que pour aller à Saint-Mihiel ; mais ce n'était pas au prince à amoindrir cet obstacle, qu'il eût, sans aucun doute, voulu voir encore plus grand.
Cette disposition de l'ordonnance évoquant les sentences des baillis à la Cour des grands jours, devenue parlement, et les dispositions analogues consignées en la coutume révisée à la même époque, étaient-elles des innovations ? A cet égard, nous sommes encore, de même que pour le Barrois et le Bassigny mouvants, fondés à nous prononcer pour la négative, c'est-à-dire que le recours en appel y était établi avant 1571. Nous avons trouvé, en 1557, Pierre Baillet, dit Oulry, de Venderesse, condamné par la prévôté de Briey, qui, arrivé au premier échelon de la potence, est reconduit en prison pour s'être rendu appelant à Saint-Mihiel. En 1542, des prisonniers de Foug, appelant de leurs sentences, sont de même conduits devant monseigneur le bailli, avec les archers
et arbalétriers du lieu. En 1565, maître Bastien, chirurgien, est conduit à Saint-Mihiel, en appel d'une sentence du prévôt de Conflans, qui le condamne à la question.
Un cas particulier se présenta en 1542 : Claude Fraustois, condamné à mort à Pont-à-Mousson, s'étant rendu appelant, on alla à Bar aussitôt, pour demander à MM. de la chambre des comptes ce qu'il fallait décider. Au lieu de le faire conduire à Saint-Mihiel, devant le bailli, la chambre envoya à Pont-à-Mousson le lieutenant de ce magistrat, qui y resta huit jours avec le substitut, pendant lesquels l'exécuteur, venu de Nancy, attendit leur décision, qui fut défavorable à l'appelant.
Voilà pour les appels devant le bailli.
Voici pour les grands jours. En 1555, Jeannot Roland est condamné à mort aux hauts jours de Saint-Mihiel. En 1565, Jehan Chaulsier, larron, condamné au gibet par le prévôt de Saint-Mihiel, jugé en appel par le bailli, est sentencié de même par les juges des grands jours.
En 1574, la servante du maire de Ranzières s'étant déclarée appelante au moment où l'on se disposait à la fustiger, son procès est porté es cour des baillis et grands jours de Saint-Mihiel. En 1568, madame de Bulgnéville, condamnée à la torture à La Mothe, dans le procès intenté contre elle et ses gens, à l'occasion du meurtre de mademoiselle du Châtelet, dudit lieu, appelle à St.-Mihiel ; Claude Muguyet, l'un de ses domestiques, condamné à mort, en fait autant.
Ces exemples ne peuvent pas laisser le moindre doute sur le droit d'appel dans les deux Barrois et les Bassigny, avant et après l'ordonnance de 1371. La Lorraine restait donc seule en arrière, malgré les grands avantages d'un recours, que les populations regarderont toujours comme une garantie consolante. Toul et Metz ne faisaient exception que parce que la justice y était confiée, non à des officiers du seigneur, mais à des justiciers pairs des accusés et dès lors plus à l'abri de suspicion. Quant à la Lorraine, c'est que le duc n'était pas le maître d'y pourvoir; les hauts-justiciers étaient là pour mettre des entraves difficiles à lever. On les a vus se récrier contre la nécessité de demander avis, la seule compensation cependant qui pût consoler du défaut d'appel ; plus tard, on les voit manifester leurs sentiments sur l'appel lui-même, en raison des frais qu'il entraînait à leur charge.
C'est avec ces institutions et cette jurisprudence que la province marcha, pendant les XVIe et XVIIe siècles, à travers des guerres et des malheurs publics qui durent singulièrement augmenter les crimes, sans rendre la justice meilleure, mais qui ne l'empêchèrent pas d'user d'une grande sévérité, notamment en ce qui concerne le crime de sorcellerie, dont nous parlerons à sa place. Le peuple, éminemment malheureux, semblait vouloir se venger de ses calamités en frappant outre mesure les accusés qui tombaient sous sa main. La ressource de l'appel était une heureuse barrière contre cette tendance; mais là où ce recours n'existait pas, il n'y avait que l'obligation de demander avis, et ce n'était pas, nous le répétons, un obstacle suffisant; à tel point que le duc, en 1629, fut forcé de défendre aux justices qui se rendaient par le peuple assemblé, de prononcer une peine plus grande que celle portée en l'avis des échevins, sa rigueur n'étant le plus souvent, dit-il, que l'effet de son inclination naturelle à juger le contraire des échevins. C'était bien là la condamnation de la procédure sans appel.
La noblesse prenait peu de souci de ces intérêts de la masse qui n'étaient pas les siens. Nous l'avons déjà dit, elle avait, dans le Barrois, le bailli pour juge ; noble lui-même, il lui présentait des garanties rassurantes. Dans la Lorraine, elle demandait souvent à la réunion des États des avantages analogues sans y être parvenue, lorsqu'en 1596 le duc Charles III lui accorda que ceux de l'ancienne chevalerie et les pairs de ceux-ci, c'est-à-dire ceux ayant qualité pour siéger aux assises, ne seraient soumis, en matière criminelle, à autre juridiction qu'à celle des Échevins de Nancy, en y ajoutant un nombre égal de gentilshommes de la même qualité, à moins que ce ne fût pour affaires touchant le point d'honneur, auquel cas le nombre pouvait en être beaucoup plus grand et l'affaire évoquée devant le prince. En matière de crime, la prononciation du jugement appartenait toutefois exclusivement aux échevins, pour lesquels l'assistance des gentilshommes n'était qu'une affaire de forme et de sécurité, mais, il faut le dire, aussi d'influence.
Aux États de 1607, un recours exorbitant d'appel fut ajouté à ce privilège de l'ancienne chevalerie. Le duc lui accorda un droit de récusation dont il se réserva d'être le juge ; en outre, il fut concédé que les gentilshommes commissaires assistants au procès auraient communication des conclusions du procureur général et de la sentence des échevins avant sa prononciation, afin qu'en cas de rigueur excessive à leurs yeux, ils pussent en appeler directement au prince et solliciter de lui l'ordre d'une autre résolution ou la grâce du coupable. C'était mettre le duc au-dessus de la loi et de la justice; mais comme c'était en faveur des accusés, il ne se trouvait aucune voix pour s'en plaindre hautement.
Par ces diverses attributions, le tribunal des échevins prit une plus grande importance, qui fut encore augmentée par les changements successifs et assez rapprochés que le même duc Charles IV lui fit subir, ce dont nous pouvons parler de suite. En 1606, il en fixa le nombre à six; en 1608, il prescrivit qu'ils seraient au moins cinq pour juger en matière criminelle. En 1635, deux membres de plus furent ajoutés, et, au retour du prince dans ses états, leur nom d'échevins fit place à celui de conseillers assesseurs, afin d'accroître le luxe de leurs charges et de les rendre toujours plus considérables.
Les magistrats du parlement de Saint-Mihiel, nobles et roturiers, voulurent aussi se soustraire aux juridictions inférieures ; ils réclamèrent le privilège de se juger eux-mêmes en matière de crimes, délits et excès, ce qui leur fut accordé aux États de 1572 et confirmé spécialement par ordonnance du 27 mai, le duc se réservant d'en connaître si, par suite de récusations, la cour n'était plus en nombre suffisant (43).
Les prévôts, comme eux et plus qu'eux officiers du prince, ne jouissaient pas de la même faveur. En 1658, Jean-François de Mulot, seigneur de La Mothe, prévôt de Saulx en Barrois, ayant passé son épée au travers du corps d'Aubin Ragache, pour le punir d'avoir quitté son village pour celui de Saint-Aubin, fut jugé par le prévôt de Commercy, M. Desmartineaux. Il y eut tant de circonstances atténuantes (au nombre desquelles il ne faut pas sans doute oublier la qualité du coupable) qu il en fut quitte pour 12 fr. d'amende. Nous reconnaissons cependant que ce jugement ne peut pas servir de règle certaine, les circonstances ne nous en étant pas autrement connues.
Les événements politiques ne devaient pas tarder à exercer sur les institutions judiciaires, et principalement sur l'Appel, une grande influence. La France avait depuis quelques années réussi à imposer sa protection aux Trois-Évéchés, ses lois n'avaient plus que quelques efforts à tenter pour s'y introduire. Dès l'an 1555, le roi Henri II, sous prétexte de protéger la bourgeoisie contre la licence militaire, y avait institué un Président royal, qui peu à peu s'empara des juridictions au point qu'il composa un tribunal ayant des assesseurs et un procureur général. Les justices locales se montrèrent fort récalcitrantes contre
ses empiétements, mais ce nouveau siège, représenté dans les évêchés de Toul et Verdun par un lieutenant et d'autres officiers composant une chambre royale, leur porta des coups d'autant plus funestes que l'occupation, qui suivit, de ces pays par les armées du roi, acheva de donner à l'autorité de ce dernier une influence sans réplique. Aussi, en 1607 et 1611, il n'avait d'autre réponse à faire aux populations suppliantes que de confirmer sans pitié ses nouveaux établissements.
Il en méditait un bien plus grand et d'une puissance plus souveraine, dont les conséquences, faciles à prévoir, avaient été déjà repoussées : c'était d'instituer une Cour de Parlement, supérieure à toutes les justices particulières dont personne n'ignorait les vices, mais auxquelles chacun tenait par esprit national. Ce projet fut réalisé en 1653; un parlement fut créé pour siéger à Metz et dominer sur les Trois-Évèchés et autres pays environnants soumis à la France. C'était l'anéantissement des mairies.
Toul et Metz se raidirent avec honneur; l'évêque de Verdun réclama ses droits ; mais le conseil du roi, se faisant la part du lion, se donna gain de cause. Pour mieux étouffer ces plaintes malencontreuses, un édit, publié en août 1654, remplaça les anciennes justices elles-mêmes par cinq bailliages dans les villes de Metz, Toul, Verdun, Vic et Mouzon, et par huit prévôtés réparties entre Gorze, Nomeny, Château-Renaud, Stenay,
Varennes, Montignon, Vienne-le-Châtel et Clermont en Argonne. Mais les résistances populaires, favorisées par les péripéties de la guerre, ne permirent pas à cet empiétement d'avoir le succès auquel on avait cru ; il fallut six ans d'invasion pour que ce joug pût enfin demeurer sur le front courbé des échevins patriotes.
La Lorraine, à son tour, était envahie. Dans la même année 1634, le parlement de Saint-Mihiel, seule cour de justice existant dans ce pays, et seulement pour le Barrois, recevait M. Barillon de Morangis, chargé par le roi de lui faire prêter serment, de la présider et de la surveiller. Deux mois après, une autre Cour, dite souveraine, était créée à Nancy pour faire les mêmes fonctions en Lorraine, en y ajoutant les affaires du domaine, impositions, aides et finances dans tous les états du duc.
C'était un acheminement à une organisation nouvelle, plus centrale et favorisant mieux la domination. L'année suivante, la prétendue infidélité du parlement de Saint-Mihiel et l'ombre de résistance de la ville où il siégeait, offrant un honnête prétexte pour réaliser ce projet politique, la Cour souveraine de Nancy fut déclarée la seule cour de justice devant subsister dans les deux duchés.
Ce coup d'état pouvait être imité avec plus grand profit en l'appliquant aux Trois-Évêchés ; un seul Parlement pour toutes les provinces conquises eût mieux permis de les maîtriser, de changer leurs relations et d'en assurer la confiscation. Autant dans ce but que pour satisfaire, comme on l'a dit, les caprices d'un ministre mécontent, le parlement de Metz fut transféré à Toul, et, le 13 juillet 1657, il était à son tour proclamé la seule Cour du pays, comprenant, avec ses attributions de 1633, celles des Cours de Saint-Mihiel et Nancy.
La magistrature lorraine, fidèle et dévouée, avait suivi son prince vaincu et fugitif; les populations voyaient en elle l'autorité légitime, et, au risque du courroux de l'ennemi, elles ne demandaient que là la justice dont elles avaient besoin. En vain le Parlement brisa ses arrêts, la Cour ambulatoire ne cessa de donner des témoignages de patriotisme et de fidélité qui, disons-le en passant, ne furent que médiocrement récompensés par un prince léger, peu digne de tant de sacrifices.
Néanmoins, le temps permettait à l'invasion de s'affermir; déjà le vainqueur, mieux assis, pouvait exiger que l'organisation des bailliages nouveaux créés en 16o4 reçût son exécution dans les Trois-Évêchés, lorsqu'en la même année 1641, à peine mis en vigueur, la paix étant faite, la Lorraine et le Barrois sortaient de ses mains pour rentrer sous l'empire du Parlement de Saint-Mihiel, érigé le 7 mai en Cour souveraine de ces deux duchés par Charles IV, qui saisissait à son tour cette occasion de porter aux privilèges de sa chevalerie un coup mortel. C'était, hélas! pour peu de jours ; six mois après, la guerre étant rallumée et l'ennemi rentré, Louis XIII rendait, le 6 décembre, au Parlement de Metz, toujours à Toul, ses attributions gigantesques.
A travers ces révolutions, la résistance des Évêchés avait cessé, la justice n'y avait plus qu'un regret impuissant de ses antiques allures. Dans celui de Verdun, le prélat, personnellement dépouillé de sa souveraineté, ne pouvait perdre si profondément le souvenir de sa défaite; d'adroites démarches lui firent obtenir, en 1654, le rétablissement de ses justices envahies ; mais le Parlement, plus attentif que le conseil du roi aux conséquences de cette faveur, la rendit bientôt illusoire et cet évêché resta, comme les autres, sous la loi du plus fort.
Le parlement de Metz, quelque peu exigeant, n'était pas satisfait de tous ces mouvements, qui ajoutaient cependant chaque fois à la grandeur de ses attributions ; à ses yeux, elles ne compensaient pas le désagrément d'habiter Toul, qu'il ne comprenait que comme un exil immérité. Oubliant les causes les plus puissantes de sa translation, qui favorisaient si bien l'accroissement de son empire et de celui de son maître, il faisait des efforts prodigieux pour sortir de cette ville. En 1658, il fit tant qu'à prix d'argent il obtint de rentrer à Metz ; mais c'était devancer de peu ce que les événements allaient réaliser, car, trois ans après, la paix ramenait encore sur son trône le duc Charles, qui, le 26 mars 1661, n'osant pas conserver une cour unique pour deux provinces qui n'étaient pas habituées à confondre leurs droits et leurs usages, et ne voulant pas perdre tout-à-fait les avantages qu'il y avait observés pendant l'invasion, la divisa en deux chambres. L'une devait siéger à Lunéville pour la Lorraine, et l'autre à Saint-Mihiel pour le Barrois non mouvant. La première fut ensuite successivement transférée à Saint-Nicolas, Épinal, Pont-à-Mousson et Nancy. Enfin, en 1667, il n'y eut plus qu'une Cour pour rester dans cette dernière ville, la chambre de Saint-Mihiel étant supprimée à jamais.
Le Parlement de Metz, resté pour les Trois-Évêchés, avait reçu, pour compensation de ce qu'il avait perdu, une immense étendue de pays du côté de l'Alsace et du Hainaut.
Cette organisation subsista pendant tout le temps que dura la paix de 1661 ; mais l'incorrigible duc ayant fourni de nouveaux prétextes à l'ambition incessante de la France, celle-ci, en 1670, s'empara encore de ses états, qui furent replacés en entier sous la domination du parlement de Metz, où ils demeurèrent pendant près de trente ans, c'est-à-dire jusqu'au traité de Ryswick, signé en 1697. Nous ne suivrons pas cette cour dans ses importants travaux; il nous faudrait, pour bien faire, copier l'oeuvre remarquable de son historien (44), et nous craindrions de la décolorer. Cet honorable écrivain, en sa qualité d'étranger, a fait assurément trop bon marché du patriotisme local, qui se sent bien justement blessé ; mais cette singularité ne le rend pas moins digne d'attention, surtout pour les hommes impartiaux disposés à ne pas accepter aveuglément toutes les fautes du passé.
Dans ce long intervalle de trente ans, sous prétexte d'améliorer des justices qui effectivement en avaient quelque besoin, mais bien plutôt pour les soumettre au régime français, le roi, en janvier 1683, avait rendu un édit qu'il est important de rapporter, afin de conserver le
souvenir de l'ancien ordre de choses réformé comme abus.
Le Roi, en son conseil, étant informé que la justice est mal rendue en plusieurs endroits de la province de la Sarre, qu'elle est différemment exercée en chacune seigneurie, et qu'au lieu d'être administrée par des officiers capables, la plupart des seigneurs hauts-justiciers emploient à la charge de bailli leurs secrétaires et receveurs, gens domestiques, lesquels, sans être instruits des lois ni assistés de personne que d'un greffier de même fabrique, donnent des jugements à leur fantaisie, tolèrent souvent le crime et imposent des amendes excessives toujours à l'avantage de leurs maîtres et à la ruine des peuples, rien n'étant si préjudiciable au public et si contraire aux intentions de S. M., qui ne désire que le bien et le repos de ses sujets ; voulant, pour remédier à de si grands abus, régler le nombre des juges, réduire l'ordre de la justice dans un état stable et uniforme en chacune desdites seigneuries, et le tout mûrement examiné ;
Le roi, en son conseil, a ordonné et ordonne que le style dressé à Metz l'année dernière, conformément à l'ordonnance de S. M. du mois d'avril 1667, sera suivi exactement pour l'instruction des causes qui se plaideront dans tous les présidiaux, bailliages, prévôtés et châtellenies desdits pays ;
Que la justice des terres portant titre de duché sera composée d'un bailli, d'un lieutenant et quatre conseillers, hommes gradués, un procureur fiscal, un greffier, quatre procureurs, six sergents avec toutes les marques de la justice, qui pourront juger en dernier ressort jusqu'à 100 livres et porter l'amende jusqu'à 30 livres.
Si le duché avait une fort grande étendue, comme celui de Deux-Ponts, le siège principal sera établi au centre, et deux autres particuliers à distances proportionnées, administrés chacun par un bailli ou prévôt, un lieutenant, un substitut du procureur fiscal du duché, un greffier, deux procureurs et trois sergents; que les appellations en première instance desdits sièges particuliers ressortiront audit siège principal ;
Que la justice des terres portant titre de comté sera composée d'un bailli, un lieutenant, un assesseur, hommes gradués, un procureur fiscal, un greffier, quatre procureurs et quatre sergents ; que lesdits juges pourront juger jusqu'à 55 livres, nonobstant l'appel, et porter l'amende jusqu'à 20 livres ; si ledit comté est de trop grande étendue pour un seul siège, ainsi que celui de Sponheim, il sera établi un ou deux sous-bailliages particuliers de chacun un bailli ou prévôt, un lieutenant, un substitut du procureur fiscal du comté, un greffier, deux procureurs et trois sergents, dont les appellations ressortiront, comme dit est, au siège principal, qui sera établi dans le plus grand lieu et le plus commode, et auquel il sera ajouté un assesseur ;
Que la justice des terres portant titre de baronnie sera composée d'un bailli, homme gradué, d'un lieutenant, un greffier, un procureur fiscal, de deux procureurs et de quatre sergents, qui jugeront jusqu'à 30 livres et imposeront à l'amende jusqu'à 15 livres, nonobstant l'appel ;
Que les justices des seigneuries de dix jusqu'à vingt villages seront composées comme dessus, et pourront juger jusqu'à 24 livres et imposer à l'amende jusqu'à 12 livres ;
Que les seigneuries de six jusqu'à dix villages ayant titre de haute, moyenne et basse justice, auront un bailli, homme gradué, un lieutenant, un procureur fiscal, un greffier et trois sergents, qui pourront juger jusqu'à 20 livres et amender jusqu'à 10 livres ;
Que les justices des seigneuries de trois jusqu'à cinq villages ayant les mêmes droits de justice, seront composées comme dessus, excepté qu'elles ne pourront juger que jusqu'à 18 livres et imposer à l'amende jusqu'à 9 livres ;
Que les seigneuries du même nombre de villages n'ayant droit que de moyenne et de basse justice, seront réduites à un prévôt, un procureur fiscal, un greffier et deux sergents, qui pourront imposer l'amende jusqu'à 6 livres ;
Que dans les seigneuries d'un à deux bourgs ou villages, ayant titre de haute, moyenne et basse justice, la justice sera exercée par un bailli, homme gradué, un lieutenant, un procureur fiscal, un greffier et deux sergents ; que lesdits juges pourront condamner jusqu'à 15 livres et à l'amende jusqu'à 7 livres 10 sous;
Que lesdites seigneuries d'un à deux villages n'ayant droit que de basse justice, seront composées d'un prévôt, d'un procureur fiscal, d'un greffier et deux sergents, qui pourront imposer jusqu'à 5 livres d'amende;
Que les parties condamnées auront voie d'appel au parlement de Metz, ou, dans les cas présidiaux, au présidial où relèveront lesdites justices, des sentences rendues contre eux, dont le principal excédera les sommes mentionnées ci-dessus ;
Que les criminels condamnés à des peines afflictives, ou le procureur fiscal pour eux, auront aussi voie d'appel audit parlement, à la conciergerie duquel lesdits condamnés seront transférés, et les procédures mises au greffe de ladite cour, afin qu'après l'examen qui en sera fait, si les sentences y sont confirmées, ils soient renvoyés sur les lieux pour y subir leurs condamnations ;
Que, pour un plus grand ordre, les greffiers desdites justices seront obligés de tenir des registres exacts, écrits en français, où toutes les causes seront insérées dans leurs circonstances et dépendances, pour y avoir recours en cas de besoin, à peine, auxdits greffiers, de 500 livres d'amende.
Accorde S. M. auxdits seigneurs deux mois, à compter du jour de la publication du présent règlement, pour se pourvoir d'officiers capables d'administrer la justice avec intégrité, conformément à ladite ordonnance de S. M. du mois d'avril 1667, dont la moitié de chacune justice an moins seront delà religion catholique, pour éviter partialité. Défense auxdits seigneurs, hauts, moyens et bas justiciers, de donner ni conférer aucunes charges de judicature à leurs secrétaires, receveurs ou autres domestiques,
à cause de l'incompatibilité, à peine de nullité des procédures et de privation de leurs dits droits, etc.
Le parlement de Metz était donc l'instrument destiné à faciliter la domination générale des pays conquis ; il assurait, en ce qui concerne le sujet qui nous intéresse, le droit d'appel en matière criminelle à tous ses justiciables.
La Lorraine, restée seule résistante à cette innovation, ne pouvait manquer de finir par y succomber ; c'est ce qui eut lieu presque à l'improviste, non par un édit qui nous soit connu, mais par un simple arrêt de la cour souveraine. En effet, on en trouve un de 1663 qui enjoint au ministère public d'interjeter appel des condamnations à mort, quand même les condamnés y acquiesceraient, et défense aux juges de les faire exécuter auparavant. Cet arrêt (45), rendu à l'occasion d'un nommé Vonixsoi, du ban de Ramonchamp, exécuté dans la prévôté d'Arches, n'invoque, nous le répétons, d'autre législation que l'autorité de la cour.
C'est en cet état, pour la répression judiciaire, que la Lorraine fut rendue à ses princes légitimes entre les mains de Léopold, qui en était le plus digne, en même temps que le plus capable pour conserver ce dépôt sacré, nonobstant les embarras du dedans et ceux du dehors.
XVIII SIECLE.
Le premier soin du comte de Carlinford, chef de la régence, fut de rétablir la Cour souveraine et les Bailliages tels qu'ils étaient en 1670, avant que le roi de France y portât la main. Ce provisoire permit de s'occuper d'une réorganisation générale que l'esprit législateur de Léopold poussa avec une activité telle, que, dès le mois d'août suivant, la province se trouva divisée en autant de sièges de justice qu'il était possible de le souhaiter pour une bonne administration. Elle fut partagée en onze bailliages et le Barrois en six, comprenant chacun des prévôtés en grand nombre ; le tout réparti ainsi qu'il suit :
LORRAINE.
1. Bailliage a Nancy, avec attribution de la justice prévôtale, composé d'un lieutenant-général, civil et criminel, un lieutenant particulier, sept conseillers et un substitut.
Prévôtés. Nancy, Saint-Nicolas, Rosières, Amance (46), Château-Salins, Gondreville, Prény, Pompey, Condé, Chaligny, Marsal et Einville, composées chacune d'un prévôt, un lieutenant, un assesseur et un substitut, à l'exception de Nancy, Château-Salins et Marsal, où il n'y avait pas d'assesseur.
2. Bailliage a Saint-Dié, composé d'un lieutenant-général, un lieutenant particulier, deux assesseurs et un substitut.
Prévôtés. Sainte-Marie-aux-Mines, composée d'un prévôt, un assesseur et un substitut.
3. Bailliage a Lunéville, composé d'un lieutenant-général, un lieutenant particulier, deux conseillers, un capitaine prévôt pour la gruerie et un procureur fiscal.
Prévôtés. Badonviller, Blâmont, Deneuvre et Azerailles.
Les deux premières composées d'un prévôt, un lieutenant, un assesseur et un substitut; la troisième sans assesseur, et la dernière composée seulement d'un prévôt et d'un substitut.
4. Bailliage de Vosges, a Mirecourt. Un lieutenant-général, un lieutenant particulier, six conseillers et un procureur.
Prévôtés. Mirecourt, Châtenois, Arches, Dompaire, Charmes, Darnay, Remoncourt et Valfroicourt, composées d'un prévôt, un lieutenant, un assesseur et un substitut, excepté les deux dernières, qui étaient sans assesseurs, et la dernière encore sans lieutenant.
5. Bailliage à Neufchateau. Un lieutenant, deux conseillers, un substitut.
6. Bailliage à Bruyères. Même composition.
7. Bailliage à Épinal, Même composition qu'à Lunéville.
8. Bailliage à Chatel. Même composition qu'à Lunéville.
9. Bailliage du comté de Vaudémont, à Vézelise. Idem.
10. Bailliage à Nomeny. Un lieutenant-général, un lieutenant particulier, un conseiller et un procureur.
11. Bailliage d'Allemagne, à Sarreguemines. Un lieutenant général, un lieutenant particulier, trois conseillers, un procureur.
Prévôtés. Sarreguemines, Valdrevanges, Amange, Dieuze, Boulay, Freistroff, Sirsperg, Schowmbourg,Saralbe, SaintAvold, Bitche et Bouquenom, composées chacune d'un prévôt, un lieutenant, un assesseur et un substitut, à l'exception de la première, où il n'y avait pas d'assesseur.
BARROIS NON MOUVANT.
1. Bailliage a Saint-Mihiel. Comme à Nancy, avec un procureur fiscal en plus.
Prévôtés. Saint-Mihiel, Hattonchâtel, Apremont, Sancy, Norroy-le-Sec, Briey, Conflans, Foug et Bouconville (47), composées chacune d'un prévôt, un lieutenant, un assesseur et un substitut.
Bailliage a Étain. Comme à Lunéville.
Prévôtés. Longuyon et Arrancy, composées comme celles du bailliage de Saint-Mihiel.
Bailliage a Pont-a-Mousson. Même composition qu'à Lunéville.
Prévôtés. Thiaucourt et Mandres-aux-Quatre-Tours, composées comme celles du bailliage de Saint-Mihiel.
Bailliage du Bassigny, a Bourmont. Un lieutenant-général, un lieutenant particulier, un conseiller et un procureur.
Prévôtés. Bourmont, La Marche, Conflans et Châtillonsur-Saône, composées comme celles du bailliage de
Saint-Mihiel, excepté qu'à Bourmont le prévôt prenait le titre de Sénéchal, comme d'ancienneté.
Bailliage a Gondrecourt, composé d'un lieutenant, de deux assesseurs et d'un procureur (48).
Prévôté. Gondrecourt, composée d'un prévôt, un lieutenant, un assesseur et un substitut.
BARROIS MOUVANT.
Bailliage a Bar. Un lieutenant-général, un particulier, six conseillers, un avocat général ayant voix délibérative dans les affaires où il ne portait pas la parole, un procureur général, un substitut et un adjoint.
Prévôtés. Bar, Souilly et Pierrefitte. La première, composée d'un prévôt, un lieutenant-général, un lieutenant particulier et un substitut ; la seconde, comme celles du bailliage de Saint-Mihiel ; la troisième, composée d'un prévôt et d'un substitut.
Dans la plupart de ces prévôtés, les fonctions de gruyer étaient attachées à celles de prévôt.
Cette organisation comprenant beaucoup plus de pays que les précédentes, ne s'étendait pas encore, ainsi qu'on
le remarque, à toutes les justices de la province : celles patrimoniales restaient en la possession des seigneurs propriétaires ; mais, par une disposition de la nouvelle législation dont nous allons parler, elles ne pouvaient plus, de même que les bailliages et les prévôtés qui précèdent, à l'exception du Barrois et du Bassigny mouvants, juger au criminel qu'à la charge d'appel à la cour. C'était là une grande innovation, dictée principalement par le désir de mieux s'assurer la souveraineté.
Le duc Léopold, animé du zèle le plus sincère et le plus éclairé pour le bien de ses sujets, auquel était d'ailleurs attachée la prospérité de ses États, entreprit de réglementer, par des lois sages et écrites, tout ce qui se rapportait à l'administration de la justice. S'il ne prit pas une part personnelle à ce travail, le choix qu'il fit des jurisconsultes qui y procédèrent atteste le soin intelligent qu'il y mit, et le résultat fait honneur à son règne. Il parut en février 1701, avec toutes les chances de durée et d'application dont il était digne. Mais ce code, si sage pour l'époque, se vit, à sa naissance, frappé de réprobation par l'Église, qui prétendit que ses privilèges et immunités y étaient violés. De longues et difficiles discussions s'élevèrent à ce sujet entre le duc et la Cour de Rome ; nous n'en parlerons pas ici parce qu'elles trouveront mieux leur place quand nous nous occuperons des officialités. Pour le moment, il nous suffît de dire qu'après transaction entre les puissances contendantes, le code de 1701 reparut en 1707 avec quelques retranchements, et qu'il devint la loi générale de la Lorraine.
Contre l'ordinaire des coutumes écrites et publiées jusque-là, il contenait les règles de la justice criminelle ; il apporta, dans cette partie de l'administration dont nous nous occupons, des innovations qu'il nous reste à signaler.
On vient de voir, par le tableau des juridictions qui précède, que les justices devenaient des corps délibérants au lieu de rester aux mains d'un seul homme, maître de réfléchir ou de juger à la légère. Les baillis et les prévôts s'y retrouvent, mais ce n'est plus que nominativement et avec des attributions toute différentes. Sans entrer dans le détail de ses dispositions où la justice civile était le plus intéressée, disons de suite que, pour juger criminellement, il fallait trois juges gradués dans les prévôtés, cinq dans les bailliages, et encore ne jugeaient-ils plus en dernier ressort. De son côté, la Cour ne pouvait statuer à moins de sept de ses membres également gradués. Ainsi, plus de sentence rendue par un seul juge, plus de sentence, même d'absolution, sans appel. Cette double règle, applicable aux justices ducales comme à celles seigneuriales, changeait les usages anciens et offrait à toute la province, sans distinction, des garanties que le morcellement de l'autorité souveraine n'avait pas permis jusque-là d'obtenir. A cet égard, l'invasion de la France était utilisée; le duc s'empressait de profiter des atteintes qu'elle avait portées sans ménagement à l'autorité des seigneurs, et il trouvait les populations merveilleusement disposées à accepter des usages dont elles s'étaient habituées à goûter les avantages.
Il faut cependant dire qu'une exception était posée pour le cas où, faute de sujets dans une justice seigneuriale, il n'aurait pu y être placé de gradués : alors la justice établie pouvait juger, mais à la charge expresse de prendre l'avis de trois gradués. Et comme la sentence était d'obligation soumise à l'appel, c'était toujours, en définitive, la Cour souveraine qui prononçait sur le sort de l'accusé.
Il serait abusif de rapporter ici toutes les dispositions notables renfermées dans ce code volumineux qui est encore dans les mains de tout le monde, et que le lecteur pourra consulter sans que nous en fassions une analyse qui paraîtrait trop longue. Les ordonnances de France, dont il était la copie, ont été d'ailleurs assez commentées sans que nos réflexions, qui ne seraient que des redites, puissent ajouter à son mérite. Pour la Lorraine, où jusque là rien n'était encore en cette matière à l'abri de l'incertitude et de l'arbitraire, cette législation nouvelle était un bienfait dont la réalité se trouve d'autant moins contestable qu'aujourd'hui encore notre législation présente les mêmes dispositions et prescrit les mêmes formalités, à tel point qu'il semble que nos ancêtres aient atteint en cette matière le dernier degré de perfection, puisque nous n'avons su mieux faire, si toutefois on en excepte la publicité des débats et le secours d'un défenseur, antiques garanties qui ne leur furent pas rendues.
En ce qui concerne ce dernier point, qui est d'une si grande importance, malgré l'abus qui peut s'y glisser, il y eut cependant une amélioration digne d'être remarquée, c'est que la défense fut admise dans certaines limites.
L'article 14 du titre 6 porta que les avocats seraient tenus de prêter leur ministère aux prisonniers pour crimes es cas où ils auraient droit d'avoir conseil. Restait à savoir quels seraient ces cas. L'article 4 du titre suivant les indiqua comme étant les accusations où, la discussion était difficile : ce qui était laissé à la discrétion du juge.
Il faut le dire, c'était moins en faveur de l'accusé que de la justice que l'avocat était ainsi appelé; celle-ci voulait une garantie pour l'aider à sortir d'embarras, et elle la trouvait dans les lumières et le zèle du défenseur de l'accusé : aussi cet article 4 ne réservait pas au juge d'autoriser ce dernier à se faire défendre, mais lui accordait le pouvoir de le lui ordonner.
La défense n'était pas une plaidoirie ; elle n'avait d'autre droit que de faire parvenir au juge des notes, plus ou moins sommaires, contenant des faits justificatifs, tels que alibi, légitime défense, folie, etc. Si les magistrats y trouvaient matière à supplément d'information, ils le prescrivaient ; sinon, l'affaire suivait son cours, sans que le défaut de production de faits justificatifs ou de moyens atténuants pût l'entraver : avec de telles restrictions, la vérité pouvait être impunément étouffée.
Lors de la publication de ce code Léopold, les autres modifications les plus sensibles portèrent sur la compétence désormais réglée ratione loci; sur la création des corps de justice délibérants; sur la confection de l'information par un seul membre, délégué à cet effet par le magistrat président, et à tour de rôle, avec cette disposition remarquable que le rapport ne pouvait être fait à la chambre assemblée que par un autre membre n'ayant pas participé à la procédure.
Une innovation avait été tentée, touchant les monitoires, mais elle échoua dans la contestation élevée par l'évêque de Toul, ainsi que nous le dirons plus loin.
Le règne de Léopold fleurit ainsi à l'abri de ces institutions qui aidèrent à sa gloire et à l'ordre public, qu'elles contribuèrent à rétablir, malgré les nombreuses atteintes qu'essayèrent d'y porter les débris des armées du siècle précédent. Dans l'organisation des justices, ce prince n'avait pu s'éloigner beaucoup de celle existante ; il n'aurait pu, sans de graves difficultés, changer trop brusquement les habitudes ; de grandes doléances se seraient fait entendre s'il avait fallu aller un peu loin chercher un juge. Il en résultait que la multiplicité des sièges nécessitait beaucoup de magistrats ; que, pour en trouver le nombre voulu, il fallait se montrer peu difficile dans le choix, et que dès lors, dans les résidences où les émoluments étaient insuffisants, il y avait de fortes raisons
pour n'y trouver à placer que des incapables, triste nécessité qui fera toujours le malheur des peuples.
En vain on en sentit alors tous les inconvénients, on n'osa y porter remède autre part que pour Gondrecourt et Bouconville, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Il était réservé au roi Stanislas, à l'aide de son gouvernement plus français que lorrain, de réaliser une amélioration que la raison, et encore mieux la force, firent accepter à la province.
Sous ce roi, par édit du mois de juin 1751, la suppression générale des justices existantes fut donc proclamée en même temps que la création de celles destinées à les remplacer. Il en résulta trente-cinq bailliages au lieu de dix-sept, et seulement sept prévôtés au lieu de cinquante-huit, le tout réparti ainsi qu'il suit :
Un bailliage royal composé d'un bailli d'épée, un lieutenant-général, un lieutenant particulier, un assesseur civil et criminel, six conseillers, un avocat du roi et un procureur du roi, dans chacune des villes ci-après :
Bar, Boulay, Bouzonville, Briey, Bruyères, Commercy, Dieuze, Épinal, Étain, Lunéville, Mirecourt, Nancy, Neufchâteau, Pont-à-Mousson, Sarreguemines, Saint-Dié, Saint-Mihiel et Vézelise.
Un bailliage royal composé d'un bailli d'épée, un lieutenant particulier, un assesseur, deux conseillers et un procureur du roi, à Blâmont, Bourmont, Bitche, Charmes, Château-Salins, Châtel-sur-Moselle, Darney, Fénétrange, Longuion, La Marche, Lixheim, Nomeny, Remiremont, Rosières, Schambourg, Thiaucourt et Villers-la-Montagne.
On remarque que, dans la première catégorie, il y avait le double de magistrats en sus dans chaque siège ; aussi étaient-ils appelés grands bailliages, pour les distinguer des autres, appelés bailliages ordinaires.
Les prévôtés étaient à Badonviller, Bouquenom, Dompaire, Ligny, Saint-Hippolyte et Sainte-Marie-aux-Mines ; elles étaient chacune composées d'un prévôt, un lieutenant et un procureur du roi.
Le ressort de ces juridictions étant rapporté en entier au Recueil des Edits (49), il devient inutile de le consigner ici ; nous ferons seulement observer pour mémoire que les appels de Bar et de La Marche étaient toujours portés au parlement de Paris, comme auparavant, et qu'il n'était rien innové quant aux justices seigneuriales.
Le roi Stanislas n'étant qu'un duc usufruitier dans la Lorraine, y fit moins prévaloir ses volontés que celles de la France, dont tous les efforts tendaient à l'introduction de ses lois et de ses usages au préjudice des privilèges dont la province avait une possession immémoriale. L'innovation la plus remarquable en matière criminelle, et dont les conséquences pouvaient produire le plus d'impression sur les esprits, fut celle de la peine des galères, entièrement inconnue auparavant, et d'autant mieux en horreur à la population. Nous dirons ce qui s'y rapporte à l'article spécial consacré à ce mode de répression.
Nous avons dit aussi que le duc Léopold essaya vainement de modifier l'usage du monitoire; c'est ici le lieu d'en parler.
On appelait monitoire l'avertissement transmis par l'Église aux fidèles, avec ordre, sous peine d'excommunication, de déclarer ce qu'ils savaient sur certains faits énoncés. L'introduction de cet usage est facile à comprendre venant de l'Eglise, qui eut toujours le désir de contribuer à la
moralisation et à l'ordre public, dont la répression est inséparable, et elle n'avait en mains d'autre moyen coercitif que ses foudres spirituelles pour atteindre ce but.
En France, l'official, c'est-à-dire l'officier judiciaire de l'Église, était tenu d'accorder le monitoire dès que le juge laïque le lui demandait, à peine contre lui de la confiscation de son temporel, qui était distribué aux pauvres et aux hospices. Les curés, chargés naturellement de la publication de cet acte, encouraient les mêmes peines en cas de refus. En Lorraine, au contraire, l'official restait libre de l'accorder ou de le refuser ; les statuts synodaux lui défendaient même de le décerner si le cas n'était important et l'objet d'une valeur excédant au moins 300 fr.
Dans son code de 1701, le duc Léopold, désireux d'échapper à ce veto facultatif accordé à une classe de ses sujets, adopta la loi de la France et la fit insérer tout au long en un chapitre spécial. Mais l'évêque de Toul ne laissa pas passer cette tentative, qui lui parut des plus hardies, et l'opposition qu'il y mit, soutenue avec toute la puissance qui militait alors pour le clergé, paralysa cette innovation. Sur ce point, sa résistance fut telle, que le malencontreux chapitre fut l'objet d'une exception particulière qui l'empêcha de figurer au code de 1707, de sorte que l'official conserva sa liberté d'action.
En 1776, Stanislas étant mort et la Lorraine réunie à la France, le roi très-chrétien, sinon plus orthodoxe, du moins plus puissant que le duc, fit meilleur marché des privilèges de l'Église. Par édit du mois de juin, la loi française en matière de monitoire fut par lui déclarée commune à la Lorraine, et l'official et les curés furent de nouveau menacés de la saisie de leur temporel en cas de refus. Cet édit, enregistré au parlement, n'éprouva aucune opposition connue et fut exécuté sans résistance.
Un autre édit, donné en 1784, restreignit l'usage du monitoire aux cas graves où la preuve ne pouvait être acquise autrement; mais cette restriction était une défense pesant sur l'Église au même degré que sur le juge laïque.
Voici dans quelle forme était rédigé cet acte de procédure qui a disparu de nos lois :
(Noms, prénoms et dignités de l'officier de l'Évêché) ....
Official de la cour spirituelle de ...
Aux sieurs curés et vicaires de notre juridiction, salut en notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous vous mandons, ayant égard à l'ordonnance de M. ... (le nom du juge) de bien admonéter, par trois dimanches consécutifs, es prônes de vos messes paroissiales, tous ceux et celles qui ont la connaissance que le (date de la perpétration du crime), certains quidams ou quidames auraient (le détail des faits incriminés). Il importe d'user de tous les moyens possibles pour parvenir à la conviction des coupables dudit fait, même par voie de monitoire, aux fins d'en avoir révélation et généralement de savoir qui, des faits ci-dessus, circonstances et dépendances, aurait vu, su, connu, ouï dire ou aperçu qui que ce soit, par rapport auxdits faits. C'est pourquoi nous admonétons tous ceux et celles qui pourraient en avoir connaissance, soit pour y avoir été présents, participants, donné conseil, prêté faveur ou autrement, en peuvent déposer, en quelque sorte et manière que ce soit, que dans six jours au plus tard après la troisième publication des présentes, ils aient à venir à révélation aux publications d'icelles sur tout ce qui pourrait contribuer à découvrir les auteurs desdits vols, autrement nous nous servirons contre eux de la peine d'excommunication.
Donné à ... le, etc.
Les faits relatés en l'ordonnance du juge pouvaient seuls être énoncés au monitoire, l'official ne pouvait y ajouter, à peine de nullité. Il lui était également défendu, sous peine de 100 fr. d'amende, de nommer les personnes suspectées.
Après cette publication au prône par les curés à qui le monitoire était adressé, les fidèles qui avaient quelques révélations à faire se rendaient près d'eux pour faire leurs dépositions, qui étaient ensuite envoyées au greffe en un paquet cacheté. Il en était donné communication au ministère public, mais non à la partie civile, qui ne recevait d'autre indication que celle du nom et de la demeure des témoins. Le tribunal, assemblé, prenait lecture de ces révélations ; s'il y avait lieu d'y attacher quelque importance, il ordonnait l'audition nouvelle des révélateurs par voie d'information régulière devant un commissaire.
La ressource du monitoire, accordée à l'accusation dans l'intérêt de la vindicte publique, n'était pas accordée à l'accusé, qui cependant pouvait en avoir le même besoin pour sa défense ; mais l'abus que lui ou sa famille auraient pu en faire, en jetant dans l'information des dépositions de complaisance, dut la lui faire interdire.
Cette inégalité dans les droits de l'accusation et de la défense était peut-être déjà une grave raison de douter de l'utilité du monitoire, qui n'était, en résumé, qu'un moyen de forcer, par la crainte d'un châtiment spirituel, les témoins à parler; moyen peu moral et fort dangereux, qui faisait descendre les ministres de paix dans l'antre de la justice, rendait la confession suspecte, s'il ne la violait, et mettait à la discrétion d'hommes étrangers à la magistrature les plus précieux éléments d'information.
L'organisation de 1751 avait composé les nouvelles circonscriptions en mêlant indistinctement les anciens ressorts sans autre considération que les besoins du service, en rapprochant le plus possible les localités du siège de la justice. Il n'y avait eu d'exception que pour le Barrois et le Bassigny mouvants, ces deux parties du duché devant rester, comme nous l'avons dit, soumises au ressort du Parlement de Paris. On eut donc soin, en composant les deux nouveaux bailliages de Bar et de La Marche, qui les représentaient, d'y comprendre les communes qui, auparavant, avaient fait partie de l'ancien ressort, malgré la distance qui les séparait de leur chef-lieu.
Quant au reste du pays, où jadis la justice criminelle se rendait en dernier ressort, il était soumis pour le recours en appel a la Cour souveraine ou Parlement de Nancy, dont la compétence était réglée par le titre 14 du code de 1707, qui lui attribuait la connaissance par voie d'appel facultatif, dans les cas méritant peine afflictive, de tous décrets de permission d'informer et suites, de toutes sentences prononçant bannissement, réparation à genoux, amende, blâme et admonition ; et par voie d'appel forcé des condamnations à la mort naturelle ou civile, à une peine afflictive ou à l'amende honorable.
Cette Cour, qui faisait passer la province entière sous le même joug, qui appliquait à tous la même loi, qui surveillait les officiers, châtiait les sujets, réglementait grands et petits, nobles, privilégiés et roturiers, était un moyen puissant de domination, un instrument non moins politique que judiciaire. L'histoire se réserve de nous en révéler les entreprises et les succès, qui sortent malheureusement de notre domaine, réduit, comme nous l'avons dit, au point de vue de la civilisation et du maintien de l'ordre public par la voie de la répression.
Le duc Léopold avait entrepris une grande tâche en réunissant sous le même niveau des populations habituées à des coutumes et à des usages d'autant plus commodes qu'ils étaient incertains, mal définis et trop souvent élastiques; cette tâche ne put s'accomplir sans bien des murmures. La sévérité paraissait l'argument le plus logique, il était le seul admis, commandé par le passé. Pendant ce règne et celui de Stanislas, la misère publique, engendrée par les guerres précédentes et par les intempéries des saisons, s'était accrue au point de paraître une plaie incurable ; un grand nombre d'années calamiteuses avaient aggravé la situation, le crime était devenu menaçant pour le salut du pays. Le système de la rigueur pouvait alors être employé sans étonner personne ; aussi les bailliages, les prévôts et les justices particulières frappaient ils rudement sans crainte de mécontenter, sinon les malfaiteurs, mais avec la certitude de l'assentiment public.
La Cour souveraine pouvait donc laisser faire et continuer sans trouble un usage devenu plus salutaire que jamais.
Cependant il n'en fut pas ainsi ; loin d'imiter les autres tribunaux, elle usa au contraire d'une modération qui doit être remarquée, et qui probablement doit lui faire le plus grand honneur. On ne peut suspecter d'une fausse et maladroite philanthropie des magistrats choisis parmi ce qu'il y avait alors de plus éclairé, en même temps que de plus élevé en dignités. Il fallait un profond sentiment du devoir pour que des hommes issus de noble race, nourris de préjugés d'origine, vivant de privilèges, se crussent obligés à user de ménagements vis-à-vis de criminels vomis par la lie de la population, et même Ip plus souvent étrangers au pays, qu'ils épouvantaient par leurs excès. Était-ce une recommandation du prince., un mot d'ordre suivi pour encourager les voisins à venir, pour conserver les prolétaires régnicoles, si disposés alors à
émigrer ? Ou bien était-ce l'influence du progrès des lumières, de plus en plus indulgentes pour la faiblesse humaine, que la société délaisse aux besoins et aux passions avec une incurie atténuante
!
C'est ce que l'on ne saurait dire.
Voici le résultat des décisions de la Cour pendant ses
88 ans d'exercice :
|
Condamnés |
Diminution de
peine |
Augmentation |
| De 1698 à 1709 |
391 |
23 |
19 |
| De 1710 à 1719 |
126 |
22 |
7 |
| De 1720 à 1729 |
394 |
41 |
26 |
| De 1730 à
1739 |
353 |
47 |
16 |
| De 1740 à 1749 |
247 |
57 |
5 |
| De 1750 à 1759 |
244 |
75 |
6 |
| De 1760 à 1769 |
179 |
39 |
4 |
| De 1770 à 1776
(50) |
226 |
33 |
10 |
| De 1781 à
1790 |
280 |
62 |
5 |
|
2,440 |
399 |
98 |
Les diminutions portent sur cent quarante-un condamnés à la peine de mort, qui fut modifiée soixante-dix fois en bannissement perpétuel, cinquante-une fois en galères à perpétuité et vingt fois en galères à temps.
La peine des galères à perpétuité fut modifiée quatre-vingts fois en celle des galères à temps.
L'augmentation a substitué à des peines moins rigoureuses : huit fois la roue, quinze fois la corde, vingt-trois fois le bannissement perpétuel, huit fois les galères à perpétuité ; ce n'était donc que dans des cas graves qu'elle avait lieu.
En général, pour que la Cour ne diminuât pas la peine, il fallait que l'accusé fut bien indigne de pitié, et, de même, quand elle l'augmentait, c'est qu'il n'avait droit à aucune compassion. Les habitants de la Lorraine allemande étaient ordinairement dans cette dernière catégorie; probablement ils avaient besoin de leçons plus sévères. Le peu de rigueur dont la Cour usa fut surtout dans les premiers temps ; à mesure que l'on avança, elle grandit son indulgence ; dans les dernières années, elle était presque faible : la simple réprimande semblait une des plus fortes peines à son usage. C'est ce que l'on verra, au surplus, avec plus de détails, lorsque nous en serons arrivés à l'histoire des peines et à celle de leur application.
Un fâcheux usage, celui de s'abstenir de motiver les sentences, s'était maintenu malgré les dangers qu'il renfermait. On se contentait de déclarer l'accusé convaincu des cas résultants du procès. La Cour souveraine, dès son installation en 1698, fit la défense, qu'elle renouvela souvent depuis, de procéder ainsi ; mais l'habitude était si enracinée et probablement si commode, qu'elle-même, plus d'une fois, ne motiva pas autrement ses arrêts les plus sévères, à tel point qu'il en est qui laissent ignorer entièrement le crime du condamné.
En 1771, cette Cour reçut une grande extension de pouvoir, les attributions et la juridiction de tout le ressort du Parlement de Metz lui ayant été conférées par suite de la suppression de ce dernier, qui avait adhéré à la résistance des autres Parlements. Elle en demeura investie jusqu'en 1773, époque à laquelle les choses furent remises en leur premier état ; mais, en compensation de cet événement, elle fut décorée du titre de Parlement, qu'elle conserva jusqu'à la révolution.
(suite)
(1) Tome 2, p. 441,
(2) Voyez EXÉCUTION.
(3) C'est donc une erreur de notre part d'avoir dit, dans V Histoire de Commercy, que le prévôt avait la justice criminelle ; nous nous empressons de la reconnaître.
(4) Arch. de Lorraine, La Mothe, 2, 26.
(5) Arch. de Lorraine, Nancy, 6, 57.
(6) Id., Fénétrange, 4, 1.
(7) Id., Ligny, 5, 6.
(8) Id., Prény, 53, 3.
(9) François de Neufchâtel, Anc. Ordon
(10) Arch. de Lorraine, Monthureux, 59.
(11) Hist. de Commercy, 1. 1, p. 84.
(12) Id., t. 1, p. 86.
(13) Id., t 1, p. 98.
(14) V. Conjurateurs, p. 5.
(15) Arch. de Lorraine, Fénétrange, 3, 3.
(16) Hist. de Saint-Mihiel, p. 94. -D. Calmet, t. 5, Dissertation.
(17) D. Calmet, t. 5, xxiii.
(18) Id., t. 3, 386.-Huguenin, Chroniques de Metz, p. 109.
(19) Cet usage fut encore maintenu en 1619, aux assises des Vosges, contre le prévôt Claude Geunelaire, qui avait eu assez peu de galanterie pour le contester aux Dames.
(20) Consulter sur ce sujet l'excellent Essai historique sur la rédaction des coutumes, par
M. le président Beaupré. Nancy, Grimblot, 1845.
(21) Histoire des lois et usages de Lorraine en matière bénéficiale, p. 6O, par Thibault, ouvrage beaucoup moins apprécié qu'il ne le mérite.
(22) D. Calmet, 5, 294.
(23) Arch, de Lorraine, Fiefs, 36.
(24) Arch. de Lorraine, Sirtperg, 6.
(25) Ces échevins poussaient un peu loin leur indépendance ; on les voit un peu plus tard faire grâce à un condamné sans consulter le duc, ce qui fait que le gouverneur demande à ce dernier s'ils ne ferait pas bien d'user de réciprocité en en faisant exécuter un sans consulter l'archevêque.
(26) Coutumes de 1594, tit. 6, art. 10.
(27) Arch. de Lorraine, Bouconville, 113.
(28) Arch. de Lorraine, La Chaussée, 2, 25.
(29) Arch. de Lorraine, Etats généraux, 10
(30) Arch. de Lorraine, Nancy, 2, 97.
(31) Arch. de Lorraine, Lamothe Clinchamps, 66, n° 11
(32) Arch. de Lorraine, États généraux, 3.
(33) Arch. de Lorraine, Fénétrange, 3, 60.
(34) Id., Longuyon, 3, 15.
(35) Arch. de Lorraine, États généraux, 44,
(36) Arch. de Lorraine, États généraux, 3.
(37) Le dessin que je donne ici est la copie exacte des grésillons de mon cabinet.
(38) Arch. de Lorraine, Puttelange, 54.
(39) Voir la planche qui suit.
(40) Voir la gravure en regard.
(41) La victime, jetée ainsi brisée loin de toute protection, était encore exposée à des outrages ignorés dont la facilité fait frémir. C'est ainsi qu'en 1586 il fallut déterrer la femme de Claudin Rouyer, de Bouconville, morte en prison après la torture pour sortilège, afin de connaître les offenses qu'elle avait subies de la part des valets chargés de la garder.
(42) C'est ce qui est justifié au besoin par les dépenses suivantes pour l'année 1498 :
A Jean Henriet, président des hauts jours dernièrement tenus à Saint-Mihiel, 200 fr. pour ses peines et salaires d'y avoir vaqué.
A maîtres Jean Bourgeois et Jean Robin, avocats et conseillers qui l'ont assisté, 200 fr.
Au clerc du président, 16 fr.
A son fils,12fr.
Aux clercs de maîtres Bourgeois et Robin, 5 fr. 2 gros.
Aux charretiers qui ont conduit les coffres et les livres du président, 3 fr. 12 gros, etc. ; en tout, 448 fr.
Ils étaient en outre défrayés pendant la route.
Si cette cour ne se composait toujours ainsi que de trois magistrats, elle ne devait sans doute la renommée dont elle jouissait qu'à la sagesse de ses décisions ou à l'étendue de ses pouvoirs.
Et il y a lieu de penser que telle était sa composition ordinaire, quand on voit le duc Antoine, en 1532, commettre le même nombre de membres.
(43) Arch. de Lorraine, Saint-Mihiel, 2, 41.- Rogéville, 1, 401.
(44) Hist. du parlement de Metz, par E. Michel, de Douai, conseiller à la cour de Metz.
Paris, Techener, 1845.
(45) François de Neufchâteau, anc. ordonnances, t. 2e, p. 153.
(46) Cette prévôté venait d'être occupée par un tailleur d'habits, nommé Sureau, à qui Charles IV l'avait donnée, La reconnaissance, par sa rareté chez les grands, peut seule excuser une semblable nomination. Ce brave Lorrain, se trouvant en Espagne pendant l'emprisonnement de ce duc, lui portait des lettres au péril de sa vie ; mais, ayant été découvert, il fut mis à la question, qu'il subit avec un courage héroïque sans qu'on pût lui arracher aucun aveu. De retour en Lorraine après bien des vicissitudes et avec les membres disloqués, le duc l'anoblit et le gratifia du titre de prévôt-gruyer d' Amance. Capitaine et magistral improvisé, ses honorables blessures lui furent sans doute fort utiles, aux yeux de ses justiciables, pour excuser son peu d'aptitude.
(47) Cette prévôté fut réunie eu 1722 à celle de Mandres-aux-Quatre-Tours.
(48) Ce bailliage exceptionnel n'ayant pas offert de ressources suffisantes aux magistrats pour y pouvoir vivre du produit de leurs épiées, fut supprimé en 1711 et réuni à celui du Bassigny. Les affaires criminelles ne pouvant être jugées que par cinq gradués, le siège était souvent impossible à compléter, faute d'avocats dans la localité pour y suppléer.
(49) Tome 8, p. 260.
(50)Le volume contenant les arrêts rendus pendant les années 1777, 1778, 1779 et 1780 manque depuis long-temps.
|