|
Un apôtre : A.
Limagne. L'Educateur. L'Homme d'oeuvres. L'Aumônier militaire
Ph. Gobillot
Ed. Paris, 1924
Ce jour-là, 27 décembre
[1915], la Division quitte les cantonnements où elle a refait
ses unités et s'est entraînée de nouveau à son esprit offensif;
elle s'en va, plus près de la frontière, tenir les tranchées
d'un secteur. Le P. Limagne dit adieu à ses hôtesses dévouées, à
la mère et à la fille, à celle que, toujours ingénieusement
délicat, il aime à nommer « Jeanne, la douce Lorraine » (2). Au
cours de la campagne, une première fois à cheval, une autre fois
à pied, il s'imposera un long voyage, trente kilomètres aller et
retour, pour venir leur prouver la fidélité de son reconnaissant
souvenir. Il a très vive, nous l'avons dit, la mémoire du coeur.
L'état-major de la Division s'établit à Saint-Clément, près de
la Meurthe ; les troupes traversent la forêt de Mondon, la
vallée de la Vezouse, et prennent leurs positions.
De suite, le P. Limagne se met à parcourir les tranchées. A ces
premières visites se rattache un épisode assez divertissant. Le
bruit s'était répandu, parmi les hommes, que des officiers
allemands, déguisés en officiers français, avaient été vus en
certains points de nos lignes, mais avaient disparu avant qu'on
ait pu les saisir. En voyant apparaître un aumônier qu'ils ne
connaissent pas encore, grand, à barbe blonde, et qui distribue
des friandises, les soldats de diverses escouades se demandent
s'ils n'ont pas affaire à un espion ; ils le reçoivent avec
défiance ; l'un même, après avoir accepté de lui un bonbon, le
rejette bien loin, de peur d'être empoisonné. Un sous-officier,
nouveau venu lui aussi, s'avance, interroge sévèrement le P.
Limagne, réclame des pièces d'identité, et, sourd à toutes les
explications qu'il lui donne, le conduit, sous escorte, au
colonel. Celui-ci est à table. Quel n'est point l'ahurissement
du sous-officier quand il le voit se lever, tendre les deux
mains au prisonnier, le faire asseoir à sa droite, tandis que
les officiers, égayés de l'aventure, lui font une ovation !
Avec l'aumônier titulaire de la Division, M. l'abbé Quénet, un
jeune prêtre très distingué du diocèse d'Amiens, très brave
aussi, très populaire près des soldats, le P. Limagne s'occupe
encore d'organiser le service religieux, la prière du soir, dans
les cantonnements de l'arrière.
Le 1er janvier, ils se trouvent à Marainviller. L'église a été
touchée par les obus : le toit est crevé, la nef tout en
désordre. On tâche de réparer les bancs, de remettre en place
les statues, de boucher avec du papier les fenêtres dépourvues
de leurs vitraux. A la grand'messe, le P. Limagne donne le
sermon. Pour la réunion du soir, des bougies seulement sont
allumées : l'église est en vue de l'ennemi.
Le 9 janvier, en pleine forêt de Mondon, c'est la solennité de
l'Epiphanie. Sous les branches d'arbres dénudés, quelques
planches abritent l'autel modeste. Aux hommes du 37e Territorial
qui l'entourent, le P. Limagne apprend à chercher, comme les
Mages, le Jésus de la crèche, à lui offrir leurs présents :
l'encens de leurs adorations, l'or de leur amour, la myrrhe
surtout, le don qui va à celui qui meurt après avoir souffert :
« Mêlons à la souffrance de l'Homme-Dieu notre propre souffrance
d'homme, de membre d'une famille, violemment arraché à son sein,
et dont le coeur est meurtri, de soldat qui couche sur la paille,
qui a froid dans ses habits mouillés, qui est sale de toute la
boue de la route, de la forêt, de la tranchée, qui reçoit à
chaque instant balles et obus et doit renouveler, à chaque
instant, le sacrifice de sa vie, ne sachant quel délai lui est
imparti pour l'accomplir. Ne perdons rien de cette douleur
débordante. Et marquons-la d'une acceptation surnaturelle qui la
transforme en mérites. Parfum merveilleux pour nous ensevelir,
s'il est l'heure, parfum efficace pour garder de la corruption
notre société, nos amis, nos camarades. Parfum sanctifiant qui
nous incline sous la même Croix que le Christ et qui transfigure
notre montée au Calvaire ».
C'est à ces territoriaux du 37e que le P. Limagne consacre les
prémices de son zèle sur le front. Leurs unités combattantes
occupent l'extrême droite du secteur, la partie la plus calme.
Et il voit encore les hommes du 81e Territorial, presque tous
des Bretons, occupés à des travaux sur les routes.
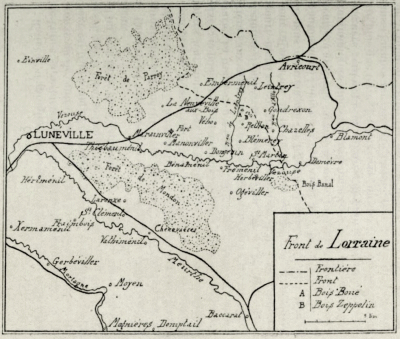
Pour l'ardeur de son âme, c'est trop peu : il voudrait se
dépenser surtout près de ceux qui peinent le plus, partager
leurs fatigues et leurs risques. Bientôt, sur ses instances, un
arrangement se conclura qui lui permettra de te faire tout à son
aise. Avec l'abbé Quénet il est entendu que tous les deux
s'occuperont de la Division entière ; toutefois, d'une manière
plus spéciale, le P. Limagne donnera ses soins à la 255e
brigade, M. Quénet à la 256e-. La première, commandée par le
colonel Coquelin de Lisle, comprend le 167e et le 168e
d'infanterie, régiments formés à Toul, peu de temps avant la
guerre ; la seconde est formée du 169e, aussi de Toul, et du
100e, de Tulle.
Rattaché, d'après les règlements, au G. B. D. (3) de la
Division, le Père a sa résidence officielle, près de
Saint-Clément, à Laronxe, poste central de cette formation
sanitaire. Mais le village est trop tranquille, trop
confortable, trop loin du bruit, à son gré. Il vient se fixer à
Bénaménil, au presbytère. De là, il lui sera facile de rayonner
dans toutes les directions du secteur.
Celui-ci est très étendu, une vingtaine de kilomètres. A
proximité de Lunéville et de Blamont, sa ligne convexe,
irrégulière, va de la forêt de Parroy, à gauche, au bois Banal,
tout près de Domèvre, à droite. C'est là que les Allemands,
après leur retraite du 13 septembre 1914, sont demeurés fixés ;
depuis lors, les positions des deux adversaires ont peu varié.
La frontière n'est qu'à cinq ou six kilomètres en arrière ; aux
mains de l'ennemi, nos villages de Emberménil, Leintrey,
Gondrexon, Chazelles, Domèvre ; plus loin, Avricourt, noeud
important de voies ferrées. Bien que réputé secteur calme,
c'est, en raison de son importance stratégique, le plus
mouvementé du front de Lorraine. Durant l'été et l'automne de
l'année 1915 qui vient de finir, des luttes violentes,
d'artillerie surtout, lui ont valu souvent une place aux
communiqués officiels. Aussi toute cette zone de mamelons,
naguère verdoyants de cultures, de prairies, d'oseraies, n'offre
plus que terres bouleversées, un spectacle de dévastation aussi
lugubre que celui qui, bientôt, sera donné par les abords de
Verdun. A l'intérieur de nos lignes, tout près du front,
Laneuveville, Vého, Reillon, Blémerey surtout, sont des cadavres
de villages, où les rats circulent à loisir ; les églises
s'ouvrent en larges trous sinistres.
A côté de Blémerey, l'église, une partie du village de
Saint-Martin, protégées par un repli du sol, sont encore debout
; le reste est à terre. Plus en arrière du front, le fort de
Manonviller n'est que ruines ; à Domjevin, les civils ont fui,
l'église est à moitié démolie ; le long de la lente et sinueuse
Vezouse, Marainviller, Thiébauménil, Bénaménil, Fréménil,
Ogéviller, reçoivent les projectiles des canons à longue portée,
mais, en somme, demeurent à peu près intacts ; enfin, situés
plus loin encore des tranchées, nous l'avons dit, Saint-Clément
et Laronxe sont indemnes de blessures.
Tel est, dans ses grandes lignes, l'aspect du secteur occupé par
la 128e division. Ces détails étaient nécessaires pour tracer le
cadre de l'activité apostolique du P. Limagne, situer d'avance
les divers terrains sur lesquels nous la verrons se déployer.
Comment, de fait, a-t-il exercé son apostolat ? Ce n'est guère à
lui qu'il nous faudra le demander. Il n'a pas eu le souci de
tenir le journal de sa campagne dans ses lettres du front,
pourtant fort nombreuses, mais en général très brèves, de loin
en loin, une rapide allusion à son ministère, jamais à ses actes
d'héroïsme. Sous un pseudonyme (6) il a publié divers articles
de journaux, où il raconte des scènes de guerre auxquelles il
assista ; mais il serait difficile, par eux, de se représenter
quel rôle splendide il a joué en ces tragiques circonstances
(4). En manuscrits, quelques' récits analogues, quelques
sermons. C'est tout (5). Pour suppléer à son silence, il nous
faudra interroger ceux qui, pendant les six mois passés en
Lorraine, furent les témoins, les admi-

rateurs de sa vie journalière : officiers, médecins,
prêtres-brancardiers, curés et paroissiens des villages où
cantonnaient les troupes.
A quatre années d'intervalle (l), malgré l'abondance des autres
souvenirs accumulés par des campagnes successives, le sien est
demeuré vivant dans leur mémoire. Que ne puis-je citer, dans
leur teneur, ces témoignages multiples ! Mieux encore que
l'admiration, dans ce concert de louanges, unanime et pourtant
indéfiniment varié, on saisirait sur le vif la vénération, j'ose
dire la tendresse émue, et l'effort d'une parole impuissante à
traduire tous les sentiments qui se pressent dans le coeur. Du
moins, l'éloquence des faits, à elle seule, parlera assez haut.
A la guerre, tous les aumôniers n'ont pas compris leur ministère
d'une façon identique. Le P. Limagne se refuse à croire que les
aumôniers de bataillon suffisent à assurer, près des hommes sur
la ligne de feu, les bienfaits du zèle sacerdotal. Dès le début,
il n'a cure de se borner aux ambulances (du reste, elles
possèdent des prêtres-infirmiers ou brancardiers), pas davantage
à l'état-major. Sans doute, il ne négligera point les officiers
des troupes combattantes ; la preuve en est que, parmi eux, il
comptera de nombreux amis (7). Mais c'est aux soldats, aux
humbles, qu'il veut réserver la meilleure part de son dévouement
; et il évitera avec soin tout ce qui pourrait compromettre son
influence sur ces âmes simples, facilement défiantes. Malgré ses
trois galons, il n'est pas d'humeur à jouer à « l'aumônier
officier ». De l'autorité militaire il a reçu une tunique de
capitaine ; il ne la portera jamais ; toujours il gardera la
soutane. Son éducation, sa culture, s'il n'écoutait qu'un
attrait naturel, le porteraient à se rapprocher davantage des
officiers avec lesquels il entretiendrait des relations
agréables ; mais il se dit qu'à les voir trop souvent, à
paraître se comporter avec eux en camarade, il risquerait, même
en faisant preuve d'intrépide bravoure, de passer, lui aussi,
aux yeux des soldats, pour un chef, un émissaire de
l'état-major, chargé de les surveiller, de les entraîner, au
besoin de leur « bourrer le crâne ». Et ce n'est pas seulement
aux heures périlleuses qu'il ira les voir ; c est
tous les jours qu'il viendra les visiter, partager leur vie,
leur donner des preuves d'un dévouement inlassable.
Par elle seule, cette continuité du sacrifice, du don de soi,
suppose déjà une vertu héroïque. Pour la mesurer, il faut encore
se représenter en quelles conditions ardues elle s'exerce.
Le secteur tenu par la 128e Division, avons-nous dit, est un
secteur calme, c'est-à-dire qu'il n'y a point de grands
engagements d'infanterie. Mais en face de Reillon, le point de
friction le plus chaud de tout le front de Lorraine, les
tranchées adverses ne sont séparées que par quelques mètres de
distance ; elles sont à la portée d'un jet de grenades, d'un
lancement de torpilles, et l'on ne s'en fait point faute. De
part et d'autre, des patrouilles fréquentes s'en vont faire une
reconnaissance, surprendre un petit poste et ramener des
prisonniers. Et, tous les deux ou trois jours, ces parages sont
secoués de fièvre : pour entraver le ravitaillement, démolir nos
travaux, l'artillerie lourde ennemie se déchaîne ; d'autant que
des crêtes qu'ils occupent, les Allemands ont une vue
merveilleuse sur nos organisations diverses. Donc terrain
âprement disputé, sans cesse en alerte, souvent très bruyant,
très meurtrier.
Et, en cet hiver 1916, toujours aussi la neige, la pluie, le
froid, le brouillard intense. La terre argileuse, imperméable,
ruisselle d'eau ; le sol, boueux, glisse sous les pieds. La
Vezouze, le ruisseau de Leintrey, leurs petits affluents,
débordés, transforment en lacs, en égouts, vallonnements, trous
d'obus, boyaux, tranchées. Les officiers, que leurs déplacements
successifs ont mis à même de faire des comparaisons, sont
unanimes à déclarer que ce coin de Lorraine est l'un des plus
épouvantables qu'ils aient vus.
Chaque jour, le P. Limagne s'en ira faire la visite du front
attribué à la 255e brigade : c'est la moitié droite du secteur,
à partir du ruisseau de Leintrey ; la zone aussi la plus
mouvementée, du moins en face de Reillon. Successivement, par
périodes de huit jours, le 167e et le 168e viennent y tenir les
lignes ; le régiment relevé s'en va, dans les villages de
l'arrière, jouir d'un repos relatif. Les unes après les autres,
jour par jour, d'une façon méthodique, le P. Limagne verra les
diverses unités qui sont à la peine. A ces visites, il apporte
son esprit d'organisation, de régularité. Bientôt il connaîtra
si bien tous les coins et recoins de nos lignes que souvent il
sera appelé à l'état-major de la Division pour donner des
renseignements sur telle ou telle tranchée ; et le général
Riberpray pourra s'écrier : « Il n'y a pas d'officier qui
connaisse mieux le secteur que Limagne ».
« Dès trois heures du matin, il est sur pied. Après avoir
soigneusement pris son réconfort spirituel : la méditation, le
saint sacrifice de la messe, en dépit de la canonnade, de la
neige, du vent, de la pluie, de la boue, il part de Bénaménil.
Casque en tête, au cou le ruban noir et jaune qui suspend la
croix d'aumônier, la soutane raccourcie aux genoux pour pouvoir
franchir les obstacles, par-dessus la soutane une capote
d'infanterie avec la croix de Genève ; guêtré de cuir, de lourds
souliers aux pieds, un solide bâton à la main, et... les poches
profondes, une ou deux musettes de toile, une énorme sacoche de
cuir noir, bondées de tous les cadeaux qu'il destine aux
soldats. Vingt à-trente kilos de charge. En cet attirail, il a
vraiment l'air d'un portefaix. Dans sa poche aussi, son repas de
midi : du pain avec un peu de chocolat ou de viande froide. De
son grand pas régulier, il marche. En route, il s'adjoint
gaiement le premier compagnon venu, agent de liaison, cuistot,
brancardier, toujours prêt à le soulager dans son âme et à se
surcharger encore d'une partie de son fardeau matériel.
Il arrive aux boyaux qui relient l'arrière aux tranchées. Dès
lors, quel voyage ! Tour à tour, ces couloirs sont fondrière ou
ruisseau ; malgré tous les efforts du génie divisionnaire, pour
en maintenir, par des planches et des poutres, les parois, des
éboulements se produisent, sans parler des marmites ennemies
qui, régulièrement, presque à jour fixe, viennent en faire un
gâchis innommable. L'eau atteint, dépasse souvent la hauteur des
genoux ; l'aumônier patauge dans cette boue, tantôt liquide,
tantôt à moitié solide, s'enlise dans les terres éboulées. Entre
les tranchées de seconde ligne établies sur une crête, au nord
de Reillon, et celles de première ligne, creusées sur la
déclivité en face, le fameux boyau de Toul circule, long de 600
mètres, avec ses multiples zigzags ; celui-là est vraiment un
égout collecteur ; on dirait que toutes les eaux du voisinage
s'y donnent rendez-vous ; quand il pleut, la boue liquide monte
jusqu'à la ceinture. Pour le parcourir, il faut près d'une
heure. En bas, au fond du ravin du bois Boué, le marécage
habituel est devenu, par l'effet de la bataille, un hideux
cloaque. Pour le franchir, il y a ce que l'on a galamment appelé
« le Passage de l'Opéra » : un pont de rondins, bordé, à droite
et à gauche, d'un amoncellement de grandes caisses de bois sans
fond ni couvercle, remplies de terre, rempart contre les éclats
d'obus, les balles, les regards indiscrets de l'ennemi.
Très souvent, soit que les boyaux, irrémédiablement obstrués,
entravent sa marche, soit qu'il veuille couper au plus court
pour visiter le plus de postes possible, le P. Limagne en sort,
s'avance en terrain découvert, impassible, froidement brave,
sous la mitraille du Boche. Un jour, un prêtre-brancardier se
permet de lui donner des conseils de prudence. « Mon ami, répond
le Père, si on voulait être prudent dans les circonstances
actuelles, on ne mettrait pas un pied l'un devant l'autre. La
position que vous me dites dangereuse, je veux la visiter avant
ce soir. Il doit y avoir là des blessés ». Et, quelques instants
après, il sort de l'abri et part.
Autre ennemi redoutable : le sol, martelé, creusé de trous
d'obus qui chevauchent les uns sur les autres, profonds de deux
mètres et demi, pleins d'une eau vaseuse. Sur la terre gluante,
son pied glisse, il trébuche, tombe dans l'un ou l'autre de ces
entonnoirs. Un jour, de son gourbi, un capitaine le voit
s'embourber dans un de ces trous fangeux, sous un feu
d'artillerie que les Allemands, après l'avoir aperçu, dirigent
sur lui, sortir seul de cette position périlleuse, et s'avancer
aussi calme, aussi souriant que s'il marchait dans un parc. Et
cet officier ajoute : « Combien de fois, tout comme le Christ,
est-il tombé sur ce sol bouleversé ? Dieu seul le sait » (8).
Enfin, après avoir affronté la mitraillera pluie, la neige, la
fatigue d'une longue marche à travers les innombrables détours
d'un maquis de boyaux, les éboulements, les trous d'obus
perfides, il arrive à la tranchée, trempé jusqu'aux os, « vêtu
de boue ». Dans la tranchée elle-même, aux parois, sur le sol,
toujours de la pluie, de la boue. Tous les quatre ou cinq cents
mètres, un guetteur est posté à son créneau, l'oeil braqué vers
les positions de l'ennemi. Un bon et large sourire sur les
lèvres, le regard très doux, caressant, la main cordialement
tendue, le P. Limagne l'aborde. Il lui adresse ses paroles
fraternelles ; avec lui, il s'installe au créneau et, par la
fente étroite, à travers une bande de terrain où s'entassent
réseaux barbelés, chevaux de frise, pieux, débris de sacs à
terre, de fils de fer hachés, emmêlés par les torpilles, tous
les deux surveillent la tranchée ennemie, toute proche, il
quelques mètres à peine. Et pendant ce temps-là, souvent, une
détonation bruyante retentit, un lourd obus part d'en face et
vient s'abattre dans notre tranchée. Instinctivement aumônier et
guetteur tournent aussitôt les yeux pour constater les effets de
l'éclatement formidable : gerbe de projectiles lancés dans tous
les sens, tranchée coupée, démantelée, chaotique. Une fois,
l'engin tombe à un mètre d'eux ; mais, sans éclater, il
s'enfonce dans la terre molle. Les obus français passent
au-dessus de leurs tètes, les frôlent presque, tant le point de
mire, la tranchée adverse, se trouve rapproché. Du reste, les
préférences du P. Limagne vont toujours aux coins les plus
exposés, là où le danger menace davantage, où il y a le plus
d'hommes à soutenir.
Tout en parlant, il puise dans son magasin ambulant et, avec un
doux sourire, à son interlocuteur il tend un petit cadeau :
paquet de tabac ou de cigarettes, pipe pour remplacer celle qui
a été perdue au dernier coup de main, savon (dans cette boue il
y a si souvent à en faire usage !), papier à lettre, crayons,
chocolat, bonbons, mouchoirs, tricots, cache-nez, chaussettes
bienfaisantes à des pieds toujours dans l'eau, brochure qui, aux
heures d'attente, fera trouver le temps moins long et fortifiera
le coeur, etc. Ces dons sont extrêmement variés. Et, chez le
grand pauvre qu'est le soldat, avec la difficulté pour lui de
s'approvisionner, ces articles divers provoquent une
reconnaissance émue, qui contribue largement à la cordialité des
rapports. Et il sait aussi découvrir des besoins plus
particuliers ; aux soldats provenant des régions envahies, aux
déshérités, à tous ceux qui se trouvent dans une situation
gênée, il vient en aide sans ostentation, s'ingéniant à tenir
cachés ses bienfaits.
Et l'aumônier s'en va trouver un autre guetteur à son créneau.
Très vite aussi, il a su dénicher les cagnas ou abris. Pour
descendre le couloir bas, étroit, qui y mène, il lui faut
courber sa haute taille. En se répétant, l'opération le laisse
tout courbaturé. A six mètres sous terre, dans cette chambre aux
parois suintantes, en compagnie des rats et des poux, il trouve
une vingtaine d'hommes, serrés sur des bancs grossiers, les
pieds dans une épaisse flaque d'eau boueuse. Ils essaient de
somnoler après leur service de nuit, ou, la pipe à la bouche, se
réchauffent autour du poêle et s'apprêtent à reprendre leur tour
de garde. Là, encore, poignées de main et sourire où passe le
don de soi total, paroles sorties du fond du coeur, mêmes
fouilles dans les insondables poches de sa capote et de sa
soutane, dans ses musettes ou sa sacoche.
En ces conversations dans les abris ou aux créneaux, le P.
Limagne avait une réserve inépuisable de paroles réconfortantes.
Simple, plein de bonhomie, il demande à chacun son nom, son
pays; il s'intéresse aux mille riens de sa vie journalière, à sa
famille, à ses peines ou à ses espoirs ; avec lui, il
s'entretient des événements de son coin de tranchée, des
camarades blessés ou morts. Son geste, son langage, s'adaptent
aux circonstances, aux gens, au milieu social ; coeur paternel,
il se met sans effort à la portée de tous. Pour gagner la
confiance, il n'a pas besoin du tutoiement ; jamais il n'y
recourt Du reste, s'il aime le soldat, il le respecte aussi, il
l'admire. Par exemple, il n'a point de goût pour le terme «
poilu » : ceux qui sont ainsi appelés n'ont point de poil dans
la main, et guère plus au visage (9). Sa bonne humeur, sa verve
naturelle trouvent le mot plaisant qui fait sourire et secoue la
timidité des confidences intimes. Il calme les inquiétudes des
uns, de ceux qu'énerve le retard des lettres impatiemment
attendues, ou qui originaires des pays envahis, restent sans
nouvelles des leurs ; il stimule les fatigués, prodigue à tous
les paroles affectueuses d'encouragement qui remettent d'aplomb
le moral. Et il a une manière si cordiale d'appuyer son bras sur
votre épaule, et de vous dire : « Cher ami ! ». « Tout de suite,
déclare, un médecin de bataillon, bien placé pour le voir de
près, tout de suite, vous étiez mis en confiance par sa manière
si simple de vous accueillir, de vous faire à vous plus qu'à
tout autre le don de son coeur. Comme il savait compatir à votre
quotidienne misère, à votre peine de l'éloignement des vôtres, à
la mort d'un ami !... Le soldat que quittait l'abbé Limagne
était plus calme, plus confiant, avait l'âme meilleure ; si
impie fût-il, il avait admis que le nom du bon Dieu fût prononcé
devant lui et à propos de lui-même » (10). Par cette confiance
mutuelle ainsi éveillée, l'aumônier préparait le terrain pour le
moment où l'on aurait besoin de son ministère. Du reste, combien
de fois, en surveillant ou ayant l'air de surveiller un créneau,
il a entendu la confession du guetteur ! Et, par exemple, quelle
joie pour lui quand, dans un petit poste, il trouve un soldat
auquel il demande si le temps ne lui paraît pas trop long et qui
lui répond, en lui montrant son chapelet : « Mais non, je tire
une bande de mitrailleuse, çà me raffermit le coeur » (11). Et
combien lui-même a distribué de chapelets et de médailles !
Souvent, le matin, il rencontre la corvée de café. En voyant, de
si bonne heure, leur aumônier, ces braves gens lui offrent un
quart de « jus ». Il accepte. Plus d'une fois, il mange à la
gamelle avec les soldats, tout comme l'un d'entre eux. Les
cuistots des roulantes se le disputent : « Monsieur l'aumônier,
une bonne assiette, du bon bouillon, un bon bout. de pain. - Eh!
bien, allons, trinquons ensemble, les enfants ! ». Il se borne à
prendre quelques bouchées, juste de quoi leur faire plaisir. Et
il continue sa tournée de visites.
« Jamais, dans son regard, la moindre lassitude des longues
marches si pénibles, dans la boue, à travers les innombrables
détours, les éboulis, les encombrements des boyaux... Si vous le
trouviez au tournant d'une tranchée, son visage était aussitôt
souriant et vous ne songiez pas que, quelques instants plus tôt,
ce même visage eût été en droit de trahir la fatigue d'un corps
toujours à la peine » (12). Ce n'est point qu'il n'ait à lutter
contre cette fatigue pour garder, malgré tout, la: cordialité de
l'accueil ; lui-même devait en laisser échapper l'aveu : « La
vie est dure ; et il faut faire effort pour maintenir toujours
Je sourire, le contact, l'entrain » (13). - En chemin, pour ne
point perdre de temps, quand la faim le harcèle, il grignote son
morceau de pain avec un bout de -chocolat, de saucisson ou de
viande froide.
Il s'arrête aux abris des officiers. « . C'est là, écrit l'un
d'eux, que plus fatigué que nous, plus trempé que nous,
méconnaissable, tant sa soutane était boueuse, il venait tous
nous voir pour nous réconforter par ses bonnes paroles si
pénétrantes et si affectueuses » (14). Il leur distribue des
revues, des livres d'un intérêt actuel et religieux. Sa visite
est courte, beaucoup moins longue que près des simples soldats,
car ceux-ci souffrent davantage. Il accepte bien un quart de
café, mais, avec un bon sourire, il refuse de s'arrêter pour se
reposer un moment ou s'asseoir à la table de la popote. Il n'a
pas le temps, il a encore beaucoup d'hommes à voir; d'ailleurs,
il a déjà déjeuné. Les officiers, du reste, ne tardent pas à'
s'apercevoir qu'il s'ingénie à venir les trouver assez avant ou
après les repas pour être plus en mesure d'opposer une excuse à
leurs instances. De loin en loin pourtant, il accepte. Assis sur
le banc plein de terre, il prend sa part des aliments froids, au
milieu des rats et des souris qui se promènent en liberté, et
des puces qui sautillent sur les assiettes. Il plaisante
gaiement sur les ébats de ces hôtes en surnombre. Pour tous les
officiers, sa présence est une fête : il y a tant de charme, de
cordialité dans sa conversation ! A l'adresse de chacun, il a un
mot affectueux. De ses musettes alors, il tire une boite de fine
conserve ; elle est la bienvenue, car, eux-mêmes, les officiers
ont à souffrir d'un ravitaillement difficile en un pareil
secteur. Quand il s'éloigne, il laisse aux âmes une impression
faite de douceur et de force : « Dans ces moments pénibles,
écrit le capitaine Colin, nous, croyants, nous pensions
davantage à Dieu, et aussi combien d'autres d'entre nous, peu
croyants ou n'osant le paraître ! De son passage nous
ressentions un bien-être délicieux qui nous transformait et nous
rapprochait du divin Maître » (15) Même note, sous la plume du
capitaine Cornet : « Il suffisait de le savoir près de soi pour
se sentir plus fort et devenir meilleur » (16).
Un médecin de bataillon nous a fait le récit de sa première
rencontre avec le P. Limagne, récit détaillé, tant les incidents
divers en demeurent profondément gravés dans sa mémoire. C'était
en février, par une nuit noire et brumeuse. Au fond de la sape
Kapelhof, poste de commandement d'un bataillon, à quinze mètres
sous terre, à cent mètres des Boches, le commandant et quelques
officiers dégustaient des huîtres et du vin de Bordeaux, régal
que venait d'apporter le cuisinier. A la lumière de l'unique
bougie, ils voient l'aumônier descendre les marches glissantes
de l'abri. Le Dr Lafitte, qui ne le connaît pas encore, est
aussitôt impressionné par la vue de cet homme, souillé de la
tête aux pieds, dont le visage, couvert de sueur, sourit sous le
masque de fatigue et s'illumine de jovialité : « Des huîtres,
Messieurs, quel luxe ici ! - Et à pareille heure ! » répond le
commandant Pierrard. Le P. Limagne cède à l'invitation cordiale,
il s'asseoit sur la banquette de terre. Il a marché toute la
journée, sa musette et sa gourde sont vides ; malgré la faim et
la soif qui le tenaillent, il se contente de deux ou trois
huîtres, de quelques gorgées de vin. A coup sûr, il ne voudrait
rien enlever à ses hôtes de la joie que leur procure un festin
aussi insolite ; il s'excuse même de la part si minime qu'il en
prend. La conversation se prolonge et le médecin, attentif,
observe que l'aumônier, pour y faire honneur, doit lutter contre
la fatigue qui s'appesantit sur lui. Puis, cédant à la bonne
humeur-causée par cet extra gastronomique en circonstance
pareille, on propose une petite promenade jusqu'à une sape où, à
vingt mètres des Boches, se terre un capitaine avec quelques
poilus : on y rira un brin, car le Docteur sera présenté au
capitaine comme un prisonnier allemand qui vient d'être cueilli.
A l'oeil du pseudo-prisonnier il n'échappe point que le P.
Limagne préférerait sans doute se reposer un peu ; mais non,
aimablement il se met de la partie. A tâtons, trébuchant, se
heurtant à chaque pas, on suit la trace d'un boyau démoli. Des
balles boches viennent siffler et s'aplatir sur le remblai ;
aussitôt, on se couche : « Ils ne dorment pas ! » dit
l'aumônier, du ton le plus simple. Et il aide son voisin à se
relever, quand il butte contre une motte de terre; et celui-ci
admire qu'il connaisse déjà, comme un vieux routier, toutes les
recettes de la sauvegarde sous le feu de l'ennemi. Dans la sape
du capitaine la joyeuse méprise n'est pas longue, mais il faut
parler à voix basse, les Allemands sont si près ! A n'en point
douter, ils entendent quelque chose. Au retour, leurs balles se
font plus drues et plus rapprochées: « Ils semblent mieux tirer
que tout à l'heure, mais ce n'est pas encore parfait », murmure
le P. Limagne qui tient l'arrière de la colonne et, par sa
présence, rassure ses compagnons. Un moment de repos à Kapelhof,
et, avec le Dr Lafitte et quelques autres, il regagne Reillon où
se trouve le poste de secours régimentaire. Le boyau de Toul est
démoli, ce n'est plus qu'un amalgame de planches disloquées, de
terres bouleversées, de fondrières. Il faut s'avancer à travers
champs, parmi les ténèbres épaisses. L'oeil de l'aumônier les
scrute dans tous les sens ; à ses compagnons il donne des
conseils avertis. Quand une fusée éclairante monte au ciel ; «
Ne bougeons pas, dit-il, restons debout ». « Je vois encore,
raconte le Dr Lafitte, sa grande stature se profiler sur le
terrain, immobile comme une statue, impressionnante de calme et
de sang-froid ». Quand la lueur s'éteint : « Repartons », dit le
P. Limagne. Souvent, il faut s'arrêter deux fois en une minute
et, chaque fois, son commandement bref et précis galvanise ses
compagnons de route et instinctivement les oblige à obéir. Du
bout de son bâton, il reconnaît le trou d'obus, l'arête d'une
planche brisée, le débris de fil barbelé qui rentre dans les
mollets, l'obus même qui n'a pas éclaté : « Attention ! »,
dit-il, et son bras relève celui qui s'est enlisé dans la fange
d'un entonnoir. Deux ou trois fois, il faut se coucher à plat
dans la boue, pour laisser passer la rafale des mitrailleuses.
Toujours, le P. Limagne se relève le premier, ranimant le
courage des autres. « Pourtant il est lui-même bien fatigué ;
mais il n'y songe pas pour ne s'occuper que de ceux qui sont
avec lui » (17). Et comme le Docteur le félicite de sa
connaissance du métier de soldat, aussi bien dans la tranchée
que sur le terrain, et lui demande s'il est au front depuis
longtemps : « Depuis peu, répond-il, mais il est si facile de
s'adapter ! », et le médecin s'en veut presque, lui qui a un
plus long séjour au front, de ne s'être pas encore adapté à ce
point. Tel fut, pour lui, le début d'une très vive amitié, où se
mêlaient l'affection, l'admiration, le respect.
En dehors des bombardements d'une intensité systématique,
souvent hélas ! il y a dans la tranchée, des morts, des blessés.
Avec les hommes, le P. Limagne se met à relever les, tués, à
chercher dans la boue les morceaux de chair, pour les envelopper
dans une capote ou dans un sac, de peur qu'il ne s'en égare.
Près du brancard des blessés, il s'attardera de longues heures,
tenant compagnie aux malheureux, pansant leurs plaies, les
consolant jusqu'à ce que, dans les ténèbres, on puisse les
transporter vers l'arrière.
Quand, le soir, souvent à dix heures ou même onze heures,
l'aumônier revient au presbytère de Bénaménil, il est harassé de
fatigue, mouillé, revêtu de boue jusqu'au-dessus de la ceinture,
mais toujours calme et souriant. « Oui, je suis un peu sale
aujourd'hui », fait-il observer à son ordonnance, le brave
Roumier. Tous les jours, il lui faut changer de soutane ; trois
sont ainsi, à tour de rôle, en service ; deux jours sont
nécessaires pour les faire sécher. Sa nourriture lui est arrivée
de Laronxe, froide naturellement. Sans s'asseoir, appuyé contre
la commode, il y touche un peu, pas plus de cinq minutes. Et il
se met à répondre, sans retard, au volumineux courrier qui lui
est parvenu dans la journée ; une fois, portant ses lettres à la
poste, l'ordonnance remarque qu'il en a écrits avant de se
coucher, plus de quatre-vingts.
La plupart, évidemment, sont assez courtes, suivant sa coutume,
allant droit au but, d'une alerte cordialité. Malgré la rapidité
de sa plume, on juge de la surcharge, après des journées
pareilles. Et, à trois heures du matin, sinon à deux, il est sur
pied. Une fois, son ordonnance le surprend tout habillé sur son
lit, alors qu'il est revenu brisé de fatigue. Deux heures avant
le jour, il dit sa messe et, après un déjeuner aussi maigre que
le repas de la veille au soir, il repart. L'hiver entier se
passe de la sorte. A dater des fêtes de Pâques, les instances de
Roumier ont enfin obtenu qu'il prenne pension, pour ses repas, à
la table de la mère du curé. Jusque-là, aux motifs tirés de la
santé il n'avait point voulu se rendre, par crainte, dans sa
charité délicate, de causer un dérangement, même payé. Dès lors,
son régime sera plus substantiel ; il est vrai que l'esprit de
mortification prend, tout de même, sa revanche ; et, le soir,
quand il revient plus tard que sept heures, ce qui est le cas
habituel, il se contentera d'un bol de café au lait. A sa soeur
Marie, religieuse Trinitaire, il écrivait alors qu'il était trop
bien, que çà ne pouvait durer.
Mais la plupart des tournées du P. Limagne se font la nuit.
Souvent, en effet, les pluies continues, les bombardements
prolongés, ont rendu impraticables les boyaux d'accès, surtout
le principal, le boyau de Toul, et il faudrait circuler
longuement en terrain découvert, sous la menace perpétuelle des
obus et de la mitraille. Et, par endroits, il y a des tranchées
complètement isolées des autres, sans communication directe par
boyaux avec l'arrière. Là aussi, ravitaillement en munitions, en
nourriture, service postal, relève de blessés, sont impossibles
de jour. Les routes mêmes de Vého à Reillon, de Reillon à
Blémerey, se trouvent constamment sous le feu de l'ennemi ; la
circulation en camions automobiles ne peut s'y effectuer qu'à la
faveur des ténèbres et alors il n'est jamais permis d'allumer
même une lampe de poche. Le village de Reillon est à ce point
sous le regard des Boches que, pour leur dérober les mouvements
de troupes dans la rue, leurs va-et-vient aux abris creusés dans
les jardins des maisons en ruines, il a fallu édifier, du côté
le plus en vue, une haute palissade de fascines, percée d'une
immense porte cochère dont les battants, garnis de paille contre
les projectiles, ne s'ouvrent qu'après la chute du jour.
Quand donc le P. Limagne veut aller passer la nuit en première
ligne, vers cinq heures du soir, il arrive au poste de secours
de Reillon, installé dans la cave d'une maison démolie. Sur
l'une des couchettes superposées, que les majors ont mise à sa
disposition, simple treillis garni d'un peu de paille jamais
renouvelée, il prend un court repos. Au milieu de la sarabande
des rats qui lui passent sur le corps, sur le visage, il ne
sommeille guère. Entre huit heures et demie et neuf heures, il
se lève, charge sur ses épaules ses musettes, « ses inimitables
musettes » (18) et il part. Dans les boyaux, il croise les
soldats du génie, les fantassins dits « au repos », mais qui,
cinq heures par nuit, viennent s'acharner, dans l'obscurité
totale et le silence, à la rude tâche de remettre en état ces
galeries sans cesse inondées d'eau et de boue ou ravagées par
les marmites boches.
Pour aller plus vite et se rendre à un plus grand nombre de
postes, d'ordinaire il renonce au long dédale des boyaux, et
s'engage sur les pistes étroites. Elles sont particulièrement
dangereuses, mais qu'importe ? A droite et à gauche du sentier,
des flaques d'eau rapprochées, qui sont autant de trous d'obus.
Dans la nuit sombre, il s'avance ainsi à travers les champs
dévastés. Un faux pas, et le voila à mi-corps dans l'une de ces
mares ; de loin en loin, son pied heurte et il s'abat sur des
rondins que les porteurs ont abandonnés en route, sur des débris
de fils barbelés mis en miettes par les projectiles ; il se
relève, les membres contusionnés, meurtris ; une fois, entre
autres, il a une main, le visage sérieusement déchirés. Et il y
a le risque de rouler dans un boyau, en se cassant la jambe.
Dans le grand silence, les coups de fusils, de canons, se
répercutent, s'amplifient. Souvent ce sont de vraies rafales de
balles et d'obus. Par intervalles, de l'un et de l'autre côté du
front, les fusées blanches s'élèvent, dessinent la ligne des
tranchées et, de leur lumière vive, éclairent ce terrain désolé.
Mais ensuite la nuit en parait plus noire. Et comment gagner la
tranchée qu'il a inscrite à son programme ? Le sol n'est que
trous d'obus sur trous d'obus, tranchées sur tranchées, boyaux
s'enchevêtrant aux trous et aux tranchées, allant partout et
n'aboutissant nulle part. De jour, pour se reconnaître, il faut
déjà un long apprentissage. Mais la nuit ! Les unes après les
autres, l'aumônier essaie diverses voies d'accès.
Quand enfin, après toutes ces péripéties diverses, il arrive au
point désiré, il n'est pas seulement boueux, il ruisselle de
sueur. Dans la tranchée silencieuse, aux heures d'obscurité
intense, pour se diriger, il lui faut palper les parois avec les
mains, les explorer du bout de son bâton. Et ce n'est pas
facile, non plus, de découvrir la silhouette du guetteur, fondu
en quelque sorte avec la terre. Il se place à côté de l'homme,
l'entretient à voix basse, avec lui tend l'oreille au moindre
bruit, surveille le terrain à chaque nouvelle fusée, avec lui
partage longuement la pluie fine, la neige, le froid. Et ainsi,
à tâtons, il va d'un poste d'écoute à un autre. Le mince rayon
de lumière d'une bougie, qui filtre à travers l'étroite
ouverture, lui dénonce les abris souterrains. A tour de rôle,
ils reçoivent sa visite. De ces entrevues, nous n'avons pas à
redire quel est, au point de vue matériel et moral, le caractère
d'affection réconfortante.
A diverses reprises, pour se donner davantage encore à ce
ministère de charité, le P. Limagne passe trois ou quatre jours
consécutifs sans revenir à Bénaménil. Il dort, à Reillon, dans
la cave du poste de secours. De bon matin, avec les brancardiers
prêtres qui s'y trouvent, il dit la messe tout près du cimetière
souvent visité par les marmites, sous un hangar improvisé,
couvert de paille, aux cloisons de mince tôle, trouées comme une
écumoire par les éclats d'obus. A cette heure, d'habitude, une
accalmie se produit dans la canonnade ; mais, plus d'une fois,
la messe s'achève dans un vrai tir de barrage. Un peu plus tard,
le Saint Sacrifice se transporte dans les débris d'une maison ;
mais bientôt, deux obus, arrivant coup sur coup, en achèvent la
ruine. On revient près du cimetière, dans un abri de
bombardement qui a donné ses preuves de résistance sous le choc
des lourds projectiles.
D'autres fois, le Père couche à Domjevin, dans une cave
quelconque, sur un peu de paille.
A Bénaménil, quelles qu'aient été les fatigues de la journée, à
la moindre alerte, dès qu'un bombardement plus vif interrompt
son sommeil à peine commencé, le voilà debout. Sur sa poitrine,
il prend la Sainte Eucharistie pour en nourrir ceux qui veulent
puiser en Dieu la force. Et il part seul, franchit les tirs de
barrage, arrive aux postes de secours avancés, pousse jusqu'aux
tranchées de première ligne, se porte rapidement aux points les
plus exposés, là où, par le fait du danger, il peut rendre le
plus de services aux corps et aux âmes. Plus d'une fois, sous
les coups d'obus, des abris s'effondrent. Alors il s'y précipite
et, sans souci du péril, il aide les hommes à dégager, à sauver
les malheureux ensevelis.
Au début, sa bravoure simple, sans forfanterie aucune,
déconcerta un peu. Mais bientôt, à force de le voir aux endroits
les plus tragiques, on s'y habitua comme à la chose du monde la
plus naturelle. « Il était, déclare un médecin de bataillon,
partout et toujours au plus fort du danger ; sa présence était
si accoutumée que, seuls, ceux qui, trop nombreux hélas !
avaient besoin de son ministère, la remarquaient. N'eût-il pas
été là, nous aurions senti qu'il nous manquait. Mais, quand le
moment était pénible et la bataille rude, nous le savions
toujours présent, nous n'avions pas à le chercher » (19).
Les territoriaux auxquels il avait consacré les prémices de son
ministère sur le front, le P. Limagne ne les abandonne pas.
Leurs tranchées, nous l'avons dit, se trouvaient à la droite du
secteur, tranchées relativement calmes, à 800 mètres des Boches.
L'aumônier pouvait aller les voir de jour. Presque
depuis les débuts de la guerre, ils étaient là, rattachés
successivement aux diverses divisions qu'ils voyaient se
remplacer à côté d'eux. Comme on le disait avec pittoresque, ils
faisaient partie du « matériel du secteur ». Le P. Limagne
aimait ces « pépères », aux tempes grisonnantes, employés à de
dures corvées, monotones, sur les routes ou dans les boyaux,
montant la garde, les yeux toujours fixés sur le même horizon,
sans espoir d'aller, comme les divisions d'attaque, contempler
d'autres cieux et goûter, après la ruée farouche, de longs repos
à l'arrière. Aux coups de l'ennemi, à défaut d'une jeune ardeur,
ils opposent la ténacité stoïque. Ces territoriaux du 37e sont
originaires de l'Yonne ; « ils n'ont vu le prêtre qu'à travers
La Lanterne ; cela m'incite, ajoute l'aumônier, à leur en
montrer un selon l'Evangile » (20).
Plus à droite encore, près du Bois Banal, il y a un escadron du
6e Chasseurs à cheval. Ceux-là ont dit adieu au beau costume
pimpant, au sabre long, aux furieuses randonnées. Comme les
fantassins, ils montent la garde aux créneaux, portent de lourds
rondins, établissent des sapes résistantes dans leur marécage,
creusent un boyau, bien défilé vers l'arrière. Pour aller à eux
avec tout son coeur; le P. Limagne a le souvenir et le deuil de
son jeune frère, qui, lui aussi, avait renoncé à son cheval de
bataille pour devenir un héroïque fantassin.
Et il s'impose de longs détours pour visiter les artilleurs,
artillerie lourde postée vers la route de Domjevin à Blémerey,
artillerie de campagne dissimulée dans des restes de boqueteaux.
Un jour qu'ils avaient été copieusement arrosés d'obus, les
artilleurs d'une batterie ne furent pas médiocrement surpris de
voir s'avancer vers eux un ecclésiastique qu'ils ne
connaissaient pas encore et qui, sans s'émouvoir des coups de
l'ennemi, venait s'enquérir s'ils n'avaient point de blessés.
C'était le P. Limagne. Pour gagner leur affection, c'était un
beau début.
CHAPITRE VI
Sur le front de Lorraine
(Décembre 1915-Juin 1916). - II
Combien d'autres épisodes nous permettraient de voir le P.
Limagne à l'oeuvre, de mesurer à quel point il dépensait, sans
compter, dévouement, abnégation, bravoure intrépide !
Dans la nuit du 1er au 2 février, de six heures à minuit, il
avait parcouru des tranchées du 169e d'infanterie, apportant
avec lui la joie, les réconforts matériels et spirituels. Il
veut maintenant passer à un bataillon du 167e, dont les
tranchées, au lieudit le Verger, sont les plus souvent arrosées
de mitraille, d'obus, de grenades. Il sait la direction en gros
: il lui faut traverser une plaine coupée par une petite
rivière, rejoindre une route et, par delà Reillon, pénétrer dans
les boyaux. Les ténèbres sont épaisses : il tombe, se relève,
s'avance en tâtant le terrain, de son bâton. Il se heurte au
bourrelet d'une tranchée, profonde de deux mètres ; il a failli
y rouler. Pour y descendre, il s'accroche aux piquets. Il la
suit ; au bout d'un certain temps, il s'aperçoit qu'elle le
conduit trop à gauche ; pour en sortir, il se cramponne, se
salit, aux parois suintantes ; quelques pas plus loin, il tombe
dans une oseraie baignée d'eau ; plus il avance, plus il y a
d'eau et d'osier. Pour se reconnaître, il allume sa petite lampe
électrique. Aussitôt une balle siffle sur sa tète : évidemment,
il y a, en face, un guetteur boche, à qui la lueur de la lampe a
dénoncé une cible vivante. Il songe que, si le jour le surprend
ainsi embourbé, en terrain découvert, c'en est fait de lui. Par
une prière fervente, il se recommande à Dieu. Il parvient à
s'écarter de l'oseraie ; quelques minutes après, son pied glisse
; c'est une rivière ; d'un peu plus, il s'y renversait. Pour en
mesurer la largeur et voir s'il peut la sauter, il allume encore
sa lampe : de nouveau, les balles sifflent à ses oreilles. La
rivière est trop large pour la franchir d'un bond ; il s'y
engage toutefois, mais il enfonce déplus en plus. Il revient sur
ses pas, palpe de ses mains ce sol décevant ; il se dit qu'en
cette posture, il ne donne guère prise aux balles, qu'il peut,
sans crainte, cette fois, recourir à l'éclairage électrique. De
nouveau les balles crépitent autour de lui. Décidément le
guetteur a l'oeil attentif. Pour arriver, le plus sur, c'est de
se résoudre à un long détour. A tâtons, longuement, péniblement,
il regagne le boyau quitté naguère et, après six ou sept
kilomètres sur la route, à quatre heures du matin, parvient aux
tranchées qu'il veut visiter. Voilà par quelles fatigues, quels
dangers, il a acheté la joie de retrouver ses chers soldats, de
s'asseoir auprès d'eux, tout souriant.
Le samedi matin, 12 février, les Allemands se montrent aux
créneaux, aux parapets de leurs tranchées et, d'un air
débonnaire, ils crient : « Kamarades Françous ! » Les nôtres se
mettent aussi à leurs créneaux, pour jouir du spectacle de cette
bonne humeur. Quelques-uns, plus défiants, flairent là un piège
de l'ennemi pour se ménager des victimes ; ils épaulent leurs
fusils. D'autres les retiennent : « Laisse donc ! Çà t'avancera
bien d'en amocher deux ou trois. Tu nous feras marmiter toute la
journée. Si tu leur f... la paix, ils nous la laisseront ». Et
les fusils reprennent leur place au repos. Subitement un vacarme
formidable : les obus de gros calibre s'abattent sur nos
tranchées, du ruisseau de Leintrey jusqu'au delà du bois
Zeppelin, occupé alors par les Boches : pauvre bois déchiqueté,
qui doit son nom à la ressemblance que ses débris tracent sur le
sol. C'est en face de ce point, sur la ligne occupée par un
bataillon du 108e, que le bombardement redouble ses coups. En
même temps, les 77 font du barrage en arrière, pour isoler la
tranchée, la couper de tout secours ; les ruines de Vého, de
Reillon, achèvent de s'écrouler. Et voici qui est plus grave :
les torpilles aériennes. Elles creusent des trous si larges, si
profonds, qu'une quinzaine d'hommes pourraient s'y tenir debout,
à l'aise ; et elles sont déprimantes par le fracas de leur
éclatement, le véritable tremblement de terre qu'elles
provoquent.
Au bruit de la canonnade, le P. Limagne accourt. Mais le boyau
d'accès est coupé par les explosions de torpilles : les planches
des parois, les fils de fer, les poutres, aménagés avec tant de
soin par le génie, ne forment plus qu'un mélange inextricable,
dont les angles, les pointes déchirent ses vêtements, ses mains,
sans parler de l'eau et de la boue. Et il est à découvert,
exposé aux coups de l'ennemi. Il n'avance qu'en se livrant à une
sorte de gymnastique ; plus d'une fois, il est obligé de ramper.
Il aperçoit une ligne téléphonique coupée : il la répare. Il lui
a fallu plus d'une heure pour parcourir une faible distance.
Enfin, il arrive aux tranchées. Les uns après les autres, il
parcourt les abris souterrains où les hommes se sont réfugiés.
Il les trouve, malgré leur courage, affolés par la commotion
nerveuse des explosions formidables, par le spectacle de ce
bouleversement universel, leur isolement de l'arrière, resté
sans doute dans l'ignorance de leur détresse, l'impossibilité de
se voir ravitaillés, la perspective de la faim. Et les mines
maintenant s'ajoutent aux obus et aux torpilles. Un abri est
comme absorbé dans un trou béant qui projette en l'air un homme
et en engloutit quatre. Plus loin, deux autres camarades sont
enterrés vivants. Ces abris deviennent des tombeaux. Et pas
moyen de porter secours aux malheureux ensevelis. Un des
combattants devient sourd et muet ; un autre perd la raison, il
balance la tête, hébété ; un sergent tombe, le ventre ouvert par
une plaque de tôle projetée en l'air avec violence ; les
intestins déchirés sortent par l'horrible plaie; à plusieurs
reprises, il crie: « Maman ! maman ! », et, après quelques
minutes d'agonie, il expire.
A ces hommes désemparés le P. Limagne apporte la confiance ; il
les assure qu'ils ne sont pas abandonnés à leur sort, le
colonel, le général de brigade sont avertis, des renforts
d'artillerie approchent ; nos canons n'attendent que la vague
d'assaut ennemie pour faire du bon travail. Les visages
assombris se détendent. Et l'aumônier se prodigue près des
blessés, des agonisants qu'il prépare à la mort.
Le bataillon est coupé en sections isolées ; par-dessus les amas
de terre bouleversée qui les séparent, il va de l'une à l'autre,
s'exposant, sans cesse, à tomber, frappé d'un obus ou englouti
par un nouveau trou de mine soudainement ouvert. Pour rejoindre
les blessés, il prête l'oreille, se guide sur les cris qu'il
entend avec peine, dans le fracas de la canonnade.
Et la pluie de fer continue toujours ; pas un morceau de pain
n'est venu de l'arrière ; la faim ajoute, pour les hommes, son
tourment aux fatigues physiques et morales de cette journée
d'angoisses.
Ici, je laisse la parole au commandant Philippe; sous sa plume,
à quatre années de distance, on trouvera toutes vibrantes encore
les émotions de ces heures dramatiques :
« Dans la nuit, je reportais mon poste de commandement à 150
mètres en arrière avec une quarantaine d'hommes pour unique
troupe de soutien, dans l'abri Kapelhof, y attendant soit un
effondrement, soit une attaque boche.
« Le premier, le seul homme que je vis arriver dans cette nuit
tragique, fut l'abbé Limagne, couvert de boue, la soutane en
morceaux.
« J'ai fait quatre fois Verdun et dans les mauvais endroits de
la rive droite de la Meuse (Fleury, les Caurières, Samogneux) ;
eh ! bien, aucun coin de Verdun n'a jamais été aussi difficile à
parcourir que cette terre argileuse de Lorraine, avec des trous
de 2 m. 50, un chaos de bouts de tranchées et de boyaux nivelés,
un sol glissant et boueux. Je me demande encore comment avait pu
faire l'abbé Limagne pour nous joindre, sans guide, en pleine
nuit de février.
« Il descendit donc dans notre abri. Je lui expliquai notre
situation vraiment tragique : ma ligne défoncée, mes abris
démolis, les fusils boueux qui ne marchent plus, les munitions
enfouies, aucune communication possible, une attaque probable
pour le lendemain, etc.
« L'abbé Limagne nous redonna confiance et, malgré moi, voulut à
tout prix nous quitter pour aller en première ligne, réconforter
les quelques hommes qui restaient, et prier, les genoux dans
l'eau et la boue, en pleine nuit, à quelques mètres des Boches,
sur les entrées d'abris effondrés, où quelques-uns de mes hommes
avaient trouvé, dans la journée, une mort affreuse et glorieuse
pour la France.
« Il vint me retrouver après avoir marché ainsi toute la nuit.
Je le chargeai alors de porter à mon colonel, à Reillon, un pli
important dans lequel je lui exposais ma situation. Le pli
parvint à destination. Mon colonel, mis au courant, me fit
protéger par tout un groupe supplémentaire du 20e Corps d'armée
et quand, le lendemain, les Boches sortirent pour m'attaquer,
ils furent arrêtés par un barrage d'artillerie tel que je n'en
ai jamais vu de pareil, même à Verdun !
« Je dois ajouter que c'est grâce à l'abbé Limagne que j'ai
obtenu la seule citation à l'ordre de l'Armée de toute ma longue
campagne. Seul homme venu de l'arrière pour me voir, il avait
pu, en effet, constater la situation dans laquelle je me
trouvais, la décrire aux grands chefs, raconter comment il
m'avait vu, moi aussi, visitant ma première ligne et mes petits
postes, en pleine nuit. Cela m'est arrivé bien d'autres fois
dans des circonstances aussi graves, mais il ne s'est plus
trouvé d'abbé Limagne pour le voir et pour le dire.
« C'est ainsi que, pendant ces circonstances dramatiques des
journées de février 1916, journées des plus terribles que j'aie
passées pendant les longues années de guerre où j'ai commandé un
bataillon du 168e régiment d'infanterie, j'ai connu et apprécié
les qualités de coeur et de courage de l'abbé Limagne. C'était un
homme brave et vraiment bon, humble et modeste, aimant les
humbles, les petits, les poilus, n'hésitant pas à braver la boue
et les obus pour venir leur porter des paroles d'encouragement
ou ses prières.
« C'est pourquoi, parmi mes souvenirs de guerre, je conserve
ineffaçable celui de notre aumônier du Zeppelin » (21)
Je n'ai pas voulu interrompre la splendeur d'un pareil
témoignage. Donc, le lendemain, dimanche 13, le bombardement de
notre ligne recommença aussi formidable. En ces deux journées,
huit mille obus de tous calibres furent déversés sur un front de
400 mètres. Aux brancardiers venus pour emporter les blessés, il
faut six heures pour faire un trajet de trois quarts d'heure.
Mais, aux moments opportuns, notre artillerie se déchaîne avec
fureur. Quelques Boches seulement s'aventurent par un boyau
d'écoulement ; des grenades étendent les premiers, les autres
s'enfuient.
Ce jour-là encore, cela va sans dire, le P. Limagne se montre
aussi dévoué, aussi héroïque. Il rapporte même un blessé sur son
dos. Dès lors, pour les soldats, il est « l'aumônier du 12
février », un « as », titre dont ils sont loin de se montrer
prodigues. « C'est un costaud », disent-ils, ou encore, dans
leur savoureuse crudité : « En voilà un qui n'a pas la trouille
».
Le 22 février, en l'église de Bénaménil, il célèbre un service
funèbre pour les victimes de ces terribles journées. « Un
catafalque a été dressé, recouvert en partie des couleurs
nationales. Pas une couronne, pas une fleur. L'office se déroule
dans sa belle simplicité liturgique. A deux reprises, moulant
dans le profond silence les émouvantes lamentations d'un violon
que fait vibrer, avec toute son âme, un caporal, premier prix du
Conservatoire de Rennes.
« Avant de donner l'absoute, l'aumônier évoque très simplement,
comme un soldat au milieu de ses camarades, comme un frère au
milieu de ses frères attristés, le souvenir de ceux pour qui il
vient de prier et dont l'image, présente à la mémoire, hante
l'esprit de leurs compagnons assemblés autour du catafalque.
« Il parle de la Patrie ; des sacrifices qu'elle a demandés et
qu'elle demandera encore, des récompenses terrestres si
disproportionnées avec l'effort accompli ; des récompenses
éternelles.
« Pas de déclamation. Presque pas de gestes.
« Je ne veux pas, dit-il, vous émouvoir, mais seulement vous
instruire un peu ». Et chacun se sent la gorge serrée et des
larmes effleurent les cils » (22).
Le lendemain, 23, le général Riberpray citait le P. Limagne à
l'ordre de la Division, avec ce motif :
« Le 12 février 1916, a tenu il parcourir les tranchées de
première ligne bouleversées par un violent bombardement
d'artillerie lourde et de minenwerfer. En dépit du danger, s'est
porté d'abri en abri sous le feu ennemi pour exercer les
fonctions de son ministère et réconforter les hommes blessés ou
ensevelis ».
Le 7 mars, à Laronxe, par un temps très froid et la neige
abondante, une assistance nombreuse, civils, soldats au repos,
prêtres-brancardiers, piquet d'honneur, se dirige vers un coin
isolé du village, devant la modeste maison qui sert de centre au
G.B.D. C'est la que des mains du Dr Friant, médecin
divisionnaire, le P. Limagne doit recevoir la croix de guerre.
Sur la route, il voit le vénérable curé de la paroisse s'avancer
avec peine, appuyé sur un bâton. Il se précipite vers lui et
affectueusement lui reproche de s'être, avec une jambe malade,
imposé ce long trajet pour venir lui donner cette nouvelle
marque de profonde amitié. « Monsieur l'aumônier, répond le bon
prêtre, je n'ai fait que mon devoir; pour tout l'or du monde je
n'aurais manqué devenir ici ; même quand il m'aurait fallu m'y
traîner sur mes genoux, j'y serais venu, bon gré, mal gré vous »
De Boulogne, où l'avait chassé la destruction de sa ville
d'Arras, l'héroïque Mgr Lobbedey envoie au nouveau décoré; ce
billet charmant :
« Cher ami, vénérable chanoine, vaillant aumônier, salut, paix,
joie, félicitations.
« Ascension d'une âme (Père Chanel) (23) par le chanoine
Limagne, verbo, scripto et... opere ».
Cette croix de guerre, le P. Limagne l'envoie à son collège,
pour être déposée aux pieds de Notre-Dame de Lourdes, dans la
chapelle de Congrégation. Filial hommage à sa mère du ciel.
L'émotion des 12 et 13 février à peine calmée, dix jours plus
tard, une canonnade furieuse se déclenche à nouveau, sur la
droite du front tenu par la Division (24). L'inquiétude est vive
: pour l'un de nos bataillons, c'est l'heure de la relève ; sous
ce feu, que vont devenir les troupes en marche ? En réalité,
l'attaque est menée plus à droite, sur les territoriaux du 37e,
un peu au nord de Saint-Martin. Une troupe d'assaut a tenté de
pénétrer dans leurs lignes, d'y faire des prisonniers ; les
territoriaux résistent vaillamment. Le P. Limagne se trouvait à
Domjevin : aussitôt, il s'informe, s'oriente et à grands pas se
porte vers le terrain de la lutte. Le tir de barrage est intense
; n'importe, résolument il s'y engage ; il réussit à le
traverser. En pleine nuit, il arrive sur le champ, de bataille.
Il le connaît mal ; même de jour, l'organisation restant encore
insuffisante, il est difficile d'y circuler à l'aise ; point de
guide pour le conduire : chacun doit rester rivé à la consigne
qui lui a été donnée. Seul, dans les ténèbres, il lui faut se
diriger vers ceux qu'il voudrait préparer à comparaître devant
Dieu. « La lutte est depuis longtemps terminée que l'aumônier
est encore là, parce qu'il reste des mourants à assister, des
blessés à porter et que ses épaules sont solides. Quand il s'en
va, c'est que sa besogne est, pour ce soir, finie. Il n'aura
plus, demain, qu'à enterrer les morts et à prier pour eux »
(25).
Le 9 mars, les Allemands bombardent avec violence nos positions,
en avant du bois Boué ; le soir, le tir redouble ses ravages. A
l'aumônier qui se trouve dans les tranchées de première ligne,
on apprend qu'un blessé est tombé à quelques centaines de
mètres, gravement atteint. Les boyaux de communication
n'existent plus : tout a été bouleversé, nivelé par les
projectiles énormes. Sans hésiter une seconde, il enjambe les
décombres, saute de trou d'obus en trou d'obus, pleins d'eau,
et, en terrain découvert, poursuivi par les balles qui frappent
la terre autour de lui, il arrive au blessé. Un peu plus tard,
questionné par un commandant sur les dangers qu'il a courus, il
répond simplement : « Je n'ai pas vu le danger, mais je devais
secourir le malheureux ». Et le témoin, après nous avoir raconté
la scène, ajoute : « Ceci n'est qu'un fait parmi tant d'autres.
Le valeureux aumônier était coutumier des actes de ce genre »
(26).
En voici encore un. Le 21 mars, le téléphone l'appelle près d'un
blessé. Il part avec un médecin de bataillon (27). Tous les
deux, ils parcourent des centaines de mètres, dans un boyau
plein d'eau. A un endroit, le boyau est obstrué ; il faut le
quitter en rampant dans la boue, faire une trentaine de mètres,
en sautant, cette fois encore, d'un trou d'obus à un autre,
tandis qu'un Boche, installé à son créneau, ne cesse de tirer
sur le prêtre et le médecin. Enfin, ils arrivent près du blessé,
étendu sur un brancard. Le P. Limagne reconnaît un jeune
caporal-fourrier de vingt-deux ans, enfant de la joyeuse
Provence, courageux soldat, excellent camarade, de plus, croyant
: fier de sa croyance et de sa pratique chrétienne. « En son
coeur, chantait un amour printanier et enthousiaste, il se savait
attendu dans sa ville pour aller à la mairie, à l'église, à la
vie, avec une compagne de son choix ». Tout à l'heure, alors
qu'il était monté sur l'abri du capitaine pour vérifier à là
lorgnette une observation faite pendant la dernière
reconnaissance de nuit, une balle lui a traversé le ventre.
Simplement, un point rouge à l'entrée et à la sortie. Mais les
douleurs vives, les vomissements sont de terribles symptômes. Le
médecin déclare le cas sans espoir : il faudra attendre la nuit
pour évacuer le blessé ou le cadavre. Le caporal-fourrier «
regarde la douleur et la mort sans forfanterie et sans crainte,
comme un chrétien. Les brancardiers l'ont porté de l'abri sombre
du capitaine dans un coin ensoleillé de tranchée ouverte sur la
France. La journée est radieuse. Il meurt en pleine lumière du
corps et de l'âme. L'aumônier est près de lui, la main dans la
main, échangeant les propos qui seuls ont un sens à cette heure,
une efficacité et une joie. A ses camarades penchés sur lui,
spontanément il demande pardon. Leur émotion s'accroît encore du
spectacle de cette humilité chrétienne, de cette résignation si
simple, de cette belle force morale. A les voir, on sent qu'ils
l'aiment. Ils ne peuvent point rester près de lui, le coeur les
serre trop. Et loin de lui, ils ne peuvent se supporter. Ils
errent muets, désolés, les yeux rouges, dans la tranchée
silencieuse. Les dernières recommandations faites à son ami, à
l'aumônier, un dernier merci à son capitaine de toute sa
sympathie qui lui était si respectueusement rendue, il boit la
fin de son dur calice de douleurs.
« A mesure que le jour baisse, cette vie s'éteint. Une rafale
d'artillerie française s'abat sur les positions ennemies qu'il
observait au moment où il a été atteint. « Les artilleurs vous
vengent », lui dit quelqu'un. Lui n'a plus souci de la terre, il
part au royaume de la Paix et de l'Amour. Dieu a pris sa cause
en main et son âme. Ce sera Lui son vengeur et sa récompense...
Le caporal-fourrier a fini son labeur, ses états sont en règle,
il jouit du repos éternel » (28).
Ces dernières phrases sont empruntées à l'article émouvant que,
sous forme impersonnelle, le P. Limagne a consacré au souvenir
du vaillant soldat. Mais il n'a pas dit que, pour lui apporter
la consolation de sa présence, il avait lui-même risqué sa vie.
Le 6 avril, pendant de longues heures consécutives, les
Allemands pilonnent nos tranchées, en avant du bois Boué. Sous
le bombardement soudain, tandis que les hommes des petits postes
restent stoïquement exposés au danger, les travailleurs,
abandonnant les outils, se réfugient en hâte dans les sapes. Et
les obus de gros calibre, les 150 et les 210, avec leurs fusées
à explosion retardée, continuent à fouiller la terre, à la
projeter en gerbes dans tous les sens. De Bénaménil, où l'a
réveillé le bruit de la canonnade, à onze heures du soir, sous
la pluie et la mitraille, le P. Limagne accourt. Dans le boyau
où il s'engage, les éclats d'obus d'un tir de barrage, pénètrent
tout à leur aise. A chaque coup, il lui faut s'allonger dans la
boue. Sans trop de peine, il parcourt ensuite les 1500 mètres de
tranchées tenues par le 2e bataillon ; ébranlées par les
détonations, elles sont indemnes de projectiles. Mais dressé sur
le léger tertre qui protège le poste du commandant, il se rend
compte que, à gauche, les tranchées du 1er bataillon sont
martelées avec rage. L'inquiétude le mord au coeur : que
deviennent les pauvres hommes sous ce déluge de fer ? N'y en
a-t-il point d'ensevelis sous les abris effondrés ? Aussitôt il
se porte vers eux. La tranchée est coupée : les planches et les
piquets qui en maintenaient les parois, disloqués, poussés les
uns contre les autres, forment une barrière redoutable ; il
arrache l'une des planches, et, par le trou étroit, à
grand'peine, il réussit à passer. Un peu plus loin, nouvel
obstacle : en travers de la tranchée bouleversée, nivelée par
les obus, s'élève un amoncellement de boue ; pour franchir cette
masse gluante, à quinze mètres des Allemands, le P. Limagne doit
ramper, s'aplatir le plus possible, tirer son corps en
accrochant ses mains aux débris de fils de fer. Quand les hommes
le voient venir à. eux, couvert de boue, après avoir ainsi «
risqué sa peau », ils sont saisis d'admiration ; « ce sont de
rudes gars, qui s'y connaissent en courage, et pourtant lequel
d'entre eût osé prendre le chemin qu'a pris l'aumônier ? » (29)
A un endroit où il n'y a plus trace de tranchées, de parapet,
des soldats ont commencé à remuer la terre : le P. Limagne
s'informe. Il y avait là une sape en construction, non encore
étayée, pourvue d'une entrée unique : six hommes s'y étaient
réfugiés, suivis bientôt d'un cuisinier qui venait d'apporter la
soupe. Coup sur coup, trois ou quatre obus ont entraîné
l'effondrement ; mais peut-être, au fond de la sape, ces «
enterrés vivants » respirent-ils encore. Le P. Limagne se mêle
aux travailleurs ; avec les mains d'abord, ils rejettent de
chaque côté la terre gluante ; puis on s'arme d'instruments ;
l'aumônier s'empare d'une pioche et, de son bras vigoureux, il
fouille inlassablement. Et le bombardement continue ; quand il
s'apaisera, ce sera pour faire place aux grenades, aux torpilles
; les tranchées boches ne sont qu'à cinq ou six mètres ; toute
pelletée de terre rejetée au dehors, toute parole entendue
amènent un lancement de grenades ; il faut causer à voix basse.
Si l'on pouvait arriver du moins à donner un peu d'air aux
enterrés, obtenir d'eux un renseignement quelconque ! « Chut !
on les entend ». On s'arrête, on écoute haletant : Non, rien, ce
sont les Boches qui parlent dans leurs tranchées. Et, malgré la
pluie qui fait glisser le manche de ses mains, malgré la
fatigue, le P. Limagne travaille toujours. Les hommes le
regardent émerveillés. A un instant de repos, d'une voix
fiévreuse, l'aumônier demande à un médecin de bataillon : «
Combien, s'ils ont pu se réfugier dans une partie de la sape non
effondrée, pourront-ils vivre de temps, dans cet air confiné ? »
Et comme le médecin lui cite des cas de survie assez longue, il
reprend la pioche avec ardeur. Tous les témoins de cette scène
ont gardé profondément gravée dans leur mémoire la vision de ce
prêtre, en bras de chemise, la soutane relevée aux hanches,
inondé de sueur, couvert de boue, hirsute, méconnaissable,
hideux, mais sublime d'acharnement, épuisé et, pendant des
heures, piochant toujours. Son exemple électrise les autres
sauveteurs. A mesure que le temps s'écoule, les chances de
retrouver vivants les ensevelis diminuent. Et, dans cet espace
resserré, on ne peut travailler qu'en petit nombre. Après quatre
heures d'efforts acharnés, on arrive à rentrée de la sape. Une
heure après, à trois mètres de profondeur, la pioche retire une
fusée à explosion retardée ; de toutes les fentes se dégagent
l'odeur, la fumée de la poudre. Bien sûr, tous les habitants de
l'abri ont succombé sous l'atteinte des éclats de l'obus ou, du
moins, sous le poids de la terre abattue sur leurs épaules. Et
l'aumônier continue à entraîner au travail. Enfin, l'on aperçoit
un bout de cravate bleue, et le cadavre du cuisinier apparaît,
encore plié, comme un homme qui descend à la hâte. Avec les
ténèbres du soir, on peut déblayer plus à l'aise. Un second
corps est découvert, fortement entamé. La nuit est avancée,
quand au fond de la sape, on distingue les cinq autres corps,
blottis les uns contre les autres, méconnaissables, pauvres
loques humaines, sales, toutes meurtries. Quelle agonie
d'épouvante fut la leur! Pour arriver jusqu'à eux, il a fallu
retourner plus de trois cents mètres cubes de terre. Est-il
besoin de dire à quel point l'affection de tous, officiers et
soldats, fut accrue pour le P. Limagne, au spectacle de ce
dévouement incomparable ? Et ils pouvaient se répéter : « S'il a
pris si vivement la pioche quand il espérait sauver les corps,
que ne ferait-il point pour -sauver les âmes ? » (30)
Dans l'après-midi du 20 mai, au beau soleil de printemps, sur la
droite du secteur, la canonnade allemande tonne avec une
intensité qui ne cesse de s'accroître. A Bénaménil, vers huit
heures du soir, un bataillon du 168e se disposait à monter en
lignes, pour la relève. Autour des bureaux de la brigade se
remarquait une certaine agitation. Bientôt le P. Limagne en sort
: il a vu le colonel Coquelin de Lisle, commandant de la
brigade, et il vient rassurer les hommes. « On estime, dit-il,
que c'est une petite attaque et que cela va s'arrêter ». Et à un
ami, médecin du-bataillon, il confie qu'il en est bien aise : il
est très fatigué, la journée du lendemain dimanche sera pénible
; il pourra donc se reposer dans un lit.
Le bataillon se met en route; à mesure qu'il approche de
Domjevin, les rafales se rapprochent aussi. Les hommes
commencent à penser qu'on se fait une fausse idée de la
situation, à l'arrière ; ils s'énervent, marchent vers la
mitraille, sans mot dire, le coeur serré. Les obus tombent sur
les premières maisons du village. On fait halte ; les soldats se
tapissent contre les murs, pour éviter les éclats des lourds
projectiles. Une heure, deux heures se passent ; de tous côtés
s'abattent les obus. Point de nouvelles : le téléphone est
coupé. Sûrement les Boches ont déclenché une attaque ; sans
doute, le bataillon sera envoyé pour donner la riposte. Et les
regards se tournent anxieux vers le coin de maison, face a la
place, où, tout à l'heure, il faudra tourner pour grimper la
côte redoutable, « Au plus fort de la canonnade, écrit le Dr
Lafitte, brusquement, je vois tourner, dans l'obscurité, à ce
fatal coin de rue, une ombre haute, de large stature, qui marche
à pas rapides, résolus. On l'a reconnu et on se le montre du
doigt : c'est le brave abbé Limagne. Moi, qui le savais épuisé
de fatigue, je le vois précipiter sa marche vers l'endroit
dangereux où l'appellent son coeur et son devoir. Il a quitté sa
chambre, agréable ce soir-là, oublié sa fatigue intense pour
voler au secours de l'infortune. Humble héros qui n'attend la
récompense que de Dieu seul ! Il aurait pu, sans faillir, se
reposer dans son lit, rassuré par le compte rendu de la brigade,
sans que personne eût songé - moi, tout le premier - que sa
place devait être ailleurs. Il a jugé par sa foi et son coeur, et
il a dompté la nature » (31)
En fait, les batteries allemandes, cachées dans les bois voisins
de Chazelles, vomissent sur notre ligne, de Reillon à
Saint-Martin, un déluge de fer. Les gros obus de 210 fouillent
les tranchées, harcèlent nos artilleurs, coupent les
communications. A travers la grêle des projectiles et un vacarme
infernal, le P. Limagne se porte vers les victimes. Chose
étrange, au poste de secours de Blémerey, on n'a pas encore reçu
de blessés ; le village reste comme un îlot intact, au milieu de
l'orage. Sans doute, les blessés auront été, de préférence,
évacués au poste de secours de Saint-Martin ; il faut y aller
voir. Quatre kilomètres de montées et de descentes en séparent ;
une bonne partie est encore bombardée violemment : qu'importe ?
En route, le P. Limagne songe avec pitié aux pauvres
territoriaux qui, depuis quinze mois, occupent ces tranchées ;
qui, à cette heure, en grand nombre, doivent les joncher de
leurs cadavres, à moins qu'ils ne soient ensevelis sous des
débris de toute sorte. Il songe à leurs femmes, à leurs enfants.
Et il pense aussi au courage des artilleurs qui, inlassablement,
répondent à l'appel angoissé des fusées rouges lancées par les
territoriaux. Et, avec douleur, avec une sorte de colère, il
pense à notre manque d'artillerie lourde : que peuvent, malgré
tout, nos 75 contre les obus formidables dont il voit les
éclairs, en face, déchirer les ténèbres ? L'un d'eux éclate près
de lui ; la commotion le renverse ; durant des semaines, il en
restera sourd d'une oreille.
« Au poste de secours de Saint-Martin, il n'y a ni blessés ni
morts. Mais il y a des nouvelles navrantes au téléphone du
colonel : la tranchée a été prise ; il y a morts, blessés,
prisonniers ; à la pointe du jour, une contre-attaque sera menée
par trois compagnies du 168e pour déloger l'ennemi de chez nous.
Navrantes, ces nouvelles. Cette contre-attaque réussira, car la
tranchée est encore plus intenable pour l'ennemi que pour nous.
Mais de combien de corps faudra-t-il couvrir cette terre pour
avoir le droit de s'y faire tuer encore ? » (32). Malgré la
fatigue de cette longue marche nocturne, le P. Limagne revient à
Blémerey : maintenant sans doute, son ministère aura lieu de s'y
exercer. Le calme est revenu ; plus de canonnade, ni de fusée,
pas un coup de fusil. A l'entrée du village, deux sentinelles
lui apprennent qu'ils n'ont vu apporter au poste de secours ni
mort ni blessé. Avec les brancardiers, il s'en va donc en ligne
pour voir, leur prêter son aide, exercer son zèle sacerdotal. «
Oh ! cette tranchée ! Le regard qui l'enveloppe n'en ramène
qu'images de destruction, pitié profonde, horreur. L'horreur, ce
sont les blessés que nous sortons et les morts qui se mêlent à
ces fractions de vivants. Au poste de secours exigu et encombré,
les deux docteurs font de leur mieux et bien, revoient les
pansements sommaires de la première ligne, réconfortent d'une
piqûre ces corps en lambeaux. Celui-là a les jambes brisées ;
c'et autre, la poitrine ouverte ; un troisième n'est que sang,
plaies et douleurs. Il crie sa soif. Et il faut chercher sa
bouche longuement pour y introduire la cuiller. Un coin de
moustache sanguinolente la cache et il ne reste que cette touffe
de poils sur ce visage sans nez et dont le pansement dérobe au
regard le front meurtri ; il ne reste de ce visage d'homme que
cette touffe navrante !... Il n'y a pas de blessure légère...
Les cadavres remisés dans une grange sans toiture sont divers
comme les formes de la mort. Celui-là semble intact de corps ;
ni une plaie ni une goutte de sang répandue. Cet autre a
l'épaule arrachée. A ce troisième, il manque la tête.
Qu'est-elle devenue, sa tête ? On l'a cherchée, on n'a pu la
découvrir. Ils sont déjà sept, alignés. Quand les blessés sont
partis - une douzaine -, les morts prennent leur place, au poste
de secours » (33). Le P. Limagne a réconforté les blessés, de sa
présence, de sa parole, de la force des sacrements. Maintenant,
il va prier près de chacun des cadavres affreux. Et, à quatre
heures du matin, après une pareille nuit sans sommeil, succédant
à une journée de fatigue, il se remet en route pour aller, par
un long voyage, s'acquitter, à Bénaménil et ailleurs, de son
habituel ministère du dimanche. A voir bientôt la manière dont
il l'entendait, on comprendra quelle volonté exigeait une telle
maîtrise de son corps.
Que d'autres spectacles funèbres viennent assombrir son âme
compatissante !
Le soir du 20 janvier, sur son chemin, il retrouvait un
artilleur jeune, heureux, superbe, hardi cavalier. Cette fois,
son cheval traînait des rondins : « Ça ne vaut pas le canon, mon
ami, lui dit le P. Limagne. - Ah ! non, Monsieur l'aumônier, les
chevaux eux-mêmes en sont dégoûtés. - C'est utile, mon ami ;
songez que vous sortez vos camarades de l'eau, que vous les
protégez contre les boulets, que vous avancez l'heure de notre
départ à tous pour chez nous ». Et l'artilleur était allé, au
grand trot, conduire son bois au Dépôt de matériel du génie. Sa
tournée faite aux tranchées, dans la nuit le P. Limagne
s'arrête, suivant son habitude, au cimetière de Reillon,
toujours plus peuplé, et au hangar de branchages qui sert de
morgue rarement inoccupée. Sur deux rondins, un brancard est
posé : sur le brancard, un artilleur enveloppé de son manteau.
De sa lampe électrique, le P. Limagne éclaire le visage : c'est
son jeune artilleur salué naguère. Un éclat d'obus au coeur
l'avait renversé de son cheval. A cet instant, une marmite
énorme explose sur le cimetière, découvre un cadavre inhumé à
deux mètres sous terre, projette des débris jusque sur
l'artilleur. Dans la fosse, l'aumônier s'en va recouvrir le
cadavre, des lambeaux de la capote déchiquetée, puis il revient
près de l'artilleur achever le De Profundis et tirer le manteau
sombre sur son beau visage glacé.
Un jour qu'il traversait le village d'Herbéviller, le capitaine
Herpin, du 37e Territorial, était accouru vers lui et l'avait
conduit à l'église, dont la voûte, d'un bloc, venait de tomber.
Naturellement religieux, il se montrait éploré de voir cet
édifice ouvert à tous les vents ; à la prière du curé, il
veillait avec soin à la conservation des confessionnaux,
remarquables par leurs sculptures. Il avait pressé le P. Limagne
de venir chez lui se reposer, se rafraîchir. A ces instances,
l'aumônier avait répondu que le temps lui manquait, mais qu'un
jour, il viendrait le surprendre et lui demander à manger, en
lignes, à son poste de commandement. L'idée avait ravi le
capitaine ; à diverses reprises, par téléphone, il avait rappelé
cette promesse. Enfin le P. Limagne se met en mesure de la tenir
; arrivé au lieu du rendez-vous, il apprend avec stupeur que le
capitaine a été tué, la semaine précédente ; on l'a trouvé à
l'entrée de sa cagna, un coup de couteau au coeur, un autre à la
tête ; les quatre hommes du poste avaient disparu, enlevés par
l'ennemi... ou non. Un mystère angoissant plane sur les
circonstances de ce drame. L'officier a été enterré à
Saint-Martin, par le pasteur : il était protestant.
Une autre fois, le Père avait résolu de passer la journée du
dimanche à Domjevin, d'y présider, le soir, un enterrement qui
lui fournirait l'occasion de voir un capitaine et un lieutenant
amis : il leur avait d'ailleurs donné ce rendez-vous. Mais,
après sa messe, il se dit qu'au lieu de s'accorder ce repos, il
sera plus méritoire d'aller trouver les soldats en leurs
tranchées : un prêtre-brancardier pourra faire les funérailles ;
quant à ses amis, il aura d'autres occasions de les voir. Et il
part dans la direction de Reillon. En route, il voyage à travers
les éclats des obus dirigés sur nos batteries ou contre nos
avions qui, en nombre, sillonnent les airs. Quand, la nuit
tombée, il revient à Domjevin, c'est pour contempler les
horribles restes de ses amis. Au retour de l'enterrement, un
obus de 77, tiré sur un avion français, était tombé sur la route
du cimetière. Une blessure au front avait mis à nu le cerveau du
capitaine ; le lieutenant avait eu la tête projetée à vingt
mètres, le bras droit lancé sur un toit, l'intérieur du corps
éclaboussé contre une muraille, le reste jeté dans la boue. Mort
aussi, un sergent ; grièvement blessés, deux autres officiers et
cinq ou six soldats.
Un jour, lors d'une tournée en ligne, le P. Limagne aperçoit,
sombre, taciturne, un jeune officier dont il connaissait
l'humeur joyeuse. Il l'interroge, mais ne peut rien lui
arracher. Un peu plus tard, il revient à la charge. L'officier
déverse le trop-plein de son coeur : il avait fini par triompher
des résistances de sa famille et avait épousé la femme qu'il
aimait. Celle-ci lui écrivait tous les jours. Brusquement, les
lettres ont cessé. Affolé, il a écrit partout pour avoir des
renseignements. Point de réponse. Il se perd en conjectures, il
fait toutes les hypothèses,... sauf la bonne. L'aumônier lui
propose de s'informer à son tour. Avec stupeur, il apprend que
la femme est devenue la maîtresse d'un politicien louche et
influent. Comment annoncer au malheureux la terrible réalité ?
Il s'en va aux tranchées. En chemin, un commandant l'invite à
déjeuner. Sans difficulté, cette fois, il accepte : ce sera un
moyen de retarder la pénible rencontre. Après le déjeuner, il
repart. A la jonction de deux boyaux, il prend le plus long,
pour se donner le temps de réfléchir encore. La canonnade
s'élève, les obus sifflent. Quand il arrive, il apprend que
l'infortuné vient de trouver la mort dans le bombardement. Le P.
Limagne respire, de son coeur monte vers Dieu une prière de
reconnaissance : la fatale nouvelle pouvait tuer le mari trompé
; il est mort sans savoir.
Un dimanche soir de mars, l'aumônier était à l'ambulance de
Bénaménil, devisant agréablement avec les majors. Soudain, un
appel du téléphone : « Allô ! Un officier du 168e gravement
blessé. Il descend avec l'auto sanitaire ». Quel sera cet
officier ? se demande avec angoisse le P. Limagne. Il connaît
tous ceux de ce régiment. On attend une heure, deux heures, deux
heures et demie. Il a fallu tout ce temps pour faire dix
kilomètres. Il pleut, en effet ; la nuit est noire, et, pour ne
point se dénoncer a l'ennemi, l'auto doit marcher feux éteints.
Enfin, elle arrive. Sur la route, on dépose lés brancards.
L'officier repose, inerte, le visage un peu pâle, mais très
calme ; les médecins défont les linges blancs qui enveloppent le
sommet de la tête : au milieu du front, un petit trou ; les
mains sont glacées, plus de pouls : le blessé est mort en route.
A la lueur de la lanterne tenue par un infirmier, le P. Limagne
le reconnaît : c'était le sous-lieutenant Debay, qu'il aimait
pour sa distinction, son coeur, sa jeunesse enthousiaste, sa
solide piété. Il avait quitté l'artillerie pour venir installer
des engins de tranchée. Vingt-trois ans, marié depuis trois mois
! L'avant-veille, l'aumônier lui avait promis de lui rendre
visite, le lendemain lundi, dans sa tranchée, en lui apportant
Le Sens de la Mort de Paul Bourget ; le livre était déjà tout
prêt dans son sac. A la vue de ce cadavre, nous dit l'un des
témoins de cette scène, « l'aumônier était navré et navrant »
(34). « Mon Dieu ! mon Dieu ! » s'écrie-t-il, dans un sanglot,
et il s'effondre, tombe à genoux dans la boue, près du brancard,
et prie. Il demande aux médecins de le laisser seul, ce soir-là,
pour veiller et continuer à prier près du corps de son ami. Il y
passe la nuit entière. Lui-même a traduit en termes poignants
les émotions de cette rencontre : « Il est des heures où la
douleur déborde, vous saute au coeur, pour le serrer, et à la
gorge ; vous étourdit de son poing brutal. On aurait envie de
mordre, de crier, de maudire » (35). Mais il se dit que le jeune
officier lui donne un autre rendez-vous, que son « à Dieu » de
naguère a pris toute sa valeur, toute sa durée. A l'heure et au
jour promis, il va à la tranchée où il aurait dû le retrouver.
Il a toujours dans son sac Le Sens de la Mort. L'officier n'en a
plus besoin ; « il avait eu le sens de la vie qui donne toujours
le sens de la mort » (36). Mais, là, le P. Limagne apprend les
circonstances de la blessure de son ami, une balle en plein
front, les détails de son intrépide agonie. Et quand, à
l'église, il prendra la parole, avant de confier à la terre
lorraine la glorieuse dépouille, on imagine de quelle âme il le
fera.
Toutes ces émotions, s'ajoutant les unes aux autres, mettaient
sa sensibilité profonde à une rude épreuve. Peu à peu, elles
creusaient de rides son visage, d'ordinaire si souriant. Sur son
coeur, elles avaient un contre coup organique, qu'il commençait à
ressentir, au soir de certaines journées d'héroïque fatigue
(37).
Bien souvent, hélas ! l'aumônier doit donc présider des
cérémonies funèbres. Il en profite pour exalter les vertus du
défunt, l'amour de la patrie, la valeur rédemptrice du sang
répandu, mais encore, par la glorification des dévouements las
plus humbles, pour maintenir l'estime réciproque, la fraternité
des âmes, en dépit de la diversité des emplois et des périls
affrontés.
Voici, par exemple, comment il parle sur la tombe d'un
ravitailleur, tué par un obus, alors qu'il allait porter du pain
à ses camarades : « ... C'est la grandeur de la cause que nous
servons et du sacrifice, que nous consentons à son service; qui
magnifie notre effort et fait du plus modeste d'entre nous le
bienfaiteur de ses frères. Ce que nous faisons, chacun, semble
peu de chose. Mais serrez ces efforts en un faisceau, ce
faisceau est une force indestructible. La goutte d'eau qui tombe
est insignifiante. Que la goutte d'eau cesse de tomber, qu'elle
fasse grève, il n'y aura plus de printemps sur la terre, ni de
froment dans les greniers, ni de pain pour nourrir l'humanité,
ni de fleurs pour la réjouir. Que chaque Français refuse de sa
sueur et de son sang, la France est morte. Elle vit, grandit et
triomphe, par nos sacrifices.
« Et peu importe notre effort, qu'il s'applique à tirer un fusil
ou un canon, à creuser une sape ou une tranchée, a soigner un
blessé ou à ensevelir un mort, à préparer la nourriture du
soldat ou à la lui apporter. Ayons l'esprit assez large pour
comprendre la nécessité et la beauté de toute fonction, et le
coeur assez bien fait pour rendre justice à qui la remplit bien.
Il n'y a pas d'embusqués à portée du canon du Boche. Chacun
offre à chaque instant sa vie pour accomplir la tâche commune.
« Celui-ci était ravitailleur, quand la mort l'a pris. Ceux qui
reçoivent à la tranchée soupe, café et vin, ne songent pas
toujours assez à travers quelles fatigues et quels périls ont
passé les porteurs. Il y a de ces ravitaillements de nuit qui
sont un supplice et qui offrent au danger - plus que la garde de
la tranchée - les soldats qui y sont employés. L'oeuvre est
utile et dangereuse. Elle grandit son homme dans la mesure où il
la remplit avec conscience et résolution. Celui-ci fut un
consciencieux et un résolu. Savez-vous de quoi il avait
préoccupation en mourant ? Je puis en témoigner, l'ayant
assisté. De ses blessures qui étaient douloureuses ? Oui. De sa
famille, de sa mère dont il parlait ? Oui. De guérir, de revoir
son pays, d'avoir sa part de joie ? Oui. Mais ce n'était point
là son refrain habituel. Il se lamentait sans cesse en face d'un
sac de pain qu'il déclarait ne pouvoir plus porter. Son idée
persistante, sa pensée dernière a été sa tâche modeste et
bienfaisante : donner du pain à ses camarades, ce qui est une
manière de donner la victoire à la France... ».
Au cimetière de Blémerey, à deux pas de l'ennemi, devant les
restes d'un territorial tué sur la route de Lunéville à
Strasbourg qu'il empierrait avec ses camarades, il apporte le
même tact délicat à combattre les comparaisons jalouses, le même
coeur à célébrer toute collaboration au salut de la patrie : « ...
Que vous teniez le fusil ou la mitrailleuse, la pelle ou la
pioche, le volant de l'auto ou les guides du cheval, c'est pour
la France que vous travaillez, pour la liberté de son
territoire, la sécurité de ses habitants, le triomphe de la
civilisation chrétienne. Ce n'est pas la fonction remplie qui
vous distingue moralement les uns des autres (toutes les
fonctions sont solidaires les unes des autres : que feriez-vous
sans routes, artilleurs ? et par où vous viendrait le
ravitaillement, fantassins ?). C'est la manière dont vous la
remplissez, les risques que vous courez, les difficultés
vaincues, qui marquent l'étiage de votre patriotisme. Et
magnifique est le patriotisme de ces territoriaux qui, de nuit
et de jour, de nuit surtout, chargent les routes, réparent les
ponts, creusent des boyaux. Travail dur, dangereux, prolongé !
Que de fois j'ai eu le coeur serré, par une nuit noire, de voir
ces ombres courbées sur la route, de Vého à Reillon, de Domjevin
à Blémerey, d'Ogéviller à Saint-Martin, tâtant des mains les
bords de la chaussée, tant étaient épaisses les ténèbres, et
n'ayant pour les éclairer que les fusées qui, la nuit, dessinent
la ligne des tranchées, ou les feux de nos canons tirant à
proximité, ou les éclatements subits des obus boches. Ils n'ont
même pas un abri contre les bombardements. Et jamais ils ne se
plaignent. Et pourtant ils ont passé la quarantaine, ils ont des
cheveux blancs sur les tempes et, sur les épaules, le poids
lourd d'une famille laissée au pays, parfois le cercueil d'un
fils, de plusieurs parfois, morts pour la patrie qu'ils servent
eux-mêmes au risque de leur vie. Ils pourraient se plaindre qu'à
cet âge ils soient sur le front. Ils ne se plaignent pas. Ils
savent qu'à l'heure du danger, chacun doit son concours à tous.
Et ils le donnent sans récrimination ni ménagement.
« Voilà pourquoi, jeunes, il faut saluer bien bas ce vétéran de
la vie qui a eu assez de jeunesse pour venir combattre avec vous
; et vous, anciens, il faut vous incliner devant ce frère tombé
à son poste, devant le deuil des siens, devant toutes les
douleurs jaillies de cette douleur et qui mettent en larmes tant
de visages. Et tous, jeunes ou vieux, prions pour celui dont la
tâche est finie et qui est allé rendre ses comptes à Dieu ;
prions pour ceux qu'il laisse et qui sont le prolongement de sa
vie sur le sol natal, pour ses frères d'armes qui, vivants
aujourd'hui, seront les morts de demain...
« Dors en paix, territorial coupé en quatre par l'obus, tandis
que pour la Patrie tu étais devenu cantonnier. Ton sang versé
pour la France fait tous les Français tes débiteurs. Et, à ta
manière, tu as eu ton Vendredi Saint, qui est la condition des
Pâques fleuries et des résurrections glorieuses ».
Comme ses oraisons funèbres, les lettres du P. Limagne nous font
sentir un coeur que toute misère émeut, et, en même temps, la
joie de se dévouer, l'humilité profonde d'un vrai serviteur du
Christ :
« Ma vie continue dans le fracas et parmi les morts. Que ce
danger et ces souffrances couvrent mes fautes » (38).
« Priez pour moi : j'ai tant envie de faire du bien ! Et il me
semble que l'heure est bonne, aux tranchées, pour réconcilier
notre temps avec l'Eglise. Nous serions bien coupables, nous,
les prêtres, si nous ne profitions point de l'aubaine » (39).
« Il est certain que l'heure est bonne pour prêcher Notre
Seigneur, et cela me suffit » (40).
« Je suis très heureux. Pourquoi ne prendriez-vous point part il
ma joie ? Confiez ma vie au bon Dieu. Il n'arrivera que ce que
la Providence voudra » (41).
« La vie que je mène est émotionnante et tragique. Je ne pensais
pas que tant d'hommes puissent tant souffrir. Je prends ma part
de cette souffrance. Et je fais de mon mieux pour soutenir et
consoler » (42).
« Je suis très heureux de ma fonction. Ce qui est triste et
malheureux, c'est que tant d'hommes souffrent tant pour se faire
tuer. J'ai une excellente santé ; j'ai peine de la peine des
autres... Allons, ne grondez pas, il fallait bien quelqu'un ici
qui les aime, ces pauvres soldats, et je les aime de mon mieux »
(43).
CHAPITRE VII
Sur le front de Lorraine
(Décembre 1915 - Juin 1916). - III.
Oui, ses soldats, le P. Limagne les aime de son mieux, et de
toutes façons.
Un jour, dans les rues de Bénaménil, il rencontre deux soldats
qui ont absorbé un peu trop de pinard. Pour leur éviter une
chute ou quelque incartade qui leur vaudrait une sanction, il
les prend par le bras, s'efforce de les guider, entraîné de
droite et de gauche par les zigzags de leur marche titubante,
incapable d'arriver à leur faire reconnaître le logis qui leur
sert de cantonnement.
Une autre fois, vers neuf heures du soir, au retour des
tranchées, mourant de faim, brisé de fatigue, il ramasse, dans
un fossé, près de Domjevin, un homme du 100e d'infanterie ; et,
tandis que l'ivrogne lui déverse sur la soutane son trop-plein
dégoûtant, il le soutient d'un bras secourable. Il y a déjà une
heure qu'il le remorque, quand il rencontre le Dr Bousquet,
médecin à l'ambulance de Bénaménil. « Qu'allez-vous en faire ?
lui demande le Docteur. - Je sais qu'il cantonne à Manonviller ;
je l'y reconduis. - Allez donc dîner, je me chargerai du paquet.
- Non, je connais tout le monde là-bas; j'intercéderai auprès du
capitaine ». « Et, ajoute le Docteur qui nous raconte le fait,
ces attentions se répétaient tous les jours » (44).
Un soir d'hiver, dans l'un des villages en ruines sur lesquels
continuent à pleuvoir les obus, un prêtre brancardier lui amène
un jeune soldat désireux de faire sa Première Communion. Le P.
Limagne veut les retenir pour la nuit : « J'ai de bonnes
couvertures, deux lits dernier modèle ; vous reposerez mieux
qu'en ligne ». Et, avec la tendresse d'une mère, il prépare tout
de ses mains. Le soldat n'en peut croire ses yeux. « Quel bon
coeur ! murmure-t-il à son compagnon. Voyez comme il est heureux
de nous faire plaisir ! »
Au cours de ses tournées, il remarque sept ou huit hommes que le
Conseil de guerre a condamnés à de durs travaux : pauvres
enfants de la rue, sans parents qui les aiment et songent à
leurs besoins. Leur état lui fait pitié ; sans retard, il leur
procure une marraine qui leur envoie colis de vivres et de
vêtements : caleçons, chemises et le reste.
- Pour donner quelque allégement à ses chers soldats, la dépense
ne compte point : sa solde, l'argent qu'il peut avoir par
ailleurs, tout y passe ; rien pour lui. « C'était vraiment la
pauvreté volontaire, telle que des saints ne l'eussent pas plus
complètement pratiquée » (45). Un jour, il n'a plus le sou ;
pour de nouvelles largesses, il lui faut emprunter à un prêtre
brancardier.
De l'intérieur, même d'Amérique, il reçoit pour ses poilus des
dons en argent, d'innombrables colis de toutes sortes : ils lui
viennent de ses élèves, de personnes amies, des pensionnats
montluçonnais de jeunes filles. Avec quelle grâce, il sait
remercier ces coeurs généreux !
« Que vous avez eu raison, petites filles, de vos doigts menus,
de moucher le gros nez de mes soldats ! C'est un geste de
Véronique, car ces soldats montent au Calvaire très chargés, et
ils n'en reviendront pas tous. Merci, petites filles. Quand je
glisserai entre leurs lèvres les gros morceaux de chocolat, je
leur dirai : C'est bon comme les petites Montluçonnaises qui
vous l'offrent » (46).
Une autre fois, il suppose que l'un des heureux poilus, ainsi
favorisés, écrit aux pensionnaires bienfaisantes, et il lui
prête ce langage :
« Mesdemoiselles,
« Je vous fais un mot de lettre par rapport au paquet que vous
m'avez fait tenir. J'allais m'entrer dans un de nos boyaux quand
un copain me crie : « Tiens, Baptiste, du tricolore ». Il ne
voyait que la ficelle rouge, blanche et bleue. C'est une
plaisante idée que vous avez eue d'appliquer cette écharpe sur
votre gros colis comme sur la panse d'un maire ! Moi, je gobe
cette idée-là. Les camarades aussi. La preuve, c'est qu'ils en
ont voulu tous un peu, du ruban. Ils prétendent que c'est bien
meilleur pour porter chance que de la corde de pendu. Je crois
bien : c'est le sourire de la France...
« J'ai défait le paquet dans notre abri qui est à cinq mètres
sous terre et à trente mètres des Boches. Et le paquet a failli
le remplir. - Comment faites-vous, les demoiselles, pour mettre
tout un magasin d'épicier, de papetier, de mercier et de
buraliste dans une boîte pas plus grande que çà ?
« Deux tablettes de chocolat !... Il y a quelque temps, ces
bâtons m'auraient laissé sans appétit. L'Intendance nous en
sucrait sans fin. Mais depuis un an, si elle nous donne parfois
un pruneau dégageant ou des harengs agressifs, elle ne nous
distribue plus du chocolat. Il paraît que, comme tous les
légumes, c'est hors de prix ! Merci de m'en avoir envoyé une
provision. Raclé délicatement sur le riz, nous ne verrons plus
ce perpétuel revenant, ce fantôme des tranchées. Et nous en
sentirons moins la fadeur. Si nous pouvons barboter un peu
d'alcool solidifié, on s'accordera une tasse de chocolat. Le
cycliste du commandant porte du lait de L... (47) pour son
patron. Le lait pur, c'est trop fort pour les officiers ; c'est
bon pour les veaux à engraisser. Il nous donnera un peu de son
lait, à nous, et il ajoutera un peu de flotte à celui de son «
huile » (48). Ce sera l'équilibre des corps. Merci pour les
tablettes.
« Les croquettes du même sont de pures gourmandises. Voilà des
boulettes comme on voudrait en faire pour les partager avec les
camarades et en offrir des poignées aux chefs.
« Vous avez pensé à la famille. Et vous m'envoyez un porte-plume
et du papier à lettre qui est joli et qui sent bon. Merci pour
la famille. J'aime les bonnes odeurs. Ces sales Boches sentent
si mauvais ! Et ce mauve plaisant est une joie pour l'oeil qui en
a assez de leur couleur de hanneton en poudre ou de fumier
verdâtre.
« Mais vive le papier à cigarettes, quand on a soin comme vous
d'y joindre des paquets de tabac ! Vive surtout la pipe discrète
et chaude, compagne des nuits gelées et des bavardages
souterrains, qui s'installe sans bruit sur votre lèvre et chasse
inlassablement le redoutable cafard. La fumée s'interpose entre
nous et le petit coin de terre aimée, la femme, le gosse, la
promise, pour changer en rêverie douce un regret irritant et un
désir insupportable. Merci pour la pipe.
« Vous y avez joint une jolie médaille, un petit crucifix et une
brochure : « Dieu et la guerre », d'un abbé dont le nom n'en
finit pas (49). Cet abbé doit écouter aux portes des gourbis,
car il se mêle à toutes nos conversations. Et c'est tapé. J'en
avais retenu une page que j'ai jetée à la figure d'un parleur
qui n'est point beau et qui salive comme une gouttière dans
notre réduit. Ça lui a éclaté sur le nez comme une grenade ! -
Je garderai la médaille. Çà me sera plus commode pour réciter
mon « Je vous salue » qui est toute une prière et qui me vient
de ma pauvre mère. Çà aide, une image, pour comprendre le livre.
- Quant au crucifix, je le fixe sur ma capote, avec un bout de
votre ruban tricolore. Celui qui est attaché là, c'est un frère.
Et çà a dit lui être joliment dur de mourir pour un tas de cocos
qui s'en f... pas mal. Je le vois à la rage qui me prend quand
je songe aux cocos pour qui je me fais tuer et qui sont toujours
les mêmes cocos de malheur.
« Je signe poliment,
« Votre serviteur, Baptiste Ranc ».
Un élève de, Troisième, parrain d'un neveu nouveau-né, a eu la
délicate pensée d'envoyer au P. Limagne des dragées, des
pralines, à l'occasion du baptême. Il lui répond :
« Mon cher petit Jean, vous êtes un parrain exquis. Les
marraines ne sont que des femmes à côté. Grâce à vous, le poilu
aura le bec sucré et rose. Et il bénira l'enfant ; l'enfant - et
surtout le parrain. Je vous embrasse, petit parrain, grand ami,
ma très chère espérance » (50).
Un pensionnat lui adresse six caisses de cadeaux pour ses
soldats ; elles sont remplies de paquets les plus divers ;
chaque élève a mis son nom sur celui qu'elle a préparé. Le Père
réunit des soldats, leur fait plonger la main dans l'une ou
l'autre des caisses ; chacun devra adresser ses remerciements à
la jeune pensionnaire dont il trouve le nom sur le paquet qu'il
aura tiré. Lettres naïves, touchantes, toutes pleines aussi
d'éloges, d'affection, pour le cher aumônier.
A la 128e Division, chez les poilus et les officiers, cette
affection était universelle. Par mille faits journaliers, il
avait su trouver le chemin des coeurs. Pas un homme qui ne l'ait
vu venir à lui, la figure souriante, une parole de consolation
ou de réconfort sur les lèvres, et, à la main, un cadeau
délicat. Et ce dévouement sans bornes se prodigue à toutes les
heures, au prix de fatigues inouïes, par tous les temps, en
dépit de tous les dangers. Il n'est point de service qu'il ne
soit prêt à rendre ; dès qu'on lui en demande un : « Tout ce que
vous voudrez, cher ami », voilà sa réponse.
Sa générosité, sa bravoure sont devenues légendaires ; avec
fierté, on aime à rappeler ses actes de courage. Mais ce qui
séduit par-dessus tout, c'est sa douceur, sa bonté. « Le poilu,
quel que fût son âge, avait retrouvé son âme enfantine, il avait
besoin d'entendre un mot d'affection et de sentir que quelqu'un
l'aimait d'autant plus qu'il souffrait davantage. Et c'était le
merveilleux effet de la charité de M. Limagne de donner à chacun
l'impression d'être aimé plus que les autres » (51). Et cette
bonté devenait plus pénétrante encore par une simplicité, une
modestie, une humilité, dont l'éloge revient sous toutes les
plumes.
L'accueil souriant que lui faisaient les poilus dans leurs
abris, les officiers dans leur popote, témoignaient de la
vénération qu'on lui portait. « Il était l'ami de tous, et tous,
quels que furent leurs sentiments et leurs croyances, venaient
irrésistiblement à lui » (52). Le Dr Bornèque fait observer qu'à
maintes reprises il a entendu des critiques, parfois justifiées,
sur la manière dont les aumôniers avaient compris leur rôle,
mais que toujours le plus intolérant n'a eu que des expressions
d'admiration pour le P. Limagne (53). « Jamais, déclare un
médecin de bataillon, je n'ai surpris, après son passage, de ces
sourires malveillants, entendu de ces mots méchants qui veulent
être des mots d'esprit, qui, trop souvent, accompagnaient une
silhouette au tournant d'un boyau » (54). « Ah ! nos soldats,
s'écrie le capitaine Colin, nos soldats le connaissaient bien et
ils l'aimaient bien. Comme ils l'attendaient chaque jour avec
impatience, et combien d'entre eux étaient inquiets, quand le
soir s'avançait, de ne pas l'avoir encore vu ! » (55) Et puis,
ajoute le capitaine Cornet, « quand sa bonne figure, douce et
souriante, se penchait sur un blessé, c'était pour ce malheureux
le suprême réconfort » (56). Bref, et en parlant ainsi je ne
ferai qu'emprunter les expressions de témoins, pour tous,
officiers et soldats, il était un père, une idole ; tous lui
vouaient un véritable culte, tous se seraient fait tuer pour
lui.
Et, dans leur désir de lui témoigner la gratitude de leur coeur,
les poilus ont des délicatesses touchantes. L'un d'eux a reçu de
sa famille deux pigeons : il faut que l'aumônier les accepte.
Une autre fois, de leur tranchée, à quelques mètres de la ligne
boche, des hommes ont tiré un perdreau ; au péril de leur vie,
ils sont allés le ramasser. Au lieu de garder pour eux un gibier
si chèrement gagné et qui ferait si bien diversion à leur menu
monotone, ils l'offrent au P. Limagne, et ils ne sont heureux,
leur visage ne s'éclaire qu'en le voyant enfin céder à leurs
instances.
A diverses reprises, des médecins, des prêtres-brancardiers
attachés à l'ambulance de Bénaménil, lui demanderont, comme une
faveur, de l'accompagner aux tranchées, pour jouir du spectacle
de sa popularité, de l'accueil que lui réservaient les poilus.
Mais l'aumônier ne s'occupe pas seulement des soldats sur la
ligne de feu, son zèle s'exerce encore près d'eux dans les
cantonnements de l'arrière. Nous l'avons dit, il avait son
pied-à-terre à Bénaménil. Dès qu'il y rentrait, il ne songeait
point à se faire une réclame, pourtant légitime, de la boue
qu'il rapportait des tranchées ; son premier soin était de s'en
débarrasser. S'il rentre assez tôt, il aime à passer la veillée
avec les hommes dans leurs cantonnements ; il les voit encore
après les offices; dans les rues, il les évite, de peur d'être
accaparé ; il est tellement populaire, que dès qu'on l'aperçoit,
il est aussitôt entouré de poilus. Souvent, par la main d'un
petit enfant, il leur fait distribuer le contenu des colis qui
arrivent de l'intérieur. Il s'efforce de dégager, de promouvoir
l'élite ; il groupe les meilleurs, les réunit pour des tombolas,
de petites agapes, où, avec un agréable menu, il leur prodigue
les trésors de sa bonté. Dans sa chambre, quand on peut l'y
trouver, il reçoit, en nombre, officiers et soldats, qui
viennent réclamer de lui le bienfait d'une direction appropriée
à leur état individuel. Chaque semaine, d'habitude il se réserve
un ou deux jours, pour rédiger ses articles, préparer avec soin
ses sermons, mettre ordre à sa correspondance, restée en retard,
malgré sa régularité à répondre, surtout lorsque il est resté
plusieurs jours de suite sans revenir des lignes. Parmi les
lettres qu'il reçoit, beaucoup viennent de pères, de mères, qui
sollicitent des détails sur un fils dont le sort les plonge dans
une angoisse mortelle. Celles-là passent avant les autres, avant
les lettres d'amitié. Avare de son temps, lui pourtant si plein
de savoir-vivre, il n'aime pas les visites de politesse banale,
toutes en futiles causeries.
Il ne fait point popote avec les officiers au repos, avec les
médecins de l'ambulance. Combien de fois quand, par hasard, ils
le rencontrent dans la rue, les uns ou les autres veulent
presque de force l'entraîner à leur table. Il se défend
aimablement : il n'est venu que toucher barre, changer de linge,
recharger ses musettes ; il lui faut, sans délai, repartir voir
ses hommes. Un jour, à l'issue d'une cérémonie funèbre, l'un des
médecins le rejoint dans sa chambre, pour l'inviter à venir,
deux heures après, déjeuner avec les camarades: Il le trouve
mangeant un morceau de pain sec. L'aumônier s'excuse : sans
retard, il doit se remettre en route pour remplir les devoirs de
son ministère. De loin en loin pourtant, il accepte ; pour les
convives, alors, c'est une fête. D'habitude, les popotes de
majors sont assez houleuses. Dans ces groupes d'une dizaine de
praticiens, les tendances ne sont point uniformes, il s'en faut
; en certaines bouches, traits d'esprit et calembours, d'une
liberté égrillarde, ne manquent point. Mais le P. Limagne en
impose à tous ; on peut même dire que tous le vénèrent ; les
plus exaltés, les moins religieux, sont ravis de le posséder;
ils l'écoutent en silence, presque avec recueillement. Dans ses
causeries, il y a tant d'entrain, de gaieté spirituelle,
d'étendue de savoir, de franche cordialité ! Sur ceux qui déjà
sont chrétiens, il exerce une influence profonde.
L'un d'entre eux, par suite d'une nouvelle affectation, doit
quitter Bénaménil ; voici comment, dans son carnet de campagne,
il consigne ses adieux à l'aumônier : « J'ai voulu avoir un
dernier entretien avec le bon abbé Limagne, lui exprimer l'estime, la sympathie que j'ai pour lui, mes regrets de le
quitter ; j'ai voulu parcourir avec lui les diverses étapes de
ma vie et, avec lui, envisager l'avenir. Avant de partir, j'ai
reçu de sa main la Sainte Communion. Est-il plus doux geste
d'adieu ?» (57)
Un autre, après la mort du P. Limagne, écrira : « Je le pleure
sans vouloir être consolé... J'espérais pouvoir m'appuyer sur
cet admirable ami, ce sûr et splendide soutien moral, pour
passer pieusement les années qui me restent à vivre ; Dieu ne
l'a pas voulu; je m'incline humblement, mais que je me sens
désemparé ! » (58)
Le P. Limagne sait qu'à l'ambulance de Bénaménil, il peut se
reposer sur le zèle des prêtres-infirmiers: Mais les malades,
les blessés qu'on y traite, sont aussi ses enfants ; deux ou
trois fois par semaine, il vient leur rendre visite. Aussitôt
qu'il apparaît dans une salle, les visages deviennent radieux,
un même cri s'élève : « Ah ! voilà M. l'Aumônier ». Ceux qui
peuvent marcher se précipitent vers lui, pour lui donner une
chaude poignée de main ; et on l'accablé de questions, on lui
demande des nouvelles du secteur : que s'est-il passé, la
veille, à tel moment où la canonnade a été plus forte ? Qui a
été attaqué ? à quel endroit ? a-t-on progressé ? y a-t-il eu
des pertes? etc. Ils savent que personne mieux que lui n est en
mesure de satisfaire leur avidité, que toujours il est à
l'avant, aux heures du péril. Et quand il est parti, après avoir
fait une distribution de petits cadeaux, les conversations,
longtemps, redisent sa bravoure, sa bonté.
Chaque soir, il y a réunion de soldats à l'église de Bénaménil,
avec récitation du chapelet, bénédiction du Saint-Sacrement ;
plusieurs fois par semaine, une allocution est donnée par le P.
Limagne, s'il est de retour. « L'église, déclare un
prêtre-infirmier, était remplie de soldats qui venaient
l'écouter ; on courait à ses sermons » (59). En son absence, la
parole sainte est annoncée par quelque prêtre-soldat auquel il a
confié le soin de prendre sa place. Pour donner de l'éclat aux
cérémonies, sa bourse surtout fait les frais d'un brillant
éclairage. Et il s'en va encore dans les cantonnements voisins,
y donne des prédications consécutives, une sorte de mission en
raccourci. Parfois, l'église est il moitié détruite ; il
rassemble les soldats dans un reste de nef, un débris de
chapelle latérale ; tant bien que mal, il bouche les fenêtres,
afin de pouvoir allumer quelques bougies en toute sécurité ! A
ceux que la mort guette à chaque instant, il prêche les grandes
vérités: la fin de l'homme, le péché, les moyens d'arriver au
ciel. Tout cela, bien entendu, sans préjudice des visites aux
tranchées, de jour et de nuit. La veille des relèves, avant de
remonter en ligne, les soldats s'approchent nombreux de la Table
Sainte. On devine quelle joie cette vue apportait au coeur de
l'aumônier. Pour être à même, avec tant de fatigues, de
continuer sa rude tâche, force lui est bien de prendre un peu de
repos. Tous les mois, à peu près, il va passer trois ou quatre
jours à Laronxe, son domicile officiel, centre administratif du
G.B.D. de la Division. Repos très relatif, d ailleurs ; il en
profite pour donner aussi de petites missions aux troupes
cantonnées là et dans le voisinage.
Le dimanche matin, dès l'aurore, à l'église de Bénaménil, il
est à la disposition de ceux qui désirent se confesser. Aux
officiers qui s agenouillent à ses pieds, il prêche
l'accomplissement du devoir humble et obscur ; il insiste sur la
vanité des récompenses humaines. « Nous ne sommes pas ici, leur
dit-il, pour chercher la pauvre gloire d'une décoration que peut
procurer la bravoure, mais pour ne regarder que le ciel, qui
nous récompensera d'après notre vrai mérite ». Les confessions
entendues, en toute hâte il s'en va, à pied, dire la messe et
prêcher à Thiébeauménil, puis à Marainviller. Pris de pitié pour
tant de fatigue, un médecin de bataillon lui offre sa monture,
sa jument Musette. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude du
cheval, un tel voyage n'en reste pas moins très pénible. Mais,
de la sorte, l'aumônier sera plus sûr de revenir à l'heure pour
la grand'messe de Bénaménil : il s'entraînera au cheval, il
accepte avec reconnaissance. « Je le vois encore, écrit le Dr
Lafitte, perché sur Musette, bonne bête qui trottait
courageusement ; avec sa haute stature, il semblait là-dessus un
géant antique, héros capable de soulever des bataillons entiers.
Il soulevait les coeurs ; c'était mieux » (60). Parfois, il s'en
va à d'autres cantonnements du voisinage, à Domjevin, par
exemple. Là, l'église n'a plus de voûte, pour ainsi dire ; les
bancs sont recouverts de plâtras. En plein hiver, les soldats la
remplissent. La pluie ou la neige y tombe en liberté. N'importe
; tous les poilus y restent, nu-tête, immobiles, pendant que
l'aumônier célèbre la messe sur un petit autel épargné par les
obus.
A dix heures et demie, il est de retour à Bénaménil. Aux
offices, nous l'avons dit, il sait donner tout l'éclat
nécessaire pour attirer les soldats. Il les place lui-même. Il
a, du reste, une manière si affable de les prendre par le bras
et de les ranger, les poilus sur des bancs en avant des fidèles,
les officiers dans le choeur. Personne n'ose lui refuser. Une
fois, un jeune médecin de bataillon dit à l'un de ses collègues
:
« Je me mettrai à l'entrée de l'église, car, si M. Limagne me
voit, il va me faire traverser l'église entière pour aller dans
le choeur, et puis... il n'y a pas moyen de refuser. Il a une
telle façon de vous conduire qu'on ne peut lui résister »...
L'aumônier sait aussi amener ses hommes à s'unir aux chants,
religieux. La joie brille dans son regard, quand il voit
l'église pleine de soldats et d'officiers, le colonel Coquelin
de Lisle, commandant de la brigade, en tête.
Pour attirer en foule les uns et les autres, il leur suffit
d'ailleurs de savoir qu'ils entendront la parole chaude, si
pleine de conviction et de foi, qui sort du coeur plus encore que
des lèvres de celui qu'ils admirent pour sa vaillance, qu'ils
vénèrent comme un père à la bonté inépuisable. Malgré toute la
fatigue d'une matinée déjà si remplie, à cette grand'messe
chantée par un prêtre soldat, il prêche, en effet. Comme thème
de ses discours, il prend l'évangile du dimanche. Sans effort,
il sait y rattacher des considérations indéfiniment variées :
rappel des points fondamentaux du dogme (et, parmi ceux-ci, à
diverses reprises; il revient sur le rôle de l'Eglise, son grand
amour), exposé des lois permanentes de la morale, de la pratique
chrétiennes : la résistance aux scandales, la prière, les
sacrements... Dans ces instructions du dimanche. Il ne cherche
point de parti pris les allusions a l'actuelle situation de ses
auditeurs, bien convaincu qu'avec une solide mentalité
religieuse, tout le reste suivra ; mais, quand l'occasions s'y
prête, il ne les fuit pas non plus. De ces heures dramatiques,
il sait tirer les surnaturelles leçons qu'elles comportent : il
exalte le courage de tous, même lorsque la mort vient abattre
les plus méritoires ardeurs ; en face d'une vie si tragiquement
précaire, il insiste sur le détachement des biens de ce monde ;
il célèbre la vertu purifiante, le mérite rédempteur de la mort
sur le champ de bataille. Par exemple, voici en substance quelle
parabole nouvelle il ajoute à celle du Semeur, qu'il vient
d'expliquer : « Quand le grain se trouva jeté sur la terre
humide, il s'inquiéta ; quand, pressé par le rouleau, il sentit
la terre se tasser autour de lui et l'emprisonner, il se crut
perdu ; bientôt il sentit qu'il se faisait en lui un travail,
qu'il allait mourir et se décomposer. Mais, de ce grain qui
mourait et se décomposait, sortit une belle plante qui s'éleva
dans l'atmosphère douce du printemps, sous les rayons ardents du
soleil ; elle s'épanouit en un épi si riche, si lourd, qu'il fit
ployer la tige qu'il portait. Et cet épi joint à d'autres épis,
en une splendide moisson, permit aux hommes de se nourrir d'un
pain de pur froment.
« L'homme qui souffre sur la terre jusqu'à en mourir, comme le
grain qui se décompose, donne naissance à une floraison de
vertus, riche moisson reçue dans les greniers célestes. En
perdant sa vie terrestre, l'homme chargé de mérites naît à une
autre vie beaucoup plus belle.
« Le grain de France, lancé sur la terre humide, enfoui dans la
terre, voué à la mort et à la décomposition, donnera naissance à
une abondante moisson qui sauvera la France et même la fera
peut-être plus belle qu'elle ne fut dans le passé. Quelle
consolation pour ceux qui souffrent et meurent ! Quel sujet, de
fierté de savoir qu'ils sont les éléments de cette glorieuse
moisson ! » (61)
Parlant de ces discours du P. Limagne, un prêtre-brancardier
ajoute cette remarque : « Il excellait à encourager et je crois
qu'il versait si largement l'espérance dans ces âmes que son
enseignement religieux eut, comme contre-coup, une heureuse
influence militaire. Le soldat, à ces instructions, puisait le
bon esprit, le sens du vrai courage et le respect de ses chefs.
La 128e Division, pour une part que Dieu seul peut apprécier,
doit au P. Limagne sa belle tenue au feu et sa résistance
acharnée dans des moments particulièrement difficiles » (62).
Pendant les deux dernières semaines de Carême, il donne comme
une mission générale à ses soldats. Tous les jours, il prêche à
Bénaménil, Domjevin, Blémerey, Thiébeauménil ou Manonviller. Les
dimanches, c'est trois ou quatre sermons qu'il donne à droite et
a gauche. Après avoir confessé bien tard, il revient harassé de
ces courses à cheval et il s'en va, dans la nuit et la boue,
faire ses visites coutumières aux tranchées. Toutes ces fatigues
valent une belle récompense à son coeur d'apôtre ; plus de la
moitié de ses poilus s'approchent des sacrements.
Le dimanche des Rameaux, fixé pour les Pâques des troupes de
Bénaménil, la messe militaire offre un spectacle magnifique.
L'église est archicomble, le choeur rempli d'officiers, l'allée
centrale pleine de soldats debout ; pour tous ceux qui ne
peuvent entrer, il faut laisser les portes ouvertes. Couvert de
sueur, le P. Limagne circule pour découvrir la moindre place
vide, caser, serrer tout son monde. A l'Evangile, il monte en
chaire et, pendant une heure, parmi ces hommes tassés, debout,
on entendrait voler une mouche, tant ils l'écoutent avec
avidité. Après la messe, le colonel Coquelin de Lisle,
commandant la brigade, l'attend pour l'emmener à déjeuner. Il
refuse. A son ordonnance qui lui en fait un doux reproche, il
répond : « Que voulez-vous ? avec les officiers, il faut rester
deux ou trois heures à table ; moi, je n'ai pas de temps à
perdre ». Et, après avoir pris un peu de viande froide et de
fromage, il part aussitôt pour aller présider les vêpres et
prêcher à Thiébeauménil. Parmi les fidèles de Bénaménil qui, eux
aussi, sont venus en foule à ses allocutions, jamais les Pâques
ne furent aussi nombreuses (63).
Le P. Limagne, d'ailleurs, se dépense encore sans réserve au
soin spirituel de la population civile. En l'absence du curé
mobilisé, c'est lui qui assume le service de la paroisse. Avec
zèle, il fait la visite des malades ; tout à tous, pour chacun
de ceux qu'il rencontre, il a un mot aimable. Au milieu du fléau
de la guerre, à deux pas de la ligne de feu, il leur donne le
réconfort de ses consolations, de sa parole encourageante. Les
âmes pieuses se félicitent de trouver en lui un homme de Dieu,
d'une vie intérieure profonde, un confesseur éclairé, à la fois
ferme et plein de douceur. Des habitants, il est universellement
aimé. Le curé qui a été en mesure d'apprécier son oeuvre, par
lui-même, lorsqu'il venait en permission, ou d'après les
témoignages de ses paroissiens, de sa mère et de ses soeurs, qui
vivaient, comme le P. Limagne, au presbytère, se plaît à
déclarer : « L impression qu'il a laissée subsiste encore... On
était heureux de le posséder. Sa présence était comme un
paratonnerre : elle inspirait confiance et sécurité » (64).
Du reste, pour les paroisses voisines, qu'un petit nombre de
prêtres non mobilisés peut alors desservir, il montre le même
empressement à venir en aide ; il trouve le moyen de rendre tous
les services qu'on lui demande ; rien ne lui paraît impossible,
toujours disposé à prêcher ici ou là. Au curé d'Ogéviller qui
sollicite le concours de sa parole à Fréménil, pour la Première
Communion, il répond sans hésiter : « Monsieur le Curé, tant que
vous voudrez et autant de fois que vous voudrez ». Et il se rend
à la cérémonie, que font plus impressionnante le sifflement du
75, les éclatements brutaux des obus boches, alors que montent
vers Jésus, pour les actes préparatoires ou d'action de grâces,
les voix argentines des petits enfants.
Et, à l'arrière comme aux tranchées: le dévouement du P. Limagne
procède d'une manière aussi effacée que possible ; une
simplicité constante qui ignore toute recherche de soi-même ;
rien qui puisse éclabousser personne.
Son zèle ne va pas seulement, avec quelle intensité, nous avons
pu en juger, aux simples poilus, aux officiers, aux médecins, à
la population civile. Il est une autre catégorie à laquelle il
se prodigue sans mesure.
« S'il fut bon pour les soldats, il fut bon, extrêmement bon
pour les prêtres de sa Division (65) ». A leur égard, il était,
non pas « l'aumônier à trois galons », mais un serviteur. Dès le
début, il comprit qu'une partie essentielle de sa fonction
consistait à les soutenir, à faciliter leur ministère. Lui-même
le disait à l'un d'entre eux : « Mon grand rôle, étant donné ma
position, est d'être le soutien de mes prêtres, disséminés ici
et là, d'être leur office d'approvisionnement moral et matériel.
Le champ est trop vaste. C'est par eux surtout que je puis agir
». A tous, il prodigue les trésors d'une délicate bonté. Il sait
s'effacer, les mettre en vedette et, d'autre part, prendre sur
lui les responsabilités. Aux aumôniers, de bataillon (66), il
laisse la plus large initiative. Dans les cantonnements, il aime
à se faire remplacer par les prêtres-soldats, s'il ne revient
pas à temps pour l'office de chaque soir. Par de fréquentes
visites, il apporte aux uns et aux autres le réconfort de sa
cordialité, de ses encouragements, des cadeaux aussi qui servent
à adoucir la dureté de leur existence. « On le voyait ». Dès
qu'il les aborde, il pose toujours la question : « Avez-vous
besoin de quelque chose ? » et, si le prêtre répond : « Non »,
d'un ton de doux reproche il lui dit : « Vous ne me demandez
jamais rien ». Une fois, au cours d'une longue tournée, il
apprend que l'un d'entre eux se trouve malade en ligne. Il
accourt, s'impose dix kilomètres de voyage en plus ; pour aller
plus vite et le voir plus sûrement ce jour-là, il n'hésite pas à
s'avancer en terrain découvert, exposé au feu de l'ennemi.
Il y a une vingtaine de prêtres dans la Division. Pour leur
faciliter la célébration du Saint Sacrifice, les fournitures
d'hosties, de vin, de cire, s'inscrivent à son budget et à celui
de l'abbé Quénet. Mais il veut aller plus loin, prendre le moyen
le plus efficace de leur rappeler l'idéal d'un prêtre du Christ,
d'exciter en eux la flamme de l'apostolat. Il a donc l'idée de
grouper, à intervalles périodiques, les prêtres de la Division,
pour une journée sacerdotale, une sorte de retraite mensuelle.
Evidemment, à la date fixée, ils ne sont pas tous libres. Alors
il ne craint pas d'aller importuner les chefs de service ; mais
le tact l'accompagne toujours ; d'un sourire, d'un bon mot, il
agrémente ses instances, et la cause est gagnée. Les réunions
ont lieu à son domicile, à Bénaménil ou à Laronxe. A l'église,
on prie en commun. Deux ou trois instructions, données par lui
et l'abbé Quénet, exposent les moyens les plus propres à faire
rayonner autour de soi le zèle de l'apôtre. Des moments sont
réservés à la réflexion silencieuse ; les conversations
familières reflètent l'esprit le plus surnaturel. Au milieu de
la journée, un repas aussi copieux que le permettent les
ressources du ravitaillement local. La bourse du P. Limagne en
fait tous les frais. Le soir venu, chacun s'en retourne à son
poste, l'âme embaumée de charité fraternelle, plus décidé à
profiter des occasions qu'offrent ces heures tragiques pour
étendre le royaume du divin Maître.
Aussi, dans le coeur des prêtres qui l'ont connu alors, la
mémoire du P. Limagne demeure-t-elle fortement imprimée. L'un
d'eux, dont j'ai déjà cité le témoignage, insiste : « Dites bien
à quel point il a été bon pour ses prêtres » (67) « Combien,
écrit un autre, mes confrères et moi, nous l'avons regretté !
Les prêtres les plus anciens de la Division, quand ils
rencontraient un aumônier militaire, aimaient à parler du P.
Limagne, et, aux nouveaux venus ils disaient tout le souvenir
profond qu'ils en gardaient » (68), Un autre encore : « Le
souvenir que je garde de lui est celui d'une grande bonté,
sincère et profonde. Pendant son séjour à la 128e Division, il
n'a cessé se donner à nous surtout, prêtres, avec une générosité
et une délicatesse telles que mon âme en garde la plus forte
impression et le souvenir le plus délicieux. Pour moi, je suis
sincère, lorsque j'affirme que le seul fait de penser à lui me
rend meilleur » (69).
En dehors de ces derniers témoignages, sur la vertu du P.
Limagne, en dehors de ceux que j'ai reproduits plus haut, au
cours de ces chapitres, combien d'autres on pourrait rapporter !
Il n'y a que l'embarras du choix ; je cite au hasard. Le P.
Ballot, capucin, brancardier : « C'était, à mon sens, le type
achevé de l'aumônier militaire, tel qu'il doit être... Il était
simple et bon : deux traits de sa personne qui encadraient et
rehaussaient un absolu mépris du danger... Cette humilité, cette
simplicité donnaient l'impression qu'il ne travaillait pas pour
le ruban, mais pour les âmes. Celles-ci étaient visiblement sa
passion et le mobile de ses actes » (70). L'abbé Moussus,
aumônier de bataillon : « Tout le bien qu'on dira de lui ne
donnera encore qu'une faible idée de sa grande et belle âme.
C'est de lui que l'on peut dire, dans toute l'acception du mot,
qu'il était une « âme » et qu'il a passé parmi nous en faisant
le bien... Je ne fais que vous répéter après tant d'autres son
trait caractéristique : c'était un saint prêtre. On voyait en
lui le prêtre partout et il faisait bon le voir » (71). L'abbé
de Lescure, brancardier : « Auprès de tous les officiers, il
jouissait d'un prestige exceptionnel. Sa bonté, sa sainteté, son
courage l'avaient mis hors pair » (72). Le P. Piacentini : « A
personne de la 128e Division, le P. Limagne n'est un inconnu.
C'est un nom...C'eut été crime de laisser dans l'ombre la grande
figure de ce saint prêtre, qui fut aussi un brave parmi les
braves » (73). Le capitaine Portères : « Vous n'écrirez jamais
toutes les bonnes actions à son actif » (5). Le capitaine Cornet
: « Le dévouement, la générosité, la bravoure de M. Limagne se
sont manifestés d'une manière toute simple, aussi effacée que
possible et tous les jours et toutes les nuits... Sa vie fut un
bel exemple de bonté, de simplicité, de générosité et de
constante abnégation » (74). Le Dr Lafitte : « Je veux
contribuer, pour ma faible part, à rendre témoignage au grand
coeur, au grand saint que fut l'abbé Limagne... Ce que j'ai
toujours admiré le plus en lui, c'est le courage simple et
modeste ! Il fut si rare !...C'était un humble... Son mérite
dépasse tout ce que l'on peut en dire... Il s'est dépensé sans
compter, au-delà de toute mesure humaine... Oubli de soi, bonté
incommensurable, intelligence remarquable et modestie sans
bornes, m'ont paru, avec une profonde piété, les traits
essentiels de son caractère » (75). Le Dr Archambault : « Je
l'ai toujours considéré comme un saint. Lorsque nous voulions le
définir entre nous, nous disions : « C'est un apôtre » (76). Le
Dr Janot, médecin-chef du G.B.D. 128 : « C est avec une vive
satisfaction que j'ai reçu la carte-photographie de M. Limagne.
Je lui donnerai la première place sur mon bureau et,
fréquemment, je jetterai sur elle un regard, pour puiser du
courage aux heures de défaillance. C'est qu'en effet, c'était un
homme d'un rare courage que l'abbé Limagne, et c'est avec une
réelle douleur que j'ai appris sa mort. Je l'appris dans cette
maison d école de Laronxe, qui avait donné à notre commune
popote une si douce hospitalité, alors que notre 128e Division
prenait part aux combats de Lorraine. Notre hôtesse, Mme
Richard, femme de l'instituteur, qui nous hébergeait, m'apprit
la triste nouvelle, en 1920, alors que j'allais lui faire une
visite de remerciements (77), et c'est les larmes aux yeux que
toute la famille Richard m'annonça l'événement (78). C'est que
l'abbé Limagne avait su se faire aimer par eux, comme il savait
se faire aimer de tous. Doux, modeste, simple, sachant se mettre
à la portée de tous, il avait réellement conquis les coeurs,
aussi bien des populations d'arrière que du soldat et de
l'officier. Sous des dehors simples, il cachait un profond
savoir et un grand coeur. Il était l'homme du devoir, dans son
acception la plus haute et la plus noble. Aussi j'avais un réel
plaisir à causer avec lui, à mes rares moments de loisir, sur
les sujets les plus divers, et c'est sa compagnie que je
recherchais de préférence à toute autre... Il n'avait pas peur
du péril, parce qu'il était soutenu par une foi ardente et un
dévouement sans bornes... Je ne vous ai cité que quelques traits
saillants de ce dévouement, car il aurait fallu citer chacune de
ses paroles, chacun de ses gestes » (79).
Le capitaine Moreau, du 252e d'artillerie : « Mes lieutenants et
mes sous-officiers, pour la plupart ignorants, des choses
religieuses, étaient unanimes à déclarer qu'il se dégageait un
charme de sa personne et que ce devait être un saint » (80). Le
commandant Ménettrier : « C'était un saint et il fut un héros
pendant tout le temps qu'il passa parmi nous. Ce n'est pas là,
d'ailleurs, mon opinion personnelle, c'est celle de tous ceux,
officiers et soldats, qui ont eu le bonheur de l'approcher
(81)... Il est certainement la plus belle figure de prêtre que
j'aie vue, dans cette guerre où les prêtres ont rivalisé de
bravoure, de courage et de dévouement» (82). L'abbé Périnelle,
officier gestionnaire du G.B.D, 128 : « Il était brave,
froidement brave... On aimait sa gaieté cordiale, on appréciait
en lui la distinction de l'homme, la sûreté de l'ami, on était
touché des délicatesses, des prévenances de sa bonté. Si on
pénétrait un peu sa vie intime, on devinait avec émotion la
mortification, l'austérité que dissimulait son enjouement. Un
amour ardent de Jésus-Christ brûlait son âme. Pour lui, vivre
c'était servir son Dieu, par amour et de toutes ses forces »
(83). L'abbé Munier, curé de Bénaménil : « Je le considérais
comme un modèle de piété, d'esprit de foi, de bon sens,
d'humilité, de simplicité, de modestie, de générosité, de bonté
souriante, d'énergie, de courage, de tact, de dignité, de
droiture » (84). L'abbé Boileau, curé de Laronxe : « De 1914 à
1918, plus de trois cents prêtres-soldats, aumôniers militaires,
brancardiers et autres, ont cantonné dans ma paroisse, à
quelques kilomètres de la ligne de feu. Tous, je les ai aimés ;
devant tous, j'ai ouvert à deux battants les portes de mon
église, de mon presbytère et de mon coeur, pour n'avoir pas à
faire, après la guerre, un douloureux mea culpa. Tous, je suis
heureux et fier de le dire, tous m'ont profondément édifié, mais
pas un plus que le cher abbé. Limagne, dont je garde un souvenir
qui ne s'effacera jamais» (85).
Le 9 juin, la 128e Division quitte le secteur de Reillon. C'est
une division d'attaque, elle est réservée à de nouvelles et
grandes batailles. En attendant, pendant trois semaines, dans
les vallées de la Meurthe et de la Mortagne, elle s'entraîne à
ce rôle par des marches; d'incessantes manoeuvres. Où ira-t-elle
? Sur la Somme ? à Verdun ? on ne sait ; mais on préférerait la
Somme, où il y aurait de beaux coups à donner, tandis qu'à
Verdun, il faudra surtout en recevoir.
Dans l'une ou l'autre hypothèse, le P. Limagne sent que de plus
terribles dangers l'attendent; auprès de ses amis, avec
insistance, il réclame le secours de leurs prières ; en tout
cas, il est prêt pour le sacrifice suprême : « L'heure est grave
pour nous tous ici. Aidez-moi de vos prières » (86). « Je vais à
mon devoir de l'heure, une heure tragique » (87). « Priez pour
moi, l'heure est décisive » (88). « Ne vous tourmentez pas de
moi, il arrivera ce que Dieu voudra. Une seule chose importe,
c'est que je fasse mon devoir » (89). « Cette vie me dévore tout
mon temps et toutes mes forces. En attendant de me dévorer tout
entier. Et si l'holocauste est agréable à Dieu, la victime est
prête. Je n'ai peut-être que cette porte de salut : mon sang. Et
il m'est indifférent d'aller où l'on en verse beaucoup » (90). «
Priez pour moi, je ne suis qu'un affreux pécheur. Si j'e ne me
lave pas dans mon sang, je suis perdu. Priez pour moi. Et
n'admirez que la patience de Dieu qui, malgré mes misères, me
supporte » (91).
Mais il veut que, pendant cette période de repos relatif, ses
hommes soient entraînés au point de vue spirituel aussi Chaque
soir, après leurs exercices de la journée, il s'en va leur
procurer la Bénédiction du Saint-Sacrement, leur prêcher, dans
les cantonnements successifs qu'ils occupent. Aux artilleurs, il
donne toute une retraite. Le 19, à Laronxe, dernière réunion
mensuelle des prêtres-soldats.
Le 24, il vient prendre son pied-à-terre à Moyen ; de nouveau,
Mme Sorlat et sa fille peuvent observer son esprit de
mortification ; à midi, il ne descend point de sa chambre ; il
se contente d'un repas froid prélevé sur ses colis de vivres.
Le jour de la Fête-Dieu, il éprouve une joie rayonnante à
présider une procession, telle qu'on en peut voir dans les
paroisses chrétiennes : chants fort bien exécutés, petits
enfants rangés en lignes, enfants de Marie vêtues de blanc avec
leur statue portée sur un brancard, dames congréganistes avec
leurs bannières, hommes du village groupés autour du drapeau du
Sacré-Coeur, et, comme escorte au Saint-Sacrement, beaucoup
d'officiers, soldats en foule.
Le 28 juin, il donne, cette fois au 100e d'infanterie, un sermon
qui lui vaut des confessions nombreuses. Le lendemain matin, à
trois heures, il dit sa messe. La division s'embarque pour
Verdun.
Une partie du voyage se fait en chemin de fer, le reste, à pied,
par étapes journalières. A la pensée du danger tout proche, les
poilus, malgré leur courage, deviennent sombres, soucieux ; le
P. Limagne leur distribue toujours le réconfort de son
enjouement, de sa gaieté. A l'avant-dernière journée, la chaleur
est terrible ; des hommes tombent sur la route. Alors l'aumônier
relève un soldat, se charge de son fusil, de son sac, soutient
par le bras le malheureux. Quand au bout d'un kilomètre environ,
il le voit reposé, ragaillardi, il va rendre le même service à
un autre ; dans la journée, c'est de 25 à 30 hommes qu'il a
ainsi secourus. Le soir, arrivé à l'étape, il est brisé de
fatigue.
A l'église du village où l'on fait halte, les soldats se
pressent, anxieux du péril tout proche. Pour ranimer les
courages, l'aumônier, malgré son épuisement, a l'idée de monter
en chaire et, en un magnifique langage, il leur demande d'aller
en chrétiens au sacrifice que la patrie exige d'eux, en ces
terribles journées.
A la nouvelle du départ du P. Limagne pour Verdun, le curé de
Laronxe, qui a pourtant connu, deux ans plus tôt, les horreurs
de l'invasion, éprouve, dans son coeur, un émoi inaccoutumé : «
Les jours les plus tristes que j'aie vécus de la guerre, ce sont
ceux qui ont suivi son départ » (92).
Tous les témoins de la bravoure de l'aumônier sur la ligne de
feu étaient convaincus que, si on allait à Verdun, il serait tué
ou prisonnier. Le bon curé le savait, il se le redisait avec
angoisse.
(1) Transposition de l'appellation de sainte
Jeanne d'Arc : « Jeanne, la bonne Lorraine ».
(2) C'est-à-dire « Groupe de Brancardiers Divisionnaires ». Nous
emploierons cette abréviation usuelle, d'un usage commode.
(3) A. de Th, c'est-à-dire Auguste de Thoras. Articles publiés,
à la fois, dans Le Centre, de Montluçon, et L'Avenir de la
Haute-Loire, du Puy.
(4) Voici comment les apprécie un médecin du front : « H. le P.
Limagne trouve assommants les gens qui parlent du front sans le
connaître Il raconte strictement ce qu'il a vu, le fait suivre
de commentaires, mais n'ajoute rien d'artificiel. Ces articles
réunis formeraient une histoire vraie ». (Lettre du Dr Audard à
Mme Audard, 22 juin 1916). Le Dr Audard a bien voulu extraire
pour nous, des lettres adressées pendant la guerre à sa femme,
les passages concernant le P. Limagne.
(5) « Toujours discret sur sa personne, il ne nous a presque
rien dit de ses campagnes. Les croquis qu'il en a dessinés, d'un
joli trait de plume, sont impersonnels. Son talent d'écrivain
fait voir la bataille ; mais, lui, on ne le voit pas. A l'en
croire, il n'a rien fait que regarder et raconter l'oeuvre
sublime des autres. Ce sont les autres qui rendent témoignage
pour lui ». Abbé Thellier de Poncheville, Oraison funèbre de M.
Limagne, prononcée à la Réunion des Etudiants, Paris, le 6
novembre 1919 (Revue Montalembert, nov. 1919, p. 709).
(6) C'est, en effet, de quatre ans après ces faits que datent
presque tous les témoignages les concernant, qui m'ont été
adressés.
(7) Parmi ceux-là, beaucoup ont trouvé une mort glorieuse.
(8) Capitaine Colin, lettre du 8 février 1920.
(9) A. de Th., Les Poilus (Le Centre, 19 avril 1916). Tout cet
article est un éloge superbe du soldat français.
(10) Dr Archambault, mémoire d'avril 1920.
(11) A. Limagne, Le Rosaire, 1920, Tourcoing, pp. 4-5.
(12) Dr Archambault, mémoire d'avril 1920.
(13) Lettre du 11 janvier 1916.
(14) Capitaine Colin, lettre du 2 février 1920.
(15) Lettre du 2 février 1920.
(16) Lettre du 24 décembre 1919.
(17) Dr Lafitte, mémoire du 14 juillet 1920.
(18) Le P. Ballot, lettre du 15 janvier 1920.
(19) Dr Archambault, mémoire d'avril 1920.
(20) Lettre du 11 janvier 1916.
(21) Lettre du commandant Philippe, 3 février 1920.
(22) Carnet de campagne du Dr Raoult.
(23) Allusion au titre du panégyrique prononcé par le P.
Limagne, le7 mai 1914, à Cuet, paroisse natale du Bienheureux :
L'ascension d'une âme : Le Bienheureux Chanel, 1914, Montluçon,
Imp. Herbin-Bouché.
(24) Le 23 février.
(25) Dr Archambault, mémoire d'avril 1920.
(26) Le commandant Gérard, lettre du 26 décembre 1919.
(27) Le Dr Ducret.
(28) A. de Th., Comment ils meurent (Le Centre, 3 avril 1916).
(29) Dr Archambault, mémoire d'avril 1920.
(30) Lieutenant Chichery, lettre du 6 mars 1920.
(31) Dr Lafitte, mémoire du 14 juillet 1920.
(32) A. de Th., Les territoriaux en première ligne (Le Centre,
12 juin 1916).
(33) A. de Th., Les territoriaux en première ligne (Le Centre,
12 juin 1916).
(34) Lettre du Dr Audard à Mme Audard, 27 mars 1916.
(35) A. de Th., Le lieutenant E. D. (Le Centre, 14 avril 1916).
(36) A. de Th., article cité.
(37) Témoignage du Dr Bousquet, lettre du 24 août 1920.
(38) Lettre du 18 mars 1916.
(39) Lettre du 11 janvier 1916.
(40) Lettre du 28 mars 1916.
(41) Lettre du 4 mars 1916
(42) Lettre du 3 janvier 1916.
(43) Lettre du 16 janvier 1916.
(44) Dr Bousquet, lettre du 24 août 1920.
(45) Le P. Ballot, capucin, lettre d'octobre 1919.
(46) Lettre du 12 mars. 1916.
(47) Evidemment Laronxe
(48) Une « huile » : un chef.
(49) Dieu et la guerre, par l'abbé Thellier de Poncheville,
Paris. Bloud.
(50) Lettre du 8 juin 1916.
(51) Dr Archambault, mémoire d'avril 1920
(52) Capitaine Portères, lettre du 20 décembre 1919.
(53) Dr Bornèque, médecin-chef du 168e d'infanterie, lettre du
27 janvier 1920.
(54) Dr Archambault, mémoire d avril 1920.
(55) Lettre du 8 février 1920.
(56) Lettre du 24 décembre 1919.
(57) Dr Raoult, carnet de campagne, 12 mars 1916.
(58) Dr Audard, lettres des 9 septembre et 8 décembre 1919.
(59) L'abbé Lécuyer, lettre du 21 juillet 1920.
(60) Dr Lafitte, mémoire du 11 juillet 1920.
(61) Docteur Raoult, Carnet de campagne, 27 février 1916. Dans
ces notes-on trouve comme le tour de phrase du P. Limagne lui
même.
(62) Le P. Ballot, lettre d'octobre 1919.
(63) D'après le témoignage de M l'abbé Munier, curé de Bénaménil.
(64) L'abbé Munier, lettre du 22 janvier 1920.
(65) M. l'abbé Moussus, lettre du 27 novembre 1919.
(66) Un aumônier de bataillon était un prêtre-brancardier
attaché au poste de secours d'un bataillon. Théoriquement, il
restait un simple brancardier et il ne portait point la soutane
; en pratique, par le consentement des autorités militaires, son
rôle consistait à assurer le service religieux du bataillon et
il avait toute liberté de circuler pour l'exercice de son
ministère.
(67) L'abbé Moussus, lettre du 12 décembre 1919.
(68) L'abbé Couard, lettre du 17 octobre. 1919.
(69) M. l'abbé Dupé, lettre du 26 octobre 1919. Citons encore un
témoignage. En 1921, au cours d'un voyage, deux anciens
confrères du P. Limagne s'entretenaient de lui, par hasard ; un
autre prêtre, qui se trouve là les interrompt : « Ce P. Limagne,
n'est-ce point celui que j'ai connu comme aumônier ? - Mais oui,
certainement. - Eh ! bien, je ne l'ai vu que deux fois cinq
minutes, et j'en garde un souvenir impérissable ; il m'a remonté
complètement et, depuis lors, j'ai fait la guerre sans crainte
».
(70) Lettre d'octobre 1919.
(71) Lettre du 27 novembre 1919.
(72) Lettre du 13 juillet 1920.
(73) Lettre du 3 décembre 1920. (Le P. Piacentini appartient à
la Congrégation des PP. du Saint Esprit). (5) Lettre du 20
décembre 1919.
(74) Lettre du 24 décembre 1919.
(75) Lettre du 15 octobre 1919 ; mémoire du 14 juillet 1920.
(76) Lettre du 9 octobre 1919.
(77) Le Dr Janot est lui-même un Lorrain.
(78)A noter que la famille Richard n'avait pourtant connu le P.
Limagne que lors de ses courts séjours mensuels à Laronxe.
(79) Lettre du 12 mai 1922. - Citons encore le témoignage d'un
médecin militaire, qui passait pour anticlérical. Après la mort
du P. Limagne, il écrivait à un ancien collègue d'ambulance : «
Dans les trop courts instants qu'il voulait bien, de temps en
temps et lorsqu'il en avait le loisir, venir passer en notre
compagnie, j'avais appris à l'estimer et à l'aimer. C'était non
seulement un homme brave, mais un brave homme, une noble et
belle ligure, dont la perte est particulièrement sensible au
clergé, car il était de ceux dont l'intelligence, la bonté, la
douceur, la chaude et persuasive, parole savent attirer l'amitié
». Plus loin, il parle de « la maladie qui est venue l'enlever à
l'affection des siens et de tous ceux qui, comme nous, ont eu le
bonheur de l'approcher » ; des détails qu'il a appris sur « la
fin édifiante, digne et courageuse, de notre pauvre et
malheureux ami ».
(80) Capitaine Moreau, maintenant chef d'escadron, lettre du 19
décembre 1919.
(81) Lettre du 20 avril 1920.
(82) Lettre du 28 juin 1920.
(83) Lettre d'octobre 1919.
(84) Lettre du 22 janvier 1920.
(85) Lettre du 22 janvier 1920.
(86) Lettre du 1er juillet 1916.
(87) Lettre du 30 juin 1916.
(88) Autre lettre du même jour.
(89) Lettre du 11 juin 1916.
(90) Autre lettre du même jour.
(91) Lettre du 29 juin 1916.
(92) Abbé Boileau, lettre du 22 janvier 1920. |













