|
10 août 1854
Le Droit
COUR D'ASSISES DELA MEURTHE (Nancy).
Présidence de M. Pierson.
Audiences des 3 et 4 août.
EMPOISONNEMENS. - DEUX ACCUSÉS. - CONDAMNATION A MORT. -
CONDAMNATION AUX TRAVAUX FORCÉS A PERPÉTUITÉ.
Le principal accusé, Jean-Christophe Marchal, garde
forestier, est un homme d'une cinquantaine d'années, de
haute taille, et paraissant doué d'une constitution
vigoureuse. Ses traits sont accentués, et son oeil, enfoncé
dans l'orbite, lance un regard plein de flamme.
Sa complice, Florentine Stoquer, beaucoup plus jeune que
lui, et qui paraît âgée de vingt-cinq ans à peine, porte dos
vêtements de deuil et ne manque pas d'un certain charme dans
la physionomie.
Dans cette affaire, d'une gravité exceptionnelle, M. le
procureur général a voulu soutenir lui-même l'accusation.
La défense est confiée à Me Louis.
Voici comment Pacte d'accusation retrace la série des
empoisonnement successifs dont Marchal se serait rendu
coupable :
Jean-Christophe Marchal, né à Angomont le 25 juillet 1802,
appartient à une famille riche de cette commune, dont la
population est peu nombreuse. Il y a un mois à peine, son
neveu était maire, son frère instituteur, un autre de ses
parens adjoint. Tous les autres membres de sa famille sont
propriétaires. Aussi cette position de fortune inspirait et
inspire encore aujourd'hui aux habitans, qui sont pour la
plupart de pauvres bûcherons, un certain sentiment de
crainte.
En 1822, appelé par la loi du recrutement a faire partie de
l'armée, Marchal fut incorporé dans le 1er régiment de
dragons. Après trois ans de service, il se fractura le
poignet et fut réformé : il était alors maréchal-des-logis.
Il rentra au village d'Angomont, qu'il n'a plus quitté
depuis. Il y a été successivement maire, garde particulier
de Mme la princesse de Poix, puis de M. Chevandier, au
service duquel il était lors de son arrestation.
Avant d'être enrôlé sous les drapeaux, Marchal avait eu un
enfant naturel de Marie-Anne Aubert. Cet enfant, né le 18
novembre 1822, est décédé quelques jours après, le 25 du
même mois. A son retour, son ancienne maîtresse était mariée
avec un nommé Vincent. Marchal épousa lui-même en 1826 Anne
Bournier, de Pexonne. Il en eut deux enfans qui vivent
encore aujourd'hui. Ce sont ses seuls enfans. L'un, employé
chez M. Chevandier, habite Angomont, l'autre se prépare à
l'état ecclésiastique au séminaire de Corbigny (Nièvre).
Marchal est un homme d'un caractère orgueilleux, ayant
beaucoup de confiance en lui-même. Il passe, à i juste titre
dans le pays pour avoir abusé de sa position de garde, afin
d'obtenir les faveurs des femmes qu'il trouvait dans les
forêts confiées à sa surveillance. Quoique marié, il avait
renoué des relations coupables avec son ancienne maîtresse,
lorsqu'une double catastrophe éclata dans le ménage de
chacun d'eux.
Le mari d'Anne Aubert, Jean Vincent, mourut le 6 juin 1838,
et Anne Fournier, la femme de Marchal, le suivit de près;
elle décéda le 2 septembre suivant. Ces deux morts
extraordinaires n'excitèrent pas alors l'éveil de la
justice. On n'osa pas en relever les circonstances. Mais il
se produisit alors un grand scandale. A peine devenu veuf,
Marchal fit venir chez lui, vers la fin d'octobre,
Marie-Anne Aubert et vécut avec elle eu concubinage. L'abbé
Guénin, curé d'Angomont à cette époque, fit de vaines
démarches pour faire cesser ce scandale. Marchal et Anne
Aubert se marièrent ensemble après dix mois de veuvage
seulement.
Mais cette dernière était devenue vieille ; Marchal s'en
dégoûta ; on le vit alors commencer et entretenir des
relations adultères avec une jeune femme de son voisinage,
nommée Florentine Stoquer, épouse Geoffroy. Anne Aubert les
reprochait souvent à son mari, et de fréquentes altercations
s'élevaient à ce sujet entre les deux époux.
C'est en ces circonstances que Marie-Anne-Aubert décéda, le
15 janvier 1853, après avoir fait devant Me Mangeon, notaire
à Badonviller, une donation de tous ses biens en faveur de
son mari. Quelques jours après, Eloi Geoffroy tomba malade
et mourut le 18 février, après avoir également fait une
donation de tous ses biens en faveur de sa femme.
Devenue veuve, Florentine Stoquer resta a Angomont un mois
environ, puis elle alla se fixer dans sa famille à
Saint-Sauveur. Les relations de Marchal avec la femme
Geoffroy, qui étaient de notoriété publique avant le décès
de Geoffroy et de Marie-Anne Aubert, continuèrent ; les
rendez-vous avaient lieu dans la forêt, et un témoin les a
surpris se livrant à d'indécentes caresses.
La famille Marchal voyait avec peine une telle conduite.
Quand il parla d'épouser la veuve Geoffroy, on lui fit de
sages observations qu'il n'écouta pas, et le mariage eut
lieu le 19 décembre 1853, après les dix mois de veuvage.
Jusqu'à cette époque, il n avait circulé dans le pays aucun
soupçon sérieux, soit sur Marchal, soit sur la femme
Geoffroy. Ce ne fut qu'à partir de ce moment, et
principalement dans le mois de janvier, que l'on parla
d'empoisonnement. A Angomont, ou la famille Marchal est
toute puissante, on n'osait rieur dire, mais à Brémenil et à
Badonviller, ces bruits, vagues d'abord, prenaient de la
consistance. On rappelait, en les groupant, les mariages
successifs de Marchal, la mort de ses deux premières femmes,
celle de Geoffroy, les nombreux adultères des accusés
pendant la vie de leurs conjoints.
Marchal était très inquiet. Florentine Stoquer, sa femme,
partageait ses inquiétudes. Aussi faisait-il d'actives
démarches pour étouffer les bruits qui circulaient. Une
chose étonnait, c'était le silence de Marchal quand on lui
disait : « Provoquez une exhumation, vos meilleurs témoins
sont dans la terre. » Les craintes et les angoisses de sa
femme augmentaient chaque jour. Epouvantés l'un et l'autre
par suite des investigations que commençait la justice, ils
se décidèrent à prendre la fuite. Ils quittent Augomont dans
la soirée du 24 janvier, ils marchent toute la nuit, et le
25, à six heures du matin, ils arrivent à Sarrebourg au
moment du passage du train-poste pour Strasbourg; ils sont
tellement pressés, qu'ils prennent ce convoi, composé
seulement de voitures de première classe.
La dame Boulanger, d'Angomont, qui allait à Strasbourg, les
rencontre à la gare de Sarrebourg et monte dans la même
voiture. Connaissant l'accusation qui s'élève contre les
époux Marchal, elle est frappée de leur tristesse et
remarque que Marchal a coupé ses moustaches. Celui-ci répond
à peine à ses questions et se borne a lui dire qu'ils vont
faire un voyage d'agrément. Les accusés, craignant d'être
arrêtés à leur arrivée à Strasbourg, descendent ii Brumath
et veulent quitter la dame Boulanger, de peur qu'elle ne
puisse fournir plus tard des indications sur la direction
qu'ils ont prise. Ils traversent Strasbourg, passent le
Rhin, vont à Kehl ; mais là on leur demande leurs papiers.
Marchal ne produit qu'un certificat de bonne conduite, qui
paraît insuffisant à l'autorité badoise. Alors les fugitifs
sont obligés de revenir rapidement à Angomont.
La veille de son départ, Marchal, accompagné de son
beau-père Rafain, s'était rendu chez Me Stingre, notaire à
Blâmont, pour faire une vente simulé de tous ses biens,
meubles et immeubles; mais son fils Théophile étant
intervenu, ce projet fut abandonné. On convint qu'un acte de
donation serait fait. On voulait ainsi frustrer le
gouvernement en cas de poursuite.
La gendarmerie ayant su que Marchal avait pris la fuite, on
prévint la justice, qui se transporta sur les lieux le 29.
Marchal y était; il s'était fait délivrer par le maire d'Angomont,
son neveu, un certificat constatant qu'il n'avait jamais
quitté le pays ; il le remit à la gendarmerie et se présenta
ensuite avec sa femme au juge d'instruction, qui les
interrogea et commença l'information.
Les témoins entendus alors, médecin, curé, habitant d'Angomont
et autres, tous déclarèrent que Marie-Anne Aubert et Eloi
Geoffroy étaient morts naturellement, l'un d'une
péripneumonie, l'autre d'une gastro-entérite.
L'information dut s'arrêter là. Cependant le Parquet de
Lunéville prescrivit à la gendarmerie de Badonviller et au
juge de paix de Blâmont de continuer leurs investigations.
Le 27 février, on apprit qu'à l'époque du décès de
Marie-Anne Aubert et d'Eloi Geoffroy (décembre 1852 à
février 1853), Marchal, à trois reprises différentes, avait
acheté de l'arsenic chez Chardin, pharmacien à Badonviller.
Les magistrats se rendirent immédiatement à Angomont.
Marchal et sa femme avaient déjà pris la fuite.
Dans la nuit du 26 au 27, devant Me Mangeon, notaire à
Badonviller, qui s'était transporté à Angomont, Marchal
avait fait donation de tous ses biens, meubles et immeubles,
à ses deux enfans, dans le but évident d'annihiler les
garanties du fisc.
Après beaucoup de recherches et d'actives démarches, la
gendarmerie parvint, le 31 mars, à arrêter les époux
Marchal, qui s'étalent réfugiés chez un nommé Lhôte, à Parux.
Les corps de Marie-Anne Aubert et d'Eloi Geoffroy furent
exhumés et soumis à une analyse qui fut faite par trois
chimistes distingués de Nancy, MM. Braconnot, Simonin et
Blondlot. Une quantité considérable d'arsenic fut retrouvée
dans les viscères de Marie-Anne Aubert et d'Eloi Geoffroy,
et, dans leur procès-verbal, les experts concluent en ces
termes : « Des faits qui précèdent nous concluons que
Marie-Aune Aubert et Eloi Geoffroy sont morts empoisonnés
par l'arsenic. »
Les auteurs de ces deux empoisonnements sont les époux
Marchal.
Il est de notoriété publique, on l'a déjà dit, que Marchal
et Marguerite-Florentine Stoquer, du vivant de leurs
conjoints, entretenaient un commerce adultérin; ils ont été
surpris en flagrant délit : Stoquer père en avait parlé à
son gendre et à sa fille. La famille Marchal en était
affligée. Marie-Anne Aubert, jalouse et profondément blessée
de la conduite de son mari, avait fait connaître son
chagrin; elle eut même à ce sujet des discussions vives avec
Marchal, auquel elle reprochait ses relations avec la femme
Geoffroy.
Peu de temps avant leur mort, Marie-Anne Aubert et Geoffroy
pressentaient qu'ils seraient bientôt remplacés par
Florentine Stoquer et par Marchal. Ainsi, la première disait
à sa filleule, Adélaïde Humbert : Quand je ne serai plus, tu
verras la femme d'Eloi entrer chez nous. Geoffroy, deux
jours avant sa mort, disait à la femme Jacquel : Mon numéro
est sorti, il faut partir, mais c'est place pour un autre !
Et par là, ajoute le témoin, j'ai compris qu'il voulait dire
que Marchal le remplacerait près de sa femme.
Marie-Anne Aubert tomba malade vers le 10 novembre 1852. A
cette époque, on voit Marchal accompagnant M. Chevandier à
la chasse, du côté de Saint-Remy-aux-Bois, prier un garde de
lui acheter de l'arsenic à Charmes. Il revient, et avec des
ordonnances du sieur Lamblé, docteur en médecine à
Badonviller. il parvient à se procurer trois fois de
l'arsenic chez le pharmacien Chardin, les 12 décembre 1852,
2 et 14 février 1853, une fois avant le décès de sa femme,
morte le 15 janvier 1853, et deux fois avant le décès de
Geoffroy, mort le 18 février 1853 : en tout, 120 grammes
d'arsenic. Avant ces époques et depuis, on ne trouve plus
d'acquisition d'arsenic faite par Marchal, si ce n'est dans
l'année 1838, chez le pharmacien Cabasse, de Raon-l'Etape.
Ce fut dans les premiers jours de janvier que la maladie de
Marie-Anne Aubert fit des progrès effrayans. Marcha!, dans
ce moment, lui administrait le poison dans les remèdes qu'il
lui faisait prendre. Les progrès de la maladie furent si
rapides, que le docteur Grandys déclare que, je 9 janvier,
étant arrivé accidentellement chez Marchal, ff fut tellement
frappé de l'aspect du facies de la malade, que l'idée du
poison a traversé son âme, mais qu'il n'a pas osé s'y
arrêter, à raison du calme et de l'impassibilité de Marchal,
qui se trouvait au pied du lit.
La femme Marchal sentait qu'elle mourait empoisonnée ; elle
refusait les remèdes que son mari lui donnait, disant à
plusieurs personnes : Donnez-moi à boire ; mais surtout ne
vous trompez pas, je ne veux pas de ses remèdes.
On remarquait que son mari allait préparer les boissons près
d'une armoire dont lui seul avait la clef, et qu'il faisait
toujours chauffer l'eau composant ces boissons. On sait que
l'arsenic se dissout facilement dans un liquide chaud,
tandis que la dissolution est, sinon impossible, au moins
très difficile et lente dans un liquide froid. Aussi les
vomissements arrivaient-ils quand Marchal donnait à sa femme
ces breuvages chauds, tandis qu'ils ne se produisaient pas
quand des étrangers préparaient et présentaient des
breuvages froids à la malade qui, à la fin, ne voulait plus
que de l'eau fraîche.
Cette malheureuse fit comprendre au nommé Clasquin, d'une
manière nette et positive, qu'elle mourait empoisonnée par
son mari ; elle fit même à ce dernier des reproches en sa
présence, en ces termes ; Oh ! mon Dieu ! quel malheur, le
plus grand malheur du monde ! Elle répondait à son mari, qui
lui demandait sa main : Va t'en, mauvais gueux ; il aurait
mieux valu pour toi et pour moi que tu ne l'eusses jamais
touchée ! Voulant désigner Florentine Stoquer, un instant
après, elle lui disait: Va-t-en, mauvais drôle! c'est toi
qui es la cause que je suis ici, Marchal se bornait à dire à
Clasquin: Eh bien ! voyez Clasquin, voilà quatre jours et
quatre nuits que je la garde. Sa femme répliquait aussitôt :
Oui, tu sais bien pourquoi tu me gardes ici.
Marchal, avant et après la mort, alors qu'on ne l'accusait
pas encore, parlait des bruits qui couraient ou qui
pouvaient courir; il faisait goûter les drogues qu'il
prétendait administrer à sa femme. A Clasquin, avant la
mort, il dit : Oh! les s... n... de D... de f... bêtes, ils
disent que j'avance sa mort; elle le dit; venez voir que je
vous fasse goûter ses drogues, vous verrez si c'est bon ou
mauvais. Après la mort, Marchal disait encore à des femmes
qui étaient venues jeter de l'eau bénite sur le corps de
Marie-Anne Aubert : Les b... de bêtes, ils disent que j'ai
avancé sa mort; eh bien, goûtez. En même temps il leur
faisait goûter d'une espèce de sirop.
Lorsque la justice fit ses premières investigations et qu'on
ignorait ses acquisitions d'arsenic, Marchal disait à Bruaut
; Je ne crains rien; si quelqu'un a été empoisonné, ce n'est
pas par moi; je n'ai jamais eu de poison en ma possession,
et, chez aucun pharmacien de France on ne peut trouver que
j'en ai acheté !
Cependant, malgré cette apparente sécurité, Marchal
cherchait à circonvenir et à suborneur les témoins. Adélaïde
Humbert, filleule de Marie-Anne Aubert, qui l'aimait
beaucoup, avait assisté aux derniers instans de sa marraine,
avait reçu ses confidences et avait vu plus d'une fois des
scènes violentes de la part de Marchal. Celui-ci, craignant
les indiscrétions de cette fille, alors que l'impunité
semblait devoir couvrir ses crimes, la chassa de sa maison,
en l'accusant faussement de l'avoir volé. Adélaïde Humbert
se rendit à Paris. L'information commencée, l'accusé
comprend l'intérêt qu'il a d'obtenir son silence, et il
écrit à Stoquer, de Saint-Sauveur, son beau-frère, pour le
prier de voir aussitôt Adélaïde Humbert qui sera entendue
par un juge d'instruction à Paris et de l'engager sans doute
à taire ce qu'elle sait.
A la même époque, afin de combattre à l'avance l'accusation
d'empoisonnement qui pèse sur lui, Marchal va trouver un
nommé Jean-Baptiste Vibert, et lui dit : Tu me sauveras la
vie et l'honneur de ma famille, si tu veux me rendre un
service dont je vais te parler. En échange de ce service, je
te donnerai une somme de 500 fr.; tu devras affirmer devant
la justice que le jour de l'an, entre midi et une heure,
t'étant présenté chez ma femme pour lui souhaiter la bonne
année, tu l'as trouvée seule -qu'en réponse à tes souhaits,
elle t'a dit : Oh ! mon pauvre Baptiste, pour mon premier
jour de l'an, c'est si j'avais du poison pour m'empoisonner!
A quoi tu as répliqué : Oh ! madame Marchal, à quoi
pensez-vous de dire des choses semblables? Mais celle-ci a
manifesté sa persistance par ces mots : Oh ! Baptiste, si
j'avais du poison, je m'empoisonnerais.
Vibert a repoussé une telle ouverture; en présence de sa
résistance, Marchal lui a dit : Au moins que la semelle de
tes souliers n'en sache rien.
Le jeune Aubry, domestique de Marchal, était le confident de
son maître, ou bien il avait surpris plus d'un de ses
secrets. A la nouvelle de l'arrestation de celui-ci il pâlit
et craint d'être arrêté comme lui ; il dit à Marguerite
Vernier : Si je disais ce que je sais, mon maître aurait le
cou coupé. Dans une autre circonstance, il disait à Thérèse
Vincent et à Alexis Maire : Si ces messieurs (c est-à-dire
les magistrats en information) savaient ce que sait Adélaïde
comme moi aussi, les Marchal seraient bientôt f...
Enfin, lorsque Marchal est détenu à Lunéville et qu'il
apprend que les charges deviennent chaque jour plus
accablantes, il cherche à faire passer à l'insu du gardien
en chef une lettre à un de ses amis qui devait lui procurer
des moyens d'évasion.
Ces faits désignaient clairement Marchal comme l'auteur de
la mort de sa femme Marie-Anne Aubert.
Marguerite-Florentine Stoquer était sa complice naturelle et
obligée. Epouse adultère, afin de pouvoir épouser son amant,
il lui fallait la mort de la femme Marchal ; elle a concerté
le crime avec le mari de celle-ci, une même pensée les
agitait tous deux, un même mobile les poussait; mais son but
n'aurait pas été atteint si Geoffroy, son mari, eût survécu
: aussi mourut-il peu de jours après.
Lors du décès de la femme Marchal, Geoffroy n'était pas
encore malade. Agé de 35 ans, il était fort, vigoureux,
travaillant activement, et cependant sa femme prédisait déjà
sa mort, car dès ce moment elle l'avait résolue d'accord
avec son complice. Se trouvant à la veillée chez la femme
Holwech, elle disait : Je mets du bleu dans le fil que je
fais afin qu'il puisse servir pour mon deuil. Comme on lui
demandait l'explication de ces paroles, elle répondit :
Qu'une femme qui disait la bonne aventure lui avait prédit
mort et dérangement; que cela ne pouvait s'appliquer à son
père, parce que cela ne ferait que malheur, et que pour
qu'il y ait dérangement, la prédiction devait nécessairement
s'appliquer à son mari On lui fit observer qu'il était gai,
bien portant ; elle ajouta : Toutes les nuits il est malade;
bien sûr il mourra, il ne sera plus à Pâques.
Quelques jours après, Geoffroy tomba malade. On attribua
d'abord son indisposition à un effort qu'il fit en forêt. Le
8 février, il donna tous ses biens meubles et immeubles à sa
femme. A partir de ce jour, la maladie augmente de gravité :
elle offre tous les symptômes de l'empoisonnement. Marchal
est toujours chez lui, il ne le quitte pour ainsi dire pas;
le docteur Lamblé l'y trouve même à deux heures du matin.
Puis Marchal continue à acheter de l'arsenic à Badonviller :
50 grammes le 2 février et 40 grammes le 14. Geoffroy ayant
désiré manger un oiseau, Marchal le fournit ; la femme
Geoffroy le prépare, son mari en mange un peu ; et depuis ce
jour dit le docteur Lamblé, ce fut un homme perdu. Il est
mort en effet, le 18 février, empoisonné par sa femme et par
Marchal qui lui administraient l'arsenic dans les aliments
et les tisanes.
L'abbé Coutret, curé d'Angomont, avait été tellement frappé
de la maladie de Geoffroy, qu'il la qualifiait, en revenant
chez lui, de Miserere. Il était si préoccupé de tout ce qui
se passait que, voyant Marchal assister aux derniers moments
de Geoffroy et recevoir sa femme dans ses bras, il le
repoussa violemment en lui disant ; Ce n'est pas là votre
place.
Marie-Anne Aubert et Eloi Geoffroy sont donc morts
empoisonnés ; ils étaient un obstacle à l'union des deux
époux adultères, le poison en a eu bientôt raison.
L instruction était complète sur ces deux crimes, lorsque
les magistrats de la Cour pensèrent que Marie-Anne Bournier,
première femme de Marchal, et Jean-Baptiste Vincent, premier
mari de Marie-Anne Aubert, avaient pu succomber à un
empoisonnement : un arrêt ordonna un supplément
d'information, qui a pleinement confirmé les prévisions des
magistrats.
On exhuma les restes de ces malheureux, une analyse chimique
fut faite par les mêmes experts, et dans les deux cadavres
on a trouvé de l'arsenic.
Marchal avait donc empoisonné sa première femme pour se
marier avec son ancienne maîtresse, après dix mois de
veuvage seulement.
Cette dernière s'était associé à ce crime en se débarrassant
elle-même de son mari, et Marchal, son horrible complice,
s'est chargé de la punir eu la faisant périr à son tour par
le poison, de concert avec la femme Geoffroy.
Son second crime n'a été qu'une épouvantable copie de celui
qu'il avait commis en 1838.
Dans leurs interrogatoires, les accusés se renferment dans
un système de dénégations absolues. Marchal dit :
Si on a trouvé de l'arsenic dans le corps de ma femme, c'est
elle qui s'est empoisonnée avec le poison que j'avais chez
moi ; quant à E!oi Geoffroy, je ne sais comment cela s'est
fait. Il prétend n'avoir acheté que deux fois de l'arsenic
pour faire périr les grillons. S'il a pris la fuite,
c'était, dit-il, pour éviter la prison préventive.
Quant à Marguerite-Florentine Stoquer, elle répond qu'elle
ne sait rien, qu'elle n'a jamais eu de poison en sa
possession. Enfin, tous deux repoussent avec énergie les
relations adultérines dont le nommé Jacquot a été le témoin
si complet.
M. LE PRÉSIDENT fait retirer Marchal de l'audience et
procède à l'interrogatoire de Florentine Stoquer.
D. A quel âge avez-vous épousé Geoffroi, votre premier mari
?-R. A dix-huit ans et demi.
D. Votre mari se portait bien ? - R. Oui, monsieur.
D. Comment est-il tombé tout à coup malade?--R. Il s'est
plaint d'avoir mal à l'estomac.
D. Saviez-vous quel mal il avait ?- R. Je crois que c'était
une fluxion de poitrine.
D. Avez-vous bien soigné votre mari ? - R. Oui, monsieur.
D. Vous l'avez beaucoup regretté ? - R. Oui, monsieur.
D. Comment alors vous êtes-vous remariée dix mois après ? -
R. Il y en a bien d'autres qui font comme moi.
D. Connaissiez-vous Marchal du vivant de votre premier mari
? - R. Non.
D. Il ne vous a jamais fait la cour? - R. Non.
D. N'ayez-vous pas eu avec Marchal des relations aussi
intimes que possible entre un homme et une femme? - R. Non.
D. Pendant sa maladie, votre mari n'a-t-il pas manifesté le
désir de manger du gibier, des oiseaux et du lièvre?
N'a-t-on pas remarqué qu'aussitôt après avoir mangé ce
gibier, qui venait de Marchal, l'état de votre mari est
devenu plus grave, qu'il a eu des vomissements, des selles
nombreuses?-R. Je ne sais pas.
D. Il est impossible que vous ayez ignoré ces circonstances?
- R. Je ne me les rappelle pas.
M. le procureur général fait remarquer que c'est à partir du
moment où il a mangé des oiseaux pris chez Marchal, que
Geoffroy est devenu plus malade. Ses coliques sont devenues
plus intenses, ses vomissemens plus fréquent. Il relève, en
outre, une contradiction dans la déclaration de Florentine,
qui avait dit dans l'instruction que son mari n'avait pas
mangé d'oiseaux, qu'elle les avait jetés. A l'audience, elle
prétend en avoir jeté au moins deux, parce qu'ils étaient
gâtés.
D. Pendant la maladie de votre mari, Marchal n'était-il pas
chez vous? - R. Je ne me rappelle pas.
D. Il y était si bien qu'il donnait à boire à votre mari?-
R. Je ne me rappelle pas.
D. De quel mal est morte la femme Aubert ? - R. Je pense
qu'elle est morte de son retour d'âge.
D. Marchal prétend que Marie Aubert a manifesté plusieurs
fois l'intention de se détruire. Est-ce vrai cela? - R. Je
ne sais pas.
D. Comment ! Marchal ne vous a-t-il donc jamais parlé de
cette circonstance? - R. Jamais.
D. La fille Olvel venait-elle chez-vous quelquefois? - R.
Oui.
D. Mais vous avez dit que non dans l'accusation ? - R. C est
que je ne m'en suis pas souvenue.
D. Vous rappelez-vous lui avoir offert du pain sur lequel
vous avez étendu de la crème, et que cette fille a ressenti
aussitôt après de violentes coliques et éprouvé des
vomissements?,-R. Je ne me rappelle pas.
D. L'accusation se le rappelle, car il sera constaté que
vous avez étendu la crème sur le pain de la fille Olvel avec
une cuiller que vous teniez à la main, laquelle était sans
doute imprégné du poison qui venait d'être donné à votre
mari.
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL. - Comment ! vous ne vous rappelez
pas que, dans sa maladie, votre mari avait de fréquent
vomissements? - R. Non, je ne me le rappelle pas.
D. Marchal venait fréquemment chez vous? - R. Il y venait
quelquefois.
D. Y restait-il tard? - R. Non, il s'en allait à bonne
heure.
D. Les débats établiront que Marchal, pendant la maladie de
Geoffroy, venait fréquemment chez vous, qu'il y restait
tard, et que, lorsque quelques visiteurs se présentaient, on
les repoussait en disant que Geoffroy était trop malade; et
cependant Marchal était là et y demeurait jusqu'à une heure
avancée de la nuit ; une fois notamment, jusqu'à deux heures
après minuit.
M. le président. - Un jour, Marchal ne vous a-t-il pas prise
dans ses bras ? - R. Il est vrai qu'un jour, étant tombée en
faiblesse, Marchal m'a relevée et m'a posée sur une chaise ;
il y avait du monde là.
D. Oui, il y avait M. le curé d'Angomont entre autres, qui,
indigné de la conduite de Marchal, l'a vivement repoussé, en
lui disant que sa place n'était pas là. Vous avez eu des
relations très intimes avec Marchal ?-R. Non, monsieur.
D. Mais on vous a vu dans le bois avec Marchal ?- R. On
s'est trompé, ce n'était pas moi.
D. Mais vos relations coupables avec Marchal sont établies,
vous vous donniez des rendez-vous dans le bois ; des lettres
fixant l'heure de ces rendez-vous étaient placées à des
endroits convenus ? -R. Cela n'est pas.
D. Vous aviez si bien des relations coupables avec Marchal
que vous êtes allés ensemble à l'enregistrement, après la
mort de votre mari, pour déclarer la succession, et que le
commis de l'enregistrement vous a d'abord pris pour deux
amoureux?- R. Je ne me rappelle pas cela.
Marchal est ramené à l'audience.
M. le président l'interroge sur quelques faits de sa vie
antérieure.
D. Cependant vous avez eu avec Anne-Aubert, alors quelle
était la femme de Jean-Nicolas Vincent des rapports intimes
? - R. Non, monsieur.
D. Cependant tout le monde croyait à ces rapports et s'en
scandalisait. - R. Je n'en ai eu aucun.
D. Des témoins déclareront le contraire. R Les témoins se
tromperont.
D. Enfin Marie Aubert, votre ancienne maîtresse avec qui
vous avez eu un enfant, devient, après la mort de son mari,
votre concubine, des témoins en déposeront, puis enfin votre
femme. De quelle maladie est-elle morte ? - R. Be son retour
d'âge, je crois ; je ne me rappelle pas bien.
D. Comment! vous ne vous rappelez pas quelle a été prise de
coliques dans un pré ; que des vomissemens n'ont pas tardé à
se produire ainsi que le dévoiement? - R. Je ne me rappelle
pas. Ce que je sais c'est que je l'ai beaucoup regrettée et
qu'en la perdant j'ai perdu plus de 10,000 fr.
M. le président rappelle les sinistres prévisions des femmes
de Marchal qui, par une sorte de pressentiment, annoncent
leur mort prochaine. Puis, s'adressant à l'accusé, il lui
demande s'il a acheté de l'arsenic en 1838.
L'accusé répond affirmativement.
D. Pourquoi était-ce faire? - R. C'était pour empoisonner
des renards qui infestaient les bois.
-Mais voyez, dit M. le président, quelles singulières
coïncidences résultent de vos actes ; en 1838, vous achetez
de l'arsenic, et c'est à la même époque que meurent Anne
Bournier, votre femme, et François Vincent, le mari de celle
que vous épousez bientôt après, et qu'ils meurent
empoisonnés. Vous achetez encore de l'arsenic en décembre
1852, et c'est le 15 janvier 1853 que succombe votre seconde
femme. Vous en achetez le 3 février 1853, et c'est le 18
février qu'expire le mari de celle que vous convoitiez, de
celle avec qui vous entreteniez un commerce adultère.
On passe à l'audition des témoins.
Le premier est M. le docteur Blondlot, professeur de chimie
à l'Ecole de médecine de Nancy. Il explique à MM. les jurés
les différentes missions dont il a été chargé pour
l'exhumation de quatre cadavres, dont deux reposaient dans
la terre depuis quinze ans, et les deux autres depuis quinze
mois environ.
Il résulte de sa déposition que la présence de l'arsenic a
été constatée par les experts dans les restes de Marie-Anne
Bournier, première femme de Marchal, de Jean-Baptiste
Vincent, de Marie-Anne Aubert et d'Eloi Geoffroy.
L'audience est levée et renvoyée au lendemain.
Au commencement de l'audience du 4, M. le président fait
retirer l'accusé Marchal, puis après avoir fait descendre
dans l'enceinte de la Cour la femme Marchal, il lui dit ;
Florentine Stoquer, vous m'avez fait appeler, ajoutant que
vous aviez quelque chose à me dire. Je me suis rendu près de
vous, pesant que vous étiez dans l'intention de me faire
connaître toute la vérité; or, c'était pour me dire
seulement qu'il était vrai, en effet, que Geoffroy, votre
premier mari, avait mangé du civet, circonstance que vous
avez jusqu'ici déniée parce que Marchal vous avait
recommandé de n'en parler à personne. Cet aveu n'est qu'un
pas fait dans la voie de la vérité, où il faut entrer
entièrement. Vous savez que c'est à partir du moment où
votre mari a mangé ce civet que son état a empiré ?
La femme MARCHAL. - Je n'en sais rien.
D. Savez-vous que ce civet renfermât une substance nuisible?
- R. Non, monsieur.
D. Vous convenez maintenant, n'est-ce pas, que Marchal
venait souvent chez vous? --R. Oui, monsieur.
D. Qu'il y restait très tard? - R. Oui, monsieur.
D. Même la fuit? - R. Je ne crois pas,
D. Il donnait à boire à votre mari? - R. Je ne me le
rappelle pas.
D. Voyons, dites la vérité, n'étiez-vous pas d accord avec
Marchal pour faire insurger à votre mari ce civet qui a
aggravés fort sa maladie?-R. Oh l non, monsieur.
M. le procureur général presse de nouveau Florentine Stoquer
d'avouer toute la vérité. Florentine assure l'avoir dite
tout entière.
D. Eh bien, voyons, vous avez assuré que votre mari avait
mangé du civet, mais vous avez nié que vous avez eu
connaissance que ce met, préparé chez Marchal, pût causer de
graves accidents. En avez-vous mangé, vous?-R. Non,
monsieur.
D. Quelqu'un chez vous en a-t-il mangé?-R. Non, monsieur.
D. Ainsi ce mets, qui devait tenter tant de monde dans la
maison d'un bûcheron, personne n'y touche, excepté Geoffroy,
qui ne tarde pas à en éprouver les funestes effets.
D. Avez-vous su de quelle maladie était morte la seconde
femme de Marchal ?-R. Non, monsieur.
D. Comment ! vous n'avez pas su qu'elle avait eu des
vomissements? - R. Non, monsieur.
D. Mais enfin, Marchal, devenu veuf, a dû vous dire :
Maintenant, si tu étais veuve, je pourrais t'épouser? - R.
Il ne me l'a pas dit.
D. Marchal ne vous a-t-il pas dit de vous faire faire un
testament? - R. Non, monsieur, c'est mon mari qui a voulu me
donner ce qu'il avait.
D. Et qui est mort six semaines après ? Ainsi, vous obtenez
de votre mari une dotation, six semaines après votre mari
meurt, et après dix mois de veuvage vous vous remariez !
M. le procureur-général rappelle encore que Geoffroy a mangé
d'un oiseau accommodé par Florentine elle-même. Cette
dernière circonstance a précédé de deux jours la mort de
Geoffroy.
Il presse Florentine de s'expliquer, de dire toute la vérité
: Vous êtes devant la justice, dit-il, c'est comme si vous
étiez devant Dieu ; revenez à la vérité, Florentine, c'est
la vérité seule qui peut vous sauver devant Dieu et devant
les hommes. Il faut dire la vérité.
L'accusée déclare l'avoir dite tout entière.
On ramène l'accusé Marchal.
M. le président lui fait le récit de ce qui vient de se
passer. Marchal en est très ému et répond d'une voix altérée
aux pressantes questions qui lui sont faites.
On appelle M. le docteur LAMBLÉ. C'est ce témoin qui a donné
des ordonnances pour faire délivrer du poison à Marchal, et
qui a été appelé au lit de mort de Geoffroy ; il a délivré à
Marchal un certificat attestant que ce dernier était mort
d'une péripneumonie. Comme dans l'instruction, la déposition
de ce témoin est embarrassée, M. le procureur général lui
adresse, à plusieurs reprises, des admonestions sévères sur
l'imprudence de sa conduite et ses complaisances pour
l'accusé. Il lui reproche de n'avoir pas su voir le
véritable caractère de la maladie de Geoffroy, lui qui la
visite plus de sept fois avant sa mort, lui qui a signé
trois ordonnances pour faire délivrer du poison à Marchal :
120 grammes d'arsenic !
On entend successivement les autres témoins dont les
dépositions rappellent les faits exposés dans l'acte
d'accusation.
M. le président fait de nouveau retirer l'accusé Marchal et
fait descendre du banc des accusés Florentine Stoquer, qui
vient se placer au milieu de l'enceinte, sur l'estrade des
témoins. M. le président l'invite de nouveau à dire toute la
vérité. Elle convient que son mari lui a dit, en revenant de
Strasbourg, qu'il avait placé du poison dans le miel qu'il
avait envoyé à Geoffroy ; mais elle nie avoir jamais eu du
poison en sa possession et avoir connu que Marchal ait
empoisonné sa femme. A cet égard, les pressantes instances
de M. le président restent sans effet.
M. le procureur général LEZAUD prend ensuite la parole et
développe les charges qui pèsent sur les deux accusés.
Me LOUIS combat ce réquisitoire et demande l'acquittement de
ses deux clients.
Après le résumé des débats par M. le président, le jury
entre en délibération et revient au bout d'une heure et
demie en rapportant un verdict de culpabilité contre les
deux accusés.
Des circonstances atténuantes ayant été admises en faveur de
Florentine Stoquer, elle est condamnée aux travaux forcés à
perpétuité.
Marchal entend prononcer contre lui un arrêt de mort dont
l'exécution aura lieu sur la place de Baccarat.
Le Pays : journal des
volontés de la France
10 août 1854
Cour d'assises de la
Meurthe.
Présidence de M. Pierson,
conseiller.
Audience des 4, 5 et 6 août,
AFFAIRE DES ÉPOUX MARCHAL. - EMPOISONNEMENT
Marchal est un homme d'une stature élevée; son extérieur est
convenable et annonce un homme appartenant à cette classe des
habitants de la campagne que leurs occupations façonnent au
contact des gens du monde.
Florentine Stoquer a une expression de figure douce et agréable;
elle est vêtue de deuil.
Après l'accomplissement de certaines formalités d'usage, il est
donné, par le greffier, au milieu du profond silence, lecture de
l'acte d'accusation, dont voici les principaux passages :
Jean-Chrislophe Marchal, né à Angomorit le 25 juillet 1802,
appartient à une famille riche de cette commune.
En 1822, appelé par la loi du recrutement à faire partie de
l'armée, Marchal fut incorporé dans le 1er régiment de dragons.
Après trois ans de service, il se fractura le poignet et fut
réformé : il était alors maréchal des logis. Il rentra au
village d'Angomont, qu'il n'a pas quitté depuis. Il y a été
successivement maire, garde particulier de Mme la princesse
Poix, puis de M. Chevandier, au service duquel il était lors de
son arrestation.
Avant d'être enrôlé sous les drapeaux, Marchal avait eu un
enfant naturel de Marie-Anne Aubert. Cet enfant, né le 18
novembre 1822, est décédé quelques jours après, le 25 du même
mois. A son retour, son ancienne maîtresse était mariée avec un
nommé Vincent; Marchal épousa lui-même, en 1826, Anne Fournier,
de Pexonne. Il en eut deux enfants qui vivent.
Le mari d'Anne Aubert, Jean Vincent, mourut le 6 juin 1838, et
Anne Fournier, la femme de Marchal, le suivit de près ; elle
décéda le 2 septembre suivant. Ces deux morts n'excitèrent pas
alors l'éveil de la justice ; on n'osa pas en relever les
circonstances, Mais il se produisit alors un grand scandale. A
peine devenu veuf, Marchal fit venir chez lui, vers la fin
d'octobre, Marie-Anne Aubert, et vécut avec elle en concubinage.
L'abbé Guénin, curé d'Angomont à cette époque, fit de vaines
démarches pour faire cesser ce scandale. Marchal et Anne Aubert
se marièrent ensemble, après dix mois de veuvage seulement.
Mais cette dernière était devenue vieille ; Marchal s'en dégoûta
bientôt. On le vit alors entretenir des relations adultères avec
une jeune femme de son voisinage, nommée Florentine Stoquer,
épouse Geoffroy. Anne Aubert le reprochait souvent à son mari,
et de fréquentes altercations s'élevaient à ce sujet entre les
deux époux.
C'est en ces circonstances que Marie-Anne Aubert décéda, le 15
janvier 1853, après avoir fait devant Me Mangeon, notaire à
Badonviller, une donation de tous ses biens en faveur de son
mari. Quelques jours après, Eloi Geoffroy tomba malade et mourut
le 18 février, après avoir également fait une donation de tous
ses biens en faveur de sa femme.
Devenue veuve, Florentine Stoquer resta à Angomont un mois
environ, puis elle alla se fixer dans sa famille, à
Saint-Sauveur. Les relations de Marchal avec la femme Geoffroy,
qui étaient de notoriété publique avant le décès de Geoffroy et
de Marie-Anne Aubert, continuèrent.
La famille de Marchal voyait avec peine une telle conduite.
Quand il parla d'épouser la veuve Geoffroy, on lui fit de sages
observations qu'il n'écouta pas, et le mariage eut lieu le 19
décembre 1853, après les dix mois de veuvage.
Ce fut à partir de ce moment, et principalement dans le mois de
janvier, que l'on parla d'empoisonnement. On rappelait, en les
groupant, les mariages successifs de Marchal : la mort de ses
deux premières femmes, celle de Geoffroy, les nombreux adultérés
des accusés pendant la vie de leurs conjoints.
Marchal était très inquiet. Florentine Stoquer, sa femme,
partageait ses inquiétudes. Aussi faisaient-ils d'activés
démarches pour étouffer les bruits qui circulaient. Epouvantés
l'un et l'autre par suite des investigations que commençait la
justice, ils se décident à prendre la fuite. Ils quittent
Angomont dans la soirée du 24 janvier, ils marchent toute la
nuit, et le 25, à six heures du matin, ils arrivant à Sàrrebourg
au moment du passage du train-poste pour Strasbourg; ils sont
tellement pressés, qu'ils prennent ce convoi composé seulement
de voitures de première classe. La dame Boulanger, d'Angomont,
qui allait à Strasbourg, les rencontre à la gare de Sarrebourg
et monte dans la même voiture. Connaissant l'accusation qui
s'élève contre les époux Marchal, elle est frappée de leur
tristesse et remarqua que Marchal a coupé ses moustaches. Les
accusés craignant d'être arrêtés à leur arrivée à Strasbourg,
descendent à Brumath et veulent quitter la dame Boulanger, de
peur qu'elle ne puisse fournir plus tard des indications sur la
direction qu'ils ont prise. Ils traversent Strasbourg, passent
le Rhin, vont à Kehl; mais là on leur demande leurs papiers.
Marchal ne produit qu'un certificat qui parait insuffisant à
l'autorité badoise. Alors les fugitifs reviennent .à Angomont.
La veille de son départ, Marchal, accompagné de son beau-frère
Ratain, s'était rendu chez Me Stingre, notaire a Blamont, pour
faire une vente simulée de tous ses biens, meubles et immeubles
; mais son fils Théophile étant intervenu, ce projet fut
abandonné. On convint qu'un acte de donation sera fait. On
voulait ainsi frustrer le gouvernement en cas de poursuite.
La gendarmerie ayant su que Marchal avait pris la fuite, on
prévint la justice, qui se transporta sur les lieux le 29.
Marchal y était; il s'élit fait délivrer, par le maire d'Angomont,
son neveu, un certificat constatant qu'il n'avait jamais quitté
le pays ; il le remit à la gendarmerie et se présenta ensuite
avec sa femme au juge d'instruction, qui commença l'information.
Les témoins entendus alors déclarèrent que Marie-Anne Aubert et
Eloi Geoffroy étaient morts naturellement, l'un de
péripneumonie, l'autre de gastro-entérite.
L'information dut s'arrêter là. Cependant le parquet de
Lunéville prescrivit à la gendarmerie de Badonviller et au juge
de paix de Blamont de continuer leurs investigations. Le 27
février, on apprit qu'à l'époque du décès de Marie-Anne Aubert,
et d'Eloi Geoffroi (décembre 1852 a février 1853), Marchal, à
trois reprises différentes, avait acheté de l'arsenic chez
Chardin, pharmacien à Badonviller, Les magistrats se rendirent
immédiatement à Angomont. Marchal et sa femme avaient déjà pris
la fuite.
Dans la nuit du 26 au 27, devant Me Mangeon, notaire à
Badonviller, qui s'était transporté à Angomont, Marchal avait
fait donation de tous ses biens, meubles et immeubles, à ses
deux enfants, dans le but d'annihiler les garanties du fisc.
Après beaucoup de recherches et d'actives démarches, la
gendarmerie parvint, le 31 mars, à arrêter les époux Marchal,
qui s'étalent réfugiés chez un nommé Lhôte, à Parux.
Les corps de Marie-Anne Aubert et d'Eloi Geoffroy furent exhumés
et soumis à une analyse qui fut faite par trois chimistes
distingués de Nancy, MM. Braconnot, Simonin et Blondlot. Une
quantité considérable d'arsenic fut retrouvée dans les viscères
de Marie-Anne Aubert et d'Eloi Geoffroy, et, dans leur
procès-verbal, les experts concluent en ces termes : « Des faits
qui précèdent nous concluons que Marie-Anne Aubert et Eloi
Geoffroy sont morts empoisonnés par l'arsenic. »
Peu de temps avant leur mort, Marie-Anne Aubert et Geoffroy
pressentaient qu'ils seraient bientôt remplacés par Florentine
Stoquer et par Marchal. Ainsi, la première disait à sa filleule,
Adélaïde Humbéry : « Quand je ne serai plus, tu verras la femme
'd'Eloi entrer chez nous. » Geoffroy, deux jours avant sa mort,
disait à la femme Jacquel : « Mon numéro-est sorti, il faut
partir, mais c'est place pour un autre ! - Et par là, ajoute le
témoin, j'ai compris qu'il voulait dire que Marchal le
remplacerait près de sa femme. »
Marie-Anne Aubert tomba malade vers le 10 novembre 1852. A Cette
époque, on voit Marchal accompagnant M. Chevandier à la chasse,
du côté de Saint-Remy-aux-Bois, prier un garde de lui acheter de
l'arsenic à Charmes. Il revient, et, avec des ordonnances du
sieur Lamblé, docteur en médecine à Badonviller, il parvint à se
procurer trois fois de l'arsenic chez le pharmacien Chardin, les
12 décembre 1852, 2 et 14 février 1853, une, fois avant le décès
de sa-femme, morte le 15 janvier 1853, et deux fois avant le
décès de Geoffroy, mort le 18 février 1853; en tout, 120 grammes
d'arsenic.
Ce fut dans les .premiers jours de janvier que la maladie de
Marie-Anne Aubert fit des progrès effrayants. Marchal, dans ce
moment, lui administrait le poison dans les remèdes qu'il lui
faisait prendre. Les progrès de la maladie furent si rapides,
que le docteur Grandys déclare que, le 9 janvier, étant arrivé
accidentellement chez Marchal, il fut tellement frappé de
l'aspect du facies de la malade, que « l'idée du poison a
traversé son âme, » mais qu'il n'a pas osé s'y arrêter, à raison
du calme de Marchal, qui se trouvait au pied du lit.
La femme Marchal sentait qu'elle mourait empoisonnée; elle
refusait les remèdes que son mari lui donnait, disant à
plusieurs personnes : « Donnez-moi à boire, mais surtout ne vous
trompez pas, je ne veux pas de ses remèdes. »
On remarquait que son mari allait préparer les boissons près
d'une armoire dont lui seul avait la clef, et qu'il faisait
toujours chauffer l'eau composant ces boissons. On sait que
l'arsenic se dissout facilement dans un liquide chaud, tandis
que la dissolution est, sinon impossible, au moins très
difficile et lente dans un liquide froid.
Marchal, avant et après la mort, alors qu'on ne l'accusait pas
encore, parlait des bruits qui couraient ou qui pouvaient
courir; il faisait goûter les drogues qu'il prétendait
administrer à sa femme. A Clasquin, avant la mort, il dit : «
Oh! les s... n... de D... de f... bêtes, ils disent que j'avance
sa mort; elle le dit; venez voir que je vous fasse goûter ses
drogues, vous verrez si c'est bon ou mauvais. »
Lorsque la justice fit ses premières investigations, et qu'on
ignorait ses acquisitions d'arsenic, Marchal disait à Bruant :
« Je ne crains rien; si quelqu'un a été empoisonné, ce n'est pas
par moi : je n'ai jamais eu de poison en ma possession, et, chez
aucun pharmacien de France, on ne peut trouver que j'en aie
acheté. »
Cependant, malgré cette apparente sécurité, Marchal cherchait à
circonvenir et à suborner les témoins. Adélaïde Humbert,
filleule de Marie-Anne .Aubert, qui l'aimait beaucoup, avait
assisté aux derniers instants de sa marraine, avait reçu ses
confidences et avait vu plus d'une fois des scènes violences de
la part de Marchal. Celui-ci, craignant les indiscrétions de
cette fille, alors que l'impunité semblait devoir couvrir ses
crimes, la chassa de sa maison, en l'accusant faussement de
l'avoir volé. Adélaïde Humbert se rendit à Paris. L'information
commencé, l'accusé comprend l'intérêt qu'il a d'obtenir son
silence, et il écrit à Stoquer, de Saint-Sauveur, son
beau-frère, pour le prier de voir aussitôt Adélaïde Humbert, qui
sera entendue par un juge d'instruction de Paris, et de
l'engager sans doute à taire ce qu'elle savait.
A la même époque, afin de combattre à l'avance l'accusation
d'empoisonnement qui pèse sur lui, Marchal va trouver un nommé
Jean-Baptiste Vibert, et lui dit : « Tu me sauveras la vie et
l'honneur de ma famille, si tu veux me rendre un service dont je
vais te parler. En échange de ce service, je te donnerai une
somme de 500 fr.; lu devras affirmer devant la justice que le
jour de l'an entre midi et une heure, t'étant présenté chez ma
femme pour lui souhaiter la bonne année, tu l'as trouvée seule ;
qu'en réponse à tes souhaits, elle t'a dit : Oh! mon pauvre
Baptiste, pour mon premier jout de l'an, si j'avais du poison
pour m'empoisonner! - A quoi tu as répliqué : - Oh! madame
Marchal, à quoi pensez-vous de dire des choses semblables? Mais
celle-ci a manifesté sa persistance par ces mots : - Oh! si,
j'avais du poison, je m'empoisonnerais. »
Vibert a repoussé une telle ouverture; en présence de sa
résistance, Marchal a dit : « Au moins que la semelle de tes
souliers n'en sache rien. »
Le jeune Aubry, domestique de Marchal, était le confident de son
maître, ou bien il avait surpris plus d'un de ses secrets. A la
nouvelle de l'arrestation de celui-ci, il pâlit et craint d'être
arrêté comme lui ; il dit à Marguerite Vernier : « Si je disais
ce que je sais, mon maître aurait le cou coupé. » Dans une autre
circonstance, il disait à Thérèse Vincent et Alexis Maire : « Si
ces messieurs (c'est-à-dire les magistrats en information)
savaient ce que sait Adélaïde comme moi, les Marchal seraient
bientôt f..... »
Marguerite-Florentine Stoquer était la complice obligée de
Marchal. Afin de pouvoir épouser son amant, il lui fallait la
mort de la femme Marchal, elle a concerté le crime avec le mari
de celle-ci ; mais son but n'aurait pas été atteint si Geoffroy
son mari eût survécu : aussi mourut-il peut de jours après.
Lors du décès de la femme Marchal, Geoffroy n'était pas encore
malade. Agé de 35 ans, il était fort, vigoureux, travaillant
activement, et cependant sa femme prédisait déjà sa mort, car
dès ce moment elle L'avait résolue d'accord avec son complice.
Se trouvant à la veillée chez la femme Holweck, elle disait : «
Je mets du bleu dans le fil que je fais afin qu'il puisse servir
pour mon deuil. » Comme on lui demandait l'explication de ces
paroles, elle répondit : « Qu'une femme qui disait la bonne
aventure lui avait prédit mort et dérangement ; que la
prédiction devait nécessairement s'appliquer à son mari. » On
lui fit observer qu'il était gai, bien portant ; elle ajouta : «
Toutes les nuits il est malade; bien sûr il mourra; il ne sera
plus à Pâques. »
Quelques jours après, Geoffroy tomba malade. Le 8 février, il
donne tous ses biens, meubles et immeubles, à sa femme. A partir
de ce jour, la maladie augmente de gravité. Elle offre les
symptômes de l'empoisonnement. Marchal est toujours chez lui, il
ne le quitte pour ainsi dire pas. Le docteur Lamblé l'y trouve
même à deux heures du matin. Puis Marchal continue à acheter de
l'arsenic à Badonviller, 50 grammes le 2 février et 40 grammes
le 14.
Geoffroy ayant désiré manger un oiseau, Marchal le fournit; la
femme Geoffroy le prépare, son mari en mange un peu, et depuis
ce jour, dit le docteur Lamblé, ce fut un homme perdu; il est
mort, en effet, le 18 février, empoisonné par sa femme et par
Marchal, qui lui administraient l'arsenic dans les aliments et
les tisanes.
L'abbé Coutret, curé d'Angomont, avait été tellement frappé de
la maladie de Geoffroy, qu'il la qualifiait, en revenant chez
lui, de miserere. Il était si préoccupé de tout ce qui se
passait, que voyant Marchal assister aux derniers moments de
Geoffroy et recevoir sa femme dans ses bras, il la repoussait
violemment en lui disant : Ce n'est pas là votre place.
L'instruction était complète sur ces deux crimes, lorsque les
magistrats de la cour pensèrent que Marie-Anne Fournier,
première femme de Marchal, et Jean-Baptiste Vincent, premier
mari de Marie-Anne Aubert, avaient pu succomber à un
empoisonnement. Un arrêt ordonna tn supplément d'information qui
a pleinement confirmé les prévisions des magistrats.
On exhuma les restes de ces malheureux, une analyse chimique fut
faite par les mêmes experts, et dans les deux cadavres on a
trouvé de l'arsenic.
Marchal avait donc empoisonné sa première femme pour se marier
avec son ancienne maîtresse, après dix mois de veuvage.
Cette dernière s'était associée à ce crime, en se débarrassant
elle-même de son mari, et Marchal, son horrible complice, s'est
chargé de la punir en la faisant périr à son tour par le poison,
de concert avec la femme Geoffroy. Son second crime n'a été
qu'une épouvantable copie de celui qu'il avait commis en 1838.
Dans leurs interrogatoires, les accusés se renferment dans un
système de dénégations absolues. Marchal dit : Si on a trouvé de
l'arsenic dans le corps de ma femme, c'est elle qui s'est
empoisonnée avec le poison que j'avais chez moi; quant à Eloi
Geoffroy, je ne sais comment cela s'est fait. Il prétend n'avoir
acheté que deux fois de l'arsenic pour faire périr des grillons.
S'il a pris la fuite, c'était, dit-il, pour éviter la prison
préventive.
Quant à Marguerite-Florentine Stoquer, elle répond qu'elle ne
sait rien, qu'elle n'a jamais eu de poison en sa possession.
Enfin, tous deux repoussent avec énergie les relations adultères
dont le témoin Jacquot a été le témoin si complet.
Cette importante affaire, dans laquelle près de cinquante
témoins ont été entendus, commencée vendredi à onze heures du
matin, ne s'est terminée que dimanche, à neuf heures du soir.
Marchal, déclaré coupable, a été condamné à la peine de mort.
Son exécution aura lieu sur la place publique de Baccarat.
Florentine Stoquer, la femme de Marchal, ayant obtenu le
bénéfice des circonstances atténuantes, a été condamnée aux
travaux forcés à perpétuité.
Journal des débats
politiques et littéraires
9 août 1854
COUR D'ASSISES DE LA
MEURTHE.
Présidence de M. Pierson
conseiller.
Audiences des 3 et 4 août.
Double empoisonnement.
Jean-Christophe Marchal, garde forestier, et Marguerite
Florentine Stoquer, sa troisième femme, comparaissaient devant
le jury comme prévenus d'avoir de complicité empoisonné 1°
Marie-Anne Aubert, veuve en premières noces de Jean Vincent, et
deuxième femme de Marchal ; 2° Eloi Geoffroy, premier mari de
Marguerite Florentine Stoquer. La prévention impute encore à
Marchal deux autres crimes d'empoisonnement, aujourd'hui
couverts par la prescription, et qu'il aurait commis sur Anne
Fournier, sa première femme, et sur Jean Vincent, premier mari
de Marie-Anne Aubert, auxquels il aurait donné la mort pour
épouser celle-ci, qui au mois de janvier dernier succombait
elle-même, empoisonnée de la main de Marchal.
Le principal accusé était un homme considérable dans le petit
village qu'il habitait et dont la population se compose de
pauvres bûcherons.
Il est âgé de cinquante-deux ans; sa taille est élevée, ses
formes sont athlétiques. Ses traits sont fortement caractérisés,
son front bas, son oeil profond et ardent.
Florentine Stoquer, qui ne parait pas avoir plus de vingt-cinq
ans, a une figure agréable ; ses vêtemens de deuil font
ressortir la blancheur et la finesse de son teint, peu
ordinaires pour une femme de la campagne.
M. le procureur général Lezaud doit soutenir lui-même cette
grave accusation.
Me Louis est le défenseur des époux Marchal.
Il est donné lecture de l'acte d'accusation, ainsi conçu
« Jean-Christophe Marchal, né à Angomont, le 25 juillet 1802,
appartient à une famille riche de cette commune, dont la
population est peu nombreuse. II y a un mois à peine, son neveu
était maire, son frère instituteur, un autre de ses parens
adjoint. Tous les autres membres de sa famille sont
propriétaires. Aussi cette position de fortune inspirait et
inspire encore aujourd'hui aux habitans, qui sont pour la
plupart de pauvres bûcherons, un certain sentiment de crainte.
» En 1822, appelé par la loi du recrutement à faire partie de
l'armée, Marchal fut incorporé dans le 1er régiment de dragons.
Après trois ans de service, il se fractura le poignet et fut
réformé : il était alors maréchal-des-logis. Il rentra au
village d'Angomont, qu'il n'a plus quitté depuis. Il y a été
successivement maire, garde particulier de Mme la princesse de
Poix, puis de M. Chevandier, au service duquel il était lors de
son arrestation.
» Avant d'être enrôlé sous les drapeaux. Marchal avait eu un
enfant naturel de Marie-Anne Aubert. Cet enfant, né le 18
novembre 1822, est mort quelques jours après, le 25 du même
mois. A son retour son ancienne maîtresse était mariée avec un
nommé Vincent. Marchal épousa lui-même en 1826 Anne Bournier de
Pexonne. Il en eut deux enfans qui vivent encore aujourd'hui. Ce
sont ses seuls enfans. L'un employé chez M. Chevandier, habite
Angomont, l'autre se prépare à l'état ecclésiastique au
séminaire de Corbigny (Nièvre). »
» Marchal est un homme d'un caractère orgueilleux, ayant
beaucoup de confiance en lui-même. Il passe à juste titre dans
le pays pour avoir abusé de sa position de garde afin d'obtenir
les faveurs des femmes qu'il trouvait dans les forêts confiées à
sa surveillance. Quoique marié, il avait renoué des relations
coupables avec son ancienne maîtresse, lorsqu'une double
catastrophe éclata dans le ménage de chacun d'eux. Le mari
d'Anne Aubert, Jean Vincent, mourut le 6 juin 1838, et Anne
Fournier, la femme de Marchal, le suivit de près, elle mourut le
2 septembre suivant. Ces deux morts extraordinaires n'excitèrent
pas alors l'éveil de la justice. On n'osa pas en relever les
circonstances. Mais il se produisit alors un grand scandale. A
peine devenu veuf, Marchal fit venir chez lui, vers la fin
d'octobre, Marie-Anne-Aubert et vécut avec elle en concubinage.
L'abbé Guénin, curé d'Angomont à cette époque, fit de vaines
démarches pour faire cesser ce scandale. Marchal et Anne Aubert
se marièrent ensemble après dix mois de veuvage seulement..
» Mais cette dernière était devenue vieille; Marchal s'en dégoût
a:onle vit alors commencer et entretenir des relations adultères
avec une jeune femme de son voisinage, nommée Florentine Stoquer,
épouse Geoffroy. Anne Aubert les reprochait souvent à son mari,
et de fréquentes altercations s'élevaient à ce sujet entre les
deux époux.
» C'est en ces circonstances que Marie-Anne Aubert mourut, le 15
janvier 1853, après avoir fait devant Me Mangeon, notaire à
Badonviller, une donation de tous ses biens en faveur de son
mari. Quelques jours après, Eloi Geoffroy tomba malade et mourut
le 18 février, après avoir également fait donation de tous ses
biens en faveur de sa femme.
» Devenue veuve, Florentine Stoquer resta à Angomont un mois
environ, puis elle alla se fixer dans sa famille à
Saint-Sauveur. Les relations de Marchal avec la femme Geoffroy
qui étaient de notoriété publique avant la mort de Geoffroy et
de Marie-Anne Aubert, continuèrent. Les rendez-vous avaient lieu
dans la forêt, et un témoin les a surpris se livrant à
d'indécentes caresses.
» La famille de Marchal voyait avec peine une telle conduite.
Quand il parla d'épouser la veuve Geoffroy, on lui fit de sages
observations qu'il n'écouta pas, et le mariage eut lieu le 19
décembre 1853, après dix mois de veuvage.
» Jusqu'à cette époque il n'avait circulé dans le pays aucun
soupçon sérieux, soit sur Marchal, soit sur la femme Geoffroy.
Ce ne fut qu'à partir de ce moment, et principalement dans le
mois de janvier, que l'on parla d'empoisonnement. A Angomont, où
la famille Marchal est toute-puissante, ou n'osait rien dire;
mais à Brémenil et à Badonviller, ces bruits, vagues d'abord,
prenaient de la consistance. On rappelait, en les groupant, les
mariages successifs de Marchal, la mort de ses deux premières
femmes, celle de Geoffroy, les nombreux adultères des accusés
pendant la vie de leurs conjoints.
» Marchal était très inquiet. Florentine Stoquer, sa femme,
partageait ses inquiétudes. Aussi faisaient-ils d'actives
démarches pour étouffer les bruits qui circulaient. Une chose
étonnait c'était le silence de Marchal quand on lui disait «
Provoquez une exhumation, vos meilleurs témoins sont dans la
terre. » Les craintes et les angoisses de sa femme augmentaient
chaque jour. Epouvantés l'un et l'autre par suite des
investigations que commençait la justice, ils se décidèrent à
prendre la fuite. Ils quittent Angomont dans la soirée du 24
janvier, ils marchent toute la nuit, et le 25, à six heures du
matin ils arrivent a Sarrebourg au moment du passage du
train-poste pour Strasbourg; ils sont tellement pressés qu'ils
prennent ce convoi, composé seulement de voitures de première
classe. La dame Boulanger, d'Angomont, qui allait à Strasbourg,
les rencontre à la gare de Sarrebourg et monte dans la même
voiture. Connaissant l'accusation qui s'élève contre les époux
Marchal, elle est frappée de leur tristesse, et remarque que
Marchal a coupé ses moustaches. Celui-ci répond à peine à ses
questions et se borne à lui dire qu'ils vont faire un voyage
d'agrément. Les accusés, craignant d'être arrêtés à leur arrivée
à Strasbourg, descendent à Brumath et veulent quitter la dame
Boulanger, de peur qu'elle ne puisse fournir plus tard des
indications sur la direction qu'ils ont prise. Ils traversent
Strasbourg, passent le Rhin, vont à Kehl; mais là on leur
demande leurs papiers. Marchal ne produit qu'un certificat de
bonne conduite, qui paraît insuffisant à l'autorité badoise.
Alors les fugitifs sont obligés de revenir rapidement à Angomont.
» La veille de son départ, Marchal, accompagné de son beau-frère
Ratain, s'était rendu chez Me Stingre, notaire à Blâmont, pour
faire une vente simulée de tous ses biens meubles et immeubles
mais son fils Théophile étant intervenu, ce projet fut
abandonné. On convint qu'un acte de donation serait fait. On
voulait ainsi frustrer le gouvernement en cas de poursuite.
» La gendarmerie ayant su que Marchal avait pris la fuite, on
prévint la justice, qui se transporta sur les lieux le 29.
Marchal y était ; il s'était fait délivrer par le maire d'Angomont,
son neveu, un certificat constatant qu'il n'avait jamais quitté
le pays; il le remit à la gendarmerie et se présenta ensuite
avec sa femme au juge d'instruction, qui les interrogea et
commença l'information.
» Les témoins entendus alors, médecin, curé, habitans d'Angomont
et autres, tous déclarèrent que Marie-Anne Aubert et Eloi
Geoffroy étaient morts naturellement d'une péripneumonic,
l'autre d'une gastro- entérite.
» L'information dut s'arrêter là. Cependant le parquet d
Lunéville prescrivit à la gendarmerie de Badonvîller et au juge
de paix de Bl^tmont de continuer leurs investigations. Le 27
février, on apprit qu'à l'époque de la mort de Marie-Anne Aubert
et d'Eloi Geoffroy (décembre 1852 à février 1853), Marchal, à
trois reprises différentes, avait acheté de l'arsenic chez
Chardin, pharmacien à Badonviller. Les magistrats se rendirent
immédiatement à Angomont. Marchal et sa femme avaient déjà pris
la fuite.
» Dans la nuit du 26 au 27, devant. Me Mangeon, notaire à
Badonviller, qui s'était transporté à Angomont, Marchal avait
fait donation de tous ses biens, meubles et immeubles, à ses
deux enfans, dans le but évident d'annihiler les garanties du
fisc. t
» Après beaucoup de recherches et d'actives démarches, la
gendarmerie parvint, le 31 mars, à arrêter les époux Marchal,
qui s'étaient réfugiés chez un nommé Lhôte, à Parux.
» Les corps de Marie-Anne Aubert et d'Eloi Geoffroy furent
exhumés et soumis à une analyse qui fut faite par trois
chimistes distingués de Nancy, MM. Braconnot, Simonin et
Blondlot. Une quantité considérable d'arsenic fut retrouvée dans
les viscères de Marie-Anne Aubert et d'Eloi Geoffroy, et dans
leur procès-verbal les experts concluent en ces termes : « Des
faits qui précèdent nous concluons que Marie-Anne Aubert et Eloi
Geoffroy sont morts empoisonnés par l'arsenic. »
» Les auteurs de ces deux empoisonnemens sont les époux Marchal.
» II est de notoriété publique, on l'a dit, que Marchal et
Marguerite-Florentine Stoquer, du vivant de leurs conjoints,
entretenaient un commerce adultérin ils ont été surpris en
flagrant délit; Stoquer père en avait parlé à son gendre et à sa
fille. La famille Marchal en était affligée. Marie-Anne Aubert.
jalouse et profondément blessée de la conduite de son mari,
avait fait connaître son chagrin; elle eut même à ce sujet des
discussions vives avec Marchal, auquel elle reprochait ses
relations avec la femme Geoffroy.
» Peu de temps avant leur mort, Marie-Anne Aubert et Geoffroy
pressentaient qu'ils seraient bientôt remplacés par Florentine
Stoquer et par Marchal. Ainsi la première disait à sa filleule,
Adélaïde Humbert : « Quand je ne serai plus, tu verras la femme
d'Eloi entrer chez nous. » Geoffroy deux jours avant sa mort,
disait à la femme Jacquel : « Mon numéro est sorti, il faut
partir, mais c'est place pour un autre » Et par là, ajoute le
témoin, j'ai compris qu'il voulait dire que Marchal le
remplacerait près de sa femme.
» Marie-Anne Aubert tomba malade vers le 10 novembre 1852. A
cette époque, on voit Marchal accompagnant M. Chevandier à la
chasse, du côté de Saint-Remy-aux-Bois, prier un garde de lui
acheter dé l'arsenic à Charmes. Il revient, et avec des
ordonnances du sieur Lamblé, docteur en médecine à Badonviller,
il parvient à se procurer trois fois de l'arsenic chez le
pharmacien Chardin, les 12 décembre 1852, 2 et 14 février 1853,
une fois avant le décès de sa femme, morte le 15 janvier 1853,
et deux fois avant le décès de Geoffroy, mort le 15 février
1853; en tout, 120 grammes d'arsenic. Avant ces époques et
depuis, on ne trouve plus d'acquisition d'arsenic faite par
Marchal, si ce n'est dans l'année 1838, chez le pharmacien
Cabasse, de Raon-l'Etape.
» Ce fut dans les premiers jours de janvier que la maladie de
Marie-Anne Aubert fit des progrès effrayans. Marchal, dans ce
moment, lui administrait le poison dans les remèdes qu'il lui
faisait prendre. Les progrès de la maladie furent si rapides,
que le docteur Grandys déclare que le 9 janvier, étant arrivé
accidentellement chez Marchal, il fut tellement frappé de
l'aspect du facies de la malade, que l'idée du poison a traversé
son âme, mais qu'il n'a pas osé s'y arrêter, à raison du calme,
et de l'impassibilité de Marchal, qui se trouvait au pied du
lit.
» La femme Marchal sentait qu'elle mourait empoisonnée; elle
refusait les remèdes que son mari lui donnait, disant à
plusieurs personnes « Donnez-moi à boire, mais surtout ne vous
trompez pas, je ne veux pas de ses remèdes. »
» On remarquait que son mari allait préparer les boissons près
d'une armoire dont lui seul avait la clef, et qu'il faisait
toujours chauffer l'eau composant ces boissons. On sait que
l'arsenic se dissout facilement dans un liquide chaud, tandis
que la dissolution est sinon impossible, au moins très difficile
et lente dans un liquide froid. Aussi les vomissemens
arrivaient-ils quand Marchal donnait à sa femme ces breuvages
chauds, tandis qu'ils ne se produisaient pas quand des étrangers
préparaient et présentaient des breuvages froids à la malade,
qui à la fin ne voulait plus que de l'eau fraîche.
» Cette malheureuse fit comprendre au nommé Clasquin, d'une
manière nette et positive, qu'elle mourait empoisonnée par son
mari; elle fit même à ce dernier des reproches en sa présence en
ces termes « Oh mon Dieu! quel malheur, le plus grand malheur du
monde ! » Elle répondait à son mari qui lui demandait sa main «
Va-t'en, mauvais gueux; il aurait mieux valu pour toi et pour
moi que tu ne l'eusses jamais touchée! » Voulant désigner
Florentine Stoquer, un instant après elle lui disait « Va-t-en,
mauvais drôle, c'est toi qui es la cause que je suis ici. »
Marchal se bornait à dire à Clasquin : « Eh bien! voyez,
Clasquin, voilà quatre jours et quatre nuits que je la garde: »
Sa femme répliquait, aussitôt « Oui, tu sais bien pourquoi tu me
gardes ici.
» Marchal, avant et après la mort, alors qu'on ne l'accusait pas
encore, parlait des bruits qui couraient ou qui pouvaient
courir; il faisait goûter les drogues qu'il prétendait
administrer à sa femme. A Clasquin, avant la mort, il dit : «
Oh! les s... n... de-D... de f... bêtes, ils disent que j'avance
sa mort; elle le. dit; venez voir que je vous fasse goûter ses
drogues, vous verrez si c'est bon ou mauvais. » Après la mort,
Marchal disait encore à des femmes qui étaient venues jeter de
l'eau bénite sur le corps de Marie-Anne Aubert: « Les b... de
bêtes, ils disent que j'ai avancé sa mort; eh bien! goûtez « .̃
En même temps il leur faisait goûter une espèce de sirop.
» Lorsque la justice fit ses premières investigations et qu'on
ignorait ses acquisitions d'arsenic, Marchal disait à Bruant : «
Je ne crains rien; si quelqu'un 'a été empoisonné, ce n'est pas
par moi ; je n'ai jamais eu de poison en ma possession, et chez
aucun pharmacien de France on ne peut trouver que j'en ai
acheté. »
» Cependant, malgré cette apparente sécurité, Marchal cherchait
à circonvenir et à suborner les témoins. Adélaïde Humbert,
filleule de Marie-Anne Aubert, qui l'aimait beaucoup, avait
assisté aux derniers instans de sa marraine avait reçu ses
confidences et avait vu plus d'une fois des scènes violentes de
la part de Marchal. Celui-ci, craignant les indiscrétions de
cette fille, alors que l'impunité semblait devoir couvrir ses
crimes, la chassa de sa maison, en l'accusant faussement de
l'avoir volé. Adélaïde Humbert se rendit à Paris. L'information
commencée, l'accusé comprend l'intérêt qu'il a d'obtenir son
silence, et il écrit à Stoquer, de Saint-Sauveur, son
beau-frère, pour le prier de voir aussitôt Adélaïde Humbert, qui
sera entendue par un juge d'instruction à Paris et de l'engager
sans doute à taire ce qu'elle sait.
» A la même époque, afin de combattre à l'avance l'accusation
d'empoisonnement qui pèse sur lui, Marchal va trouver un nommé
Jean-Baptiste Vibert et lui dit « Tu me sauveras la vie et
l'honneur de ma famille si tu veux me rendre un service dont je
vais te parler. En échange de ce service je te donnerai une
somme de 500 fr.; tu devras affirmer devant lai justice que le
jour de l'an, entre midi et une heure, t'étant présenté chez ma
femme pour lui souhaiter la bonne année, tu l'as trouvée seule;
qu'en réponse à tes souhaits elle t'a dit : « Oh! mon pauvre
Baptiste, pour mon premier jour de l'an c'est si j'avais du
poison pour m'empoisonner! » A quoi tu as répliqué :« Oh! madame
Marchal à quoi pensez-vous de dire des choses semblables? » Mais
celle-ci a manifesté sa persistance par ces mots : « Oh!
Baptiste, si j'avais du poison je m'empoisonnerais. »
» Vibert a repoussé une telle ouverture; en présence de sa
résistance, Marchal lui a dit « Au moins que la semelle de tes
souliers n'en sache rien. »
» Le jeune Aubry, domestique de Marchal, était le confident de
son maître, ou bien il avait surpris plus d'un de ses secrets. A
la nouvelle de l'arrestation de celui-ci, il pâlit et craint
d'être arrêté comme lui; il dit à Marguerite Vernier : « Si je
disais ce que je sais, mon maître aurait le cou coupé. » Dans
une autre circonstance, il disait à Thérèse Vincent et à Alexis
Maire : « Si ces messieurs (c'est-a-dire les magistrats en
information) savaient ce que sait Adélaïde, comme moi aussi, les
Marchal seraient bientôt f... ».
» Enfin lorsque Marchal est détemt à Lunéville et qu'il apprend
que les charges deviennent chaque jour plus accablantes, il
cherche à faire passer, à l'insu du gardien en chef, une lettre
à un de ses amis qui devait lui procurer des moyens d'évasion.
» Ces faits désignaient clairement Marchal comme l'auteur de la
mort de sa femme Marie-Anne Aubert Marguerite
» Florentine Stoquer était sa complice naturelle et obligée.
Epouse adultère, afin de pouvoir épouser son amant, il lui
fallait la mort de la femme Marchal ; elle a concerté le crime
avec le mari de celle-ci, une même pensée les agitait, tous
deux, un même mobile les poussait ; mais son but n'aurait pas
été atteint si Geoffroy, son mari, eût survécu ; aussi mourut-il
peu de jours après.
» Lors de la mort de la femme Marchal, Geoffroy n'était pas
encore malade. Agé de trente-cinq ans, il était fort, vigoureux,
travaillant activement, et cependant sa femme prédisait déjà sa
mort; car dès ce moment elle l'avait résolue, d'accord avec son
complice. Se trouvant à la veillée chez la femme Holwech, elle
disait « Je mets du bleu dans le fil que je fais, afin qu'il
puisse servir pour mon deuil. » Comme on lui demandait
l'explication de ses paroles, elle répondit « Qu'une femme qui
disait la bonne aventure lui avait prédit mort et dérangement ;
que cela ne pouvait s'appliquer à son père, parce que cela ne
ferait que malheur, et que pour qu'il y ait dérangement, la
prédiction devait nécessairement s'appliquer à son mari. » On
lui fit observer qu'il était gai, bien portant ; elle ajouta : «
Toutes les nuits il est malade; bien sûr il mourra, il ne sera
plus à Pâques. »
» Quelques jours après, Geoffroy tomba malade. On attribua
d'abord son indisposition à un effort qu'il fit en forêt. Le 8
février, il donne tous ses biens meubles et immeubles à sa
femme. A partir de ce jour, la maladie augmente de gravité. Elle
offre tous les symptômes de l'empoisonnement. Marchal est
toujours chez lui, il ne le quitte pour ainsi dire pas. Le.
docteur Lamblé l'y trouve même à deux heures du matin ; puis
Marchal continue à acheter de l'arsenic à Badonviller, 50
grammes le 2 février et 40 grammes le 14. Geoffroy avant désiré
manger un oiseau, Marchal le fournit; la femme Geoffroy le
prépare son mari en mange un peu et depuis ce jour, dit le
doctenr Lamblé, ce fut un homme perdu. Il est mort, en effet, le
18 février, empoisonné par sa femme et par Marchal qui lui
administraient l'arsenic dans les alimens et les tisanes.
» L'abbé Coutret, curé d'Angomont, avait été tellement frappé de
la maladie de Geoffroy, qu'il la qualifiait en revenant chez
lui, de miserere. Il était si préoccupé de tout ce qui se
passait que, voyant Marchal assister aux derniers momens de
Geoffroy et recevoir sa femme dans ses bras, il la repoussa
violemment en lui disant : « Ce n'est pas là votre place. »
» Marie-Anne Aubert et Eloi Geoffroy sont donc morts
empoisonnés; ils étaient un obstacle à l'union des deux époux
adultères, le poison en a eu bientôt raison.
» L'instruction était complète sur ces deux crimes lorsque les
magistrats de la Cour pensèrent que Marie-Anne Fournier,
première femme de Marchal, et Jean-Baptiste Vincent, premier
mari de Marie-Anne Aubert, avaient pu succomber à un
empoisonnement; un arrêt ordonna un supplément d'information qui
a pleinement confirmé les prévisions des magistrats.
» On exhuma les restes de ces malheureux; une analyse chimique
fut faite par les mêmes, experts, et dans les deux cadavres on a
trouvé de l'arsenic.
» Marchal avait donc empoisonné sa première femme pour se marier
avec son ancienne maîtresse, après dix mois de veuvage
seulement.
» Cette dernière s'était associée à ce crime en se débarrassant
elle-même de son mari, et Marchal, son horrible complice, s'est
chargé de la punir en la faisant périr à son tour par le poison,
de concert avec la femme .Geoffroy. Son second crime n'a été
qu'une épouvantable copie de celui qu'il avait commis en 1838.
» Dans leurs interrogatoires, les accusés se renferment dans un
système de dénégations absolues. Marchal dit : « Si on a trouvé
de l'arsenic dans le corps de ma femme, c'est elle qui s'est
empoisonnée avec le poison que j'avais chez moi; quant à Eloi
Geoffroy, je ne sais comment cela s'est fait. » II prétend
n'avoir acheté que deux fois de l'arsenic pour faire périr les
grillons. S'il a pris la fuite, c'était, dit-il, pour éviter la
prison préventive.
» Quant à Marguerite-Florentine Stoquer, elle répond qu'elle ne
sait rien, qu'elle n'a jamais eu de poison en sa possession.
Enfin tous deux repoussent avec énergie les relations
adultérines dont le nommé Jacquot a été témoin si complet.
» En conséquence, sont accusés, etc. »
Après avoir fait retirer Marchal de l'audience, M. LE PRESIDENT
procède à l'interrogatoire de florentine Stoqiier.
D. A quel âge avez-vous épousé Geoffroy, votre premier mari ? -
R. A dix-huit ans et demi.
D. Votre mari.se portait bien? - R. Oui, Monsieur.
D. Comment est-u tombé tout à coup malade? - R. Il s'est plaint
d'avoir mal à l'estomac.
D., Savez-vous quel mal il avait ? - R. Je crois que c'était une
fluxion de poitrine.
D. Vous avez bien soigné votre mari ? - R. Oui, Monsieur.
D. Vous l'avez beaucoup regretté ? - R. Oui, Monsieur.
D. Comment alors vous êtes-vous remariée dix mois après ? - R.
Il y en a bien d'autres qui font comme moi.
D. Connaissiez-vous Marchal du vivant de votre premier mari ? R.
Non.
D. Il ne vous a jamais fait la cour? - R. Non.
D. N'avez-vous pas eu avec Marchal des relations aussi intimes
que possible entre un homme et une femme ? - R. Non.
D. Pendant sa maladie, votre mari n'a-l-il pas manifesté le
désir de manger du gibier, des oiseaux et du lièvre ? N'a-t-on
pas remarqué qu'aussitôt après avoir mangé ce gibier qui venait
de Marchal, l'état de. votre mari est devenu plus gravé, qu'il a
eu des vomissemens, des selles nombreuses ? - R. Je ne sais pas.
D. II es impossible que. vous ayez ignoré ces circonstances ? -
R. Je ne me les rappelle pas.
M. LE PROCUREUR-GENERAL fait remarquer que c'est à partir du
moment où il a mangé des oiseaux pris chez Marchal, que,
Geoffroy est devenu plus malade. Ses coliques sont devenues plus
intenses, ses vomissemens plus fréquens. Il relève, en outre,
une contradiction dans la déclaration de, Forentine, qui avait
dit dans l'instruction que son mari n'avait pas mangé d'oiseaux
qu'elle les avait jetés. A l'audience, elle prétend en avoir
jeté au moins deux, parce qu'ils étaient gâtés.
D. Pendant la maladie de votre mari, Marchal n'était-il pas chez
vous ? - R. Je ne me rappelle pas.
D. Il y était si bien qu'il donnait à boire à votre mari. - R.
Je ne me rappelle pas.
D. De quel mal est morte la femme Aubert ? - R. Je pense qu'elle
est morte de son retour d'âge.
D. Marchal prétend que Marie-Aubert a manifesté plusieurs fois
l'intention de se détruire. Est-ce vrai cela?- R. Je ne sais
pas.
D. Comment ! Marchal ne vous a-t-il donc jamais parlé de celle
circonstance ? - R. Jamais.
D. La fille Olvel venait-elle chez vous quelquefois ? - R. Oui.
D. Mais vous avez dit que non dans l'instruction ? - R. C'est
que je ne m'en suis pas rappelée.
D. Vous rappelez-vous lui avoir offert du pain sur lequel vous
avez étendu de la crème, et que cette fille a ressenti aussitôt
âpres de violentes coliques et a éprouvé des vomisseinens ? - R.
Je ne me rappelle pas.
M. LE PRESIDENT : L'accusation se le rappelle, car il sera
constaté que vous avez étendu la crème sur le pain de la fille
Olvel avec une cuiller que vous teniez à la main, laquelle était
sans doute imprégnée du poison qui venait d'être donné à votre
mari.
M. LE PROCUREUR-GENERAL. Comment ! vous ne vous rappelez pas que
dans sa maladie votre mari avait de fréquens .vomissemens ? -
R.Non, je ne me le rappelle pas.
D. Marchal venait fréquemment chez vous ? - R. Il y venait
quelquefois.
D. Y restait-il tard ? - R. Non, il s'en allait à bonne heure.
M. LE PROCUREUR-GENERAL : Les débats établiront que Marchal,
pendant la maladie de Geoffroy, venait fréquemment chez vous,
qu'il y restait tard, et que, lorsque quelques visiteurs se
présentaient, on les repoussait en disant que Geoffroy était
trop malade. Et cependant Marchal était la et y demeurait
jusqu'à une heure avancée de la nuit une fois, notamment,
jusqu'à deux heures après minuit.
M. LE PRESIDENT reprend l'interrogatoire.
D. Un jour, Marchal ne vous a-l-il pas prise dans ses bras? - R.
Il est vrai qu'un jour, étant tombée en faiblesse, Marchal m'a
relevée et m'a posée sur une chaise; il y avait du monde là.
D. Oui, il y avait M. le curé d'Angomont, entre autres, qui,
indigné de la conduite de Marchal, l'a vivement repoussé en lui
disant que sa place n'était pas là. Vous avez eu des relations
très intimes avec Marchal ? - R. Non, Monsieur.
D. Mais on vous a vue dans le bois avec Marchal? - R. On s'est
trompé, ce n'était pas moi.
D. Mais vos relations coupables avec Marchal sont établies, Vous
vous donniez des rendez-vous dans le bois; des lettres fixant
l'heure de ces rendez-vous étaient placées à des endroits
convenus ? - R. Cela n'est pas.
D. Vous aviez si bien des relations coupables avec Marchal que
vous êtes allés ensemble à l'enregistrement, après la mort de
votre mari, pour déclarer la succession, et que le commis de
l'enregistrement vous a d'abord pris pour deux amoureux ? - R.
Je ne me rappelle pas cela.
M. LE PRESIDENT, avant de clore cet interrogatoire, soutenu par
la femme Florentine Stoquer avec beaucoup de sang-froid, résume
son système de défense et fait ressortir sa coïncidence avec
celui de Marchal. (Ce dernier est ramené à l'audience.)
M. LE PRESIDENT l'interroge sur quelques faits de sa vie
antérieure, et lui demande comment, lors de son retour du
régiment, il n'a pas épousé Marie Aubert, à qui il devait une
réparation.
L'accusé répond qu'il ne s'en souciait pas.
D. Cependant vous avez eu avec cette femme, alors qu'elle était
la femme de Jean-Nicolas Vincent, vous avez eu, dis-je, des
rapports intimes avec elle ? - R. Non, Monsieur.
D. Cependant tout le monde croyait à ces rapports et s'en
scandalisait. - R. Je n'en ai eu aucuns.
D. Des témoins déclareront le contraire. - R. Les témoins se
tromperont.
D. Comment, après avoir dédaigné la femme Aubert, vous êtes-vous
décide à l'épouser ? - R. C'est ma mère qui l'a voulu ainsi et
qui m'a dit que je devais la prendre chez moi.
D. Vous aviez des rapports adultères avec cette femme ? - R.
Non, Monsieur.
L'accusé nie énergiquement ce fait.
D. Enfin Marie-Aubert, votre ancienne maitresse, avec qui vous
avez eu un enfant, dont vous ne vous souciiez plus pour votre
femme, devient après la mort de sou mari votre concubine, des
témoins en déposeront, puis enfin votre femme. De quelle maladie
est-elle morte ? - R. De son retour d'âge, je crois, je ne me
rappelle pas bien.
D. Comment vous ne vous rappelez pas qu'elle a été prise de
coliques dans un pré, que des vomissemens n'ont pas tardé à se
produire ainsi que le dévoiement ? - R. Je ne me rappelle pas;
ce que je sais, c'est que je l'ai beaucoup regrettée, et qu'en
la perdant j'ai perdu plus de 10,000 fr.
M. LE PRESIDENT rappelle les sinistres prévisions des femmes de
Marchal, qui par une sorte de pressentiment annoncent leur mort
prochaine. Puis s'adressant à l'accusé, il lui demande s'il a
acheté de l'arsenic en 1838.
L'ACCUSE répond affirmativement.
D. Pourquoi était-ce faire ? - R. C'était pour empoisonner des
renards qui infestaient les bois.
Mais voyez, continue M. LE PRESIDENT, quelles singulières
coïncidences résultent de vos actes: en 1838, vous achetez de
l'arsenic, et c'est à la même époque que meurent Anne Fournier,
votre femme, et François Vincent, le mari de celle que vous
épousez bientôt après, et qu'ils meurent empoisonnés. Vous
achetez encore de l'arsenic en décembre 1852, et c'est le 15
janvier 1853 que succombe votre seconde femme. Vous en achetez
le 3 février 1853, et c'est le 18 février qu'expire le mari de
celle que vous convoitiez, de celle avec qui vous entreteniez un
commerce adultère.
M. LE PROCUREUR GENERAL fait ressortir avec beaucoup de force la
gravité de l'acte par lequel Marchal se faisait donner par sa
femme la totalité de ses biens, puis de la vente que Marchal
voulait opérer ensuite de ses biens réunis à ceux de sa femme,
sans se réserver la moindre parcelle de sa fortune ni l'usufruit
d'aucune chose.
MARCHAL explique qu'il voulait que sa femme donnât son bien à
ses enfans, mais que le notaire lui fit observer que l'acte de
cette donation couterait 400 fr., tandis que si sa femme faisait
la donation en sa faveur, l'acte ne coulerait plus que 60 fr. Il
aurait bien préféré que la donation eût lieu en faveur de ses
fils.
L'interrogatoire des deux accusés est terminé.
Le premier témoin est M. LE DOCTEUR BLONDLOT, professeur de
chimie à l'Ecole de Médecine, de Nancy. Un mouvement très marqué
de curiosité se manifeste dans l'auditoire à l'appel de son nom.
Le savant professeur explique à MM. les jurés les différentes
missions dont il a été chargé pour l'exhumation de quatre
cadavres dont deux reposaient dans la terre depuis quinze ans et
les deux autres depuis quinze mois environ.
II résulte de sa déposition que la présence de l'arsenic a été
constatée par les experts dans les restes de Marie-Anne
Fournier, première femme de Marchal, de Jean-Baptiste Vincent,
de Marie-Anne Aubert et d'Eloi Geoffroy.
L'audience est levée et renvoyée au lendemain.
Audience du 4 août.
M. LE PRESIDENT fait retirer l'accusé Marchal, puis après avoir
fait descendre dans l'enceinte de la Cour la femme Marchal, il
lui dit : « Florentine Stoquer, vous m'avez fait appeler,
ajoutant que vous aviez quelque chose à me dire. Je me suis
rendu près de vous, pensant que vous étiez dans l'intention de
me faire connaître toute la vérité; or, c'était pour me dire
seulement qu'il était vrai en effet que Geoffroy, votre premier
mari avait mangé du civet, circonstance que vous avez jusqu'ici
déniée parce que Marchal vous avait recommandé de n'en parler à
personne. Cet aveu n'est qu'un pas fait dans la voie de la
vérité, où il faut entrer entièrement. Vous savez que c'est à
partir du moment où votre mari a mangé de ce civet que son état
a empiré ?
LA FEMME MARCHAL : Je n'en sais rien.
D. Saviez-vous que ce civet renfermât une substance nuisible? -
R. Non, Monsieur.
D. Vous convenez maintenant, n'est-ce pas, que Marchal venait
souvent chez vous ? - R. Oui, Monsieur.
D. Qu'il y restait très tard ? - R. Oui, Monsieur.
D. Même la nuit ? - R. Je ne le crois pas.
D. Il donnait à boire à votre mari? - R. Je ne me le rappelle
pas.
D. Voyons, dites la vérité ; n'étiez-vous pas d'accord avec
Marchal pour faire manger à votre mari ce civet qui a aggravé si
fort sa maladie ? - R. Oh! non, Monsieur.
M. LE PROCUREUR GENERAL presse de nouveau Florentine Stoquer
d'avouer toute la vérité. Florentine assure l'avoir dite tout
entière.
D. Eh. Bien ! voyons, vous avez assuré que votre mari avait
mangé du civet, mais vous avez nié que vous ayez eu connaissance
que ce mets préparé chez Marchal put causer de graves accidens.
En avez-vous mangé, vous? - R. Non, Monsieur.
D. Quelqu'un chez vous en a-t-il mangé? - R. Non, Monsieur.
D. Ainsi ce mets qui devait tenter tant de monde dans la maison
d'un bûcheron, personne n'y touche, excepté Geoffroy, qui ne
tarde pas à en éprouver les funestes effets. Avez-vous su de
quelle maladie était morte la seconde femme de Marchal ? - R.
Non, Monsieur.
D. Comment ! vous n'avez pas su qu'elle avait eu des vomissemens
? - R. Non, Monsieur.
D. Mais enfin Marchal, devenu veuf, a dû vous dire: «
Maintenant, si tu étais veuve, je pourrais t'épouser» ? - R. Il
ne me l'a pas dit.
D. Marchal ne vous a-t-il pas dit de vous faire faire un
testament? - R. Non, Monsieur; c'est mon mari qui a voulu me
donner ce qu'il avait.
M. LE PRERSIDENT : Et qui est mort six semaines après? Ainsi,
vous obtenez de votre mari une donation; six semaines après,
votre mari meurt; et après dix mois de veuvage vous vous
remariez.
M. LE PROCUREUR GENERAL rapelle encore que Geoffroy a mangé d'un
oiseau accommodé par Florentine elle-même. Cette dernière
circonstance a préeédé de deux jours la mort de Geoffroy.
Il presse Florentine de s'expliquer, de dire toute la vérité.
Vous êtes devant la justice, dit-il, c'est comme si vous étiez
devant Dieu. Revenez à la vérité Florentine, c'est la vérité
seule qui peut vous sauver devant Dieu et devant les hommes. Il
faut dire la vérité.
L'ACCUSEE déclare l'avoir dite tout entière.
On ramène l'accusé Marchal.
M. LE PRESIDENT lui fait le récit de ce qui vient de se passer.
Marchal en est très ému et répond d'une voix altérée aux
pressantes questions qui lui sont faites.
On appelle M. le docteur Lamblé. C'est ce témoin qui a donné des
ordonnances pour faire délivrer du poison à Marchal et qui a été
appelé au lit de mort de Geoffroy ; il a délivré à Marchal un
certificat attestant que ce dernier était mort d'une
péripneumonie. Comme dans l'instruction, la déposition de ce
témoin est embarrassée ; M. le procureur général lui adresse à
plusieurs reprises des admonestations sévères sur l'imprudence
de sa conduite et ses complaisances pour l'accusé. Il lui
reproche de n'avoir pas su voir le véritable caractère de la
maladie de Geoffroy, lui qui l'a visité plus de sept fois avant
sa mort, lui qui a délivré trois ordonnances pour faire délivrer
du poison à Marchal : 120 grammes d'arsenic !
M. LE PRESIDENT demande au témoin où il a rédigé les
ordonnances. Il ne se le rappelle pas. Marchal se le rappelle
lui, et indique que la première a été délivrée à Badonviller et
la seconde chez lui. Quant à la troisième, il n'en a jamais eu
connaissance.
M. LE PROCUREUR GENERAL fait cette remarque que le poison
délivré sur la troisième ordonnance a été remis a un
commissionnaire chargé d'apporter également des médicamens pour
Geoffroy, et qu'il résulterait de la dénégation de Marchal que
les quarante grammes d'arsenic délivrés le 14 février auraient
été remis à Florentine Stoquer,
M. Blondlot est rappelé. M. LE PRESIDENT veut savoir de lui si
un médecin peut se méprendre sur les traces que le poison
imprime aux traits du visage, M. BLONDLOT croit que tout médecin
clairvoyant doit s'en apercevoir. L'audience continue.
(Gazette des tribunaux)
Journal des débats
politiques et littéraires
10 août 1854
Cours et Tribunaux
COUR D'ASSISES DE LA MEURTHE.
Présidence de M, Pierson,
conseiller.
Audiences des 3 et 6 août.
Double empoisonnement.
On continue l'audition des témoins.
M. LE DOCTEUR HRANDIN, médecin à Badonviller: Dès les premières
fois que je visitai la femme Marchal (Marie-Anne Aubert), je la
trouvai gravement malade. Elle se plaignait de violentes
douleurs d'estomac et d'envies de vomir. Le soupçon d'un
empoisonnement a traversé mon âme ; mais en voyant Marchal, dont
la réputation était excellente, calme, affectueux, plein de
soins pour sa femme, j'ai repoussé cette pensée.
M.J. HOLSTEIN : J'ai en 1838 donné à Marchal un certificat, afin
qu'il put se faire délivrer de l'arsenic dont il disait avoir
besoin pour détruire des grillons.
M. CLAUDEL, maréchal des logis de gendarmerie à Badonviller
Avant le mariage de Marchal avec la veuve d'EIoi Geoffroy, je
n'avais rien entendu dire sur son compte; mais quinze jours
environ après ce mariage, on me rapporta que la rumeur publique
attribuait au poison la mort de Marie-Anne Aubert et d'Eloi
Geoffroy. Je me rendis à Angomont. Marchal vint se plaindre à
moi de calomnies dont il se prétendait l'objet. Je l'engageai à
provoquer l'exhumation des deux cadavres, afin de se justifier;
il m'a répondu que cette opération était trop triste. Il m'a
demandé si je ferais un rapport et si je savais ce que ferait le
procureur impérial; j'ai répondu que je ferais un rapport à mes
chefs, mais que j'ignorais quel parti prendrait M. le procureur
impérial.
Le lendemain j'ai appris que Marchal et Florentine Stoquer
étaient partis. Ils étaient allés à Strasbourg. Mais n'ayant pas
pu passer à Kehl faute de passeport, ils sont revenus à Angomont.
Ils ont été interrogés par M. le juge d'instruction. Mais leur
arrestation n'ayant pas été ordonnée parce qu'ils ont présenté
un certificat du maire attestant qu'ils n'avaient jamais quitté
leur maison, ils ont pris la fuite de nouveau. Pendant un mois
nous les avons cherchés de village en village.
Enfin, le 31 mars, soupçonnant qu'ils étaient cachés chez un
sieur Lhôte, je m'y suis rendu dans la nuit. J'ai fait entourer
la maison de manière à ce que personne n'en pût sortir. J'ai
alors frappé à la porte, que Lhôte n'a ouverte qu'après m'avoir
fait attendre plus de dix minutes, sous prétexte de s'habiller.
Après avoir cherché dans toute la maison, nous avons trouvé
Marchal et Florentine cachés sous un lit, entre le plancher de
la chambre et celui formant le fond du lit. Marchal affectait
une grande dévotion, il communiait deux fois par an et il
n'aurait pas fait gras un jour maigre.
BRUANT : Le lendemain de la descente de la justice à Angomont,
Marchal m'a dit qu'il n'avait jamais acheté de poison dans
aucune pharmacie de France.
M. LE PRESIDENT fait observer à Marchal qu'il est constaté par
sa propre signature, qui a été retrouvée sur le registre du
pharmacien, qu'il avait acheté de l'arsenic en 1838, et qu'en
outre il lui en avait été livré en décembre 1852 et en février
1853, sur les ordonnances du docteur Lamblé.
M. LATREILLE : II y a deux ans, j'accompagnais Marchal à une
battue près de Charmes. Il me dit qu'il avait besoin d'arsenic
pour empoisonner des rats; qu'il était difficile de s'en
procurer à Badonviller. Il me demanda de lui en acheter à
Charmes et de le lui remettre le lendemain. Etant rentré à
Charmes très tard, je n'ai pas exécuté cette commission. J'en ai
donné le motif à Marchal, que j'ai revu le lendemain à la
chasse. Il m'a alors engagé à venir à la fête à Angomont. en me
recommandant de .ne pas oublier de lui apporter de l'arsenic;
mais je ne l'ai pas revu depuis.
M. CHARDIN, pharmacien à Badonviller : Marchal m'a demandé de
lui vendre de l'arsenic pour détruire des renards, mais j'ai
refusé. Je ne lui en ai livré que sur les ordonnances de M. le
docteur Lamblé les 12 décembre 1852, 2 et 14 février 1853, soit
le 2, soit le 14 février, sans qu'il me soit possible de me
rappeler lequel de ces deux jours l'arsenic a été remis, non pas
à Marchal lui-même, mais à un commissionnaire qui venait
chercher des médicamens pour Eloi Geoffroy.
THERESE VINCEENT a entendu Aubry (domestique de Marchal) dire :
« Si ces messieurs (il voulait parler des magistrats chargés de
l'information) savaient ce que je sais, mes maîtres seraient
bientôt f... »
MARGUERITE CUNY : Marchal m'a dit, quelque temps avant la mort
d'Anne Aubert, qu'il serait bientôt veuf; que s'il se remariait,
il ne voulait pas d'une vieille femme, parce qu'elle resterait
auprès du fourneau (du poêle) ; ni d'une jeune, parce qu'elle
aurait des enfans; qu'il saurait bien en trouver une encore
jeune et jolie et qui n'aurait pas d'enfans. J'ai compris qu'il
voulait parler de Florentine Stoquer qui, mariée depuis
plusieurs années, n'avait pas d'enfans. Plusieurs témoins
viennent ensuite déposer qu'il y a environ trois ans ils ont vu,
dans la forêt, la femme Geoffroy s'abandonner à Marchal.
MARIE-ANNE BOURA a vu Marie-Anne Aubert, pendant sa maladie,
repousser une soupe que lui offrait son mari.
MARGUERITE ZABÉE : Deux ou trois jours avant la mort de
Marie-Anne Aubert, son mari lui ayant offert à boire, elle lui
dit : « Ne me donnez pas quelque chose de mauvais. »
ADELAIDE HUMBERT : Marie-Anne Aubert était ma tante et ma
marraine ; je suis restée chez elle depuis l'âge de cinq ans
jusqu'à ma dix-huitième année. Elle avait bien du chagrin de
voir que son mari allait avec d'autres femmes et surtout avec
Florentine. Il y eut bien des discussions entre Marchal et sa
femme à ce sujet. Pendant la maladie de ma marraine, j'ai
remarqué que, quand Marchal lui donnait à boire, elle vomissait
immédiatement quand elle recevait à boire d'autres personnes les
vomissemens arrivaient moins promptement et avec moins de
violence. Ma tante m'a dit que si elle mourait, Eloi Geoffroy ne
tarderait pas à mourir aussitôt elle serait bientôt remplacée
par la femme d'Eloi. Marchal m'a fait plusieurs propositions que
j'ai repoussées.
ELISABETH THOMAS : Adélaïde Humbert m'a dit qu'elle quittait la
maison de Marchal pour se soustraire à ses tentatives de
séduction.
JOSEPH HUMBERT : Adélaïde est venue un soir me dire que Marchal
voulait la séduire ; elle m'a dit que sa marraine, pendant sa
maladie, avait prédit que, si elle mourait, la femme d'Eloi
Geoffroy viendrait bientôt dans la maison.
M. COUTRET, curé de Brémenil, dépose que Marchal accomplissait
régulièrement ses devoirs religieux, qu'il a donné des ornemens
à l'église. Il ajoute : Lorsque Marchal est venu me parler des
rumeurs qui l'accusaient et me demander comment il pourrait les
faire cesser, je lui ai conseillé de demander l'exhumation des
cadavres de Marie-Anne Aubert et de Geoffroy. Je lui ai dit :
Vos meilleurs témoins sont dans la tombe ! Je lui ai répété ce
conseil plusieurs fois, mais jamais il ne m'a répondu sur ce
point. M; le curé rend compte aussi de la scène qui s'est passée
au moment où Geoffroy venait d'expirer et qui est relatée dans
l'acte d'accusation.
SEBASTIEN CLASQUIN : J'ai été lié avec Marchal ; cependant,
environ deux ans avant la mort de sa seconde femme, j'avais
cessé d'aller chez lui, parce que Marchal m'imputait, bien qu'il
n'en fût rien, d'avoir dit que son bien était hypothéqué ; il en
était résulté un refroidissement entre nous. Cependant, l'ayant
rencontré dans le cours de la maladie de sa femme Marie-Anne
Aubert, je lui demandai comment elle allait. Il m'invita à
entrer pour la voir. Je trouvai la femme Marchal dans son lit;
ses bras étaient étendus de chaque côté de son corps ; elle se
plaignait. Son mari s'étant éloigné quelques instants, elle
joignit ses mains avec effort, en disant « Ah quel màlheur ! je
suis une femme perdue?" Son mari étant rentré et ayant voulu lui
prendre la main, elle la retira en disant « Ah! mauvais gueux,
il serait à souhaiter que tu ne l'eusses jamais touchée » et
elle détourna sa tête vers le mur. Marchal lui demanda pourquoi
elle se détournait ainsi, mais elle resta dans la même attitude.
Il lui prit alors la tête dans ses deux mains pour la lui
redresser. Elle dit alors « Ah ! misérable ! il faut donc que je
meure dans tes mains !» Marchal s'assit alors et me dit en se
croisant les bras sur la poitrine : « Voilà trois jours et trois
nuits que je garde ainsi ma femme, et voilà la reconnaissance
qu'elle me témoigne » La femme s'écria « Ah ! mauvais gueux ! tu
sais bien pourquoi tu me gardes ! » En me reconduisant, Marchal
me dit : « Je serai veuf aussi vrai que nous sommes deux. » En
rentrant chez moi, je me suis dit : Si la femme Marchal en
revient, je l'interrogerai de près, et si elle meurt, j'y
penserai toute ma vie
MARCHAL dément le témoin ; il nie qu'il soit venu chez lui
pendant la maladie de sa femme. Il soutient que cette dernière
avait, avant sa maladie, chassé Clasquin à coups de trique.
M. LE PREIDENT. Clasquin, est-il vrai que la femme Marchal vous
ait traité comme le prétend l'accusé ? - R. Non. seulement une
fois elle m'a reproché doucement d'avoir dit que leur bien était
engagé, et je lui ai assuré que je n'avais jamais tenu ces
propos; elle n'a pas insiste davange.
M. LE PRESIDENT : Marie-Anne Aubert ne vous a-t-elle jamais
témoigné le chagrin qu'elle éprouvait des relations de son mari
avec la femme Geoffroy ? - R. Une fois je me suis trouvé avec
Marie-Anne Aubert à la fontaine; je venais de faire une maladie
de quatre mois, et je me plaignais de ma mauvaise santé. La
femme Marchal me dit : « Allez, chacun a ses peines ; vous ne
savez pas combien je suis malheureuse ! » Je lui ai répondu: «
Vos peines, je les connais bien. » En effet, je. savais que
Marchal fréquentait d'autres femmes, et entre autres celle ici
présente.
M. LE PRESIDENT. N'avez-vous rien appris de Vibert ? - R. Vibert
m'a raconté que. Marchal était venu le trouver après les
premières recherches de la justice et lui avait dit « Je suis un
homme perdu, mais vous pouvez me sauver. Vous direz à ces
messieurs que vous avez été chez nous le jour du nouvel an, et
que ma femme vous a dit qu'elle voulait s'empoisonner. Si vous
voulez dire cela, je vous donnerai 500 fr. » Vibert ayant
hésité, Marchal lui a dit « Je vois bien que vous ne voulez pas
le faire; mais du moins que la semelle de vos souliers n'en
sache rien, ni la terre qui est au-dessous. »
VIBERT SEGARD, ouvrier dans une scierie : J'ai travaillé de
longues années sous les ordres de Marchal. A l'époque ou la
justice est venue pour la première fois à Angomont, Marchal est
venu me trouver à la scierie; il m'a parlé en pleurant des
bruits qui couraient sur son compte à propos de la mort de sa
femme et de Geoffroy il m'a dit « Je suis un homme perdu. » Le
voyant pleurer, j'ai pleuré aussi. Il m'a dit alors: « Vous
pourriez me rendre un grand service si vous déposiez que,
pendant la maladie de ma femme, vous m'avez vu venir tous les
jours à la scierie. » Je lui promis de faire ce qu'il me
demandait. Il a ajouté : « Je vous donne 500 francs si vous
voulez dire que vous avez été au 1er janvier souhaiter la bonne
année à ma femme, qu'elle s'est plainte à vous d'être malade, de
beaucoup souffrir; qu'elle vous a dit qu'elle voudrait mourir,
qu'elle voudrait avoir de quoi s'empoisonner. » Je lui ai
répondu : « Oh ! non. Si je dis cela, la justice m'interrogera
cinquante fois, je ne pourrai pas soutenir mon témoignage. » Il
m'a a dit alors « Eh bien, puisque vous ne voulez pas faire ce
que je vous demande, qu'au moins la semelle de vos souliers et
la terre qui est dessous ignorent ce qui vient de se passer
entre nous. »
De nombreux-témoins sont encore entendus, qui viennent confirmer
les charges relevées dans l'acte d'accusation.
LE PRESIDENT fait retirer l'accusé Marchal et fait descendre du
banc des accusés Florentine Stoquer, qui vient se placer au
milieu de l'enceinte, sur l'estrade des témoins. M. le président
l'invite de nouveau à dire toute la vérité. Elle convient que
son mari lui a dit, en revenant de Strasbourg, qu'il avait placé
du poison dans le miel qu'il avait envoyé à Geoffroy ; mais elle
nie avoir jamais eu du poison en sa possession et avoir connu
que Marchal ait empoisonné sa femme. A cet égard, les pressantes
instances de M. le président sont sans résultat.
L'audience est suspendue. Elle est repris à une heure. La foule
est plus grande qu'elle n'a jamais été. Le nombre des dames est
considérable.
M. LE PROCUREUR GENERAL entre dans le récit des faits. Il
s'attache a prouver le crime d'empoisonnement d'Anne Fournier,
et adresse des remercîmens pleins d'éloges au savant chimiste
dont les expérimentations ont été si concluantes dans cette
affaire; puis il prend successivement les témoignages, les
groupe, et conclut en demandant un verdict de culpabilité contre
les deux accusés.
Me LOUIS prend la parole pour la défense.
De vives répliques ont lieu; après quoi LE PRESIDENT résume les
débats.
Le jury entre dans la salle des délibérations et rentre en
audience au bout d'une heure et demie, rapportant un verdict de
culpabilité contre les deux accusés. Des circonstances
atténuantes sont admises en faveur de Florentine Stoquer Cette
dernière est condamnée à la peine des travaux forcés à
perpétuité.
Marchal est condamné à la peine de mort. L'exécution aura lieu
sur la place de Baccarat. (Gazette des Tribunaux).
| Jean-Christophe Marchal a été
guillotiné à Baccarat le 6 octobre 1854.
Marguerite Florentine Stoquer était
née à Saint-Sauveur le 28 juillet 1823. On ignore la
date de sa libération, mais elle est décédée le 11 avril
1904 à Saint-Sauveur, au domicile de son beau-frère, le
bucheron Joseph Lauber.
|
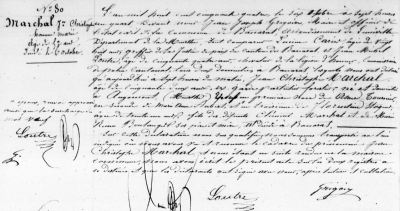
Acte de décès de Jean-Christophe Marchal
Etat-civil de Baccarat - 6 octobre 1854 |
|













