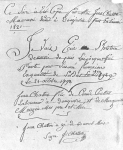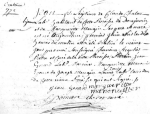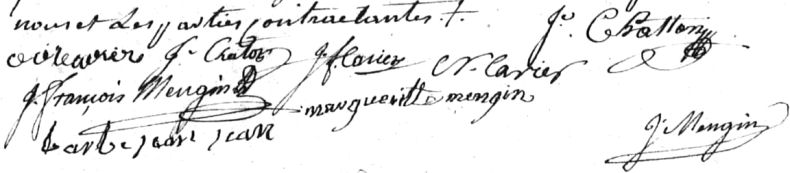Cahiers de vieux soldats de
la Révolution et de l'Empire
publiés et annotés par M. E. Gridel et le capitaine Richard
Éd. Paris, 1902
DEUX VIEUX SOLDATS
Depuis quelques années, la collection de nos mémoires militaires
s'enrichit journellement de nouvelles trouvailles, au grand
bénéfice de notre histoire, et les Français d'aujourd'hui se les
arrachent et les dévorent, avides de se pénétrer des sentiments
véritables qui agitaient nos pères, riches et pauvres, grands et
petits, nobles et roturiers, pendant que se déroulait ce cycle
extraordinaire, cette épopée centenaire que l'on a appelé la
Révolution et l'Empire.
Les mémoires des généraux d'alors sont assez nombreux, mais ils
ne nous donnent généralement que la note heureuse, la note du
succès. Ceux-là fréquentaient les cours, et avaient vaillamment
conquis tous leurs grades à la pointe de leur sabre mais enfin,
c'étaient des soldats instruits et heureux à la guerre, ceux que
chérissait surtout le Grand Empereur, et dont il a peuplé les
rangs de la noblesse d'épée du Premier Empire. Plus rares sont,
par contre, les humbles qui ont obscurément suivi leurs chefs,
ne glanant sur les champs de bataille de l'Europe que des coups
de sabre pour leur propre compte, largement rendus, il est vrai,
pour le compte des autres. Et pourtant, n'étaient-ce pas ces
humbles qui composaient la masse de l'armée française ?
Il aurait été bien tentant de savoir d'un grand nombre d'entre
eux, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils
sentaient dans la grande épopée dont ils ont été les acteurs les
plus actifs.
Mais voilà eux, les humbles, étaient l'action mécanique, et les
autres, ceux qui sont arrivés aux échelons élevés de la
hiérarchie militaire et nous ont laissé le récit de leurs
gloires, étaient la pensée.
C'est pourquoi, lorsqu'on retrouve, dans les tiroirs poussiéreux
d'un bahut de village, des manuscrits laissés par de vieux
soldats de cette époque fameuse, il faut s'empresser de les
sauver de l'oubli et de les livrer à la publicité, tout en se
gardant de les dénaturer pour les rendre plus présentables au
lecteur, sous prétexte que l'orthographe et le style n'en sont
pas suffisamment châtiés. A cette époque, dans les classes
inférieures de la nation, l'instruction, même primaire, était
chose assez rare. Il n'est donc pas étonnant que les manuscrits
émanant de vieux soldats de la Révolution et de l'Empire soient
choses rares, précieuses certes, car il est, à notre avis, aussi
intéressant de savoir comment le général baron Thiébault a gagné
ses éperons d'or et ses étoiles, que de se rendre compte de
l'état d'esprit de ces modestes héros, « dont la valeur et le
dévouement procuraient les succès des généraux et préparaient
leur gloire ».
Or, le hasard a fait tomber entre nos mains deux vieux
manuscrits, curieux à plus d'un point de vue, gardés depuis près
d'un siècle dans des papiers de famille, et destinés
probablement, non pas à la publicité à laquelle nous allons les
livrer, mais à la destruction lente des vers et des rongeurs
impitoyables.
Ces deux cahiers authentiques n'ont pas la prétention d'être des
documents historiques, quoique les faits qui y sont relatés se
rapportent à des faits rigoureusement historiques. Mais nous
avons pensé qu'on lirait peut-être avec intérêt ces notes
naïvement rédigées, véritables documents humains, par deux vieux
soldats, comparses obscurs de la grande épopée.
Lorrains tous deux, ils sont nés dans l'arrondissement de Luné
ville Jean Chaton à Domjevin, canton de Blamont; Nicolas Leclère
à Bénaménil, canton sud de Lunéville, Ces deux villages sont
voisins et distants l'un de l'autre de quelques kilomètres à
peine. La rivière de la Vezouze, qui descend des contreforts des
Vosges, serpente lentement au travers d'une riante prairie, et
sépare les territoires des deux villages.
Chatton, à Domjevin, fut, en 1792, un des volontaires appelés
par décret de la Convention, à la défense de la patrie en
danger.
Il partit tout simplement rejoindre l'armée pour y servir
jusqu'à la fin de la guerre contre l'étranger. Ce ne fut
seulement qu'en 1803 qu'il pût, après avoir, pendant onze ans,
guerroyé en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Bavière, en
Suisse et en Italie, obtenir enfin son renvoi dans ses foyers.
Pour être libéré, il dut être réformé. Qu'auraient dit à sa
place ceux qui, de nos jours, trouvent déjà trop dur de
consacrer trois ans au service de leur pays ? Et cependant, cet
homme des champs, arraché à la charrue, ne laisse échapper de
plaintes, que dompté par la faim et les misères. Les forces
humaines ont des bornes.
Chatton était un réquisitionnaire un peu forcé; il subit le
service militaire, mais ne s'en plaignit jamais. Et, cependant,
en lisant ses modestes mémoires, on sent qu'il n'y va pas de bon
coeur, il supporte le métier des armes plutôt qu'il ne l'aime il
y a tout vu, tout enduré. La bataille ne lui a jamais causé la
moindre frayeur, être tué en combattant lui importait peu, il
allait obscurément dans le tas, chair à canon, plastron vivant
aux coups de baïonnette. Mais l'être humain a souffert cependant
toutes les misères, « les froids, la faim, la nudité, et tant
d'autres choses ». Aussi, est-ce en ces quelques lignes que peut
se résumer tout l'esprit du réquisitionnaire de 1792 « Croyez,
amis, dans une guerre de trente ans que nous avons faite, qu'il
s'y a bien passé des maux et des biens un a devenu riche,
l'autre a devenu pauvre, l'autre a devenu estropié ».
[...]
CAHIER DE CHATTON
Ce livre a été copié par moi, Jean CHATTON,
manoeuvre à Domjevin, fait en l'année 1820.
Je vais écrire l'histoire de ma vie, depuis l'époque que j'ai
parti pour l'armée française en qualité de soldat, en 1792. Le
21 octobre 1792.
Jean CHATTON fils de Claude Chatton, laboureur à Domjevin, et de
Marguerite Mengin, mes père et mère.
Jean CHATTON.
âgé de 60 ans 6 mois.
Signé J. CHATTON.
CHAPITRE PREMIER - Volontaire national à l'Armée de
Sambre-et-Meuse
Volontaire national de 1792. - Maréchal des
logis. Qui va à la chasse perd sa place. A l'armée de
Sambre-et-Meuse. - La politique à l'armée. - Bataille de
Fleurus, 26 juin 1794. - Prise de Maëstricht, 2 octobre 1794. -
Prise de Bréda. Hiver de 1794. - Prise de Luxembourg, 20 mars
1795. - Les maraudeurs. Jean Chatton est sur le point d'être
fusillé. Misères des soldats devant Coblence. - La soupe au
trèfle. - Retraite sur le Rhin de l'armée de Sambre-et-Meuse. -
Déblocus de Mayence, 28-29 octobre 1795. - Quartiers d'hiver à
Deux-Ponts. - Une permission de seize jours. - De Deux-Ponts à Domjevin à pied. - Déserteur. - Les gendarmes.
J'ai été incorporé dans le 3e bataillon de la Manche. J'y ai
resté un an (1).
J'ai rentré dans l'artillerie en qualité de soldat du train
conduisant les chevaux. Au bout d'un an, j'ai reçu le grade de
maréchal de logis en second, à la paye de 120 francs par mois
(2). J'ai obtenu une permission pour venir voir mes parents. En
mon pays j'y ai passé ma permission, parce qu'il faisait
meilleur qu'à l'armée seulement, j'ai bien vite été cassé et
remplacé. Car vous devez savoir à l'armée, un qui manque et qui
laisse échapper sa place, elle est bientôt prise (3).
Je ne vous dis pas les misères que j'ai eues depuis que je vous
écris ceci Nous avons fait la bataille d'Arlon et la prise de la
ville en même temps. De là, nous avons traversé la forêt des
Ardennes, nous avons marché pendant cinq jours sans vivres : a
fallu presque mourir de faim (4).
C'était du règne de Robespierre, de Houchard et Saint-Just qui
trahissaient la France pour se faire rois.
En ce temps-là, ils ont guillotiné on ne sait combien de
milliers de personnes innocentes mortes, ou fusillé des milliers
de soldats pour assouvir leur férocité (5).
De là, nous avons été bloquer la ville de Charleroi, clef de la
Belgique nous en avons fait le siège et la prise en même temps,
le 7 messidor.
Le lendemain, nous avons donné la fameuse bataille de Fleurus,
L'ennemi a perdu 50,000 hommes. Les Français 22,000, sans
compter les blessés(6).
Nous avons marché sur la ville de Liège, nous ayons resté devant
cette ville pendant quatre mois. Nous avons fait la fameuse
bataille de Senef (?) (Seneux) avec grandes pertes (7).
De là, nous avons pris la ville d'Aix-la-Chapelle, avec pertes
de monde, et la ville de Juliers : on a poursuivi l'ennemi la
baïonnette dans les reins dans les belles plaines de Cologne; on
les a fait sauter dans le Rhin, on a pris 40,000 ennemis et on a
gardé le Rhin. De là, j'ai fait le blocus de la ville de
Maëstricht et la prise; ils y avaient 12,000 Autrichiens et
4,000 Hollandais (8).
De là, j'ai été au siège de Bréda, dans l'intérieur de la
Hollande, par le plus rude hiver qu'il eût peut-être jamais fait
(9).
Après la prise de cette ville, nous avons pris nos quartiers
d'hiver, après la Hollande conquise, jusqu'à Pâques (10).
De là, nous avons venu au blocus de Luxembourg, nous y avons
resté deux mois et puis elle s'a rendue aux Français (11).
De là, j'ai été devant la ville de Coblence, nous y avons resté
depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre que nous avons
passé le Rhin.
Devant cette ville maudite pour moi, j'ai bien manqué d'être
fusillé ou avoir la tête lavée avec du plomb pour avoir été à la
maraude pour nos chevaux d'artillerie. J'ai été pris par quatre
gendarmes et quatre dragons, à onze heures du soir, et mené au
quartier général. Après avoir été interrogé, j'ai été conduit en
prison pour attendre mon sort après bien des débats et
pourparlers, le commandant et beaucoup d'officiers, ainsi que M.
Croizier, qui était dans ce moment mon capitaine, qui se sont
bien employés pour moi, Jean-Baptiste Carrière m'a apporté la
nouvelle, au bout de cinq jours, par le guichet de la prison où
j'étais détenu, que je n'en mourrai pas, mais que j'aurais cinq
ans de galères. De tout cela, après bien des supplications, j'ai
été enfin mis en liberté, grâce à Dieu (12).
Et nous avons été délivré de la famine à laquelle nous étions
réduits devant ce Coblence. Nous avons été dans la misère deux
mois, Tantôt nous avions une livre et demie de pain à partager
entre douze hommes. D'autres jours, point ; sans viande, ni sel,
ni argent, car c'était la chute des assignats, puisqu'ils ne
valaient plus rien. Nous allions à cinq lieues chercher des
petites pommes, à la Saint-Jean, pour manger, arracher les
pommes de terre ; nous mangions des pleines marmites de trèfle,
sans sel ni graisse, pour ne pas mourir de faim. Jugez quel
triste sort que le pauvre soldat a en faisant la guerre. Il y a
beaucoup de bavards qui disent que le soldat est heureux de
faire la guerre.
En allant au blocus de Mayence, nous avons bien pillé les
pauvres paysans pour avoir à manger.
J'ai battu en retraite. Cette retraite a coûté une grande perte
à la France. Nous avons laissé de l'autre côté du Rhin, proche
de Montabaur, 4o pièces de canon, 80 caissons de poudre, tous
les fourgons de l'ambulance. Il faisait si mauvais temps qu'on
ne pouvait marcher par les mauvais chemins (13).
Devant Mayence, il y a resté, tant pièces de canon que caissons,
1200 (14). Nous avons battu en retraite pendant six semaines,
sans recevoir une seule ration que pain toujours maraudé. Nous
avons marché sur Deux-Ponts. Là nous avons pris nos quartiers
d'hiver pour nous un peu remettre.
Toute cette grande retraite était toute par trahison (Hô les
gueux !)(15).
Dans la ville de Deux-Ponts, j'ai reçu une permission de seize
jours. J'ai resté au pays trois mois. Vous pouvez vous imaginer
en restant si longtemps au pays, j'ai été cassé de ma place.
J'étais brigadier dans l'artillerie à la paye de quatre francs
par jour, un bon bidet entre les jambes ; je n'étais pas mal je
n'avais rien à faire que de faire les bons de pain, viande,
etc., foin et avoine pour les chevaux. Au bout de trois mois,
les gendarmes viennent me sommer de rejoindre. Où aller, plus de
place? En avoir perdu une si belle, que faire Je ne pouvais
rester (16).
CHAPITRE II - La 17e demi-brigade sur le Rhin et en Italie
Passage du Rhin à Kehl. - La traversée de la
France de l'est à l'ouest et de l'ouest à l'est. - Les monstres
marins. Huningue. - Départ pour l'Italie. - Le grand
Saint-Bernard. - Milan. - Combat de Porto-di-Fermo (27 novembre
1798). - Atrocités des Napolitains. - Les représailles. -
Dispersion des Napolitains - Fuite du roi de Naples. - Marche
sur Naples. - Guerre sauvage. - Arrivée à Naples. - Caserte.
J'ai rejoint à Strasbourg. Je suis
incorporé dans la 17e demi-brigade d'infanterie de ligne, 2e
bataillon, 6e compagnie (17).
Je passe le Rhin à Kehl, nous allons en cantonnement dans la
forêt Noire, depuis le mois de mai jusqu'au mois de novembre
(18).
Nous repassons le Rhin (19), nous allons à Zurich, en Suisse,
nous restons cinq jours.
Nous reçûmes l'ordre pour aller à Coutances (20), en Normandie,
sur le bord de la mer. Nous y restons six semaines. En arrivant
à Granville, en Normandie, c'est là que j'ai vu deux poissons.
Un pesait douze cents, l'autre neuf cents (21).
Nous retournons à Bâle, en Suisse. Traversé la France deux fois
dans six semaines.
Nous revenons à Huningue. D'Huningue nous avons eu l'ordre pour
aller à Milan, en Italie (22), passant par la Suisse, par
Saint-Maurice, à l'embouchure du lac de Genève, par le
Mont-Blanc, par le bas Valais, par le haut Valais, à
Saint-Pierre, bourg au pied du grand mont Saint-Bernard; de
Saint-Pierre au couvent, il y a huit lieues toujours monter et
des précipices de deux lieues, qui font trembler les hommes les
plus hardis. Trois lieues avant d'arriver au couvent, il y a des
glaces et des neiges depuis la création du monde. En toutes
saisons, il y fait un froid excessif.
Du couvent a la ville d'Aoste, il y a encore six grandes lieues
en descendant très rapidement, il faut faire ces quatorze
lieues-là dans un jour (23).
Arrivant à la grande ville de Milan, le lendemain nous partons
pour la ville de Porto-Fermo, au camp. Nous étions 24,000
hommes. L'ennemi, qui était Napolitains, étaient 80,000. Nous
avons livré bataille à deux heures après-midi, pour sonder leurs
forces. C'était une fausse attaque (24).
Le lendemain, à trois heures du matin, nos tirailleurs
commencent l'attaque. Nous avançons hardiment sur l'ennemi. On a
trouvé trois canonniers et trois soldats du train qui avaient
été pris la veille, qui étaient liés les bras derrière le dos et
morts sur le champ et une de nos vivandières, morte et fendue
depuis le bas du ventre jusqu'au menton, et un canonnier mort
dedans son ventre. Jugez quelle cruauté Notre général, Rusca, en
voyant cette barbarie, crie Soldats, guerre à mort (25) !
Pour venger nos frères, on donne le signal, on bat la charge, on
fonce sur l'ennemi. On bat, on a cassé tout ce qui se rencontre
devant nous. Nous avons pris la moitié de l'artillerie, tous
leurs canons et caissons, tous leurs bagages, magasin de farine,
blé, avoine, 50 voitures d'habillement en tous genres et 0o
bâtiments à une lieue de là, qui étions sur le bord de la mer,
qui chargeaient blé, avoine, farine, draps, selles et brides.
Notre artillerie légère court au grand galop, met ses pièces en
batterie; c'était l'affaire d'un moment. On tirait à boulet sur
leurs bâtiments du bord de la mer. Six coulent à fond,
vingt-quatre autres se rendent en mettant drapeau blanc (26).
Depuis cette heureuse journée, l'armée a été dispersée dans les
montagnes, dont les frontières du pays de Naples sont garnies,
Tous leurs contingents, dispersés dans les montagnes, sont
formés avec les paysans en brigandage. Nous nous sommes battus
avec ces brigands depuis la Toussaint jusqu'au mois d'août et
les troupes réglées du roi de Naples ont embarqué pour aller
dans les Deux-Siciles, à trente lieues de la ville de Naples,
par mer (27).
Nous avons tout fusillé, les paysans et soldats rebelles ; et
ces brigands, autant des nôtres qu'ils prenaient, ils les
brûlaient vifs, leur arrachaient les boyaux du ventre vivants.
Quelle guerre ! Quelle cruauté ! Entre chrétiens se dévorer !
Tantôt il y avait 8,000 brigands. réunis dans un bourg, tantôt
6,000 sur un passage ; nous allions après, on en faisait une
boucherie. On en prenait par milliers, on tirait à coup de
mitraille dessus pour les envoyer en enfer tous ensemble (28).
Après bien des marches, nous arrivons enfin devant la ville de
Naples, qui est la ville capitale (29).
La 17e dont j'étais soldat, part de Caserte ville, très grande
ville de plaisance du Roi, avec un Louvre ! par sa grandeur, il
y logerait bien 40,000 hommes. Il y a un beau parc devant le
Louvre, et il y a toutes sortes de gibiers et des beaux bassins.
CHAPITRE III - L'Expédition de Benavente
Les trésors du roi de Naples. - Les Fourches
Caudines. - A la baïonnette. - Plutôt la mort que l'esclavage. -
Jean Chatton dans un château. - Rumeurs et précautions. - Les
adjudants-majors de la 17e. - L'affaire de Popoli. - Cuit à la
broche. - La veilleuse. - Un bon lit. - La plume de cinq pieds.
- Insomnie. - Pressentiments.- Alerte. - Départ subit de la 17e.
- Triste réveil. - Abandonné. - En reconnaissance. - Un costume
protecteur. - La récolte des paysans. - Enfermé dans le château.
- En pénitence contre une porte. - La mort de mon cheval. -
Pillage du château. - Transes mortelles. - Prêt à mourir. -
Fuite subite des brigands. - A la nuit. - Déguisement. -
Bonsoir. - Porte trop bien gardée. - Chatton saute dans le
fossé. - Une chute terrible. - Sauvé, mais mal loti. - Les
premiers pas. - La rivière. - Le canal. - L'échelle en
passerelle. - Au jour. - Rencontre d'un brigand.- Italien de
cuisine. -Dépouillé par les brigands. - La fuite. - Manqué, mais
cerné. - A genoux, les yeux bandés. - Le scapulaire protecteur.
- Un forcené. - Conseil de guerre. - Sauvé par les femmes. - En
route pour Montesarte. - Insulté par les gamins. - La maison du
gouverneur. - Cordiale réception. - Les jolies demoiselles du
gouverneur. - L'interrogatoire. - Les demoiselles obtiennent la
grâce de Jean Chatton. - A déjeuner. - Fureur des paysans. -
Garde-robe recomplétée. - Adieux.-- La galanterie française. -
Si j'étais riche ! - En route pour Caserte. - En carrosse. - Une
ruse de guerre du général Broussier. - Sauvé ! Je retrouve la
17e à Caserte.
Nous avons reçu l'ordre pour aller à Benavente ville, pour aller
chercher un trésor que le Roi n'avait pas eu le temps d'emporter
(30). C'est pour vous faire savoir, quand le roi de Naples a
appris la nouvelle que les Français venaient à sa rencontre, il
a fait faire des contributions, tant en argent qu'en argenterie,
dans tout son royaume. Il en a fait des dépôts dans les
couvents. Nous avons été si rapidement, et massacré son armée,
qu'il n'a pas eu le temps de les enlever. Mais les Français, que
rien ne leur échappe, les savaient bien avoir par la voix des
paysans, moyennant une petite récompense.
Et, étant en chemin de Caserte à Benavente, il y a quinze milles
ou cinq lieues, après une lieue de marche, nous fûmes attaqués
par 8,000 brigands qui étaient embusqués près d'une montagne.
Ils nous surprennent, ils font feu sur nous. Ils nous ont tué 60
hommes et blessé 30. Nous autres, nous avions l'arme à volonté,
car on ne se déméfiait de rien. Nous nous formons en bataille,
car on avance au pas de charge : ils se sauvent dans la montagne
voisine, toujours en nous harcelant, depuis neuf heures du matin
jusqu'à dix heures du soir. Nous n'étions que 1,700 hommes
contre 8,000 paysans; point de cartouches seulement trois
cartouches à tirer par soldat. Quoi faire ? Pas moyen d'en avoir
Les paysans, ne voyant que quelques coups de fusil tirés, se
sont bientôt aperçus que nous manquions de munitions. Ils
venaient de tous côtés sur nous, comme des enragés, en nous
criant « Français rendezvous » Nous autres, nous marchions
toujours en bataillons carrés, baïonnette en avant. Notre
commandant lui répond « Nous rendre à des brigands ? plutôt la
mort » Nous faisions des charges à la baïonnette dessus pour les
mettre en fuite (31).
Dans cette belle colline, il y a des beaux bourgs et bien des
beaux villages. On les pillait nous brûlions des villages, nous
lâchions le vin dans les caves. Les brigands se renfermaient
dans leurs maisons, en faisant feu sur nous. Nous, pour les
prendre, on mettait le feu dans leurs villages, on les faisait
griller comme des harengs sur la grille.
Après nous avoir bien battus, tant d'une part que de l'autre,
nous arrivons à notre destination, car vous savez bien que des
milliers de paysans n'ont jamais arrêté la marche des soldats
français. « Plutôt la mort que l'esclavage », c'est la devise
des bons Français ! (32).
Je pansai les chevaux de mon commandant et de mon adjudant-major
: j'en avais deux, et nous étions logés tout en bas de la ville,
chez un prince, et toute notre demi-brigade était dans un
couvent. Ils couchaient tout habillés, sac au dos, les bretelles
dans leurs bras et la tête dessus leurs sacs, giberne au côté,
fusil chargé entre leurs bras, pour être prêts en cas d'alerte,
car l'espion a rapporté qu'il y avait bien 12,000 brigands
autour de la ville. Il fallait bien se garder pour ne pas être
assassiné par ces loups de brigands. On faisait patrouilles sur
patrouilles ; on en prenait de temps en temps quelqu'un qui
voulait être trop hardi. On ne tirait pas dessus de peur de
faire du bruit, on lui enfonçait trois ou quatre coups de
baïonnette dans l'estomac, il mourait comme des chiens enragés
(33).
Je reviens à moi qui est dans mon logement avec l'adjudant-major
du troisième bataillon et l'adjudant du deuxième, qui est mon
maître. Le soir, nous soupons bien et d'un bon appétit. Après
souper, l'adjudant du troisième bataillon dit à mon maître « Il
te faut aller à l'ordre chez le chef ». - Il dit « Non, je
n'irai que demain le matin. Puisque nous allons rester trois
jours ici pour nous reposer » (34).
L'adjudant me dit « Chatton, vous porterez nos selles au sellier
pour les faire raccommoder. Nous nous ferons faire chacun un
pantalon ».
Nous avions bien du drap. Ce drap, nous l'avions pris à la ville
de Popoli. Là où nous nous avions battus la veille de Noël, en
attendant la messe de minuit. C'était encore une affaire âcre.
Les brigands étions 6,000, enfermés dans un couvent et bien
barricadés, et une rivière qui coulait au pied.
Nous les avons pris, non point sans peine, car nous avions
perdu, sur nos trois bataillons, 5 capitaines et 16 tant
lieutenants que sous-lieutenants, et 300 soldats et notre
général de brigade (35).
C'est là, avant d'arriver à Popoli, que j'ai vu une ordonnance
du 7e chasseurs à la broche, près d'un grand feu, tout noir
rôti. Un autre, les boyaux hors de son ventre qui remuait
encore. Quelle cruauté pour des hommes. Bref... (36).
Je vais coucher à l'écurie, je fais remplir ma gourde de vin, je
me fais donner une assiette d'huile d'olive, car, dans ce pays,
on ne brûle que de l'huile d'olive, car les olives sont très
communes avec un bouchon de liège. Je fais un trou au travers du
bouchon pour y passer la mèche. J'allume la mèche, je la mets
près de moi, pour, en cas d'alerte, que j'y voie clair pour
seller mes chevaux.
Mes précautions faites, je me fais un lit, j'y mets beaucoup de
plume de cinq pieds (37). Je me dis voilà bien trois mois que tu
ne t'es pas déshabillé, tu vas bien reposer cette nuit. Je bois
un coup de vin de ma gourde, je me mets à genoux. je prie Dieu
d'avoir pitié d'un pauvre pécheur et de vouloir me préserver de
tomber entre les mains des brigands (38).
J'avais bien donné à souper à mes chevaux, du moins qu'ils
soient toujours prêts à marcher. Je me mets dans mon lit de
paille, croyant bien reposer. Je me couche à neuf heures.
J'entends sonner dix heures je ne peux pas m'endormir. J'entends
sonner onze heures. Je me dis pourquoi donc tu ne peux dormir,
c'est sûrement à cause que tu es déshabillé. Je me réhabille, je
me recouche de nouveau encore, sans pouvoir dormir. Je me dis
c'est donc ton ange gardien qui veille sur toi pour t'avertir
d'être sur tes gardes (39).
Voilà donc que j'entends sonner minuit; une heure.
Entre une heure et deux heures, j'entends la voix d'un paysan
qui crie à sa langue « Francisco ! Francisco : », par deux fois.
Je me lève vite, je sors de l'écurie, je vais dans la basse-cour
je n'entends plus mot, tout est muet pour moi.
Hélas ! C'étaient nos gens qui partaient sans en avertir mes
maîtres qui dormaient bien tranquilles au château. Nos gens
enlevaient un trésor qui était dans un couvent, tel que j'en ai
fait mention en avant. Notre troupe avait cinq charrettes pour
charger cet argent et argenterie les roues étaient, ainsi que
les pieds des chevaux, entortillés avec du linge et des étoupes
pour ne pas faire de bruit pour ne pas donner l'éveil aux
bourgeois de la ville (40).
Bref, je reviens à moi. Je me recouche,
comme n'entendant plus rien, je m'endors jusqu'au jour. Il
valait bien mieux partir, mais j'ignorais le départ de nos gens.
Nos maîtres et moi, nous voilà endormis dans le sein des
brigands. Hélas que deviendrons-nous tous trois, quand il sera
jour? (41).
Je me lève au grand jour, je prends mon étrille pour étriller
mes chevaux. Le prince était sur la porte de l'écurie. En me
frappant sur l'épaule, il m'annonce que notre troupe est partie.
Je prends mes selles pour seller mes chevaux. La selle me tombe
des mains.
L'épouvante s'empare de mes sangs. Je ne sais quoi faire, ni
quoi devenir. Je veux courir après le prince pour lui demander
où étaient messieurs les adjudants-majors. Je sors de l'écurie,
je traverse la basse-cour. Je me trouve dans la rue. Je tire sur
ma droite pour aller à ma porte cochère elle était fermée. En me
retournant, quel affreux spectacle se présente à mes yeux, Près
de moi, une femme avec une hache à la main, comme une lionne
quand on lui a pris ses petits ; deux hommes avec chacun un
fusil à la main, ils couraient en passant près de moi.
Je tourne la face du côté du château. Ils m'ont sûrement pris
pour le cocher du seigneur, ou que Dieu ait envoyé mon bon ange
pour leur mettre un bandeau aux yeux, qu'ils ne m'ont pas
reconnu pour français, car, s'ils m'avaient reconnu, j'étais
immolé à l'instant. Il est bon de vous dire qu'à l'affaire que
nous avons eue avec l'armée napolitaine, j'ai pris dans les
caissons, une veste et un pantalon et un chapeau dont j'étais
habillé. Sûrement, ils m'ont pris pour un des leurs.
Je rentre dans la basse-cour, je regarde derrière moi, de
crainte qu'ils ne me suivent, mais je ne vois personne. J'entre
à l'écurie, je me recommande à Dieu, qu'il veuille bien avoir
pitié de moi. Je prends ma gourde, je bois un peu de vin pour me
donner de la force. J'étais si faible, que je tombais presqu'en
défaillance. Jugez dans quelle frayeur j'étais. Il n'y avait pas
à balancer, il fallait bien chercher un lieu pour me soustraire
aux yeux de ces brigands infernaux.
Toutes les cloches de la ville sonnent le tocsin. Tout le peuple
et les enfants faisaient un hurlement dans les rues. Je ne crois
pas, si l'enfer était déchaîné, si damnés feraient une frayeur
pareille.
Je vais dans la cour, je frappe à toutes les portes. Hélas elles
sont toutes fermées. Je monte un escalier pour aller à la
deuxième étage: Les portes, de même, sont fermées. Quoi faire ?
Je monte au troisième. Toujours les portes fermées. Je mets mon
dos à une porte pour l'enfoncer, mais je n'ai pas pu. Je ne
pouvais monter sur le toit, car le dessus était voûté. Il m'a
bien fallu faire pénitence dans ma position, devant ma porte,
depuis neuf heures du matin jusqu'à dix heures du soir. A dix
heures du matin, les paysans viennent dans la cour ; ils entrent
dans l'écurie, prennent mes chevaux. Il yen avait un qui était
méchant, il commence à ruer. Ils ne font ni une ni deux, ils
l'ont tué à coups de fusil pour décharger leur colère,
puisqu'ils ne trouvaient pas les hommes,
Ils prennent mon porte-manteau, ils partent de la cour et ils
s'en vont dans les rues en criant et en faisant un tintamarre
diabolique. A midi, ils reviennent dans la cour et dans le
château. Ils brisent, ils enfoncent les portes, faisant semblant
de chercher les Français dans les maisons. Ils sont entrés dans
la cave pour y boire le vin.
Les voilà qui montent les escaliers en criant et hurlant comme
des loups. Moi, je me jette à deux genoux, croyant recevoir le
coup de mort, je me recommande à Dieu. Je tire mon stylet de ma
poche pour me l'enfoncer dans le coeur, prêt à lancer le coup. Un
rayon de lumière, enfin, vint me frapper aux yeux. Une main
invisible vint retenir la mienne, prête à me frapper moi-même
(42). Le stylet me tombe de la main. Les paysans se sauvent,
descendent les escaliers comme si l'ange exterminateur était
après leurs trousses pour les faire descendre en enfer après les
avoir exterminés.
Depuis ce moment, je n'ai plus vu ni entendu de brigands. J'ai
fait ma pénitence jusqu'au soir, sans boire ni manger.
A dix heures du soir, je fais mes préparatifs pour sortir de ma
retraite. Je coupe mes bottes en souliers pour aller jambes nues
comme les paysans. Je mets une bonne botte de foin sur mes
épaules pour me faire une bosse. Je prends, en passant dans la
cour, une trique de fagot, en cas, si quelqu'un m'attaquait, que
je puisse en tuer un auparavant qu'il me tue.
Je pars dans cet équipage, je traverse la rue pour me rendre au
rempart, passant près des paysans. En vue, ils me souhaitent le
bonsoir « Bono cero ». Je réponds « Bona cera ». S'ils m'avaient
reconnu, soyez sûrs qu'ils ne m'auraient pas souhaité un bonsoir
de bouche. Cela aurait été plutôt un bonsoir d'un coup de stylet
dans le ventre.
Après avoir traversé la ville, me voilà dans un parterre qui
bordait le rempart. Je cherche un endroit propice pour sauter en
bas. Mais hélas ! j'étais trop haut ! Comme j'ai remarqué, il
avait bien trente ou quarante pieds de hauteur. Je me dis tu as
échappé jusqu'à présent pour te tuer en sautant en bas de ce
rempart. Je sors de mon enclos, je guide mes pas du côté de la
porte de la ville qui était fermée, croyant descendre et monter
après les jambages (43). Que vois-je au clair de lune ? Un
paysan endormi proche de la porte, avec un fusil entre ses bras,
auprès de la muraille. J'ai eu envie de le tuer d'un coup de
pierre, mais j'ai eu peur de le manquer, car, si je l'avais
manqué, qu'il eût crié, j'étais un homme mort.
Quand on est seul, on tire bien des conseils, mais ils ne sont
pas toujours bons (44).
Je rentre dans mon parterre. Il fallut bien me décider à me tuer
en sautant ou mourir dans mon parterre quand il aurait fait
jour. Mon parti était pris, je monte sur le rempart. Je jette
mes pieds de l'autre côté de la muraille je m'accroche à la
muraille avec mes mains. Je me laisse ainsi tomber en bas. Je
tombais sur mes pieds, je retombais à l'envers, c'est-à-dire sur
le dos. Ma tête, ma pauvre tête, frappe la terre. Je vois la
lune, les étoiles, le ciel qui tournent, je ferme les yeux; me
voilà sans connaissance.
J'avais sauté à dix heures du soir, je m'en ai relevé que vers
les deux heures du matin.
C'était le 7 janvier 1798 (45).
Je me lève tout cassé, mes jambes ne veulent pas me porter. Je
retombe sur mon séant, je reprends un peu. Les larmes me tombent
des yeux. Je me dis il faut donc que je meure ici. Je me traîne
sur mes mains et sur mes genoux, dans la vigne qui était proche
de moi. Comme c'était pleine lune, le temps était clair. Je
prends un pesseau (46), je me lève, je m'en sers comme d'une
crosse. Je marche pour prendre la route que nos gens avaient
pris. Une grande rivière se trouve devant moi il fallut bien me
jeter dedans pour la passer. Elle était très rapide, a fallu
presque me noyer. J'y allais jusqu'à la ceinture. L'eau me
sautait jusqu'à sur l'épaule. Sans mon grand pesseau, l'eau
m'aurait entraîné, c'était fait de moi. Je marche tout mouillé.
La glace prend après mes habits jugez, au 7 janvier, quelle
froideur qu'il fait en cette saison. Après avoir bien marché, je
trouve une autre rivière comme ce serait le canal de Domjevin,
qui était profonde. Quel obstacle ! J'ai suivi le canal. Par
bonheur, je trouve une petite maison. Il y avait une échelle et
une planche dessus la rivière. J'y passe à bas bruit, en me
sauvant. La lune allait se coucher et le soleil se lever, et moi
encore proche de la ville et loin de la montagne pour m'y cacher
pendant la journée.
Je marche, muni de gros cailloux dans mes poches pour assommer
un paysan, en cas qu'il vienne après moi pour m'attaquer. A huit
heures du matin, je suis rencontré en montant une grande
hauteur, suivant ma route, par un brigand. Il m'a regardé, il
était d'un côté de la route et moi de l'autre. Il traverse la
route, il vient à moi, il me dit en langue italienne « Tu es
Français ? ». Moi, je lui réponds dans la langue italienne « Non
io sommo soldato italiano canonico (je suis soldat italien et
canonnier). Où vas-tu ? qu'il me dit. - Je lui réponds Je vais
chez moi (i andoto a casa mia). - Tu es Français, tu as la chair
trop blanche. Retourne à la ville avec moi, ou sinon je te tue
(47) ».
Un autre vieux paysan arrive. Il le fait passer devant moi avec
une pierre à la main, et moi entre deux, comme Notre Seigneur
entre deux larrons.
Le gros brigand était armé d'une carabine, deux pistolets à sa
ceinture. Moi, je lui dis que je ne voulais plus marcher, que
j'aimais autant mourir ici que d'aller mourir à la ville. Il me
prend par le manteau, il me l'arrache de dessus le dos. Il me
fait mettre bas mon habit, mon gilet, mes souliers il me demande
mon argent, ma montre (48).
Je dépose tout devant lui. Je croyais qu'il allait ramasser tout
ce que je lui avais déposé devant lui. S'il l'avait ramassé,
j'avais trois cailloux dans mon gousset, sitôt qu'il s'aurait
baissé, je l'aurais assommé je ne risquais plus rien, puisqu'il
me fallait mourir.
Il arme sa carabine pour me tuer. Sitôt que je vois armer son
arme, je saute dans le fossé, je me sauve en descendant, faisant
toujours des crochets. Il tire ; il me manque.
La balle saute à deux pas de moi. Il crie « Que l'on m'attrape
ce Français ».
Les paysans étaient à travailler aux vignes. Ils courent après
moi me voilà entouré de tous côtés me voilà encore pris une
fois. Passant près d'une petite maison, il en sort deux paysans
et une femme. Je suivais une petite haie vive. Deux paysans
courent, me barrent le chemin, avec chacun un fusil. L'autre
vient droit devant moi, me lance un coup de barre sur la tête
pour m'assommer. J'oblique à gauche, il me manque ; il redouble,
j'en fais autant. Sans la haie, il m'aurait tué du premier coup.
Un autre, sur la gauche, s'avançait à pas de géant, tenant une
fouine à trois fourchons, prêt à me l'enfoncer dans le côté.
Je m'élance devant ceux qui étaient devant moi avec leurs
fusils, je me jette à deux genoux, je tire ma cravate de mon
gousset, je me bande les yeux (49). Je jette un cri en réclamant
mon Dieu et sa sainte mère la Vierge Marie en langue italienne.
Cette pauvre femme avait passé la haie, vient sur moi, me tire
le mouchoir qui me servait de bandeau aux yeux. En me relevant,
elle dit :
« Ce Français est chrétien comme nous autres, je ne veux pas
qu'on le tue ».
C'est que j'avais un scapulaire pendu à mon cou cette bonne
femme l'a vu. C'est pour cela qu'elle m'a pris pour un bon
chrétien (50).
Elle m'emmène dans sa petite maison. Sitôt que j'y fus arrivé,
plus de trente, tant hommes que femmes, enfants, ont venu voir
le pauvre prisonnier. Les voilà à se disputer ma mort entre eux,
mais les femmes, les braves femmes, se jetaient après eux pour
les empêcher de me tuer. Il en vint un haut comme un arbre, un
gros bâton à la main, disant en entrant « Où est-il, le coquin
de Français, que je le tue ? Les Français, ils m'ont pillé ma
maison, lâché mon vin, enfin, tout cassé, violé mes filles, il
faut absolument que je le tue ».
Les pauvres femmes se jettent après lui plus de dix, elles le
désarment. Enfin, il s'apaise comme les autres. J'avais si
chaud, si soif, je demande à boire.
Une femme de la société part dans sa maison voisine, elle
m'apporte du vin dans une cruche. Elle me l'a présenté en me
disant « Buvez, pauvre Français ! ». Je bois sûrement un bon
coup. D'après toutes ces menées, ils tiennent conseil pour voir
ce qu'ils feraient de moi. Il fut délibéré qu'ils m'allaient
mener à la ville de Monte-Sarte, au gouverneur de la ville. Là,
que l'on me jugerait (51).
Quatre paysans m'ont emmené. Comme j'étais presque nu, je
tremblais de froid, à cause que j'avais eu chaud en courant, je
tremblais. L'un des paysans me jette son manteau sur mes
épaules, un autre me couvre la tête de son bonnet. Je suis,
entre leurs quatre, emmené en ville.
Auparavant d'arriver au gouverneur, il me fallut encore faire
une petite pénitence. Il y avait beaucoup de jeunes galopins sur
la place, en entrant en ville, qui jouaient à la balle. Ils
viennent après moi. Un me tire par les cheveux, les autres me
donnent des coups de pied au derrière un autre m'applique un
coup de poing dans l'estomac en m'injuriant que j'étais bon à
tuer, que j'étais bien gras, il me renverse, comme je n'étais
guère fort dans ce moment-là.
Arrivé devant la belle et grande maison du gouverneur, il était
à la croisée, en veste à manches blanches de flanelles. Il
m'appelle de la main en me disant « Voici un Français venez,
citoyen français ».
Moi, comme j'étais résolu de mourir : bah ! bah ! Tu m'appelles
pour me faire mourir avec d'autres de mes camarades que tu tiens
dans ta prison.
Il envoie un de ses laquais m'attendre sur le premier escalier.
En me voyant aussi débile et aussi languissant, il me prend par
la main et il me tire. Je lui dis « Un moment, si l'on a
déjeuné, moi je n'ai rien dans le ventre »
Le gouverneur, qui m'attendait sur la porte de sa chambre, il me
dit « Vous êtes Français ? Je lui réponds Oui, Monsieur, mais je
ne le serai pas longtemps. Il me répond « N'ayez pas peur, vous
êtes en lieu de sûreté ! »
Il me fait asseoir vis-à-vis de deux jolies demoiselles.
Dans tout autre occasion, j'aurais eu un beau caprice pour
elles. Monsieur m'interroge sur ma naissance, mon lieu, ma
demeure et mon pays. Je lui dis que j'étais fils d'un émigré du
village de Bénaménil, que mon père était en Autriche, et moi,
que j'avais entré au service d'un commandant, que j'avais été
pris par les paysans, que j'avais eu les yeux bandés, prêt à
être fusillé (52).
« Ah les gueux », dit-il.
Comme il parlait bon français, il me demande si je savais parler
la langue italienne. Je lui réponds que non il racontait tout ce
que je lui disais à ces belles demoiselles et à deux de ses amis
qui étaient avec lui, en langue italienne. Et moi, je comprenais
tout. Il me dit « Il me paraît que vous êtes un enfant bien
élevé ». Il me fait lire et écrire. En voyant mon écriture, il
dit « C'est bien. Je peux vous faire grâce, et, en même temps,
vous faire condamner à mort. Mais non, j'ai pitié de vous, parce
que j'aime les Français, et que mes deux filles me demandent
grâce pour vous ».
Moi, je jette un regard attendri sur ces demoiselles, et, en
même temps, les larmes tombent de mes yeux. Je me jette à genoux
devant ces aimables demoiselles, voulant baiser le bas de leurs
robes. Une de ces aimables enfants se prend à pleurer, en me
pressant par la main pour me relever. Je me relève en les
remerciant de la bonté qu'elles avaient pour moi. Leur cher papa
me demande si je voulais déjeuner. Comme il n'était que dix
heures du matin, je lui dis que j'acceptais son déjeuner, qu'il
y avait trente-huit heures que je n'avais pas mangé, que je
mangerai un peu, que cela pourrait me remettre d'avoir tant
souffert.
On m'apporte des oeufs cuits dans la cocote (quoquotte) (53) avec
de la saucisse coupée par tranches, avec une bonne bouteille de
vin.
Les paysans étaient sur la place, faisant des hurlements
épouvantables. Je crois qu'ils m'attendaient pour me voir
mourir. J'ai eu la curiosité de les regarder par la fenêtre. Il
me dit « Citoyen français, retirez-vous, car vous savez, dans
les émeutes, il n'y a pas de loi, ni de commandement, ni de
respect pour personne ». Je lui fais bien mes excuses de
l'impertinence que j'ai eue. Bref, je déjeune, et, pendant mon
déjeuner, il commande à son cocher d'apprêter son carrosse et
d'y mettre quatre chevaux, un postillon devant et un derrière.
Comme je n'avais que ma chemise et mon pantalon, Monsieur me
fait donner une de ses vestes de nankin, un gilet, un chapeau,
une paire d'escarpins. Il me fait réhabiller, et me fait ma
queue lui-même.
Le cocher arrive, son chapeau à la main, et dit « Il cavalo somo
preto (les chevaux sont prêts) ».
Il me dit « Citoyen français, il vous faut partir je veux vous
conduire à Caserte, là où sont les Français ».
Ces aimables filles me voyant partir, elles m'ont demandé la
permission de me serrer la main. Ho ! messieurs, mesdames, qui
lisez l'aventure de ma captivité, ah quelle impression que des
si douces mains ont fait sur mon coeur. Si j'avais osé, oui...
mais...
Je leur souhaite toutes sortes de bonheur en les quittant ce ne
fut pas sans verser des larmes. J'aurais voulu être aussi riche
que le roi, j'en aurais épousé une pour l'aimer et chérir le
durant de ma vie.
Je n'aurais fait que mon devoir d'aimer celles qui devenaient
d'intercéder pour me sauver la vie (54).
Monsieur le gouverneur de la ville de Monte-Sarte et deux de ses
amis et moi, montent en carrosse. Nous partons au galop, passant
sur la place, au milieu de plus de 200 personnes qui criaient «
Le voleur de Français, le voilà qui est échappé! ». Nous avons
traversé une petite plaine qui était remplie de paysans morts
depuis deux jours, que nos gens avaient tué. C'étaient ces
brigands de Benavente, la ville que j'ai fait pénitence sur les
escaliers depuis neuf heures du matin jusqu'à dix heures du soir
(55).
Ils couraient après nos gens pour leur reprendre le trésor
qu'ils emmenaient. Les Français, voyant venir les brigands, ils
ont fait embusquer un bataillon derrière une haie verte, à
terre. Nos deux autres bataillons se sauvent en avant, en
retraite. Les paysans à courir, croyant déjà tenir nos gens.
Tout d'un coup, quand ils eurent dépassé le bataillon qui était
embusqué, il se lève, chargeant à la baïonnette dessus ces
coquins-là. Les deux autres bataillons font demi-tour. Les
brigands sont pris entre deux feux. Ils tuent, ils crèvent tout
ce qui se trouve dans leurs mains. De 7,000, il n'en a réchappé
que 2,000 qui ont gagné la montagne. Si bien que la plaine était
couverte de corps morts, et ils ont tout de suite descendu dans
le royaume de Pluton.
Mon bon gouverneur, après cinq lieues de chemin, il me dépose
aux premiers postes de nos braves Français. En m'embrassant, il
me donne un au revoir et me souhaite toutes sortes de bonheur,
et moi, je lui en fais autant.
Voilà, par la grâce de Dieu, ma délivrance et ma pénitence faite
pour le moment.
CHAPITRE IV - La conquête de la Pouille et la retraite de
l'Armée de Naples
Prise de Naples. - Malade. - Un remède de bonne
femme. - Une double ruade. - Les étapes en boitant. - Foggia. - Un
massacre de brigands. - Le général Schérer. - La retraite sur
Plaisance. - Capoue. - Désespoir des blessés abandonnés. - La
retraite de Macdonald. - Combat d'Isola. - Bataille de la Trébie
(18 au 20 juin 1799). - La 17e demi-brigade soutient la
retraite.
De là, je fus au siège de la ville de Naples. On s'est battu
dans tous les faubourgs ; tous les bourgeois étaient barricadés
dans leurs maisons. On enfonçait les portes, on tuait tous ceux
qui avaient les armes en main et brûlait les maisons pour les
mieux attraper (56).
Le lendemain, la ville se rend aux Français. De là, nous avons
été dans la Pouille (57). Moi, au bout de quelques jours, je
deviens si blanc, si maigre, point d'appétit, un furieux point
de côté qui me coupait la respiration. Je ne pouvais reposer ni
dormir la nuit. Un bon bourgeois dont j'étais logé chez lui, me
voyant malade et souffrant, me demande quelle maladie que
j'avais. Je lui fais le détail de ma misère : il me tue trois
pigeons, l'un après l'autre, que j'applique par son ordre tout
vivants, remplis de sang et tout chauds sur le point de côté. Le
lendemain le sang caillé se détache. Je crache des morceaux de
sang comme des grosses noisettes. L'appétit me revient peu à
peu, au bout de quelques jours (58).
Pour comble de bonheur, je reçois une ruade de deux coups de
pied sur les deux reins : je fus renversé et assommé sur place.
Jugez quel contre-temps pour moi, après déjà tant eu de malheurs
auparavant, je me dis il faudra donc laisser mes os en Italie.
Quand il a fallu partir le lendemain, pas pouvoir marcher, ni me
tenir à cheval. Quoi faire ? Quoi devenir ? Rester entre les
mains des brigands, c'était fait de moi, car tous nos pauvres
blessés ou malades qu'on laissait dans des petites ambulances,
sitôt nos troupes parties, on les assommait ou on les brûlait.
Je prends deux bâtons, je me traîne comme je peux en suivant mon
bataillon. Arrivé dans la ville capitale de la Pouille, nommée
Foggia San Via (59). Située dans une belle plaine, il vient un
espion qui a rapporté à notre général (Championnet), qu'il y
avait un rassemblement de brigands au nombre de 5,000 à Foggia.
Nous allons après, nous n'étions plus que 1200 hommes pour nos
trois bataillons. On les attaque, on les culbute, on tue. Ils se
mettent dans leurs maisons, ils se barricadent. On enfonce les
portes, on tue, on hache tout ce que l'on rencontre sous nos
mains. J'en ai compté dans les chambres jusqu'à trente tués
(60). De là, nous allons attaquer les rassemblements de paysans
de la Calabre, nous avons perdu beaucoup de monde sans pouvoir
nous enfoncer dans des monceaux de montagnes.
Le général Schérer nous trahissait en Italie (61). Les Russes et
les Autrichiens nous coupaient le chemin, proche de Plaisance,
de l'autre côté du Pô, grande rivière. Nous avons battu en
retraite pendant six semaines. C'était au mois d'août, nous
battons en retraite de la Calabre jusqu'au Pô, proche de
Plaisance, jour et nuit, sans nous reposer.
Nous étions à l'arrière-garde pour soutenir la retraite (62).
En passant dans la ville de Capoue, nos pauvres blessés et nos
malades qui étaient à l'hôpital, quand ils ont su que nous
quittions le pays, les pauvres malheureux descendaient les
escaliers, la tête en bas. Cela faisait pitié de voir comme ces
malheureux se lamentaient. Nous ne fîmes pas une lieue qu'ils
étaient assommés et brûlés. Une grande quantité nous suivait,
tout languissants ; ils tombaient sans se pouvoir relever,
aussitôt ils étaient tués par les paysans. Il paraît qu'ils
avaient juré de massacrer toute notre armée (63). Nous ne
trouvions ni paysans dans bourgs, ni villages, ni chevaux, ni
charrettes pour transporter nos pauvres malades, car ils
avaient-tout sauvé ce qu'ils avaient dans les montagnes. Il y
avait deux petits corps d'armée devant nous, qui pillaient et
brisaient tout ce qu'ils trouvaient devant eux. Nous autres,
nous ne trouvions rien à manger. Il nous fallait marcher sans
vivres. Nous avons fait trois jours de marche sans voir aucune
personne dans ville, ni village. Passé trois jours, nous les
avons retrouvés à Isola, petite ville bien forte.
La, 14,000 brigands nous attendaient, croyant bien nous tous
prendre (64). Il y avait une grande rivière, ils nous
disputaient le passage. Nous avons fait nos préparatifs pendant
trois jours pour passer la rivière. A deux heures du matin, nous
culbutons tout ce qui se présente devant nous; nous prenons la
ville, on tue tout hommes, femmes et en fants. On met la ville
au pillage et puis on met le feu aux quatre coins de la ville et
nous partons. A force de marcher, nous arrivons devant la
citadelle de Plaisance. Les Russes et Autrichiens nous disputent
le passage (65),
Nous nous avons battu à deux heures après-midi pendant trois
jours, sans pouvoir passer. Le champ de bataille était jonché de
corps morts et blessés. Nous battons en retraite le troisième
jour. Nous étions trahis, comme j'en ai fait mention ci-devant,
par le traître Schérer. Nous devions partir à deux heures du
matin, nous n'eûmes l'ordre de partir qu'à neuf heures. A deux
heures après-midi, l'ennemi nous bloque de toutes parts, nous
prend vingt-deux bouches à feu, la moitié de notre petite armée,
notre demi-brigade qui soutenait la retraite. Les Russes
chargent à la baïonnette dessus nous, ils nous tuent la moitié
de nos gens et prennent le reste. Nous nous sommes sauvés
dix-sept, d'entre les mains des Russes. Voilà presque tout notre
armée détruite, ils nous ont pris plus de 400 voitures et tous
nos canons, sans en réchapper un seul. Voici notre belle armée
de Naples détruite.
CHAPITRE V - Le siège de Gênes - La rentrée en France - La
libération
Gènes. Bloqués. - Les misères du siège. - Nous
nous retrouvons sept pays à Gènes. - Masséna capitule avec les
honneurs de la guerre. - Dévalisé par des barbets. - Marengo. -
Licencié. - Retour en France. - Dépouillé par les médecins. -
Retour au régiment. - Nantes. - La carotte. - Belle-Isle-en-Mer.
- Libéré par congé de réforme. - Actions de grâces et recettes.
Nous voilà jetés dans les montagnes de Gênes, comme des lièvres.
Nous battons en retraite jusque dans la ville de Gênes. Nous y
passons l'hiver, le plus souvent sans pain, que d'avoir du pain.
Après Pâques, nous voilà bloqués par les Autrichiens et les
Napolitains par terre, les Anglais par mer (66). Nous voilà
bloqués pendant huit mois. C'est à ce blocus que nous avons tenu
compagnie à la misère. Dans toutes les guerres que les Français
ont faites, il n'y a pas eu de blocus pour y être aussi
malheureux que celui de la grande ville de Gênes. Nous étions
24,000 hommes, il n'en est sorti que 8,000. Nous étions cinq
garçons de Domjevin. On a mangé presque tous les chevaux de la
garnison, on a tout mangé, fèves, haricots, dragios (dragées)
chocolats. On mettait tout en réquisition pour nourrir les
troupes on nous faisait du pain avec du sang, de la paille
hachée, pétrie avec du sang des chevaux, du chocolat pour lui
donner du goût (67).
J'ai acheté plusieurs fois quatre oignons gros comme des
noisettes pour quatre sous. Sans une chopine qu'on vous donnait
soir et matin, aurait fallu mourir de faim. La peste était dans
les hôpitaux. Les drapeaux noirs étaient aux quatre coins de la
ville. On a fait nombre de 30,000 bourgeois, femmes et enfants
morts de faim et de la peste.
Après le blocus qui a duré huit mois, nous ne sommes sortis que
8,000. Jamais on n'a vu de blocus pour avoir vu et entendu dire
tant de misère. Nous étions moi, J. Chatton, Jean Levreau,
Jean-Joseph Carrière, François Chatton, tonnelier, Claude Mengin,
Stanislas Thiéry, François Mélice de Lunéville, nous croyions
tous mourir dans Gênes.
Enfin, notre général, Masséna, a capitulé avec les honneurs de
la guerre, de là, nous allons à Milan. Nous partons de Milan
pour revenir à Gênes. De là, nous partons pour aller à Nice, à
quarante lieues de Gênes.
Nous étions auprès de la petite ville de Savone, nous avons été
rencontrés par quatorze barbets ou quatorze brigands du Piémont
(68). Ils nous somment de leur donner ce que nous avions sur
nous ; que seulement celui d'entre nous cinq que nous étions,
celui qui cacherait un sou, serait fusillé sur la place. Nous
leur donnons, or, argent, montres, boucles d'oreilles et nos
porte-manteaux (69).
Comme vous le voyez, j'ai été pris par les brigands deux fois et
dévalisé et presque nu : belle réussite. Nous sommes retournés
sur nos pas, à Gênes. De là, nous allons à Milan, nous y restons
dix mois. Il est bon de vous faire savoir que quand nous avons
sorti du blocus de la ville de Gênes, que la veille d'être
débloqué, que Bonaparte est venu avec 50,000 hommes au milieu de
la belle plaine de Marengo, derrière l'armée du général Melas,
général autrichien. Les Autrichiens étaient 250,000 hommes;
Bonaparte a commencé la bataille à deux heures du matin. Elle a
été gagnée seulement à quatre à cinq heures du soir. Bonaparte a
pris le général et toute son armée, tout son canon. Enfin, pas
un soldat n'a été réchappé, Melas a capitulé. Son armée et lui
ont repassé l'Adige sans canons, ni bagages quelconques (70).
Je reviens à moi. Je suis licencié je reviens en France. Arrivé
chez ma mère, comment faire, n'y pouvant (71) rester au bout de
quelques jours, comme n'ayant point de congé, il me fallut
partir; où aller? Je pars pour Metz. J'ai essayé d'avoir mon
congé. J'ai dépensé cent cinquante francs en passant à la visite
de ces voleurs de médecins ou des bouchers de chrétiens, quand
ils m'ont eu dépouillé, ils m'ont laissé là. Je suis réduit sans
le sou. Je vends ma montre (72).
Et puis je me mets à la garde de Dieu, mettant tout à lui ma
confiance. Je pars ainsi, je vais à Luxembourg. Je reste
vingt-deux mois. Nous partons pour aller à Nantes, en Bretagne.
J'ai vu pour ce coup-là, qu'il me fallait jouer de la plus
grande de mes finesses. Je commence à faire le malade, comme
j'avais une hernie (73), j'ai joué mon rôle, parce que je voyais
qu'il ne m'était pas possible de me retirer, aurait fallu que
j'y meure. On ne donnait pas de congé absolu, il me fallait
tâcher d'en avoir un de réforme (74).
Nous partons pour Vannes, port de mer de Bretagne, de là, nous
avons embarqué pour aller à Belle-Isle-en-Mer à quinze lieues de
traversée. C'est une ville que Belle-Isle sur le bord de la mer.
L'île n'a que deux lieues de tour, l'on n'y voit point de bois.
Le bois qu'on y brûle, on l'amène de la Grande Terre. Là nous
avons resté quinze jours sans vivres. Nous faisions la soupe
avec du poisson et du hareng. Le poisson est si abondant qu'il
se donne presque pour rien. Le cidre à six liards le pot : un si
bon que le vin des côtes de Dombasle.
A force d'amis et d'argent que j'ai fait venir de mon pays, et
ma bonne conduite envers mes chefs qui sont bien voulu employer
pour moi, ainsi que mon brave sergent-major qui était de
Haraucourt, dont nous nous qualifions de pays et d'amis, et
notre brave chirurgien-major, nommé Levaet, j'ai été enfin
délivré et sorti de l'esclavage. J'ai reçu mon congé à Lorient
après avoir été débarqué. J'ai reçu ma feuille de route avec
trois sous par lieue. En quittant, j'ai été regretté de tous mes
camarades et ainsi que de mes braves chefs. Mais j'ai été bien
aise d'être délivré de tant de misères corporelles.
Ainsi soit-il ! Amen :
Si j'avais voulu écrire tous les tours et détours que j'ai fait
et les traverses et les misères que j'ai essuyées, les froids,
la faim, la nudité, ainsi que tant d'autres choses, il m'aurait
bien fallu une main de papier ; ce que j'ai écrit est sincère et
véritable, sur ma parole la plus sacrée. Croyez amis, dans une
guerre de trente ans, que nous avons faite, qu'il s'y est bien
passé des maux et des biens, l'un a devenu riche, l'autre a
devenu pauvre l'autre a devenu estropié (75). Ainsi je termine,
car il y aurait trop de choses à vous compter.
Fait et copié par moi,
Jean CHATTON.
Vieux Souvenirs.
Il n'y a pas une année que je ne repasse depuis que je suis
revenu de l'armée, ce papier, et tout ce que j'ai essuyé à
l'armée, et chaque fois que je repasse ce passage, les cheveux
se dressent de dessus ma tête et que mes sangs se meuvent de
toutes mes veines et quelquefois, les larmes me tombent des
yeux.
Je remercie bien Dieu de m'avoir conservé la santé jusqu'à
présent, d'avoir venu dans un âge aussi avancé que je suis à
présent. Loué soit à d'ore à jamais, les saints noms de Dieu, de
Marie, Joseph et sainte Anne.
J'ai parti l'an 1792 et j'ai revenu dans l'année 1803, chez mes
parents à Domjevin.
J. CHATTON,
Agé de 61 ans.
Remèdes et Oraisons.
Remède pour guérir les cors aux pieds.
Prenez des feuilles de rampan, la quantité que vous voudrez, et
puis vous achèterez du meilleur vinaigre de Bourgogne, vous
mettrez vos feuilles dans le vinaigre infuser et puis vous
mettrez une feuille de rampan sur ledit cor, soir et matin,
pendant quinze jours, le cor disparaît et jamais il ne revient
plus.
Remède approuvé pour la rompure d'un enfant.
Prenez du beurre frais avec de la cire jaune que vous ferez
fondre, cela fait une graisse. Vous graissez l'hernie le soir et
matin, vous prendrez de la mousse d'épine noire que vous mettrez
entre deux linges, que vous appliquerez sur le mal de l'enfant
vous réitérerez le remède plusieurs fois et l'enfant se trouvera
guéri parfaitement.
Remède pour arrêter le sang de telle coupure que ce soit.
Dieu est né la nuit de Noël, à minuit. Dieu est mort. Dieu est
ressuscité. Dieu a commandé que la plaie se ferme, que la
douleur se passe, que le sang s'arrête et que ça n'entre pas en
matière, ni en senteur, ni en chair pourrie, comme ont fait les
cinq plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ. Natus est Christus,
mortuus est, resurrexit Christus.
Chaque fois que l'on répète ces mots latins, on souffle en forme
de croix sur la plaie, en répétant le latin par trois fois, sans
oublier la mémoire à l'intention des cinq plaies de Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Oraison pour couper la fièvre.
Quand Jésus porta sa croix, il lui survint un Juif, nommé
Marc-Antoine, qui lui dit Jésus, tu trembles. Je ne tremble ni
ne frissonne, et celui qui en son bras, ce billet portera,
jamais fièvres ni frissons n'aura.
Je commande aux fièvres tierces, fièvres quartes, fièvres
intermittentes, fièvres puerpuéreuses, de s'arrêter du corps de
cette personne. Jésus, Maria, Jésus.
Il faut faire une neuvaine de réciter cinq pater et cinq ave
maria en l'honneur des cinq plaies de Notre Seigneur
Jésus-Christ. Dieu soit béni et loué sur la terre et en tout
lieu.
Ainsi soit-il
ÉTATS DE SERVICES DE JEAN CHATTON
VOLONTAIRE RÉQUISITIONNAIRE EN 1792
Incorporé au 3e bataillon de la Manche 21 octobre 1792
Soldat chargé du train en 1793
Maréchal des logis en second 1794
Bataille et prise d'Arlon. 21 mai 1794
Prise de Charleroi. 25 juin 1794
Bataille de Fleurus 26 juin 1794
Bataille d'Aldenhoven. 2 octobre 1794
Prise de Maëstricht. 4 novembre 1794
Prise de Bréda. 28 décembre 1794
Prise de Luxembourg. 7 juin 1795
Passé à la 200e demi-brigade 8 juillet 1795
Campagne de la Lahn octobre 1795
Déblocus de Mayence. octobre 1795
Incorporé à la 17e demi-brigade de bataille. mars 1796
Passage du Rhin, à Kehl. 23 juin 1796
Combat de Freudenstadt 4 juillet 1796
Bataille de Biberach. 2 octobre 1796
Défense de Kehl. 26 octobre 1796
Passage du Rhin, à Diersheim 20 avril 1797
Combat de Porto di Fermo 26 novembre 1798
Combat de Popoli. 24 décembre 1798
Affaire de Benavente. 16 janvier 1799
Assaut de Naples. 23 janvier 1799
Combat de San Severo 20 mars 1799
Prise d'Andria. 27 mars 1799
Combat d'Isola 12 mai 1799
Prise de Modène. 12 juin 1799
Bataille de la Trebbie. 18-19 juin 1799
Combat de San Giorgio. 20 juin 1799
Siège de Gênes. 6 avril-4 juin 1800
Libéré par congé de réforme, à Lorient, en 1803 |