|
Les fastes de la
gloire : ou, Les braves recommandés a la Postérité; monument
élevé aux défenseurs de la patrie, par une société d'hommes de
lettres, et de militaires
Louis François L'Héritier
Tome II - 1818
GEOFFROY (François),
capitaine à la suite des hussards du Jura, officier de la
Légion-d'honneur, né à Amenoncourt, département de la Meurthe.
Le 23 septembre 1800, Geoffroy, qui avait à peine atteint sa
dix-neuvième année, entra volontairement en qualité de soldat au
2e régiment de hussards, où, après avoir obtenu les grades
inférieurs, il s'éleva au grade de capitaine, par des actes
d'une rare intrépidité. La campagne d'Austerlitz, qu'il fit
comme fourrier, lui valut les galons de maréchal-des-logis-chef.
Le 17 octobre 1806, à Halle en Prusse, la 2e compagnie, que
commandait le brave Becker, aujourd'hui lieutenant-colonel,
était d'avant-garde. Elle pénétra pêle-mêle, avec le 9e régiment
d'infanterie légère, dans la ville, en sabrant tout ce qui se
trouvait devant elle. Impatient de combats et de gloire, le
maréchal-des-logis-chef Geoffroy, quittant le gros de la troupe,
se jeta dans une petite rue, pour être l'un des premiers à
couper la retraite de l'ennemi ; à peine arrive-t-il au détour
de cette rue, qu'il aperçoit quatre grenadiers prussiens qui le
couchent en joue : aussitôt il leur crie en allemand, en
marchant toujours sur eux : « Vous êtes morts si vous faites
feu. » Epouvantés de cette menace, les grenadiers mettent bas
les armes, et leur vainqueur les emmène prisonniers. Parvenus
sans obstacle jusqu'à la porte par laquelle ils devaient sortir,
les Français sont arrêtés par le feu meurtrier de quatre pièces
d'artillerie qui vomissent la mitraille, et par la mousqueterie
de deux bataillons ennemis. A la vue du péril, les voltigeurs du
9e régiment d'infanterie légère montrent de l'hésitation,
l'intrépide Geoffroy veut encore être le premier à donner
l'exemple ; au milieu d'une grêle de balles, il franchit la
porte au galop, en criant en avant !... Au même instant ce mot
heureux, qui a plus d'une fois décidé la victoire, est répété
avec enthousiasme par les voltigeurs qui chargent avec
impétuosité à la baïonnette et culbutent les Prussiens. « Aux
pièces ! camarades, aux pièces ! s'écrie de nouveau » Geoffroy,
en s'adressant à quelques hussards de sa compagnie. Quatorze
d'entre eux se précipitent sur ses pas, foncent avec lui sur la
batterie, sabrent les canonniers, et enlèvent les pièces.
Geoffroy s'étant ensuite réuni à son régiment, au moment où il
allait effectuer une charge contre les hussards d'Oussudon,
forts de huit cents hommes, devança encore ses frères d'armes et
s'enfonça au milieu des rangs ennemis, d'où il ne sortit que le
dernier, et après avoir sabré le colonel. Dans cette
circonstance, il faillit être la victime de son extrême bravoure
: entouré par un grand nombre de cavaliers ennemis, il se
défendit pendant quelques minutes ; mais un coup de sabre qu'il
reçut sur le poignet l'ayant désarmé, il allait être fait
prisonnier, lorsqu'il fut heureusement dégagé par des soldats de
son régiment qui vinrent à son secours. Cette action lui valut
par la suite la décoration de la Légion-d'honneur et le grade de
sous-lieutenant dans la compagnie d'élite.
A Morangue, dans la Vieille-Prusse, il combattit avec la même
distinction : quoique grièvement blessé d'an coup de feu au
dessus de l'oeil gauche, il prit part à tous les engagemens
qu'eut à soutenir le 1er corps d'armée commandé par le maréchal
Bernadotte dans sa retraite sur Strasbourg en Pologne.
Passé en Espagne avec le 2e de hussards, Geoffroy assista à
toutes les batailles et combats où se trouva le corps. A
Medeline (1), il fit partie de la cavalerie commandée par le
brave général Lasalle, et mérita des éloges pour sa belle
conduite.
Le 17 décembre 1809, toute l'armée française étant sur la rive
droite du Tage, le sous-lieutenant Geoffroy faisait partie d'un
détachement de cent cinquante chevaux, qui, sous les ordres du
capitaine Dradziansky, se trouvait l'un des plus rapprochés du
fleuve. A 9 heures du soir, l'adjudant-commandant Blancheville,
arrivé avec un bataillon d'infanterie et deux cents dragons,
demanda un officier intelligent pour passer le Tage, et aller
sur la rive gauche s'assurer du mouvement que faisait l'ennemi.
Geoffroy s'offrit pour cette expédition. Parti aussitôt avec
vingt-cinq hussards et un guide espagnol, il se dirigeait dans
l'obscurité et par des sentiers aussi étroits que difficiles,
vers Villa-Rubia, distant de plus d'une lieue du point de
départ, lorsque parvenu à un quart de lieue de cet endroit, il
entendit très-distinctement le bruit d'une forte colonne qui
s'avançait. Jugeant alors qu'il était d'autant plus dangereux de
continuer sa marche avec tout son monde, qu'il avait derrière
lui un long défilé, il fit arrêter son détachement, et, suivi
seulement de cinq hussards des mieux montés, il voulut pousser à
fond sa reconnaissance. A l'entrée du village, il adressa la
parole à trois paysans, qui, l'ayant pris pour un de leurs
compatriotes, lui apprirent que l'armée espagnole venait
bivouaquer autour de Villa-Rubia, pour se diriger le lendemain
sur Aranjuez, où elle se proposait d'effectuer son passage. Il
fallait s'assurer de la vérité de ce récit : après s'être
transporté jusqu'au lieu où les troupes se mettaient en
bataille, Geoffroy r ayant terminé sa mission, revient sur ses
pas pour rejoindre son détachement, lorsqu'en traversant une des
rues du village, il aperçoit un grand nombre de cavaliers
ennemis presque tous officiers d'état-major. Le danger était
imminent : mais l'audace ne triomphe-t-elle pas de tous les
obstacles ? « Escadron, en avant, s'écrie » aussitôt le
courageux sous-lieutenant. » Surpris, épouvantés de voir des
Français si près d'eux, les Espagnols n'ont pas le temps de se
reconnaître ; quelques-uns d'entre eux sont sabrés, et le reste
s'enfuit au camp, où il répand l'alarme dans l'armée, qui
demeura sur pied toute la nuit. Après ce coup hardi, Geoffroy et
ses hussards revinrent auprès de l'adjudant-général Blancheville,
au moment où on les croyait prisonniers. Informés des
dispositions de l'ennemi, les Français se mirent aussitôt en
marche, et livrèrent le lendemain la bataille d'Ocagna, où ils
remportèrent une des plus éclatantes victoires.
La belle défense de Honda fournit encore à Geoffroy l'occasion
de se signaler par de glorieux exploits. Avec trente cinq
hommes, on le vit dans une sortie résister, pendant plus de
trois heures, à plus de trois cents insurgés; blessé pendant
l'action en cherchant à sauver des hussards qui avaient été
démontés, il n'en continua pas moins à combattre. Peu de temps
après, le 3 mai 1810, dans la brillante affaire où le colonel
Vinot, à la tête d'une poignée de braves, repoussa l'attaque de
six mille Espagnols, il déploya la plus grande valeur dans
plusieurs charges heureuses qu'il fit avec le capitaine
Poitiers, et les deux officiers Leclerc et Covaruvias. (Voy.
tom. Ier pag. 515.)
Le roi Joseph étant venu à Ronda avec quatre cents hommes de la
garde, ordonna une reconnaissance sur Agofin, à moitié chemin du
fort de Gibraltar. Le sous-lieutenant Geoffroy, choisi pour en
commander l'avant-garde, forte de trente chevaux, montra encore
dans cette circonstance qu*il était familier avec tous les
périls. Le 26 août 1810, à la Palma en l'Andalousie, dans une
charge de soixante-six hussards Contre quatre cents cavaliers
espagnols, il se précipite au milieu des rangs ennemis, où,
quoiqu'ayant reçu trois coups de sabre, il fut, suivant sa
coutume, le premier et le dernier à combattre. Après cette
affaire, qui coûta aux ennemis quarante hommes tués, cinquante
blessés et une grande quantité de chevaux, le colonel Vinot et
le prince d'Aremberg, qui tous deux avaient été témoins de sa
bravoure, l'embrassèrent et le comblèrent d'éloges (2).
Vingt jours s'étaient à peine écoulés, qu'il acquit une nouvelle
gloire à l'affaire de Fuente-del-Canto, en Estramadure, où il
enleva la première pièce de canon; vingt actions éclatantes le
signalèrent encore à l'armée comme l'un de ses plus vaillans
officiers : mais il ne montra nulle part plus de courage que le
5 février 1811, sur les bords de la Gebora. Forcés de se retirer
sur la rive gauche de cette rivière, près de Badajoz, les
Français furent suivis par l'ennemi qui, fort de près de trois
mille hommes de cavalerie et soutenu de onze pièces
d'artillerie, passa le pont pour venir les attaquer. Le général
Latour-Maubourg, dont les talens égalent la valeur et le
sang-froid, après avoir fait retrograder sa cavalerie pendant
quelque temps, lui ordonna tout-à-coup de se porter en avant. Le
2* de hussards était en tête; surpris de cette manoeuvre
audacieuse, l'ennemi chercha à repasser le pont; mais une charge
impétueuse mit bientôt le désordre dans ses rangs, et malgré la
mitraille que vomissait son artillerie, il fut enfoncé de toutes
parts. Un torrent furieux, qui mugissait à dix pas du pont,
suspendit un instant la course victorieuse de nos soldats; on ne
pouvait le traverser sans s'exposer à être entraîné par ses eaux
à la fois rapides et profondes : qui osera le premier tenter une
entreprise aussi périlleuse ? Chacun hésite; le sous-lieutenant
Geoffroy, qui, un mois auparavant, dans un combat près de
Badajoz, avait eu son cheval tué sous lui, s'élance seul dans le
torrent. Encouragés par son exemple et ses discours, quelques
hussards se précipitent après lui : « Camarades, leur dit-il,
les canons sont de l'autre côté, il faut les enlever. » Mais la
force du courant entraîne ces braves; parvenu sur l'autre bord,
Geoffroy se trouve seul sur le pont au milieu des ennemis ; en
vain, son sabre à la main, se multiplie-t-il pour faire face à
tout; il frappe autour de lui des coups mortels, il pare, il
riposte avec une adresse extraordinaire ; cependant, accablé par
le nombre, mis hors de combat par un coup de sabre, et désarmé,
il va succomber, quand le capitaine Dradzianski, avec quelques
hussards des plus déterminés, se hasarde à franchir le torrent
pour voler à son secours. Geoffroy, heureusement dégagé par cet
officier, revient à son régiment, où les éloges qu'il reçoit du
général Latour-Maubourg et la joie de ses camarades deviennent
pour lui une compensation du regret qu'il éprouve de n'avoir pas
été secondé à temps dans sa résolution d'enlever les canons de
l'ennemi.
Nommé lieutenant aide-de-camp du général Baron Gérard,
aujourd'hui lieutenant-général, et ancien colonel du 2e régiment
de hussards, Geoffroy fit avec lui la campagne de Russie,
pendant laquelle il se distingua, surtout aux batailles de la
Mozaisk et de Mariolaschlwez. Le lendemain de cette dernière, en
allant donner l'ordre aux tirailleurs de se porter en avant, il
faillit être la victime de son intrépidité. Ayant aperçu
plusieurs chasseurs des 6e et 25e régimens, qui, démontés,
étaient sur le point d'être faits prisonniers par les cosaques,
sans considérer le nombre des ennemis, il se jette au milieu
d'eux, afin de sauver ces militaires. Mais entouré de toutes
parts, il lui fut impossible de parer tous les coups qu'on lui
portait : il fut percé du fer d'une lance, et ne dut son salut
qu'à un officier, qui, par une charge des plus hardies, réussit
à l'arracher des mains des barbares. Placé dans une voiture,
souffrant cruellement de sa blessure, que l'on jugeait mortelle,
ne pouvant obtenir aucun secours, il fit ainsi la retraite de
Moscou. Il n'était pas encore guéri, qu'il combattit à Dresde,
où il fut fait prisonnier le 2 novembre 1813. Rentré dans sa
patrie, après huit mois de captivité, cet officier, dont les
longs et glorieux services avaient été récompensés par le grade
de capitaine et le brevet d'officier de la Légion-d'honneur, a
été nommé, en 1817, capitaine au 5e escadron de remplacement des
hussards du Jura, n° 1er. Le capitaine Geoffroy est l'un des
guerriers qui combattirent dans les trois immortelles journées
d*Austerlitz, d'Iéna et de Friedland.
(1) La
bataille de Medeline est un des plus beaux faits d'armes de la
vie militaire du général Lasalle. Il commandait alors toute la
cavalerie, et avait en outre sous ses ordres une division
d'infanterie allemande qui était formée en carré sur la seconde
ligne. Les Espagnols, bien supérieurs en nombre, formaient un
demi-cercle qui enveloppait, pour ainsi dire, l'armée française,
à qui il ne restait, pour toute retraite, que le long pont de
Medeline sur la Guadiana. Nos troupes étaient écrasées par
l'artillerie ennemie. Le général, ayant reçu du maréchal Victor
l'ordre de battre en retraite, avait commencé sa marche
rétrograde, lorsque l'infanterie espagnole encouragée par ce
mouvement, et soutenue par une nombreuse cavalerie, s'avança au
pas de charge. Le général en chef de l'armée ennemie, se croyant
assuré de la victoire, parcourait sa ligne assez près de celle
de nos troupes, pour qu'on l'entendît crier à ses soldats de ne
faire aucun prisonnier. Indigné de ce qu'il venait d'en- tendre,
le général Lasalle, qui déjà avait eu quelques officiers et
plusieurs ordonnances tués à ses côtés, toujours à cinquante pas
en avant de la première ligne, voyant tout le danger qu'il y
aurait à battre en retraite par un défilé aussi étroit que le
pont de Médeline, ordonna au 26e régiment de dragons (et non au
4e de cuirassiers, comme nous l'avons indiqué par erreur dans
notre premier volume, pag. 404), de charger un carré de six
mille hommes qui débordait le flanc droit de notre armée.
L'armée s'ébranla aussitôt que la ligne, et marcha à l'ennemi
qui fut enfoncé et culbuté sur tous les points. Jamais déroute
ne fut plus complète : quatorze mille huit cents Espagnols morts
sur le champ de bataille, cinq mille prisonniers dont quatre
mille périrent des suites de leurs blessures, furent dans cette
journée le fruit de l'intrépidité et du génie de Lasalle. (Voy.
tom. 1er pag. 499, la notice sur ce général). Dans le
grand nombre d'officiers qui se signalèrent dans cette occasion,
on remarqua surtout les braves capitaines Dradziansky, et Braun
du 2e de hussards ; le 3e escadron de ce corps, commandé par le
premier de ces officiers, fit des prodiges de valeur. Les
généraux Villate, Borde-Soult, Latour-Maubourg, Ruffin et le
colonel Meunier se couvrirent de gloire.
(2) Cette charge qui est, sans contredit, le plus beau fait
d'armes dont puisse s'honorer le 2e de hussards pendant la
guerre d'Espagne, était commandée par le capitaine Leclerc, cité
transitoirement dans le 1er vol. des Fastes, pag. 315, 317 et
318.
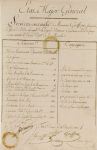 |
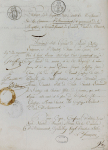 |
|













