|
Le Grand Couronné de Nancy
Henry Frichet
Ed. Rouff - 1917
20 AOUT 1914
|
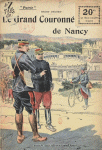 |
Huit heures et demie du soir venaient de sonner !
Réméréville, où des troupes d'arrière-garde étaient de passage, se noyait d'ombre. Les fenêtres des maisons étaient closes et toutes lumières éteintes, car des zeppelins avaient été signalés dans la direction de Lunéville. Le camp ayant été consigné, aucun soldat ne vaguait à travers les rues devenues silencieuses après avoir été remplies, tout le jour, d'agitation et de rumeurs.
Au mess, les officiers s'attardaient à commenter fiévreusement les événements, à colporter des bruits singuliers et contradictoires. La guerre ! Personne n'osait y croire deux mois auparavant, et voilà qu'elle serrait l'Europe emprisonnée dans ses formidables mâchoires.
Le colonel du ... régiment d'infanterie avait réuni le matin même les officiers à l'issue du rapport : sa parole avait été coupante comme un sabre :
- La France vit actuellement les heures les plus solennelles de son histoire. Comme elle ne peut pas mourir, elle vaincra, mais ce sera dur. Messieurs, la patrie compte sur vous.
Le lieutenant nancéen, François Beaudoin, était un patriote très ardent. Son père, né à Thionville, avait fait la campagne de 1870, et son grand-père, colonel de
houzards, avait chargé à Waterloo, à la tête de son régiment, contre les colonnes de Blücher. L'empereur l'avait décoré de sa main.
Lui, le petit-fils, entré à Saint-Cyr dans un très bon rang, n'avait fait que suivre d'instinct la tradition familiale, ne comprenant, d'ailleurs, point que l'on pût être autre chose que soldat. « Servir » était la devise des Beaudoin qui, de père en fils, depuis au moins deux siècles, s'étaient distingués sur tous les champs de bataille.
Les émotions que le jeune homme éprouve sont à la fois violentes et confuses : La France parle, sans doute ; mais ce n'est pas tout à fait exact, c'est la Guerre qui parle. Le grand Géant semble s'être assis au milieu des nations, déchirant des hommes, grondant et hurlant.
Soudain, une pensée lumineuse et jolie comme un rayon de soleil perce le voile sévère de ses réflexions : Geneviève, la jeune fille qu'il aime de tout son coeur, habite Réméréville, et il doit la retrouver le soir même.
- Huit heures cinquante-cinq. Elle sera là dans quelques minutes, fit-il en regardant sa montre. Chère et si douce amie ! je vais la voir pour la dernière fois, peut-être !
Et son coeur se serra.
Il se glissa dans l'ombre du clocher de la vieille église et attendit. Pourvu qu'elle puisse venir !
- Elle ne viendra pas, se dit-il, désespéré, lorsque le dernier coup de neuf heures eut achevé de se faire entendre au beffroi ; d'habitude, elle est toujours la première au rendez-vous.
Soudain, la silhouette gracieuse et tant désirée apparut à l'angle d'une petite rue. Le coeur du jeune officier bondit au-devant d'elle.
- Vous ! C'est vous, Geneviève ? Je vous attendais avec une impatience !
- Moi aussi, mon ami, il me tardait de vous rejoindre !
Et ils s'étreignirent la main avec passion.
- Je voudrais tant que nous puissions nous marier tout de suite ; mais je vous ai dit les raisons qui me font ajourner jusqu'après la guerre la réalisation de notre beau rêve. La guerre sera de courte durée, espérons-le.
- Espérons-le. murmura-t-elle en écho.
Puis elle demanda, d'un souffle :
- Vous partez bientôt ?
Il ne répondit rien ; en tournant la tête, il s'aperçut qu'elle pleurait ; de grosses larmes silencieuses roulaient de ses yeux, tombaient jusque sur sa robe.
Ils se promenèrent longtemps, n'échangeant que de rares paroles; puis, quand ils furent devant la porte de la maison de la jeune fille, il répéta :
- Je vous aime, Geneviève.
Elle répondit :
- Je vous aime, François, ayons confiance.
Quelques heures plus tard, le clairon sonnait la générale. Les dernières avant-gardes françaises, dont faisait partie
Beaudoin, allaient renforcer une brigade mixte du 20e corps sur la position de
Flainval.
On apprend que les forces allemandes, arrivant de toutes les directions, concentrent leurs efforts pour donner le coup de bélier terrifiant et en finir une bonne fois, disent les chefs avec ces Français qui ont la prétention de vouloir résister.
Le lendemain 22 août, des hurlements sauvages et une galopade effrénée retentissent dans la principale rue de Réméréville.
Courbés sur leurs chevaux lancés au galop, le revolver au poing, passent comme un ouragan six cavaliers vêtus de gris : ce sont des chevau-légers bavarois.
Epouvantés, les habitants s'enferment dans leurs maisons.
Dix minutes après, de nouveaux hurlements et le vacarme effrayant d'une galopade. C'est une avalanche de deux cents cavaliers qui descendent la grande rue. Ils s'arrêtent au bas du village, dans la cour du château.
Un bruit sourd, cadencé, de troupe en marche. Une colonne d'infanterie passe. Les hommes vont d'un pas allongé. Ils sifflent une mélopée monotone et triste qui scande leur marche. Une autre troupe arrive au pas gymnastique et disparaît au tournant de la route de Nancy. Le village est bientôt rempli de soldats. Des automobiles arrivent sans cesse, des officiers en descendent. Des cyclistes, des cavaliers partent de tous côtés. A la même heure, des colonnes allemandes débouchaient à
Mazerulles, Erbéviller, Courbefraux,
Drouville, Maixe.
Les soldats allemands se conduisent comme des brutes dans le village, où ils se répandent. Pleins de méfiance, ils parcourent les maisons, les écuries, les greniers : ils inspectent tous les coins, ouvrent les armoires, enfoncent les baïonnettes dans les matelas et, toujours, frappent les murs avec la crosse de leur fusil.
|
A Réméréville, près de la fontaine, au milieu du village, une troupe stationne. L'officier crie devant les maisons fermées :
- Monsieur ! Monsieur !
Personne ne répond.
Enfin il se décide à pénétrer dans la demeure la plus proche et en fait sortir une jeune fille, Marie-Thérèse Guérin.
- Pourquoi ne répondez-vous pas ? demande l'officier.
- J'étais dans le jardin, derrière la maison.
- Prenez ce verre et buvez. Nous verrons bien si cette eau
est empoisonnée.
La jeune fille prend l'eau à la fontaine et boit.
L'officier se tourne vers ses soldats et dit : |
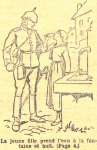 |
- Es ist gut.
Puis il interroge :
- Y a-t-il des soldats français ici ? Quand sont-ils passés ? Avaient-ils l'air découragé ? Peuvent-ils se battre encore ? Ils ont pris la fuite à notre arrivée, n'est-ce pas ? Mais où se sont-ils repliés ?
- C'est la nuit que nos soldats ont traversé le village, répond la jeune fille ; je n'ai donc pu juger de leur état. Quant à dire où ils sont allés se retrancher, cela me serait bien difficile, n'étant pas sortie de chez moi.
- Ya, ya, reprend l'officier moqueur. Demoiselles françaises malignes ! malignes !
Des boches sont montés dans le clocher de l'église. On les voit en observation à une lucarne où ils ont installé une mitrailleuse. Les aiguilles de l'horloge marquent l'heure allemande.
Le canon tonne du côté de Lunéville. |
II
LES FORCES EN PRÉSENCE - EN ROUTE
Des renseignements précis sont arrivés au général de Castelnau sur les forces de l'ennemi et ses intentions.
Le prince royal de Bavière, qui conduit son armée par tous les chemins, venant de Delme, de Morhange, a pour objectif le Grand-Couronné et Lunéville.
Pendant qu'elle progresse rapidement, l'armée du général von Herringen débouche du Donon et des cols des Vosges et se dirige à marches forcées sur la ligne de la Mortagne et la forêt de Charmes. Son intention est de prendre à revers les forces françaises qui ont pour mission de défendre la trouée de Charmes.
L'armée du général Dubail est en retraite sur la Meurthe.
L'armée du général de Castelnau s'est aussi repliée, mais en faisant demi-cercle à droite, de façon à occuper les hauteurs du Grand-Couronné qui défendent Nancy.
Les deux armées, par ce double mouvement, se sont séparées l'une de l'autre ; entre elles, une fissure s'est produite : cette fissure se trouve dans la région de Lunéville, en face de la trouée de Charmes. L'ennemi doit éprouver la tentation de se précipiter par cette porte et de gagner vivement la fameuse trouée. C'est précisément ce que désire le haut commandement français qui manoeuvrera de façon à attirer l'ennemi vers cette trouée de Charmes et à le prendre, pour ainsi dire, dans la souricière.
L'armée Dubail doit résister sur les lignes successives de rivières qui prennent la plaine en écharpe : la Vezouze, la Meurthe, la Mortagne, tandis que le général de Castelnau s'organisera et s'appuiera sur le Grand-Couronné de Nancy.
La position du Grand-Couronné devient ainsi la base de notre contre-offensive dans l'Est.
N'omettons pas de dire que Nancy est défendu naturellement à l'Est par le Grand-Couronné et à l'Ouest par la forêt de Haye.
Déjà, l'attaque ennemie a commencé depuis 8 h. 30, des hauteurs de Crion et de Sionviller.
Le 15e corps, ne se sentant pas de force à engager le combat avec derrière lui la rivière de la Meurthe, est autorisé à se replier sur la rive gauche.
Cependant, il faut résister le plus longtemps possible.
Le général de Castelnau donne l'ordre au général Foch, qui est à la tête du 20e corps, de soutenir le 15e corps. Le général Foch charge de cette mission la 11e division (la division de fer), commandée par le général Ferry.
Alors la 22e brigade (de la 11e division), sauf quelques détachements isolés qui ne tarderont pas à rejoindre, venant de Morhange où elle s'est battue deux jours, se met en route pour Dombasle, où elle arrive dans la nuit du 21 au 22 août. Dombasle, à 7 kilomètres environ au nord-ouest de Lunéville, est situé à l'embranchement de la Meurthe (rive droite) et du canal de la Marne. En moins d'une journée, cette brigade fait plus de 50 kilomètres. Sur la route, on voit défiler pendant des heures au milieu d'un nuage de poussière de la cavalerie, de l'infanterie, des convois de vivres, des canons, des voitures d'ambulance, des voitures de paysans réquisitionnées, et tout cella passe, passe comme un fleuve.
Cette 22e brigade, il était écrit qu'on ne la laisserait pas reposer une heure. Les hommes avaient à peine débouclé sacs et ceinturons et allumé le feu pour préparer le café qu'elle reçoit l'ordre de franchir la Meurthe et d'occuper les hauteurs de Flainval (à 5 kilomètres au sud de Dombasle). Il faut à tout prix empêcher l'ennemi de tourner le Grand-Couronné vers le Sud. Elle doit aussi maintenir ses liaisons avec le 16e corps.
Les chasseurs à pied et les soldats d'infanterie de cette 22e brigade n'ont à peu près rien mangé depuis vingt-quatre heures, et ils gravissent dans un silence provoqué par la fatigue les pentes qui conduisent à Flainval.
On n'entend que le bruit sec de la terre foulée, le cliquetis du quart sur le fourreau de l'épée-baïonnette. Les pipes se sont éteintes aux bouches brûlées par la soif. Le képi pèse comme du plomb sur les crânes bouillants ; on respire avec peine, la poitrine tendue par le poids du sac ; les courroies coupent les épaules, et la main droite est fatiguée de tenir la bretelle du fusil, dont la crosse frappe à chaque coup sur la cuisse. Dans la chaussure, les pieds cuisent et s'alourdissent : on marche...
Le paysage se déroule, pareil à une magnifique
tapisserie d'un coloris tendre et bleuté. Des forêts
montent et descendent aux pentes des coteaux,
formant un rideau mouvant et perfide. Au fond du
vallon, c'est un tapis vert à peine coupé par le
damier de quelques champs : on marche. Les vêtements
sont gris de poussière, la sueur ruisselle sur les
visages terreux. Les drapeaux roulés dans leur gaine
sont portés en tête du régiment. Aux flancs des
colonnes, des chiens tirent la langue. On marche...
Soudain, tous ces soldats éreintés lèvent la tête. Ils ont entendu comme un ronflement de tuyau d'orgue, et là-haut, au-dessus des nuées, se profile la silhouette d'un taube qui vient sans doute de Metz ou de Thionville. On l'aurait cru immobile sur ses larges ailes, si sa vitesse ne se fût révélée sur les dessins des nuages qui ont l'air de courir en sens inverse de l'oiseau. Ces nuages blancs, découpés dans l'azur, ont en effet l'air de glisser sous le ventre du taube.
Soudain, du côté de Nancy, un autre aéroplane, plus petit, plus léger, qui a l'air de voler plus vite, arrive avec un bruit de moteur qui va toujours grandissant. C'est un Français.
Les deux ennemis se sont vus. Attention !
L'aéroplane français plane un instant, puis s'élance, tel un faucon, sur son adversaire. L'Allemand gagne en hauteur. Il s'élève, s'élève, devient plus petit et plus pâle. Le Français aussi monte. Il monte et avance avec une rapidité vertigineuse. Inévitablement ils vont se rejoindre L'Allemand continue à fuir en altitude. puis, plus rien. Il a disparu.
- Tiens, le voilà encore ! s'écrie un soldat.
- Oui, le voilà ! le voilà ! répètent d'autres soldats en montrant du doigt l'oiseau boche qui a l'air de sortir du flanc d'un nuage.
Le Français s'est lancé immédiatement vers lui, dans le champ illimité de l'éther. Mais l'ennemi a disparu. La chasse se poursuit peut-être dans l'invisible.
Tout à coup, comme une perdrix frappée à mort par le plomb du chasseur, on voit le taube qui pique droit contre le sol, le nez en avant.
Le temps se couvre. O bonheur ! Il va peut-être pleuvoir.
III
LE COMBAT
Buifs ! Boum ! Vavraboum !
Les obus ont porté à quinze mètres trop bas. Mais les boches vont peut-être rectifier leur tir. Une sueur glacée court tout le long de l'échiné ; la chair se contracte. Ce premier jet d'obus accélère la respiration : on suffoque.
Les commandements se succèdent.
- En tirailleurs ! A mille mètres, feu à volonté !
Les coups de sifflet trillent. Cinq fois, dix fois, la rafale asperge la ligne. Enfin, sans trop savoir comment ni pourquoi, les hommes sont parvenus à dominer leur émotion. Le trouble a fait place à de la colère.
- Zut ! s'écrie un soldat ; un éclat d'obus a enlevé ma gamelle de dessus mon sac, et j'avais ma provision de tabac dedans !
Un duel d'artillerie commence. Nos 75 ne s'arrêtent pas de tonner. Le paysage tremble, frémit, hurle, se convulsé. La terre pulvérisée grêle en l'air. Parfois un obus de gros calibre traverse l'air, sifflant comme une bête rageuse, et ce sifflement des projectiles produit un énervement particulier : les sourcils se rapprochent, les épaules remontent, autrement dit on fait le « gros dos » ; enfin les yeux clignent et l'on baisse un peu la tête, comme si l'on s'attendait à recevoir un formidable coup.
Un caporal crie aux hommes de son escouade :
- Ceux qui ont besoin de faire leur testament n'ont qu'à demander une permission de quinze jours pour aller voir leur notaire.
A ce moment, le colonel ouvre un pli qu'un sous-officier vient de lui remettre. Le sous-officier attend, immobile, à la distance réglementaire.
Mais, subitement, le colonel chancelle. II a la cuisse broyée par un éclat d'obus.
Des officiers s'empressent autour du chef vaillant, qui est un père pour ses hommes.
Les lèvres pâles du colonel s'entr'ouvrent.
- Messieurs, je vous en prie, éloignez-vous, ne me soutenez pas. Non, pas devant mon régiment.
Chacun comprend. Autour du blessé, le cercle respectueux s'élargit.
Et le colonel, faisant un effort surhumain pour se ternir droit sur sa jambe valide, achève de lire l'ordre qui vient de lui être transmis.
Un nouvel obus gronde, éclate à trente pas et un paquet de mitraille décapite net le colonel.
Dzim ! Aïe ! Le lieutenant Beaudoin secoue sa main gauche. Une balle vient de lui érafler le pouce. Rien de grave. Arrêt de cinq minutes dans un trou pour mettre un pansement.
- Heureusement, se dit-il, j'ai la main droite valide pour écrire à Geneviève et pour porter haut et ferme le drapeau du régiment.
Il s'élança sur un petit mamelon au pied duquel gît pour toujours le corps du colonel, et fait flotter dans l'air les plis de l'étendard. Quelques balles sifflent, rageuses, des obus éclatent, enfin le bombardement allemand, qui avait beaucoup diminué d'intensité, cesse presque complètement.
IV
AU SUD DE LA MEURTHE
L'ordre que lisait le colonel au moment où il fut tué par un obus, était celui-ci : « L'ennemi a perdu le contact; repassez la Meurthe et faites sauter les ponts derrière vous. »
En réalité, ce jour-là, nous avions réussi à maintenir en face de nous des forces trois fois supérieures aux nôtres. Pour ce fait d'armes, quelques semaines plus tard (le 16 octobre), le général de Castelnau citait à l'ordre du jour le général Ferry.
Le 20e corps a pris ses positions au sud de la Meurthe. Le général de Castelnau veut défendre, coûte que coûte, la trouée de Charmes. Son plan est de relier le Rembétant aux plateaux de Saffais et de Belchamps. De toutes ces hauteurs, qui commandent à la fois les vallées de la Meurthe et de la Mortagne et les plaines de la Moselle au sud, on peut empêcher l'ennemi de progresser.
Les mesures prises par le général de Castelnau étaient excellentes, puisqu'elles empêchaient l'ennemi de pénétrer par la classique trouée de Charmes, malheureusement, Lunéville n'était plus solidement défendu. En effet, le 15e corps n'avait pu attendre le choc au nord de cette ville. Le 16e corps, attaqué, dès le matin, sur Crion-Siouville, fut forcé à la retraite après avoir fait une défense héroïque. L'avant-garde du 21e corps allemand avait poussé une si violente offensive que notre 31e division commença à plier. Une contre-attaque sur Croisemau dégagea momentanément cette division. Mais elle finit par céder.
Lunéville était découvert.
V
LES ALLEMANDS A LUNÉVILLE
L'artillerie allemande se porta aussitôt sur les hauteurs qui dominent Chantelieux et ouvrit un feu violent.
Lunéville est pris.
Hâtons-nous de dire que les Bavarois qui occupèrent la ville en furent bientôt chassés (ils en auraient même été chassés plus vite si nous avions eu le triste courage de bombarder lâchement la charmante petite cité lorraine).
Après avoir assuré la garde militaire de la ville, placé des avant-postes dans les faubourgs, les Allemands établirent une batterie dans ce joli jardin Louis XV, si galamment baptisé « Le Bosquet ».
Ils placèrent d'autres pièces sur des points plus élevés, arborèrent leur drapeau aux fenêtres de la mairie; puis, suivant leur coutume théâtrale, décidèrent que le lendemain, dimanche 23, vers midi, ils opéreraient, à travers les rues de Lunéville, une entrée en musique avec tambours et fifres.
Le lendemain, à midi, le roulement sec des petits « trommels » plats et le sifflement aigu des fifres retentissaient à l'entrée de la Grande-Rue, au bas de la cité d'Einville. Toute une division bavaroise, bien astiquée, commença à défiler à ce grotesque pas de parade qui indique si bien le degré d'autoritarisme humiliant de la discipline prussienne.
Les rues étaient désertes.
Le maire s'avança au-devant de l'état-major et se déclara responsable des actes des habitants. Un général lui répondit :
- Les habitants n'ont rien à craindre, tant qu'ils ne commettront aucune hostilité contre nous. Mais s'ils attaquent un seul de mes soldats, le premier que je ferai fusiller, ce sera vous.
- Vos paroles ne m'intimident pas, répliqua le représentant de la ville.
Derrière les persiennes, plus d'une Lunévillaise pleurait, plus d'un homme serrait les poings, mais nul n'esquissait un geste de révolte, hélas! trop inutile.
VI
UN ARDENT PATRIOTE, M. KAHN, EST FUSILLE.
Un homme, M. Kahn, ne put supporter la douleur d'un pareil spectacle. Il ouvrit sa porte toute grande et, tenant à la main un drapeau tricolore déployé, ivre d'une sainte colère, s'élança vers le premier rang des tambours en criant :
- Vive la France et mort aux boches !
Le sort de M. Kahn fut vite réglé. Sur le geste d'un lieutenant, huit hommes se détachèrent, poussèrent le manifestant qui ne cessait de crier : « Vive la France ! » devant un mur et le couchèrent en joue.
M. Kahn jeta sur ces brutes un regard de mépris et, dans un dernier « Mort aux boches! » s'abattit sur le pavé de la rue.
Devant le cadavre, d'où le sang coulait en rigoles, toute la division bavaroise défila.
Le maire, le sous-préfet et le député de Lunéville, demeurés à leur poste, furent pris les premiers comme otages et menacés cent fois de mort. Ils eurent la chance de ne pas être exécutés.
Le brave sous-préfet, M. Minier, fut réduit à se nourrir, pendant quinze jours, de miel et de sardines, seul « fond d'armoire » que l'ennemi lui ait permis d'utiliser.
L'occupation de Lunéville était un succès dont on fit grand étal en Allemagne. Cependant la résistance de nos troupes dans la journée du 22, notamment au combat de Flainval, aurait dû avertir les chefs allemands qu'ils n'avaient pas affaire à des armées épuisées.
Deux jours après l'occupation de Lunéville, les atrocités commençaient.
Les Allemands pourchassaient les habitants qui se sauvaient sur les toits ; on les tuait comme du gibier et, quand les soldats allemands ne pouvaient les découvrir, ils mettaient le feu à la maison en disant :
- Ils sortiront ou ils crèveront !
Une vieille femme malade fut fusillée dans son lit.
Ils imposèrent à la ville deux contributions de guerre : la première de 10.000 francs, la seconde de 650.000 francs, payables en or. Les habitants de Lunéville versèrent à la caisse municipale leurs réserves d'or, et la somme exigée put être réunie.
Nulle part on ne constata un mouvement de révolte, comme les Allemands ont voulu le prétendre pour justifier leurs assassinats, précédant comme partout le pillage et les incendies destinés à faire disparaître la trace de leurs forfaits.
VII
L'AVALANCHE ALLEMANDE
Dans la matinée du 23, l'ennemi a envahi la vallée de la Vezouze et s'est mis en marche vers la vallée de la Meurthe.
Venant d'Avricourt, de Blamont, de Cirey, du Donon, du col des Vosges, l'armée von Heeringen et la gauche de l'armée du kronprinz de Bavière forment un vaste arc de cercle dont le point culminant est aux pentes du Donon et dont la corde se trouve être la Meurthe. Von Heeringen descend ce plan incliné pour aider l'armée bavaroise dans sa marche vers Rozelieures et la trouée de Charmes.
Devant cette avalanche, nous reculons, mais avec un but précis d'offensive ultérieure.
Le général Dubail (1re armée) opère vers le sud-ouest une conversion de sa gauche et de son centre, afin d'établir sa liaison en équerre avec la droite du général de Castelnau qui, le 23 au soir, aura son point extrême au nord de la forêt de Charmes, vers
Villacourt. Le 8e corps quitte, en conséquence, ses cantonnements à l'est de la forêt de
Moudon, pour s'articuler avec la droite de la 2e armée (général de Castelnau), laissant ainsi à l'ennemi la faculté d'entrer de lui-même dans le piège qui lui est largement ouvert. |
Le 2e corps d'armée passa la Meurthe par un temps abominable. En sortant
d'Hablainville, un convoi du 95e régiment (16e division) fut pris dans une terrible tempête. En pleine forêt, les chevaux avançaient difficilement, et d'énormes grelons cinglaient le visage. En débouchant du bois, le soleil réapparut. Mais un spectacle navrant s'offrait aux regards des soldats. Sur tous les chemins qui, du nord, débouchaient sur la Meurthe, passaient des files interminables de fugitifs.
- Où allez-vous ? leur demandait-on.
- A la grâce de Dieu.
Ils fuyaient l'invasion, traînant un chariot sur lequel ils avaient jeté à la hâte leurs enfants, leurs bardes et leurs matelas. |
 |
Après avoir passé la Meurthe, on fit sauter les ponts.
Le 8e corps (le 23 août au soir) s'est porté en entier sur la ligne
Damar-aux-Bois, Hallainville et Fauconcourt. A sa gauche, il a laissé le 2e bataillon alpin pour contenir l'ennemi et l'empêcher notamment de franchir la Mortagne avant la fin de la retraite du corps d'armée et sa liaison avec la 2e armée. Il s'agit, avant tout, d'assurer la sécurité des mouvements qui permettront d'établir solidement le barrage de la trouée de Charmes. Ainsi, les troupes françaises, descendant de Sarrebourg, se repliaient en combattant vers Gerbéviller. La bataille, dans cette région, fui terrible. Près de
Crevic, tout fut brûlé, y compris la maison du général Lyautey. Puis les troupes françaises continuèrent à se replier vers
Rozelieures. |
VIII
A GERBEVILLER
Une poignée d'hommes permit la retraite du 8e corps en retenant une journée entière une brigade bavaroise ayant à sa tête le général Clauss.
Un détachement de 54 chasseurs alpins, commandé par l'adjudant Chèvre, un enfant du pays, reçoit l'ordre de tenir le plus longtemps possible, c'est-à-dire jusqu'à -la mort, les ponts de la Mortagne qui relient les deux parties du bourg de Gerbéviller.
Il est neuf heures du matin (24 août).
L'adjudant, qui a pris sa lorgnette, inspecte l'horizon et dit à ses hommes :
- Les canons en batterie là-haut, à Fraimbois, ne vont pas tarder à nous canarder.
Il avait à peine achevé sa phrase que les pièces concentrent leur tir sur le petit ravin où les chasseurs se sont abrités, et une volée de balles claque sur les pierres en coups de fouet furieux.
- Dispersons-nous, commande l'adjudant, et harcelons l'ennemi. Nous avons deux gros sacs de cartouches que je cache ici. Vous enverrez un homme aux provisions à tour de rôle.
Ces 54 alpins firent des prodiges : cachés tantôt à un endroit, tantôt à un autre, d'où ils exécutaient des feux de salve meurtriers contre un ennemi qui n'arrivait pas à les surprendre, ils multiplièrent tellement leurs efforts héroïques que les Bavarois subirent, en fin de compte, des pertes nombreuses et d'autant plus cruelles que nos terribles diables bleus n'étaient jamais où l'on croyait les surprendre : ils avaient l'air d'être partout et -ils n'étaient nulle part, puisqu'on ne pouvait pas les atteindre.
Quand les chasseurs virent que les munitions commençaient à s'épuiser, ils se replièrent tous derrière la barricade qu'ils avaient établi près du pont qui est à l'entrée du bourg. Là, ils arrêtèrent la marche des Allemands jusqu'à la nuit tombante. Derrière des tas de pierres, accroupis ou couchés à plat ventre, ils brûlèrent leurs dernières cartouches ; puis ils se glissèrent, sans être vus, derrière les murs des jardins bordant la rivière et purent ainsi gagner la route de Rozelieures.
Ils avaient rempli leur mission. Toute une brigade allemande avait été tenue en respect par une cinquantaine de chasseurs, à près de 15 kilomètres en avant des cantonnements. La conduite admirable de cette petite troupe, que l'on eût crue sacrifiée, permit aux chefs de donner quelque repos au 8e corps, qui en avait tant besoin.
Quand les Bavarois, fous de rage, purent entrer dans Gerbéviller, ils mirent le feu aux maisons, se ruant sur les habitant qui tentaient de se sauver. Ils tiraient au hasard, par les fenêtres et par les soupiraux des caves. Les rues fuirent vite jonchées de bouteilles et de barriques dont ils avaient vidé le contenu en poussant des hurlements d'ivrognes.
Un officier à cheval, suivi de quatre soldats, fonce sur une religieuse et lui dit :
- Vous avez dans votre maison des soldats cachés avec des armes.
- Non, monsieur, répondit la soeur, nous avons seulement des soldats français, mais ils sont gravement blessés ; entrez et vous les verrez.
Il descend alors de son cheval et, toujours suivi des soldats revolver au poing, lui-même tenant une petite baïonnette - sorte de poignard - pénètre dans l'hospice.
Arrivé au lit, il jette brutalement les couvertures par terre et découvre un pauvre blessé qui agonise. Ses jambes sont enveloppées d'ouate et le lit est plein de sang. Il lui dit avec des injures affreuses, en français :
- Les vôtres ont crevé les yeux de nos blessés.
Le pauvre petit moribond tourne vers lui un regard presque éteint et ne répond pas.
Alors, plein de haine, il lui met son poignard tout près de la gorge.
La religieuse se jette devant ce misérable en criant :
- Ici, c'est la maison du bon Dieu ; on ne fait de mal à personne.
Il se calme un peu et il continue à inspecter partout, dans le dortoir, dans le réfectoire, jusque dans l'éplucherie.
A chaque lit. il arrache brusquement les couvertures, toujours escorté de ses soldats armés. Enfin, il dit :
- Madame, nous ne sommes pas des barbares, mais des civils ont tiré sur nous tout à l'heure.
- Non, monsieur, ce ne sont pas des civils, ce sont des soldats qui défendaient le pont. Si vous mettez chez -nous vos blessés, ils seront sacrés; nous les soignerons comme les nôtres, mais promettez-moi d'arrêter les incendies.
Alors, il répondit un « oui » de complaisance et il partit.
Bientôt la ville entière brûlait. Il était onze heures du soir; les débris enflammés tombaient partout dans les rues et l'odeur affreuse qui se répandait provenait de la chair grillée des animaux surpris dans les étables.
Les Allemands avaient pris quarante et un otages. On leur fit planter les pieux où ils devaient être attachés et exécutés. On les laissa plusieurs jours dans une terrible incertitude pendant que les soldats les insultaient et leur disaient : « Français, capout ! »
IX
JOURNÉE DU 25
L'ordre est donné : la 1re armée doit faire front et lutter sur place; la 2e armée, placée perpendiculairement à la 1re, doit tomber sur le flanc de l'ennemi s'il s'engage dans la région des rivières au sud-ouest de Lunéville.
D'une part, les Allemands cherchent à glisser vers leur objectif, qui est la trouée de Charmes; d'autre part, les armées françaises prennent toutes mesures urgentes pour barrer la route à l'ennemi, le contre-attaquer et le mettre en échec.
Plusieurs grands combats sont imminents.
François Beaudoin est reparti avec ses hommes pour Dombasle. Il fume une petite pipe en bruyère - un cadeau de Geneviève. Le temps est clair. Une brise à peine sensible frissonne dans les arbres verts au bord de petits cours d'eau qui murmurent en bousculant de menus cailloux. Dans l'air doré, des oiseaux chantent. La vie apparaît avec des douceurs ignorées jusqu'alors et le jeune lieutenant a le coeur plein de rêves de tendresse, mais, par une pression violente de sa volonté, il chasse toutes pensées amollissantes; en face de lui se dresse le terrible géant ; la guerre.
Le canon tonne sans discontinuer. Un fourrier arrive vers lui en courant et lui apporte l'ordre de se placer avec sa section sur une petite crête abritée par un verger. Des Allemands doivent être dans le bois voisin et sa mission est de renseigner le colonel sur le nombre et la position exacte des ennemis. |
Baudoin n'hésite pas à utiliser les chiens de guerre.
Les cinq chiens du bataillon se placent en demi-cercle autour d'un caporal. Leur maître leur présente des bérets et des casquettes allemandes qu'ils flairent. On leur met à chacun un manteau de fougères et de branches d'arbres. La tête elle-même est couverte de verdure. Seuls, la gueule et
les yeux sont libres.
- Allez ! commande le caporal.
Nique part le premier, Lutin le second, puis Tambour, Tobie et Pilou.
On les voit d'abord gagner la vallée au galop et ils entrent dans le bois. |
 |
Une demi-heure après, Tobie et Lutin reviennent avec un calot de fantassin, Pilou rapporte le casque d'un colonel, Tambour une coiffure d'artilleur. Quant à Nique, il tient entre ses dents un képi français ensanglanté.
Beaudoin traduit ainsi le résultat de cette reconnaissance :
- Il y a un régiment entier d'infanterie ennemie dans le bois, car voici le casque de celui qui le commande. Enfin, un soldat français est blessé. Nique y conduira le service de santé.
En position derrière nous, nos 75 lancent un ouragan de fer. Un quart d'heure se passe et un taube avant survolé nos positions, les boches se mettent à tirer sur la batterie qu'ils croient avoir repérée. Les obus de tous calibres pleuvent; mais, plus ils tirent, plus nos 75 répondent. Nos fantassins se couchent d'abord, le nez dans la terre qui tremble, pour laisser passer cette grêle de mitraille, puis ils prennent une vigoureuse offensive. Le régiment auquel appartient Beaudoin forme autour du bois un cercle qui va toujours se resserrant; bientôt les boches qui n'ont pas été blessés, après une résistance opiniâtre, finissent par se rendre, car ils sont complètement encerclés.
Ce qui divertit fortement nos troupiers, c'est la vue d'un officier allemand, gros, gras, la figure apoplectique et qui, sans cesse, porte la main à son crâne dénudé : c'est le colonel dont un de nos bons chiens a ravi la coiffure.
En regagnant leurs positions, les soldats virent un cheval qui n'avait plus que la peau et les os. Cette pauvre bête rôdait, lamentable, autour du petit bois, mangeant des feuilles de chêne, car l'herbe était rare en cet endroit. Elle portait, suspendu à l'encolure, un écriteau sur lequel les boches avaient écrit : « Soldats français, rendez-vous ! l'armée française a été écrasée dans le Nord. Le général Joffre est mort. Paris s'est rendu. En France, on meurt de faim. »
Ce fut un grand éclat de rire parmi nos poilus.
Retournant l'écriteau, un loustic répondit : « Nous avons du poulet, du vin de Champagne, de la confiture, du tabac et... des pruneaux à vous envoyer. Nous vous invitons à un repas pantagruélique. Demain, après-demain et jours suivants, grands déjeuners à la fourchette. »
Maintenant la nuit tombe, le soleil couchant allonge les ombres des arbres; la vallée est toute baignée dans les rayons jaunes du crépuscule, mais le long des chemins et des sentiers, au bord des ruisseaux, gisent des cadavres qui semblent s'être couchés sur le dos ou sur le côté pour mieux dormir. Quelques-uns ont l'air de fixer une première étoile qui s'allume au firmament; à côté d'eux s'étale une petite mare de sang et Beaudoin pense à toutes les mères qui, ne recevant pas la lettre tant attendue, pleureront à jamais le fils qu'elles ont bercé dans leurs bras.
Mais l'heure n'est pas aux rêveries douloureuses. L'homme d'action en a l'âme à peine effleurée. Il faut lutter! Il faut vaincre ! Or, nos armées reformées sont capables de livrer bataille sur le terrain qu'elles occupent. En aucun cas, le mouvement de repli ne sera poussé plus loin. Des ordres sont donnés : une offensive violente sera lancée sur les hauteurs du Grand-Couronné et sur les positions occupées par les 15e et 16e corps.
Cette offensive a pour but, soit d'arrêter l'ennemi, au cas où il marcherait sur Nancy, soit à le prendre de flanc s'il porte son effort vers la trouée de Charmes.
D'une façon comme de l'autre, le rôle de nos troupes est nettement défini : il s'agit de retenir les forces allemandes, de les empêcher de passer la Moselle, soit en direction de Verdun, soit en direction de Toul, et de tenir ferme pour qu'elles ne puissent prendre à revers les armées françaises qui battent en retraite vers le sud et qui bientôt vont livrer la grande bataille entre Verdun et Paris. |
X
LE GÉNÉRAL DE CASTELNAU A SON PLAN
De même que von Kluck négligera Paris pour aller vers le sud, une reconnaissance d'avions nous signale que les forces allemandes ne se portent pas vers Nancy.
C'est ce qu'avait prévu le général de Castelnau. Tous les renseignements concordent : l'armée ennemie, laissant de côté le chef-lieu de la Meurthe-et-Moselle, se précipite en masse vers le sud-ouest : la route qu'elle suit indique nettement son objectif : c'est Rozelieures et la trouée de Charmes.
Ainsi l'armée allemande se jette tête baissée dans le piège.
Les colonnes ennemies viennent de partout, de Damelevières, de Mont, de Lunéville. Elles se réunissent autour de la route de Lunéville à Bayon, se croyant déjà maîtresses des passages, mais l'offensive que l'ennemi n'a pas prévue s'est développée sur son flanc et même sur -ses derrières.
Le prince de Bavière croyait évidemment qu'il suffisait de mous devancer sur nos lignes de communication.
Mais le général de Castelnau avait aussi son plan.
Dès l'aube du 24 août, l'attaque ennemie se dessine contre notre 3e corps, que l'artillerie allemande crible de ses rafales furieuses, tandis que l'infanterie cherche à franchir les hauteurs au sud-ouest de Remenoville et aux approches de
Rozelieures, afin de percer entre Chatel, Charmes et Bayon.
Le général de Castelnau conforme ses ordres à cette situation et commande aux 15e et 16e corps de se porter en avant; quant aux détachements qui se trouvent dans la région de
Borville, ils doivent presser leur marche au-devant de l'ennemi. Le 8e corps va attaquer maintenant vers le nord, tandis que le 16e corps, renforcé, attaquera vers l'est
(Einvaux, Franconville).
Cette manoeuvre admirable - qui fut parfaitement exécutée - fait le plus grand honneur au général de Castelnau.
Parmi les épisodes qui la marquèrent, la prise de
Lamath, petit village sur -la rive gauche de la
Mortagne, fut particulièrement dure. Le 6e bataillon de chasseurs s'y distingua.
Cependant, malgré des prodiges de courage, le régiment de gauche du 8e corps, qui supporte tout le poids de l'offensive ennemie, est repoussé de
Rozelieures. Le 8e corps va-t-il être forcé à la retraite? L'entrée de la trouée va-t-elle se trouver ainsi découverte? Non point. Le général de Castelnau a gardé des forces disponibles. D'un magnifique élan, le 2e bataillon de chasseurs, appuyé sur les lisières par des escadrons à pied du corps de cavalerie et des fantassins, reprend à la baïonnette le bois de
Lalau, qui commande Rozelieures, et s'y maintient jusqu'au soir, malgré des pertes sévères, tandis qu'à l'ouest le 16e corps attaque de flanc.
Cette action vigoureuse bouche le vide qui tend là se produire entre le piton de Borville et les hauteurs de
Rozelieures.
Pour s'emparer de ce bois de Lalau, situé sur une hauteur, il fallut un mordant terrible.
Les mitrailleuses, cachées derrière les arbres, font entendre leur tac-tac-tac émotionnant. On dirait le bruit monotone du grand moulin de la mort. Beaucoup d'hommes couchés ont le crâne brisé ou les mains coupées. Il faut faire vite ! Allez-y, les gars, et vive la France ! Canons, mitrailleuses, grenades, fusils sont au travail. L'atmosphère de la colonne bourdonne et bruit comme celle d'une usine métallurgique. Nos hommes ont mis baïonnette au canon. Beaudoin dit au clairon : |
- Sonne la polka, sonne le tango, sonne la
valse, sonne la mazurka, sonne le tremblement,
sonne tout ce que tu voudras, mais ne sonne pas
la retraite...
Le tintamarre crépitant des balles continue. Pourquoi ce petit chasseur a-t-il, soudain, une épaulette de sang sur sa veste bleue? Les soldats bondissent et rivalisent d'ardeur. Les commandements
s'entre-croisent. Beaudoin apprend que son capitaine, papa Lagadec (ainsi que l'appellent familièrement ses soldats), est mortellement blessé.
Mais-on n'a pas le temps de s'attarder aux regrets.
On se battit terriblement pendant les journées du 24 et du 25 août.
Grâce à la formidable énergie déployée par nos troupes, le général de Castelnau put télégraphier de
Pont-SaintVincent, le 25, à 15 heures : « En avant partout, à fond. » |
 |
Ordre admirable qui révèle le coup d'oeil et la décision d'un grand chef.
L'armée tout entière s'ébranle
La bataille qui se livra dans la soirée du 25 et dans la nuit du 25 au 26 fut une des plus fertiles en actes d'héroïsme.
Le colonel et le lieutenant-colonel d'un régiment avaient été tués.
Le général de brigade donna alors des instructions à un commandant, tout jeune, rayonnant de santé, de force et de courage qui avait pris Aa tête du régiment.
- Mais prenez garde, deux colonels ont déjà été tués.
- Je serai le troisième, répondit le commandant en souriant : jamais deux sans trois.
Au même instant, un obus éclate et le décapite. Il avait commandé nominalement dix minutes son régiment.
Un autre colonel part à la tête de quelques hommes; un obus éclate encore, blesse six hommes et atteint le colonel, qui meurt quelques heures après en disant au général :
- Je n'ai pu accomplir ma mission. Pardonnez-moi !
Le lieutenant Beaudoin, durant cette terrible journée, et ses hommes, et toute l'armée française, non, la France entière - car ces soldats sont, pour la plupart, des civils déracinés - tous ont été sublimes de courage et d'esprit de sacrifice.
A un moment donné, il s'agit de déloger les Allemands d'un petit bois d'où ils commencent à nous asperger.
Des ordres se colportent de bouche en bouche.
On se met en marche.
- Y a du bon, mes enfants! crie le commandant. Vous allez bien marcher, hein ?
Quelques balles viennent, çà et là, s'enfoncer dans la terre brûlée par le soleil et font voler de petites volutes de fumée.
Brusquement, de sombres flammes s'élancent et frappent l'air de détonations épouvantables; des fusants sortent du ciel, des explosifs sortent de terre. Des hommes courent dans de grands flots de fumée; des cratères s'ouvrent; des rafales se déchaînent. La stridence des éclats déchire Les oreilles, frappe sur la nuque, traverse les tempes. Une odeur de soufre brûlé, de laine chaude et de sang soulève le coeur. La vue est obstruée par une avalanche fulgurante. C'est le barrage. Il faut passer dans cet enfer. On se hâte. On entrevoit comme dans un cauchemar des hommes qui tombent la face en avant, pareils à des statues de pierre; d'autres qui
s'asseoient pour ne plus se relever. Les uns ont l'immobilité des choses, d'autres sont agités de tremblements convulsifs Mais on continue à crier : « En avant en avant! » chacun prend le pas de course en évitant les blessés qui crient, se débattent ou bien s'accrochent aux soldats valides qui ont autre chose à faire qu'à plaindre et à secourir les camarades. D'aucuns répliquent durement : « Fiche-nous la paix ! » ou bien : « Les brancardiers vont venir te porter au poste de secours. »
Mails, devant nos soldats, l'ennemi reflue, disparaît derrière un tourbillon de fumée.
Puis, sans bien s'expliquer pourquoi, on sent que c'est fini. Plus de résistance. Un vide, un grand vide. On souffle un instant et l'on se regarde.
- Tu n'es pas amoché?
- Non, et toi?
Moi non plus Aujourd'hui, y a bon.
Chacun a le visage enflammé, rouge de fièvre et ruisselant de sueur. On est là pêle-mêle. On halète, puis l'exaltation s'apaise. Il ne reste plus qu'une infinie fatigue. |
XI
A L'AUBE DU 26 AOUT
La plupart des Villages qui se pressent au pied du Grand-Couronné étaient réoccupés par nos troupes.
Quand nous entrâmes dans Remenoville, que les Allemands furent obligés d'évacuer, les maisons brûlaient; on piétinaient littéralement les cadavres des Bavarois et des Français. Le petit ruisseau qui va se jeter dans la Mortagne était couleur de pourpre.
Aussitôt la fièvre de la bataille tombée, les hommes ont faim.
- Qu'est-ce qu'il y a à becqueter? demande un poilu.
- Des fayots à l'huile, et puis de la bidoche.
- C'est pas du cataplasme, au moins? fait un soldat en soulevant le couvercle de la marmite.
- Et dans ce seau-là, e'est-y du pinard, du bon?
- Mets tes lunettes si tu ne vois pas clair.
Puis les poilus « ne disent plus rien, tout entiers occupés à avaler.
Plus tard, quand la nuit tombe, chacun s'installe du mieux qu'il peut pour dormir. Derrière les armes rangées en faisceaux, des monceaux de corps inanimés se détachent en masses noires sur les fronts de bandière. Çà et là apparaissent des sentinelles qui semblent des fantômes veillant sur les morts. Spectacle à la fois majestueux et sinistre. Le calme qui règne n'est troublé que par les plaintes des blessés que l'on évacue vers les postes de secours ou par les hennissements des chevaux et des mulets estropiés errant à l'aventure.
Le lendemain 3 septembre, nous apprenons que les Allemands, venus de l'est, occupent Pont-à-Mousson; le lendemain, que le kronprinz, arrivé par le nord, a enlevé le fort de Mousson.
Le peloton du lieutenant Beaudoin est en tête du régiment, qui se porte sur la colline
d'Amance.
Nos troupes sont exténuées... On marche de nuit : la lune brille dans un ciel très pur où tremblent les essaims d'étoiles que l'on a regardées par des soirs d'amour ou de beaux rêves. On fait halte, assis sur le revers des fossés.
Puis on reprend le pas de route dans la nuit pleine d'astres, éclairée encore par les fusées lancées par les boches.
Tout à coup, le bruit se confirme que les troupes prussiennes ont l'ordre de prendre Nancy. Guillaume II est impatient de fouler sous les sabots de son cheval d'armes la capitale de la Lorraine.
En effet, les armées allemandes descendent les versants de la Seille, qui se couvrent d'uniformes gris si nombreux qu'on dirait une invasion de mulots; traversent la rivière par les ponts de
Chambley, Moncel, Brin et Bioncourt, puis remontent l'autre versant. Sur les crêtes de
Doncourt, de Bourthecourt et de Rozebois, elles établissent leurs batteries..
Nous ripostons avec énergie; mais déjà le feu des obus ennemis dirigé contre Amance et ses environs a mis le feu aux villages de
Laitre, de Bouxières-aux-Chênes et de
Fleur-Fontaine. Les clochers des églises et les maisons s'écroulent comme ces jouets de carton sur lesquels des enfants font partir leurs petits calons de cuivre. Des incendies s'allument sous le vent de la mitraille.
Cependant, nos admirables 75 font des vides énormes dans les rangs allemands. Mais à mesure que des brèches se forment dans la formidable muraille humaine qui s'avance, d'autres troupes accourent, sans souci des cadavres qui s'amoncellent.
C'est une avalanche qui roule et qui grossit sans cesse; elle est à la fois si compacte et si puissante qu'il semble qu'aucune force humaine n'est capable de l'arrêter. Les soldats tombent, la terre est rouge de sang, mais l'avalanche continue sa course que rien n'arrête et va tout écraser. |
Le chant grave du Deutschland über alles, entonné comme un psaume funèbre par tous ces milliers d'hommes qui ont fait le sacrifice de leur vie, monte vers le ciel, emplit l'espace, se mêle à la voix des canons. Ces soldats savent que leur empereur est sur un monticule d'où il les observe, qu'il est impatient de vaincre. Alors, dans un effort de plus en plus violent, ils concentrent tous leurs efforts sur
Amance.
- Allons! s'écrient les Allemands, Amance est à nous, ou il le sera bientôt.
Les chefs ordonnent que la route de Nancy soit ouverte avant la nuit, car Guillaume II a décidé de faire le jour même une entrée triomphale dans la vieille cité lorraine.
Le kaiser, vêtu de blanc, monté sur son grand cheval de bataille et entouré de dix mille cavaliers de sa garde, se trouve dans le bois de
Morel, et à chaque instant il envoie des ordres de plus en plus pressants. Il faut en finir une fois pour toutes. |
 |
- Ce soir, messieurs, dit-il aux officiers qui l'entourant, nous dînerons à Nancy, à l'hôtel de la préfecture.
Nos chefs, dont les troupes sont inférieures en nombre, ont-ils gardé l'espoir de résister à l'élan de l'adversaire? Oui ! car les généraux français savent que la confiance et l'audace sont les pierres angulaires de tout succès.
Il faut à tout prix tenir jusqu'à l'arrivée de renforts.
- Si nous nous maintenons tout le jour, dit le général Ferry, nous aurons fait un miracle.
Le miracle se réalise.
La douceur du crépuscule a remplacé l'éclat du soleil d'été. Nous tenons bon devant l'avalanche qui, en certains points, se disloque sous le feu de nos 75. Bientôt arrive la nuit; on se bat toujours; çà et là des villages brûlent.
Un rayon d'espoir luit dans l'âme française.
Le lendemain, les efforts allemands redoublent d'intensité; l'ennemi s'acharne et il est plus nombreux, plus mordant. Après un tir bien réglé, Vélaine, qui est la clef du défilé entre les deux monts
d'Amance, succombe et les Allemands envahissent le défilé avec la rapidité d'un torrent dont on aurait ouvert les digues.
- Nous sommes perdus, pensent les plus optimistes.
Soudain, les renforts sut lesquels nous ne comptions pas encore arrivent. Cette bonne nouvelle électrise les hommes, va porter un surcroît de courage jusqu'à la première ligne des tirailleurs. Derrière l'infanterie, vivement engagée, le canon français, cette fois, tonne sans arrêt; nos 75 font merveille et nos fantassins voient devant eux des champs entiers de casques à pointe couchés comme des épis sous la faux du moissonneur.
La mitraille passe en sifflant comme un vent d'équinoxe. Les clairons sonnent. Les officiers donnent des ordres nets. Une fièvre de triomphe anime les âmes. Un vieux chasseur à barbiche blanche interpelle Beaudoin :
- Je crois, mon capitaine, que, cette fois, les hoches prennent quelque chose pour leur rhume.
Le fait est que le ciel et la terre sont déchirés de bruit. C'est partout le crachement effroyable d'un volcan, cependant que le tic-tac d'un moulin à café s'impose au milieu de ce vacarme d'enfer.
Guillaume II a ordonné de faire donner les réserves. Alors, tout un corps d'armée s'avance, pareil à un immense ruban gris, vers les ponts de la Moselle.
Mais nos batteries d'artillerie, nos fantassins, admirablement postés sur les hauteurs, effectuent un tir si précis, si meurtrier, que l'ennemi n'arrive pas à franchir la rivière.
Cependant les Allemands n'abandonnent pas la partie. Ils luttent avec une énergie farouche et, pendant des heures, c'est un effroyable combat. L'air, traversé par le sifflement des balles, par des obus, semble secoué par un vent de folie.
Mais voilà que la tempête s'apaise : l'avalanche allemande oscille, s'arrête, puis recule: maintenant, elle court, bat en retraite, cependant que les dix mille cavaliers de la garde impériale galopent vers Metz à bride abattue.
La victoire si présomptueusement escomptée la veille par les Allemands, s'était changée en déroute.
Avant le coucher du soleil (11 septembre), les années françaises étaient victorieuses. |
XII
BLESSÉ
Nous poursuivons les fuyards. Nos 75 crépitent sans arrêt. Les obus fendent l'air au-dessus de la tête des fantassins et voit éclater au milieu des boches. Un bruit diabolique fait trembler toute la campagne. Une tempête de battements rauques, de clameurs furibondes, de cris perçants de bêtes, s'acharnent sur la terre où traînent des loques de fumée. Beaudoin grimpe une colline en tête de sa section. Il commande :
- Feu à volonté!
Tout le monde est plein d'énergie; une excitation anime les nerfs. Les boches sont devant l'officier à 50 mètres. Il s'arrête un instant pour donner un ordre. Soudain il éprouve un double sentiment, il veut repartir, et il a l'impression d'être cloué sur place. Est-il touché? Un engourdissement dans le côté droit le paralyse. Sa respiration est longue à venir; tout à coup, une cascade de sang s'échappe de la manche de sa vareuse; son bras droit est lourd comme du plomb; la terre disparaît sous ses jambes : il tombe à genoux, il veut crier : impossible ! impossible aussi de faire un mouvement. Un caporal se précipite, défait la vareuse; enlève la chemise : au-dessus du sein droit est un petit trou d'où s'échappe le sang; le poumon est traversé, la balle est ressortie sous l'omoplate.
Beaudoin a soif..., le caporal lui tend un flacon de gnolle; il en vide la moitié; son képi est à terre, il appuie la tête sur ce képi et aussitôt il se sent bien.
Un soldat s'élance, prend l'officier sur son dos et descend la côte rapidement. Chaque mouvement qu'il fait active l'hémorragie, la faiblesse du blessé s'accentue et sa blessure devient si douloureuse qu'il supplie le porteur de le laisser tranquille; alors celui-ci le pose à terre, puis, avec l'aide du caporal, s'occupe à confectionner un brancard avec deux fusils et une toile de tente; ils l'installent dessus, mais la toile s'est détachée et le blessé roule à terre. Le soldat n'hésite pas à reprendre sur ses épaules, et le voilà parti à la recherche d'un poste de secours. Affalé sur lui, Beaudoin éprouve un instant de soulagement, puis il voit des personnes autour de lui, il est dans une chambre que le soleil éclaire. Pourtant rien de tout cela n'est vrai; le soleil s'est couché ; c'est son cerveau qui commence à battre la breloque... Beaudoin reprend ses sens.
- je vais vous donner à boire, dit le soldat qui déposa son officier sur une butte de terre.
La nuit tombe. A l'horizon se détachent les silhouettes de voitures cassées, d'arbres dépouillés par la mitraille.
Enfin, voici des brancardiers. L'officier s'abandonne au balancement de leur marche; il n'a plus conscience de ce qui se passe autour de lui.
XIII
AU CHEVET DU BLESSÉ
Le lieutenant Beaudoin est à Nancy, à l'hôpital. II est encore bien faible, mais la guérison fait de rapides progrès.
Pour l'instant, il dort.
A son chevet se penche une dame de la Croix-Rouge et, comme si le bon regard posé sur le blessé avait eu une influence sur son sommeil léger, Beaudoin ouvre doucement les yeux.
- Voulez-vous boire un peu de limonade? demande la gracieuse infirmière.
- Je vous remercie, madame; j'accepte par pure gourmandise, car maintenant la soif qui me dévorait est bien éteinte. Mais quelle heure est-il donc? N'est-ce pas le jour de la visite des parents? L'attente va me paraître longue.
- C'est moi qui attends, fait Geneviève en se levant soudain de la chaise où elle était assise. Voilà près d'urne demi-heure que je guette votre réveil. Vous dormiez d'un sommeil d'enfant.
- Oh! mon amie, déjà vous ! C'est mon rêve qui continue. Donnez-moi vite la main afin que je ne doute pas de la réalité. Elle est brûlante, votre main. Seriez-vous malade ? interrogea-t-il avec anxiété.
- J'étais si émue en arrivant tout à l'heure. Je redoutais une rechute, j'étais stupide. Et voilà qu'au contraire le médecin m'a annoncé que vous étiez en si bonne voie de guérison que, dès la semaine prochaine, vous serez autorisé à sortir en ville, avec moi, bien entendu.
- Et nous ferons la dînette ensemble?
- Oui, si vous promettez d'être raisonnable.
- Je promets... Approchez-vous, Geneviève... encore, davantage.
Et François, ayant posé un baiser sur la joue fraîche de la jeune fille, murmure à son oreille : - Quand le bonheur passe, mon amie, que faut-il faire?
- Il faut le saisir bien vite.
- Alors, nous nous marierons dans quinze jours, si toutefois vous n'avez pas changé d'avis d'ici là, demande-t-il malicieusement.
- Qui sait ? Les femmes sont si volages !
Elle se met à rire. Puis, devenue soudain sérieuse, elle reprend :
- Vrai, bien vrai, vous voulez bien de moi pour votre petite femme?
Il fit : oui, des yeux.
Alors, le coeur de Geneviève, trop gonflé de bonheurs, éclata en sanglots.
FIN |













