|
Souvenirs de l'invasion de 1914 -
Lorraine - Gerbéviller
Le
Pays lorrain - 1936
Le Bouchon sur la Vague (1)
Souvenirs de l'invasion de 1914
I
Depuis l'attentat de Serajevo,
nous suivions à Gerbéviller (2) les événements au jour
le jour, mais avec ce recul du temps et de l'espace qui
préserve les campagnes de toute nervosité. Pourtant le
31 juillet 1914 je décide d'aller aux nouvelles et, pour
explorer un peu le monde extérieur, de passer
l'après-midi à Lunéville. Ma première visite est pour
l'abbé Guyon, premier vicaire de Saint-Jacques à qui
j'apporte le salut de ses frères, mes amis. Avec lui je
monte à l'une des tours de Saint-Jacques pour faire un
tour d'horizon. De là-haut l'abbé me montre tout le
secteur de la frontière où patrouille déjà, me dit-il,
une partie de la 2e division de cavalerie de Lunéville.
Au quartier du 8e dragons où je me rends ensuite dans
l'espoir d'y rencontrer un de mes bons amis de Nancy, le
cavalier Paul Benoît-Gény, on me répond que son peloton
est sur la frontière. La cour et la place du château
présentent un aspect qu'on ne leur a jamais vu. Les
chevaux des escadrons qui tiennent garnison dans
l'ancienne résidence du roi de Pologne sont tous dehors,
alignés la tête aux murs le long desquels ils sont
attachés. Leur robe brillante qui étincelle au soleil
témoigne de leur bonne forme. Derrière eux, par terre,
le harnachement tout neuf de la collection de guerre
fait une ligne éclatante et fauve. Les hommes sont
équipés prêts à partir. D'une aile à l'autre du château
et sur la place, où les curieux s'amassent, cavaliers et
gradés de tous rangs s'affairent, coiffés du bonnet de
police. On sent qu'au premier signal chevaux, selles et
cavaliers ne feront plus qu'un pour courir à l'ennemi.
Adossé face à l'amont, au parapet du pont tout proche de
la Vezouse, le colonel du 31e dragons (3), la cravache
sous le bras, en bonnet de police, lui aussi, comme au
cantonnement, le regard ferme quoique vague, semble
fixer au delà de l'horizon réel un horizon imaginaire où
le porte, on le devine, son émouvante méditation. Je
m'arrête pour le contempler discrètement pendant
quelques minutes. Il est déjà parti, projeté
fonctionnellement en avant, comme ses éclaireurs qui
surveillent et protègent la frontière et que sa pensée
accompagne. Il symbolise à la fois le chef et le
guetteur, toute l'armée, toute la France, calme et
résolue, debout devant l'ennemi (4).
De retour à la gare pour rentrer à Gerbéviller, je vois
passer le dernier train, paraît-il, qui franchira la
frontière à Avricourt. Les wagons sont bondés
d'Allemands dont beaucoup, peut-être, vont bientôt
revenir, l'arme au poing.
Par cette visite à Lunéville, en état d'alerte, en
mission de couverture, je suis désormais plongé dans
l'ambiance de guerre. Elle envahit Gerbéviller, à son
tour, quelques heures plus tard. Vers minuit les ordres
d'appels individuels sont remis aux réservistes des
jeunes classes. Les scènes émouvantes auxquelles ont
donné lieu ces premiers départs m'échappent. De ma
chambre à coucher sur le jardin silencieux, je ne me
doute pas de ce qui se passe. Mais rendus plus tragiques
par la nuit, ces adieux brusqués ont provoqué dans tous
le pays, jusqu'alors tranquille et comme indifférent,
une fièvre que l'aurore n'a point coupée et qui place
les moins avertis face à la réalité et à l'héroïque
devoir. « Heureux les morts! » me dit une épouse et une
mère qui avait vu son mari disparaître dans la nuit et
qui pense peut-être que je suis orphelin.
Des ouvriers peintres de Nancy qui restauraient mes
persiennes depuis huit jours me quittent à midi en
laissant tout leur matériel et en me donnant rendez-vous
pour le lundi matin. Mais, par précaution, ils
raccrochent tous les volets, bien qu'inachevés.
Dans l'après-midi, mon ami Henri Grasse et moi allons,
comme souvent, cueillir à la fermeture de son bureau le
receveur des Domaines, M. Sohier, pour faire avec lui
une promenade. Nos pas nous portent sur la route de
Seranville (5). Arrivés au-dessus du viaduc de Bronville,
au point d'où la route surplombe la vallée de la
Mortagne et où le Donon et une partie des Vosges
apparaissent au-dessus du clocher de Moyen (6), nous
nous arrêtons, comme d'habitude, et devant le paysage
nous nous taisons. Notre silence s'emplit aussitôt du
bruit amorti des cloches qui sonnent éperdument derrière
nous à Gerbéviller. Il est cinq heures du soir à peine.
Ce n'est pas encore l'Angelus à cette saison. La
mobilisation ? Ce n'est pas le tocsin, mais la volée. Je
pense à la fête de la Portioncule, marquée à Gerbéviller
par l'indulgence franciscaine accordée à la chapelle du
château par le Souverain Pontife.
Mais cette hypothèse ne nous satisfait point. Nous
revenons sur nos pas. Un cycliste, en nous croisant nous
lance : « Ça y est ! Voilà la mobilisation qui sonne ! »
C'est donc en union intime avec la terre lorraine, en
vue de la frontière qui suit au lointain horizon la
crête des Vosges, que nous avons reçu l'Appel des Armes.
A travers un paysage que sa souriante indifférence ne
nous rend pas moins cher en ce moment, nous rentrons à
Gerbéviller par le faubourg Saint-Pierre. Les femmes
sont sur les portes, en larmes, les hommes, affairés,
font leurs adieux aux voisins, aux amis, leurs derniers
préparatifs, leurs ultimes recommandations. Des flammes
brillent dans leur regard. Peu de mots. La plupart
résolus, confiants dans le succès, comme soulagés d'en
finir avec les menaces allemandes renouvelées d'année en
année et de mettre enfin le peuple insolent à la raison.
Ni forfanteries, ni lâchetés.
Le spectacle de la rue me rappelle un soir d'incendie de
mon enfance.
A la mairie des affiches sont posées : le premier jour
de la mobilisation est le dimanche 2 août. Pour nous,
gens des frontières, contrairement à la proclamation de
Poincaré, parue le lendemain (« La mobilisation n'est
pas la guerre ») qui nous fait un peu l'effet de ces
paroles d'espoir qu'on prononce sans conviction au
chevet des mourants, la mobilisation et la guerre, c'est
tout un. Et déjà nous tendons l'oreille, surpris de ne
point entendre le canon et prêts à voir arriver des
Prussiens.
Le dimanche 2 août les départs se poursuivent. On voit
le comte Emmanuel de Lambertye monter dans un
compartiment avec les réservistes de son âge. Son frère,
Charles, le marquis de Gerbéviller, l'a précédé pour
aller à Toulon reprendre son service d'enseigne de
vaisseau. A ceux qu'il laisse, au premier rang desquels,
sa mère, Madame la marquise de Lambertye, qui va, le
lendemain, regagner Paris, après avoir mis le château de
Gerbéviller à la disposition de la Croix-Rouge, le comte
lance un adieu joyeux et plein d'espoir : « Nous
reviendrons bientôt ! »
Le départ des hommes mûrs donne un aspect bizarre au
pays. La vie paraît suspendue. Les cloches se taisent.
Le service des trains est arrêté. Aucun convoi ne passe
plus sur la ligne à voie unique de Mont-sur-Meurthe (7)
à Bruyères (8). Une locomotive haut-le-pied est en
faction permanente à la gare. Un officier de dragons
accompagné d'un planton est arrivé dès la première heure
pour procéder à des réquisitions de chevaux. Il sera là
quatre ou cinq jours et pendant tout ce temps c'est le
seul élément militaire que nous verrons, à notre grande
surprise. Les journaux continuent à nous parvenir, nous
maintenant en communication avec le reste du monde et à
l'unisson de l'élan national qui soulève le pays et rend
la France à elle-même. Ils nous racontent que des
économistes ont calculé que la guerre ne pourrait durer
plus de trois à quatre mois. Les trois années que je
viens de passer à la Faculté de Droit ne m'ont pas
inculqué un tel respect des théories économiques que je
ne me garde d'accueillir avec le plus parfait
scepticisme ce genre hasardé de prophéties. Je note dans
le journal que j'ai ouvert le 21 juillet trois points
qui résument mon état d'esprit : Une parenthèse s'ouvre
dans ma vie. Sera-t-elle jamais fermée ? et quand ? Dans
trois mois, six mois, un an, trois ans ou plus?
Et si elle se ferme, sur quoi se fermera-t-elle ? Sur
quel monde ? Même victorieux, de quels bouleversements,
de quelles révolutions aurons-nous été les témoins ou
les victimes ?
Et ces points d'interrogation se localisent dans ma
pensée sur les noms et les visages de mes amis et de mes
contemporains déjà sous les drapeaux, ou, comme moi,
mobilisés demain. Ma plume les énumère sur la page du
cahier. Lesquels ne reviendront pas ? Lesquels vont
tomber les premiers ?
Les jours passent pourtant, tranquilles et sévères. Je
n'ose plus toucher mon piano. Il me faut bouder cet ami
très cher; ses cordes darderaient de flèches si aiguës
tant de coeurs meurtris !
Nous n'interrompons pas néanmoins notre saison de bains
de rivière. Mais, en brassant les eaux fraîches de la
Mortagne, nous ne pouvons nous empêcher de penser - et
nous le formulons avec une grandiloquence enfantine,
mais voulue, où il entre plus de littérature que de
pressentiment : - « Dans quelques jours, peut-être, tu
charrieras des cadavres et du sang ! »
Entre temps, la vie de guerre s'organise. Les femmes,
les jeunes gens, les vieillards remplacent aux champs et
à l'étable, au four et au moulin, les hommes qui sont
partis. Des deux médecins de Gerbéviller, l'un, le
maire, le docteur Camus, est allé rejoindre son poste de
médecin de réserve à Neufchâteau, l'autre, le docteur
Louviot (9), mobilisé sur place, aménage à l'hospice une
ambulance avec le concours bénévole de mon grand-oncle,
le docteur Labrevoit (10), médecin principal de l'armée
en retraite. En prévision des batailles prochaines,
l'autorisation de la marquise de Gerbéviller est mise à
profit et des lits, réquisitionnés chez l'habitant, sont
installés au château dans toutes les pièces disponibles.
Je fais la quête des lits dans le faubourg Saint-Pierre
avec mon voisin Louis Guyon (11) que j'aide à les
charger sur sa voiture et à les décharger au château. Ce
sont pour la plupart des lits de fer qui jurent
curieusement avec le somptueux décor où nous les
alignons, en pensant à ceux à qui ils sont destinés.
Chaque soir à l'appel du curé-doyen, l'église s'emplit
d'une

Cliché Bastien.
Intérieur du château de Gerbéviller après le
bombardement.
Le grand vestibule avec les restes de quelques-uns des
lits de l'hôpital installé dans le château.
foule de fidèles qui récite
pieusement le chapelet. La voix du curé, M. le chanoine
Vanat, se fait chaque jour plus lasse et plus sombre
quand il prononce : « Récitons cette cinquième dizaine
pour demander à Dieu d'écarter de cette paroisse les
malheurs de la guerre » (12).
Le 7 août, sous un ciel lourd qui vient de se couvrir au
milieu de l'après-midi, un cavalier apparaît au passage
à niveau de la gare (13) à cent et quelques mètres de
chez moi, à l'entrée même de Gerbéviller quand on vient
de l'Ouest. C'est un chasseur à cheval. Il s'avance
prudemment, la carabine au poing, le doigt sur la
gâchette. Il interroge les premières personnes qu'il
rencontre. « A-t-on vu des Allemands ? » Ces précautions
élémentaires d'une armée en marche d'approche nous font
sourire. Se croit-il déjà en pays ennemi ? Il rebrousse
chemin et retourne vers ceux qui le suivent à vue,
assurant la liaison avec le gros du régiment. C'est le
16e chasseurs de Beaune (14), qui va inaugurer à
Gerbéviller les cantonnements de guerre. L'annuaire
m'apprend que c'est le régiment de cavalerie de corps du
8e corps d'armée (15) [Bourges]. Sa présence renforce
notre tranquillité. Nous nous savions protégés par la
frontière vivante constituée par les troupes de
couverture. Voici maintenant l'armée toute entière qui
vient les rejoindre. Pendant son court séjour le
régiment pousse des reconnaissances sur la Meurthe et la
forêt de Mondon (16) où, dit-on, circulent des
patrouilles allemandes, mais à leur grand désespoir, car
ils veulent en découdre, nos cavaliers reviennent
bredouilles. Le séjour du 16e chasseurs à Gerbéviller
est marqué par un accident pénible. Un cavalier (17)
qui, pour des raisons mal définies et contrairement aux
ordres reçus, s'était écarté, le soir, des lisières Est
du cantonnement, du côté de la brasserie, est accueilli,
à son retour, par le : « Qui vive ? » d'une sentinelle.
Se sentant peut-être en faute, il se tait et la
sentinelle l'abat d'un coup de carabine. On l'enterre le
lendemain. C'est le premier tué du régiment, la première
victime de la guerre à Gerbéviller. La population se
mêle en une communion étroite aux chefs et aux camarades
du malheureux, autour de sa tombe, au cimetière
communal.
Après le départ du 16e chasseurs, nous voyons passer de
l'infanterie, puis cantonner le 48e d'artillerie, -
artillerie de la 15e division (Dijon). - Il passe deux
ou trois nuits à Gerbéviller, formant le parc dans un
pré à proximité de la gare et allant dans la journée se
mettre en batterie sur la Meurthe. Le passage répété des
batteries gagnant leur position ou rentrant au
cantonnement et des attelages allant à l'abreuvoir à la
rivière, emplit notre quartier d'un tumulte cliquetant,
d'une poussière et d'une odeur de cuir, de crottin et de
graisse, bien caractéristiques de l'artillerie. Aux
manoeuvres ou dans les revues, je n'ai jamais vu que des
batteries sur le pied de paix, à quatre canons et quatre
caissons. Le défilé de ces batteries sur le pied de
guerre, encombrées de forges, d'échelles-observatoires,
de fourragères, de fourgons et de caissons, au milieu
desquels disparaissent les quatre canons, bouleverse
toutes mes notions élémentaires sur l'organisation de
l'armée. Mais j'admire la magnifique tenue de ce
régiment, ses beaux attelages, ses harnachements neufs,
son matériel bien soigné, l'ordre et l'impression de
force qu'il dégage et mon oncle Labrevoit fait avec les
débuts de la guerre de 1870 des comparaisons
avantageuses et réconfortantes.
Au delà de l'horizon, la frontière s'anime. On entend le
canon lointain à peu près tous les jours. Des bruits
courent : les Allemands sont à Ogéviller (18). Mais le
mouvement en avant de l'armée se poursuit. Au 48e
d'artillerie succède le 210e régiment d'infanterie,
régiment de réserve du 8e corps (Auxonne). Formé depuis
quelques jours de réservistes de classes relativement
jeunes, ce régiment, le premier élément de réserve que
nous voyons, offre un aspect tout différent des
régiments d'active auxquels nous sommes habitués.
L'ordre et l'esprit y sont excellents, mais il manque
encore fatalement de cohésion et d'entraînement et la
machine paraît un peu lourde. Le lieutenant-colonel qui
le commande est logé chez mon oncle, le docteur Labrevoit, dont la maison est contiguë à la mairie. Je
suis donc aux premières places pour assister aux
honneurs rendus au drapeau, après l'entrée du régiment,
cérémonie toujours recherchée, à laquelle, nous, civils,
nous nous empressons de prendre part, pour saluer, nous
aussi, l'emblème qu'enveloppe en ce moment un frisson et
une majesté incomparables, tandis qu'au loin le canon
tonne.
Aussitôt installé, le colonel va faire le tour du
cantonnement. J'en profite pour me faufiler dans sa
chambre et voir pour la première fois de tout près un
drapeau de régiment. Saisi d'émotion à la vue de cette
étoffe brillante, inerte, dans un coin de la chambre,
mais chargée d'un si prenant symbolisme, c'est tout
juste si je ne fléchis pas le genou, comme en entrant
dans une chapelle, et d'un geste non prémédité et
instinctif, j'en porte la soie éclatante à mes lèvres.
La fête de l'Assomption se déroule, sinon dans la joie,
du moins dans la confiance. Les Allemands ont été
repoussés dans les premières rencontres à la frontière
et nous voyons notre armée continuer sa progression. Le
voeu de Louis XIII s'accomplit avec une ferveur et une
espérance nouvelles (19). Un à un, les éléments
débarqués dans la vallée de la Moselle, sur les quais
militaires des gares de la ligne de Nancy à Gray par
Epinal, à Charmes et à Châtel, passent devant nous, de
jour et de nuit, dans une revue gigantesque qui, depuis
le premier éclaireur du 16e chasseurs jusqu'au convoi
administratif d'armée et aux équipages de ponts, fait
défiler sous nos yeux tous les organes d'une armée
mobilisée au complet et des délégations de toutes les
provinces de France, ce qui nous vaut la plus
remarquable leçon de choses militaires et de piquantes
observations. Plus encore que l'éclaireur du 16e
chasseurs qui nous avait presque offusqués en pénétrant
chez nous la carabine au poing, certains déracinés par
la mobilisation de trop lointaines provinces semblent,
après tant d'heures de chemin de fer, se croire déjà en
pays ennemi. Ceux-là, peu nombreux, heureusement, mais
peut-être plus qu'on ne pense, ne distinguent pas la
Lorraine de l'Alsace-Lorraine ni l'Alsace-Lorraine de
l'Allemagne et pour eux ça n'est déjà plus la France,
car ils ne savent pas au juste où passe la frontière.
Montrant à un officier du génie le Donon et les Vosges,
je le vois s'émouvoir : « Ah ! voilà la ligne bleue des
Vosges ! » et s'étonner aussi de la voir encore si
éloignée. J'entends un autre, d'un accent sonore qui
voudrait être gentiment protecteur, me déclarer : « Nous
venons défendre votre pays ». Et je ne puis réprimer une
grimace comme à l'audition d'une fausse note. Des
enfants de la plaine trouvent les environs de
Gerbéviller particulièrement accidentés et l'instant
d'après quelque montagnard me dit : « Que c'est plat
chez vous ! » Belles leçons de relativisme.
Après les éléments combattants des premiers jours nous
voyons les parcs d'artillerie, leurs sections de
munitions, les trains régimentaires, le service
sanitaire avec ses groupes de brancardiers de corps
d'armée et de division et leurs pleines charretées de
jeunes élèves de l'École de Lyon, le troupeau de bétail,
les autobus parisiens transformés en voitures à viande
et dont beaucoup portent encore les plaques indiquant
l'itinéraire auquel ils étaient affectés dans la
capitale et cet ineffable convoi administratif d'armée
où chevaux et mulets de toutes tailles, attelés aux
voitures de réquisition des modèles les plus variés et
les plus effarants apportent dans nos rues des images
bourguignonnes, berrichonnes ou morvandelles. C'est
comme l'exode de tout un peuple, une véritable
émigration; ça tient du déménagement autant que de
l'expédition, du militaire et du romanichel, du « camp
volant » comme on dit en Lorraine; ça n'a pas d'âge et
évoque aussi bien les guerres de l'antiquité que les
campagnes du Premier Empire ou la Guerre de Trente Ans.
Le mot impedimenta si souvent rencontré dans Tite-Live
ou César a pour moi maintenant un sens vécu. Et ça
roule, ça cahote, pendant des heures et des jours, au
milieu des rires, des quolibets et des lazzis, car tout
ce monde, toujours dans un ordre parfait, est dans
l'ensemble bien moins grave que les combattants de
l'avant qui, pourtant, ne manquaient pas de bonne
humeur, ni de moral.
Le jeudi 20 août, le docteur Louviot m'invite à
l'accompagner dans son automobile jusqu'à Vennezey (20)
où il a un malade à voir. Nous nous heurtons à un
équipage de ponts encombrant la route et dont les longs
bateaux font un curieux alignement dans le vallon du
ruisseau de Paleboeuf (21) qui paraît, du coup, un lac
subitement asséché. Rien ne manque donc au défilé.
Voilà, pensons-nous, pour passer le Rhin.
Le bruit de la canonnade redouble, mais lointain.
II Je suis en train d'observer les phases de l'éclipse de
soleil du vendredi 21 août 1914, quand, vers 10 heures
du matin, les premières vagues de la retraite de
Sarrebourg-Morhange atteignent Gerbéviller, sous la
forme d'un détachement de prévôté d'armée, venant, non
plus de l'ouest, comme toutes les troupes qui passent
depuis plus de dix jours, mais de la direction du front.
Ces gendarmes s'arrêtent devant la mairie et ne nous
cachent pas qu'il y a un mouvement de repli. Dans
l'après-midi une escadrille de blancs avions vient
atterrir dans un pré au bord de la route de Remenoville
(22), à 500 mètres à l'ouest de la gare. Cela rappelle
le Circuit de l'Est, trois ans plus tôt. Les curieux se
précipitent. Des gendarmes, sortis on ne sait d'où,
gardent les monoplans qui reprennent bientôt leur vol
vers l'arrière. Réjouis par les premiers succès de
Blâmont, nous nous croyions depuis quelques jours en
sûreté et à l'abri de l'invasion. Ces premiers indices
de revers voilent de tristesse et d'appréhension notre
sérénité.
A chaque heure croît notre angoisse, alimentée par des
faits nouveaux. On apprend la mort des premiers enfants
de Gerbéviller tombés au champ d'honneur. C'est le
chasseur Joseph Milanus, qui, le 11 août, a ouvert le
glorieux martyrologe.
Dans la soirée, des troupes combattantes en déroute
passent en laissant derrière elles une impression
déplorable dont je recueille au matin les échos
indignés.
Dans la journée du samedi, la bataille, jusqu'alors
lointaine se rapproche. Déjà elle ne semble plus au delà
de l'horizon (23). Après le déjeuner un gros orage
éclate, ajoutant le tonnerre à la canonnade. A l'église,
où les vitraux tremblent, près de claquer, des femmes,
groupées autour du confessionnal, pleurent et prient à
haute voix. Les bataillons refluent sans arrêt, certains
complètement démoralisés. L'hospice recueille quelques
blessés ou malades qui ne peuvent suivre la retraite.
Les unités mélangées appartiennent, en majeure partie,
au 16e corps (24). Chaque homme qu'on interroge déclare
qu'il est le seul qui reste de sa compagnie. Isolé de
ses camarades, il est sans doute de bonne foi, mais
combien y a-t-il donc de compagnies dans ces régiments ?
Derrière les colonnes, des fuyards nombreux, grimpés sur
des carrioles avec quelques couchages, du petit mobilier
et des provisions, mêlent leurs tristes équipages aux
voitures militaires, la plupart hâves et sombres, les
uns terrorisés, muets et pleurant, d'autres semant la
panique. Le soir on dit que les Allemands sont à
Lunéville (25). Instants inoubliables où naissent dans
l'âme des sentiments nouveaux - de rage et
d'anéantissement - à la vue de l'abîme qui s'entr'ouvre.
Une anxiété très aiguë s'empare de moi, d'autant plus
vive que le mystère s'obstine à planer sur la nature du
malheur attendu.
Dans la nuit (du 22 au 23) des ponts sautent (26). Des
incendies annonçant l'approche des barbares enflamment
l'horizon. Vers minuit, j'ouvre ma porte, bien
timidement, à une section du 2e bataillon de chasseurs à
pied, pensant déjà avoir affaire aux Allemands.
« - Croyez-vous qu'ils viendront jusqu'ici ?
« - Ils n'y sont pas encore, c'est bon ! Et nous, nous
sommes toujours-là ! »
Après avoir cantonné à la maison, les chasseurs
disparaissent au petit jour. De telles scènes nous sont
familières. Il n'est pas d'année qu'une manoeuvre ou
l'autre de nos garnisons lorraines ne nous en ait fait
vivre de semblables. Mais cette fois il ne s'agit plus
de thème conventionnel, c'est le drame lui-même qui se
joue et sa poignante réalité qui nous étreint.
Beaucoup d'habitants de Gerbéviller ont suivi la
retraite et, comme les fonctionnaires et les services
publics, évacué la place. Nous voyons la locomotive
haut-le-pied qui, depuis la mobilisation, montait la
garde à la gare, s'en aller en emmenant le personnel.
Nous sommes désormais comme en une ville assiégée,
séparés du monde extérieur. Il reste pourtant encore la
possibilité de fuir. Fuir ! Acte et mot répugnants !
N'ayant encore aucune autre obligation militaire que
d'attendre à Gerbéviller ma feuille de route de la
classe 1914, dont l'appel va évidemment être devancé,
alors que l'autorité militaire n'accepte pas
d'engagements pendant les vingt premiers jours de la
mobilisation, je considère comme un devoir de demeurer
jusqu'à nouvel ordre avec les miens, chez moi, et comme
une désertion et un geste de défaitisme, dira-t-on plus
tard, de grossir le cortège des fuyards. Et comment fuir
avec les vieillards qui m'entourent ? Je crois aussi,
pour l'avoir lu récemment dans les publications du
général Maitrot (27) que, sur les avancées de la Trouée
de Charmes (28) l'armée française utilisant une à une
les coupures du terrain et les tranchées successives que
lui offrent les vallées parallèles de la Vezouse, de la
Blette, de la Verdurette, de la Meurthe, de la Mortagne
et de l'Euron, marquera un temps d'arrêt sur chacune de
ces lignes et que, de Gerbéviller, on aura bien le temps
de se sauver quand on se battra sur la Meurthe de
Saint-Clément (29) et de Fraimbois. Education livresque
mise à l'épreuve de la réalité ! Et je pense que les
demeures abandonnées pourraient être les plus éprouvées.
Une voisine qui a connu la guerre de 1870 me l'affirme
en se moquant des « froussards » qui partent et en
ajoutant : « Si les Prussiens viennent (le mot : Boche,
à peine lancé, n'était pas encore répandu) on verra
bien. On les a bien eus en 70 ! » Et puis de telles
puissances affectives me lient à ce Gerbéviller où la
tombe de mon père est fraîchement scellée que je ne
songe nullement à m'éloigner. C'est une grosse
imprudence dont tous les risques ne m'échappent pas,
mais pourquoi ne pas mourir là et faire d'une chère
maison, que je ne puis alors imaginer détruite, mon
propre tombeau (30).
L'appréhension du lendemain se fait pourtant chaque jour
plus vive. Et à vouloir « tenir », faire front très
inutilement et « crâner » très imprudemment sous la
menace ennemie, nous n'en devinons pas moins la cruelle
imminence qui pèse sur nous et il faut dominer les
réactions qu'un organisme non initié oppose aux premiers
contacts avec les réalités de la guerre. Une brusque
dépression des nerfs, trop tendus dans l'inaction,
détermine chez moi une crise de bile et de larmes.
Le dimanche (23 août) est radieux. Pas le moindre bruit
de guerre. Quelques rares avions dans un ciel très pur.
Le docteur Louviot reçoit l'ordre de se replier sur
Bayon (31). Mon oncle Labrevoit assure le service à
l'ambulance de l'hospice avec les médecins-majors de
passage. Dans la matinée deux divisions de cavalerie
(32) 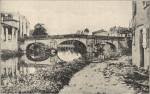
Cliché Bastien.
Le pont de Gerbéviller sur la Mortagne interdit aux
allemands de 8 h. du matin si 5 h. du soir par les 60
chasseurs du 2e B. C. P, commandés par l'adjudant Chèvre
et demeuré intact au milieu de la bataille dont il était
l'enjeu.
qui ont protégé la retraite défilent au trot devant nos
fenêtres. J'ai le plaisir de saluer rapidement au
passage dans les rangs du 8e dragons quelques figures
amies, notamment deux camarades de Nancy : Pierre Machon
(33) et Paul Benoit-Gény.
L'après-midi, calme et silence complets. Quelques
cavaliers isolés, des estafettes, qui s'arrêtent pour se
rafraîchir et dont on ne peut tirer grand'chose. On dit
que des patrouilles de cavalerie allemandes sont dans
les bois du marquis, « à la Reine » (34), en bordure de
la route de Lunéville. Peu de monde dans les rues. Ceux
qui sont restés se terrent. Nous descendons vers la
Mortagne. Mais le grand pont est barricadé et nous ne
pourrons pas passer (35). Nous rebroussons chemin,
impressionnés par le calme pesant, sous le grand ciel
bleu de nos belles vacances d'autrefois, devenu si lourd
de menaces dans le silence des cloches qui se sont tues
depuis qu'elles ont lancé l'appel aux armes le soir du
Ier août.
La journée s'achève tranquille et la nuit est
étrangement douce et paisible.
Le lendemain, lundi 24, le premier passant que
j'aperçois par ma fenêtre est un cavalier allemand qu'un
des nôtres emmène prisonnier. Quelle joie et quel bon
présage ! Mais évidemment, « ils » ne doivent plus être
bien loin. Vers 8 heures et demie, muni de ma jumelle,
je sors pour aller voir ce qui se passe. En descendant
la rue, je rencontre un de mes conscrits, Albert
Krakowski, qui estime le moment venu de s'en aller, vers
Bayon ou Charmes. Mais je ne peux croire que les
Allemands passeront; on les repoussera. Je sais
l'importance de la Trouée de Charmes et n'ai-je pas été
témoin, deux 
Cliché J. Godfrin.
La défense de Gerbéviller le 24 août 1914.
Bas-relief en bronze du monument aux morts de
Gerbéviller, par E. Bachelet (1924).
mois plus tôt, de l'importante manoeuvre de cadres qui
réunissait, en juin 1914, tous les officiers généraux et
chefs de corps des grandes unités aujourd'hui engagées,
sur le terrain même où ils auraient à combattre et
qu'ils doivent donc connaître parfaitement ?
Près de la mairie, un dragon me demande « un chemin pour
gagner rapidement Vallois (36) par la rive gauche et
défilé de la rive droite, car la Mortagne va être
attaquée d'un moment à l'autre ». Je le mets sur la
voie, complète sa carte de quelques renseignements et le
voilà parti. Je monte sur le toit de la maison Labrevoit
pour scruter l'horizon et observer la rive droite.
J'aperçois quelques uhlans (37) patrouillant dans les
vergers et cherchant à reconnaître les abords de la
localité.
Sur la route de Lunéville, un important groupe, en
stationnement, de chevaux non montés, de véhicules (dont
on ne distingue que les roues) et d'hommes à pied
grouillant à leurs côtés. Je me demande quelle arme et
quelle armée ce peut être, quand un panache de fumée
jaillit à peu de distance du groupe, suivi d'une
détonation et les shrapnels dégringolent sur les tuiles
autour de moi. C'est ainsi que mon inexpérience
d'observateur apprend l'aspect qu'offre à 2.000 ou 3.000
mètres l'artillerie ennemie se mettant en batterie près
d'une route où se rassemblent ses avant-trains. Je viens
de voir tirer le premier coup de canon sur Gerbéviller
(38).
L'heure n'est plus à demeurer sur les toits.
Je remonte chez moi en invitant à s'abriter une jeune
voisine qui balaye nor-

Cliché Bastien.
Le château de Gerbéviller avant la guerre.
malement son trottoir, comme chaque matin, sans s'être
encore aperçue de rien et je lui fais remarquer le bruit
des balles qui ne cessent de tinter sur les tuiles.
Rentré à la maison, je prends en hâte quelques mesures
de précaution, comme de dissimuler les albums de Hansi
qui traînent sur une table au salon (39). Mais j'oublie
de faire disparaître ma jumelle que j'accroche
négligemment dans le vestibule, pensant sans doute en
avoir encore besoin. Elle fera le soir le bonheur d'un
Boche qui ne me laissera que l'étui. Je m'installe à la
cave avec ma grand'mère (40) et la domestique (41).
A intervalles irréguliers et sans hâte les obus tombent
sur la ville. Petit bombardement de 77 qui me paraîtra
dans la suite bien anodin et comme un jeu d'enfant; mais
c'est mon baptême du feu et je le trouve assez sérieux
pour ne pas penser que ce n'est qu'un simple ondoiement.
Bien vite le séjour à la cave m'est insupportable.
Le moindre bruit de l'extérieur est dénaturé, déformé,
amplifié par l'imagination troublée : un éclat d'obus
tombant sur une trappe de cave, c'est une cheminée qui
s'écroule, un carreau cassé fait croire à un toit
éventré. De quart d'heure en quart d'heure, entre les
salves, je sors dans la rue ou au jardin pour essayer de
me rendre compte des ravages. Les chasseurs défendent le
pont et la rivière. De temps

Cliché Bastien.
Les ruines du château de Gerbéviller.
en temps l'un d'eux passe devant la maison assurant la
liaison entre les différents postes et l'arrière. Pas
d'autre mouvement dans la rue. Depuis 9 heures et demie
tout le quartier situé sur la rive droite - la Vacherie,
qu'on appelait le Faubourg Notre-Dame avant la
Révolution - est en flammes. Le vent d'ouest-sud-ouest
éloigne de nous les masses de fumée qui se gonflent dans
le ciel à l'horizon au-dessus des toits de notre
quartier demeuré tranquille et inerte (42). On amène un
blessé à l'hospice.
Une soeur s'avance au milieu de la rue et devant le
spectacle terrible qui s'offre à elle dans le
rayonnement de la plus splendide matinée d'été, elle
lève les bras au ciel en un geste d'effroi et de
supplication.
Dès les premiers coups de canon, mon vis-à-vis, Louis
Guyon, avait mené dans un parc à quelque cent mètres sur
la route de Haudonville (43) pour les mettre à l'abri
des coups, ses vaches et le cheval qui lui reste après
les réquisitions. M'apercevant sur le trottoir, il me
fait signe. Je traverse la rue et le suit; il me montre,
tout navré, une brèche de plusieurs mètres de diamètre
dans le mur de sa maison, côté jardin, où vient
d'arriver un obus. L'air est encore plein de poussière
dans

Cliché Bastien.
Intérieur de la chapelle de M. le marquis de Gerbéviller
après le bombardement.
Au centre, le saint Jean-Baptiste de Paul Dubois : tombé
de son socle.
l'écurie. Un peu plus tard, il me rappelle : « Viens
voir! Le château qui brûle ! »
Et par la brèche de son mur qui encadre le sinistre
tableau, je vois, au milieu des flammes qui le dévorent,
le dôme où flottait le matin encore le drapeau de la
Croix-Rouge. Sa couverture de zinc, près de fondre,
étincelle d'une lueur verdâtre, étrange et délicate.
Avec quelle douleur je vois successivement atteints ce
château des Lambertye-Tornielle et sa chapelle, lieux
vénérés où j'ai éprouvé mes premières émotions
esthétiques devant le Tarcisius de Falguière (44), le
Jean-Baptiste de Paul
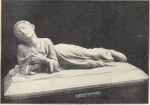
Cliché des Archives photographiques d'art et d'histoire,
Saint Tarcisius d'Alexandre Falguière (Musée du Louvre).

Clichés J. Godfrin
Débris de saint Tarcisius d'Alexandre Falguière détruit
le 24 août 1914 par les Allemands à Gerbéviller devenu
par cette nouvelle mutilation le symbole du martyre de
la ville.
Dubois (45) et les rares beautés de ces reliquaires
d'art que j'ai revues et admirées quelques jours plus
tôt encore en aidant à l'installation de l'hôpital.
A midi, une accalmie. Nous prenons notre repas, à la
cave toujours, impatientés de ne voir ni entendre la
réaction des nôtres. Notre artillerie semble muette,
nous n'entendons même pas les coups de feu des chasseurs
en avant de nous. Pourquoi ce silence et cette apparente
inaction ? (46) Et pourtant, avec une naïve confiance,
je songe encore que la journée pourra s'achever par la
retraite de l'ennemi et un Te Deum à l'église !
De nouveau dans la rue et toujours sans oser m' éloigner
de la maison, j'entends une. fenêtre du premier étage
s'ouvrir à l'hospice et la voix flûtée d'un pensionnaire
bien connu crier : « N... de D... de B.... D.... ! Ils
ne sont seulement pas f.... de faire les chambres à 1
heure de l'après-midi ! » En même temps jaillit de la
fenêtre à bout de bras un vase de nuit dont le contenu
est aussitôt vidé sur le trottoir. Ainsi la comédie se
mêle au drame.
L'instant d'après, le bombardement reprend et cette fois
les coups tombent non loin de nous. Guidé par le bruit
de leurs explosions, je me dirige vers le jardin;
j'arrive à point à la porte vitrée pour voir un obus
percuter dans le mur qui me sépare du jardin voisin, à
une vingtaine de mètres de moi. Les éclats de pierre et
d'acier retombent en pluie à mes pieds sur la terrasse
et je me replonge en hâte à la cave, où l'on tremble dès
que je suis dehors. C'est le premier obus que je vois
éclater et sans sortir de chez moi. Redoutable privilège
et honneur des Lorrains de recevoir le baptême du feu à
domicile.
Je me rends vite compte qu'après le château, dans la
matinée, c'est l'église toute proche que prennent
maintenant pour cible les pièces allemandes, car après
les premiers écarts en direction (notamment ce coup à
droite tombé dans mon jardin) le tir se précise.
Ressorti une fois de plus de la cave, j'en suis les
effets sur l'église qui résiste de toute sa carrure. Sur
les pierres de taille de la tour les obus éclatent sans
pénétrer. Dans la toiture ils s'enfoncent en pulvérisant
les tuiles dans un nuage de rouille. Navrant et poignant
spectacle (47) ! Le clocher s'effrite sous les coups et
les trois cloches - nos cloches aux voix aimées -
frappées par des éclats tintent de temps à autre,
rendant un son plaintif comme le gémissement de victimes
innocentes et qui ne comprennent pas. Nous comprenons,
nous, à ce moment, qu'elles sonnent le glas de
Gerbéviller et peut-être le nôtre.
Passé dans la rue pour savoir ce qui se passe de ce
côté-là, je vois sortir de l'hospice un fantassin
français sans armes. Il m'aperçoit, court à moi, l'air
affolé, me suppliant de le cacher. Il est malade, il
pleure et grelotte de fièvre. Il n'est plus maître de
lui et ne veut plus retourner à l'hospice, par peur des
Allemands qui l'y feront prisonnier ou l'y tueront,
croit-il. Il entre à la maison sans que je l'y invite,
car je ne vois pas ce que je peux faire pour lui et sa
présence chez moi me paraît particulièrement
inopportune, aussi bien aux yeux de l'autorité française
que vis-à-vis de l'envahisseur. Je le fais descendre à
la cave et s'y reposer quelques instants et, après lui
avoir donné à boire, je réussis à lui faire comprendre
que sa place n'est pas là. Qu'il fuie vers l'arrière
s'il en a la force ou qu'il retourne à l'hospice au
milieu des camarades qu'il y a laissés à l'abri de la
Croix-Rouge. C'est à la première alternative qu'il se
résoud une fois réconforté et le malheureux s'en va,
gémissant et frissonnant.
De nouveau, côté jardin; au sommet du clocher, une
petite flamme cherche à se livrer passage entre les
ardoises de la pointe de la flèche. Sous les coups de
l'artillerie allemande la charpente de bois du clocher a
pris feu.
Vers cinq heures du soir, les chasseurs se retirent
(48). L'un d'eux, un des agents de liaison auxquels j'ai
donné le matin mes dernières cigarettes, me dit en
passant devant la maison et en me revoyant sur la porte
: « On s'en va... Il fallait tenir jusqu'à présent.
Maintenant, on ne peut plus... Planque toi, va ! Les
v'là qui montent ! » En effet du bas de la rue s'élève
une rumeur : cris et hurlements accompagnant une
cacophonie dominée par les fifres perçants, les trompes
sans mélodie et les tambours aux roulements mats et
lents. C'est ça le peuple de Wagner !
Suivant le conseil « du vitrier », je retourne à la
cave. Le tumulte devient plus distinct. Bientôt la porte
de la maison est ébranlée par un choc violent. La
domestique, pratiquant le platt-deutsch, s'élance pour
ouvrir à l'envahisseur tout en me refoulant dans la cave
(dont elle referme sur moi la trappe), en bas, nous
l'entendons parlementer; nos prières redoublent. A la
porte la conversation ne se prolonge pas. Des pas
approchent de la trappe et, scandant ses appels de coups
de crosse de fusil, une voix peu rassurante s'écrie :
Heraus ! Heraus ! Schnell ! Heraus !
En même temps la domestique m'appelle.
Qu'est-il advenu ? Que vais-je trouver en haut de
l'escalier ? La pointe d'une baïonnette peut-être.
Secondes du paroxysme d'angoisse et pour la première
fois un de ces instants précieux où l'on a la sensation
claire d'être à l'article de la mort. Aussi en
gravissant les marches, me préparé-je moins à paraître
devant un soldat allemand que devant Dieu lui-même. Je
soulève péniblement la trappe et me voilà en face d'un
jeune « feldgrau » (49) au teint rose, l'arme au pied,
baïonnette au canon.
- « Cachez-vous vite, me dit la domestique. Il vous y
autorise et dira qu'il n'a rien vu de suspect dans la
maison. Mais disparaissez au moins pendant trois jours,
sans quoi vous serez fusillé ».
Et le Boche aussi insiste : Schnell ! in der Stroch, auf
dem Dach!
Comprenant alors que j'étais sauvé, au moins
provisoirement et sans m'attarder à des remerciements,
je bondis dans l'escalier de service qui prend naissance
en haut de l'escalier de la cave et qui mène directement
au grenier, au deuxième étage. Je suis à peine au
premier étage quand la horde envahit le vestibule.
Au grenier j'avise une soupente inaccessible entre le
toit et le dessus des mansardes. J'y monte avec une
échelle que je retire derrière moi et je m'étends,
l'échelle à mon côté, dans l'angle formé par la toiture
et le plancher, sur une couche de poussière, vieille au
plus de vingt-trois ans, l'âge de la maison, et pas
encore très moelleuse.
On sait l'influence des sensations et des émotions
antérieures ou concomitantes sur un état de conscience
donné : je viens d'échapper à un tel danger que
j'éprouve une béatitude extrême. Toute inquiétude a
disparu. J'ai l'impression d'être en sécurité, au calme.
Loin de gémir sur ma situation précaire et la
perspective de passer là au moins et au mieux, plusieurs
jours et plusieurs nuits, je ne songe qu'à me réjouir de
vivre encore libre et à en remercier Dieu (50). Par
quelle merveilleuse attention de la Providence, en
effet, et grâce à quel sang-froid de la domestique qui,
sans peur et en deux mots, a plaidé pour moi, dépeint
par elle comme un enfant malade, ai-je échappé à la
fureur du barbare? (51)
(A suivre.)
Jean GODFRIN.

Cliché H. Grasse.
L'église de Gerbéviller au printemps de 1915. (Voir
Maurice BARRÈS, L'âme française et la guerre. V. Les
voyages de Lorraine et d'Artois, p. 311. Le printemps
qui surgit des ruines.) Vue prise du point où l'auteur
en observait le bombardement le 24 août 1914.
(1) Le 31 juillet 1914 il n'y avait plus de doute que
pour ceux qui voulaient espérer contre toute espérance
que la guerre allait éclater. J'ouvris un cahier, décidé
à y consigner au jour le jour, tant que les événements
me le permettraient, les faits dont je serais le témoin
et les impressions qu'ils provoqueraient en moi et
autour de moi. Cette rédaction fut interrompue le 24
août suivant, à l'arrivée des Allemands à Gerbéviller où
je résidais depuis la fin de juin, en vacances depuis le
16 juillet, et le cahier qui la contenait, bien qu'il
ait été vu sur mon bureau, de longues semaines après le
passage des Allemands, a disparu ensuite de la maison,
ouverte alors à tout venant, sans que je sache s'il a
été détruit ou s'il a paru assez intéressant pour
trouver preneur.
Le récit qu'on va lire comprend trois parties : la
première - du 31 juillet au 21 août - est une tentative
de reconstitution fragmentaire, à 22 ans d'intervalle,
du cahier en question; un résumé de la deuxième -
journées des 21, 22, 23, 24, 25 et 26 août - écrit à la
hâte entre deux séjours sous Verdun, en février-mars, a
paru dans La Foucotte (Bulletin de Guerre) de l'année
1916 (p. 160). J'ai dû le compléter de quelques détails
et de quelques notes. Enfin la troisième partie - étapes
de Gerbéviller à Nancy et Dijon - reproduit,
partiellement, une série de lettres écrites de septembre
à décembre 1914.
Qu'on ne cherche point dans ce récit un chapitre de
l'histoire de la bataille de Lorraine ou de l'histoire
de Gerbéviller. C'est une simple note, d'où a été
volontairement exclu tout fait, même certain, dont je
n'ai pas été moi-même témoin oculaire ou auriculaire à
l'une des dates envisagées, contribuant à donner, au bas
d'une grande page de l'histoire de France et du pays
lorrain, des impressions et l'atmosphère des premiers
mois de la Grande Guerre.
(2) Meurthe-et-Moselle, chef-lieu de canton de
l'arrondissement et à 13 km. sud de Lunéville sur la
Mortagne, affluent de gauche de la Meurthe.
(3) Colonel Dezaunay.
(4) Cette vision - comme bien d'autres de ce premier
mois de guerre - ne s'effacera jamais à mes yeux de son
cadre et, sur le parapet du pont, je retrouve, à chacun
de mes fréquents passages, immuable et muet, le colonel
inconnu, statufié par l'impression profonde de 1914.
(5) Meurthe-et-Moselle, arr. de Lunéville, canton et à 4
km. 500 S. de Gerbéviller.
(6) Meurthe-et-Moselle, arr. de Lunéville, canton et à 5
km. S.-E. de Gerbéviller.
(7) Meurthe-et-Moselle, arr. de Lunéville, cant. et à 9
km. N.-O. de Gerbéviller. Bifurcation sur la ligne de
Paris à Avricourt.
(8) Vosges, chef-lieu de canton de l'arrondissement et à
21 km. E.-N.-E. d'Épinal. Bifurcation sur la ligne
d'Épinal à Saint-Dié.
(9) 1868-1926.
(10) 1842-1920.
(11) 1870-1927.
(12) Comme si quelque pressentiment l'accablait de son
poids. M. le chanoine Vanat, en effet, après avoir
failli tomber sous les coups de l'artillerie allemande,
en allant sous le feu, le 24 août, vers l'église, pour
tenter, en vain, de sauver les Saintes Espèces, fut, le
soir même, à l'arrivée des Allemands, arrêté comme otage
et comme « franc-tireur » (étant accusé d'avoir
développé l'esprit patriotique de la jeunesse et d'avoir
été « l'âme de la résistance » ) traîné sur les champs
de bataille des environs, à la suite des troupes, avec
les autres otages, pour être fusillé, gracié sur le
témoignage de trois prisonniers du 2e bataillon de
chasseurs à pied qui jurèrent devant Dieu qu'aucun
habitant de Gerbéviller n'avait tiré sur les troupes
allemandes et, finalement, après un douloureux exode
(dont il a donné le récit dans le Bulletin de
l'Association des Anciens Prisonniers civils de
l'arrondissement de Lunéville, 1930), interné en
Allemagne d'où il ne revint qu'en 1915, au cours d'un
échange de prisonniers civils et grâce à l'intervention
de S. M. Alphonse XIII, roi d'Espagne, intéressé à son
sort par la marquise, de Gerbéviller, née Soto-Mayor. M.
le chanoine Vanat, né en 1848, à Fraimbois
(Meurthe-et-Moselle, arr. de Lunéville, cant. et à 4 km.
800 au N.-N.-E. de Gerbéviller), chevalier de la Légion
d'Honneur depuis 1933, continue aujourd'hui à diriger sa
paroisse avec un zèle infatigable et exemplaire, entouré
de la vénération affectueuse de ses ouailles et de
l'admiration de tout le diocèse de Nancy et de Toul,
dont il est le doyen des curés en exercice, après
soixante-trois ans de sacerdoce, dont trente et un comme
curé-doyen de Gerbéviller.
(13) Ce passage à niveau est formé par le croisement de
la voie ferrée Mont-sur-Meurthe-Bruyères à son arrivée à
la gare de Gerbéviller (côté Mont-sur-Meurthe) et de la
route de Gerbéviller aux Vosges qui constitue l'artère
principale de la partie de Gerbéviller située sur la
rive gauche de la Mortagne (rue des Ponts, place du
Château, rues Carnot, du Centre (aujourd'hui
Clemenceau), de la Gare (aujourd'hui Maurice Barrès) et
l'un des itinéraires principaux de la trouée de Charmes,
menant vers les ponts de la Moselle, avec les routes de
Lunéville à Bayon et à Charmes. Cette route (ancien
chemin de Grande Communication n° 31, aujourd'hui :
chemin d'intérêt commun n° 22, embranchements divers),
se détache dans Gerbéviller même de la route (autrefois
: départementale n° 8 de Lunéville à Rambervillers,
aujourd'hui : Nationale 414) de Château-Salins à
Rambervillers et c'est à cet endroit que se trouve le
pont de Gerbéviller sur la Mortagne qui commande donc
une des voies d'accès de la trouée de Charmes.
(14) Côte-d'Or, chef-lieu d'arrondissement, 38 km. S.-E.
de Dijon.
(15) Le 8e C. A. appartenait à la Ire armée (général
Dubail) dont il était le corps de gauche en liaison à
gauche avec le 16e C. A. droite de la IIe armée (général
de Castelnau).
(16) Entre Meurthe et Vezouse, à une dizaine de
kilomètres au N.-E. de Gerbéviller.
(17) Blanchard (Antoine), 26 ans, de Chenôve, canton de
Buxy (Saône-et-Loire).
(18) Meurthe-et-Moselle, arr. de Lunéville, cant. et à
10 km. S.-O. de Blâmont et 17 km. N.-E. de Gerbéviller.
(19) Chant du Sub tuum avant la messe et procession
après les vêpres avec récitation des oraisons spéciales
en exécution du voeu perpétuel prononcé par le roi Louis
XIII en 1638 pour placer la France sous la protection de
la Sainte Vierge.
(20) Meurthe-et-Moselle, arr. de Lunéville, canton et à
7 km. S.-O. de Gerbéviller.
(21) Affluent de droite de l'Euron.
(22) Meurthe-et-Moselle, arr. de Lunéville, canton et à
4 km. 750 au S.-O. de Gerbéviller.
(23) Il s'agit du violent combat soutenu héroïquement le
22 août 1914 dans la région Nord de Lunéville (Crion-Sionviller-Cote
305) par la 31e division française (général Vidal) du
16e corps contre deux divisions allemandes, au terme
duquel l'ennemi put pénétrer dans Lunéville.
(24) « Je n'ai jamais vu un tel mouvement de retraite,
me confiait 22 ans plus tard le général Vidal lui-même,
dans la plus grande confusion, mais en bon ordre. »
(25) Les premières patrouilles allemandes sont en effet
entrées à Lunéville, le soir du 22 août et le lendemain
(dimanche 23), le XXIe corps bavarois défilait dans la
ville « fifres et tambours sonnant leur victoire (Adrien
Bertrand, La Victoire de Lorraine, 20e édition, Berger-Levrault,
1917, p. 34).
(26) Du moins entendîmes-nous des détonations sourdes et
isolées que nous interprétâmes ainsi, car, dans ces
premières semaines de guerre, le canon se taisait la
nuit. Ce jour-là, d'ailleurs, le 22 à 23 heures, le
général Ferry, commandant la 22e brigade du 20e corps,
reçut l'ordre de se replier en faisant sauter les ponts
de la Meurthe (maréchal FOCH, Mémoires, t. I, p. 64-65).
Les ponts de Blainville sautèrent vers minuit (Voir A.
MARTIN, Blainville-sur-l'Eau, p. 182).
Et c'est à 4 heures du matin le 23 que l'on fit sauter
le pont de Rosières-aux-Salines (Communication inédite
du général de Ponydraguin lors du passage du Congrès
historique des Anciens Combattants de la Trouée de
Charmes au Léomont le 18 août 1934). Le pont de
Xermaménil (sur la Mortagne) ne sauta que dans
l'après-midi du dimanche 23, à l'apparition des
reconnaissances de cavalerie allemande sur la rive
droite de la Mortagne et c'est également le dimanche
après-midi qu'une tentative maladroite ne réussit pas à
détruire les ponts de Mont (Communication inédite du
commandant Chèvre lors du passage du Congrès historique
des Anciens Combattants de la Trouée de Charmes à
Gerbéviller le 18 août 1934). Le pont de Mont sur la
Meurthe fut détruit par les Français dans les premiers
jours de septembre au cours d'une des fluctuations de
bataille devant un retour offensif de l'ennemi plus
menaçant. Les autres ponts détruits dans la région,
notamment ceux de Rehainviller et Lunéville le furent
par les Allemands au moment de leur retraite vers le 10
septembre.
Notre interprétation des détonations perçues à
Gerbéviller dans la nuit du 22 au 23 août paraît donc
avoir été exacte. Il s'agissait des ponts de Blainville
et de Rosières.
(27) Voir notamment : Le Correspondant, 1913, I, p. 662
et 663.
(28) Charmes, dép. des Vosges, chef-lieu de canton de
l'arr. et à 14 km. N.-E. de Mirecourt; sur la Moselle, à
22 km. S.-O. de Gerbéviller. Il n'est pas superflu de
rappeler que l'expression : Trouée de Charmes, n'a aucun
caractère géographique, moins encore que l'expression :
Grand-Couronné de Nancy, d'origine militaire, elle
aussi, mais qui, du moins, s'applique à un ensemble
orographique bien déterminé. La Trouée de Charmes, terme
purement militaire, désigne la brèche volontairement
laissée, dans le système de fortification conçu par le
général Séré de Rivière et adopté après le traité de
Francfort, entre le système fortifié Belfort-Épinal au
Sud et le système fortifié Toul-Verdun au Nord et
destinée à canaliser une invasion dans une zone où le
terrain, loin d'être une trouée et une voie d'accès
naturelle, présente au contraire une série de coupures
favorables à la défensive.
(29) Meurthe-et-Moselle, arr. de Luné ville, canton de
Lunéville-Sud, à 8 km. N.-E. de Gerbéviller, sur la
Meurthe.
(30) État d'esprit du moment qu'avec le recul des années
on reconnaît comme sien, mais avec la même curiosité que
s'il s'agissait d'un autre que soi... tantum mutatus ab
illo. - J'ignorais alors, n'ayant pas de 2e Bureau à ma
disposition, qu'à Blâmont, les jours précédents, des
hommes de mon âge avaient été brutalement tirés de leur
lit par les Allemands pour être emmenés en captivité.
Cette hypothèse-là, sans doute la pire de toutes et
suffisante pour me faire prendre le large, ne retint
donc pas mon attention.
(31) Meurthe-et-Moselle, arr. et à 18 km. S.-O. de
Lunéville. Chef-lieu de canton à 15 km. O.-S.O. de
Gerbéviller.
(32) Ou, du moins, des éléments de deux divisions de
cavalerie; 2e D. C. et 6e D. C. (dragons et chasseurs à
cheval de Lunéville - dragons et cuirassiers de Lyon)
avec leur artillerie. Le commandant Chèvre, dans sa
communication du 18 août 1934 au Congrès historique des
Anciens Combattants de la Trouée de Charmes, note très
exactement : « Le 22 dans la soirée, le corps de
cavalerie installé dans la région de Moyen-Vallois-Seranville
était couvert par des éléments de la brigade légère de
chasseurs dans la région de Fraimbois et par le 2e B. C.
P. à Gerbéviller. Le 23 pour 9 heures, tous ces éléments
avaient franchi la Mortagne ».
(33) Mort pour la France, sous-lieutenant au 56e R. A.
C. (Voir Livre d'Or de l'Institution de La Malgrange,
Nancy, ancienne Imprimerie Vagner, 1923, p. 141).
(34) Bois de la Reine, 2 km. N. de Gerbéviller.
(35) Toute la journée, en effet, l'adjudant Chèvre et sa
section de chasseurs à pied du 2e bataillon (en garnison
à Lunéville avant la mobilisation) organisent la défense
des passages de la Mortagne qui leur sont confiés. Dans
sa communication du 18 août 1934, le commandant Chèvre
précise : « Une ligne d'avant-postes fut établie sur la
Mortagne :
2e compagnie à Mont; - 3e compagnie à Lamath; ire
compagnie à Gerbéviller.
Le capitaine Thomassin répartit sa compagnie en deux
échelons :
Une section à Haudonville (lieutenant Gamelin) ; Une
section à Gerbéviller (adjudant Chèvre) ;
Les autres sections sur la croupe à l'Ouest du bois d'Haudonville.
Pour ces unités la journée du 23 se passa à organiser la
résistance sur la Mortagne. »
Dans notre quartier opposé à la direction de l'ennemi,
nul ne se doute même de leur présence, encore moins de
leurs préparatifs : « rues barricadées sur toute leur
profondeur et largeur; tranchées profondes en avant du
village. Pas un chasseur dans les maisons. »
(Communication précitée du commandant Chèvre).
(36) Meurthe-et-Moselle, arr. de Lunéville, cant. et à 4
km. S.-E. de Gerbéviller.
(37) En ce début de guerre tout cavalier ennemi était
volontiers baptisé uhlan. Il ne faut donc pas attacher
ici à ce terme la précision qu'il pouvait avoir dans la
nomenclature de l'armée allemande.
(38) Cf. Echo de Paris, 28 août 1915. Notes du
lieutenant Gamelin publiées par Maurice Barrés.
(39) Que je ne devais d'ailleurs jamais retrouver par la
suite.
(40) Madame veuve François, née Thiéry-Bonneville
(1844-1916), de Nancy.
(41) Mademoiselle Célestine Wittrich (1854-1932), de
Neuf village, en Lorraine annexée de langue allemande,
aujourd'hui département de la Moselle, arr. de
Château-Salins, cant. et à 5 km. O.-S.-O. d'Albestroff.
(42) Tandis que, de l'autre côté de la Mortagne, à notre
insu, le pillage et le massacre accompagnaient
l'incendie. Voir Rapports et Procès-verbaux d'enquête de
la Commission instituée en vue de constater les actes
commis par l'ennemi en violation du droit des gens,
Imprimerie Nationale, 1915, t. I, p. 27-29, 32-138,
148-168.
(43) Meurthe-et-Moselle, arr. de Lunéville, canton et à
0 km. 750 au N.-O. de Gerbéviller.
(44) Magnifique marbre blanc, réplique de celui qui fait
aujourd'hui partie des collections du Musée du Louvre
après avoir appartenu aux collections du Musée du
Luxembourg de 1871 à 1926. Il avait été offert au
marquis de Gerbéviller, en témoignage de reconnaissance,
par l'auteur auquel son Tarcisius avait valu une
médaille au Salon de 1867, quand il avait été exposé à
Paris, comme envoi de Rome, et qui obtint l'année
suivante pour cette réplique la médaille d'Honneur du
Salon. Car c'est sur les indications du marquis de
Gerbéviller, Ernest de Lambertye-Tornielle (1828-1904),
alors à Rome, qui lui en avait fourni le modèle et
l'idée, en lui présentant un petit Romain dont il avait
remarqué le type pour en faire un saint Tarcisius, que
Falguière en avait entrepris l'exécution. Il paraît
qu'examinant avec le marquis de Gerbéviller la maquette
qu'il venait de terminer, Falguière, mécontent de
l'effet, eut l'idée de tailler dans la glaise et de
retirer une tranche de quelque épaisseur de la partie
inférieure du corps. Rapprochant et rajustant les deux
morceaux, il obtint alors ce ploiement recroquevillé des
jambes qui, joint à l'expression douloureuse et pure du
visage, donne à cette oeuvre splendide tout son accent
tragique, si remarquablement mis en relief dans la niche
qui lui avait été ménagée dans sa chapelle par le
marquis de Gerbéviller.
(45) Bronze célèbre (Salon de 1863) retrouvé à peu près
intact, quoique mordu par les flammes, après l'incendie
de la chapelle, comme le montre la photographie que nous
publions. Prêtée à l'Administration des Beaux-Arts en
1917 pour une exposition des objets d'art mutilés,
provenant des provinces envahies, exposition qui fut
prolongée et transférée en Amérique, cette statue fut
volée à Philadelphie dans des circonstances restées très
mystérieuses et, malgré toutes les démarches de M. le
marquis de Lambertye, jamais retrouvée.
(46) Je ne pouvais penser - car alors ces notions
m'échappaient et il aurait fallu être au courant des
intentions du commandement - qu'il ne s'agissait que
d'un combat d'avant-postes, devant une position de
résistance que chaque heure gagnée rendait plus solide
et garnissait d'effectifs plus frais et moins encore que
l'ennemi prêtait le flanc à la IIe armée française, dont
le chef jetait alors (le 24 à 11 h. 15) les bases de la
contre-attaque victorieuse du 25.
(47) Que leur ont fait ce château, cette église, cette
bourgade paisible dont les maisons n'ont même pas servi
d'abri aux chasseurs qui défendaient les passages de la
rivière ? Reçus à coups de fusils après trois jours
d'une poursuite qui leur avait donné à penser qu'une
brèche définitive était ouverte dans notre front, les
Allemands n'ont pu deviner qu'à Gerbéviller se jouait le
prélude du redressement français. Ils ont prétendu
faussement, sans avoir jamais pu en apporter la preuve
ou le témoignage, que les habitants avaient tiré parce
qu'une de leurs premières victimes - on l'a su plus tard
- avait été un de leurs officiers supérieurs un major
(chef de bataillon), tué par un des premiers coups de
feu des chasseurs de l'adjudant Chèvre (qui faisaient du
tir ajusté « au lapin »), comme il pénétrait dans la
localité pour en reconnaître les défenses.
Ivres de rage, ils n'en étaient pas à un mensonge près
pour trouver un prétexte aux atrocités auxquelles leur
cruauté avait voué notre malheureux pays. Et ce mensonge
était si gros que jamais ils n'ont osé en faire état
dans leurs récits de guerre. Au contraire, voulant
cacher le sort barbare qu'ils ont délibérément infligé à
Gerbéviller sans l'ombre d'une raison ou d'un prétexte
avouables ou vraisemblables, et alors que, seuls, le
château et sa chapelle et la tour de l'église furent
incendiés par les obus, ils écrivent dans leur relation
officielle de la guerre : « Sous le tir efficace des
canons allemands, cette localité (Gerbéviller) se mit à
flamber, ce qui en rendit complètement impossible la
traversée par nos troupes (Archives du Reich. La guerre,
mondiale, t. I, 5e partie, p. 578). Voilà comme on écrit
l'histoire quand on ne veut pas avouer qu'une section de
chasseurs à pied a tenu en échec pendant plus de 8
heures une brigade allemande.
(48) Les avant-postes de Lamath et de Mont n'ayant pu
tenir aussi longtemps qu'à Gerbéviller, la retraite de
l'adjudant Chèvre et de sa section fut particulièrement
difficile, car les Allemands s'étaient infiltrés sur la
rive gauche de la Mortagne en aval de Gerbéviller. Après
s'être heurtés à une compagnie allemande qui creusait
des tranchées aux lisières de Gerbéviller et dont ils
réussirent à passer inaperçus, les défenseurs de la
Mortagne trouvèrent Remenoville occupé par l'ennemi et
ne purent rallier les lignes françaises qu'en se jetant
dans les bois au Sud de Gerbéviller et, à la faveur de
la nuit, atteindre le 25 à 3 heures du matin les
avant-postes du 8e C. A. au delà d'Essey-la-Côte
(Meurthe-et-Moselle, arr. de Lunéville, canton à 8 km.
500 au S.-O. de Gerbéviller). (Communication précitée du
commandant CHÈVRE le 18 août 1934. Voir également les
notes du lieutenant GAMELIN dans l'Echo de Paris du 28
août 1915).
(49) Du 166e R. I. (62e Br.-31e D. I.-XXIe C. A.) en
garnison à Bitche avant la guerre.
(50) Instinctif optimisme de la jeunesse ! Pas un instant
l'idée ne m'effleura que j'étais peut-être bloqué
définitivement dans les lignes allemandes. Ma confiance
dans le succès de nos armes ne me laissait pas douter un
instant que ce ne fût qu'un mauvais moment à passer.
(51) Alors que dans d'autres maisons, tant de
malheureux, au sortir de leur cave, ont été accueillis à
coups de revolver ou faits prisonniers (Voir : Rapport
et Procès- Verbaux d'enquête de la Commission instituée
en vue de constater les actes commis par l'ennemi en
violation du Droit des Gens, Imprimerie Nationale,
MDCCCCXV, t. 1), j'ai trouvé devant moi un coeur
généreux, une exception dans la masse, un bras indigné
qui refusait d'exécuter les assassinats commandés.
Assassinats commandés, car j'ai toujours considéré qu'en
précisant : « qu'il disparaisse pendant trois jours,
sans quoi il serait fusillé », cet Allemand apportait
une preuve que les assassinats et les atrocités commises
par l'ennemi à Gerbéviller avaient été prescrits par
l'autorité allemande et résultaient d'un mot d'ordre,
d'une consigne, donnés par le commandement. Entré chez
moi en compagnie d'un camarade capable de le dénoncer,
cet Allemand eût-il pu prendre une initiative aussi
généreuse et tellement compromettante pour lui qu'il
disparut de son côté, qu'on ne le revit plus dans la
maison et qu'il fut impossible de gratifier son humanité
de la moindre bouteille de vin, ni du moindre merci.
J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un Lorrain, car
les Lorrains et les Alsaciens étaient assez nombreux
dans cette division.
Le Pays lorrain - 1937
Le Bouchon sur la Vague
Témoin invisible et aveugle, je n'ai plus qu'à prêter
l'oreille aux bruits du dehors.
Dans la maison, l'ennemi s'installe, criant, vociférant,
éparpillant dans le vestibule la paille bruissante. Un
moment, des pas lourds se font entendre dans l'escalier.
Mon coeur se serre, mais ils s'arrêtent au premier étage.
Ces Messieurs visitent plutôt la cave que le grenier.
Derrière les Allemands sont entrés une foule de
sinistrés, femmes et enfants surtout, pleurant
gémissant, tout émus des horreurs dont ils viennent
d'être les témoins. Des bribes de conversations me
parviennent.
Je reconnais des voix. Et toujours en plein drame, le
burlesque : au milieu de ces pleurs et de ces cris,
jaillit, tonnante, la voix irritée et impérative de la
domestique qui clame, en claquant les portes : « Les
cochons ! Ils m'ont volé mes haricots ! » Et je
l'entends réclamer un chef et raconter que le plat de
haricots qui cuisaient sur le feu lui avait été
subtilisé, pendant qu'elle avait le dos tourné. Car
malgré les circonstances tragiques, elle ne négligeait
pas les devoirs de sa charge et ne pouvait admettre que
quelqu'un pénétrât dans sa cuisine.
Petit à petit, le bruit à l'intérieur se calme.
Du dehors parvient une autre rumeur : dans un mélange de
cris gutturaux et sauvages, les interjections et les
commandements des Teutons avinés, où percent les Hoch !,
les Nach Nanzig !, Nach Paris !, les hymnes guerriers
rejoignent le cliquetis des bouteilles brisées ou
poussées du pied, le fracas des portes et des fenêtres
enfoncées, des vitres en éclat, le roulement des
caissons pilant le verre qui jonche la rue, le
piétinement des bataillons en marche vers l'avant, les
beuglements des bestiaux lâchés, les pleurs affolés des
femmes et les plaintes d'enfants perdus et appelant : «
Maman ! Maman ! » La nuit tombée l'incendie éclaire mon
grenier de lueurs dansantes. J'ai un instant la peur de
devenir ou d'être devenu fou.
Bientôt c'est presque le silence. En bas les Teutons
ivres ronflent comme des moteurs et l'on peut m'apporter
quelques aliments, du poulet froid, du chocolat et une
bouteille d'eau de Seltz, un pardessus et des nouvelles.
J'apprends le carnage auquel se sont livrés les
Allemands, les premières victimes connues : l'ancien
instituteur François, abattu d'un coup de revolver quand
il sortait de sa cave dans la rue, M. le curé, emmené
comme otage. Jusqu'à présent tous les miens sont sains
et saufs et réunis chez moi, car la maison Labrevoit,
comme la maison de mon grand-père Godfrin (1), est en
flammes. Mais la cuisinière de ce dernier a disparu (2).
La formule livresque : « à feu et à sang » danse dans ma
tête, comme une scie obsédante. Aucun incendie aux
environs immédiats. Mon oncle Labrevoit me recommande de
ne pas bouger et me fait dire qu'il n'a pas le courage
de monter lui-même et de me voir dans cette position
misérable. Une liaison sera assurée toutes les fois que
la chose sera possible sans éveiller l'attention, par sa
soeur, ma tante Labrevoit (3), ma grand'mère et la
domestique, qui, seules avec lui, ont connaissance de ma
présence et de ma cachette. Pour éviter les impairs
possibles, à cause de sa surdité, et en même temps le
tranquilliser, on a fait croire à mon grand-père que
j'avais pu partir dans la journée et c'est la version
répandue parmi les sinistrés qui ont envahi la maison.
Un officier allemand se prélasse dans mon lit et c'est à
grand'peine que les divers membres de ma famille ont pu
se réserver les matelas où ils vont s'étendre tout
habillés. On me rapporte également ces propos d'un autre
officier allemand au docteur Labrevoit : « Votre pauvre
pays ! Ça ! c'est du vandalisme ! » (4) Dans l'obscurité
et la solitude la clarté de l'incendie m'inquiète. Je me
déchausse et, avec mille précautions, retenant ma
respiration et l'oreille tendue, je sors de ma cachette.
Puis, à l'aide de mon échelle, je monte successivement
aux lucarnes tournées vers les quatre coins de
l'horizon. Le vent est bon et, toujours des secteurs
Ouest, écarte les flammèches. De plus nul feu n'est
allumé dans les environs immédiats, car, à cette heure,
et je ne m'en doute pas, l'énergique soeur Julie est
intervenue pour arrêter l'incendie dans notre quartier
(5).
Mais quelle vision infernale dans la sérénité d'une
belle nuit d'août ! Les étoiles pâlissent devant la
flamme qui monte de la ville en feu. Le clocher tout
proche domine le sinistre comme une haute torche. Des
millions d'étincelles grimpent vers les astres en une
danse fantastique et, dans le craquement des poutres et
des planches, les pierres disjointes tintent en
dégringolant des murs vers le sol. Dans cet
anéantissement, que de souvenirs engloutis : dans la
maison de mes arrière-grands-parents, toute pleine des
absents, et dans les demeures amies où se sont épanouies
jusqu'à hier nos exubérances de jeunesse
 ! !
Soeur Julie.
Malgré l'horreur qui m'environne, je peux, dans ma
cachette réintégrée, m'endormir profondément, rassuré
sur les risques d'incendie.
C'est un violent coup de canon qui me réveille le mardi
25 août aux premières heures du jour, alors que la
chaleur étouffante de la veille a fait place sous les
tuiles à la plus pénétrante fraîcheur. Se sent-on plus
près du ciel quand on n'en est séparé que par
l'épaisseur d'un toit ? Ma première pensée en cette
aurore du 25 août est une prière qui jaillit, ardente,
convaincue de son efficacité, car j'y mets
instinctivement tout l'effort que je ne puis porter
ailleurs : « Saint Louis, roi de France, saint Louis,
fêté chez nous jusqu'à l'année dernière, comme la fête
de famille par excellence, la fête du père et du chef,
saint Louis, aux enfants de vos sujets qui défendent
leurs foyers, à nos canons qui tonnent, donnez la
victoire, aidez-les à repousser l'ennemi et sauvez-nous
! »
La première liaison que j'ai avec le monde extérieur
m'apprend que les Allemands qui cantonnaient à la maison
l'ont quittée de bonne heure. On respire plus à l'aise.
Aucun des miens ne manque à l'appel. La nuit a été très
agitée. Allées et venues incessantes de sinistrés,
cherchant un abri, des parents, des amis, des voisins,
Une fillette blessée, la petite Solange Schneider, que
sa mère emportait toute sanglante dans ses bras, a été
hébergée un instant à la maison (6). Puis ce fut le
départ des troupes allemandes. Et maintenant la bataille
s'est rallumée tout près de nous. Le défilé des
régiments allemands qui vont au feu est ininterrompu.
Mais ils ont autre chose à faire aujourd'hui que de
s'occuper des malheureux habitants de Gerbéviller. Mon
oncle est retourné à l'hospice pour y panser les blessés
et aider les soeurs autour des médecins allemands. Nous
sommes nettement en dehors de la ligne de feu. Il n'y a
qu'à prier : « Saint Louis ! saint Louis ! saint Louis !
» La canonnade redouble. La bataille se fait plus
intense, comme la chaleur du jour qui rend à nouveau
suffocante l'atmosphère de ma soupente. J'en sors avec
plus de précaution encore que dans la nuit pour tenter
un tour d'horizon et tâcher, par les mansardes, très
discrètement, de jeter un coup d'oeil dans la rue. Tout
Gerbéviller qui achève de se consumer fume encore. Par
ci, par là, un toit encore intact. En face de chez moi,
la maison de Madame Victor Henry (7), ma cousine, paraît
pleine de réfugiés, au milieu desquels elle-même va et
vient de son train alerte. Des soldats allemands se
reposent sur son trottoir ou adossés au mur et à la
grille de son jardin. Une colonne de cuisines roulantes
monte la rue. C'est la première fois que je vois cet
ustensile dont l'armée française est dépourvue.
L'officier qui la commande s'arrête pour demander son
chemin. J'entends qu'on lui répond : « Mais vous tournez
le dos à Fraimbois ! » C'est pour les Allemands la
direction de l'arrière et comme on croit facilement ce
qu'on désire, j'y vois un signe de retraite. Vers midi
mon oncle Labrevoit quitte l'hospice pour se restaurer
et se reposer un instant à la maison. « Ils sont en
train de recevoir une pile, me fait-il dire, les blessés
allemands affluent à l'hôpital; je panse des blessures
terribles, dont je n'avais pas idée, produites par obus.
Notre 75 fait merveille. Et un médecin allemand qui dit
quelques mots de français m'a déclaré d'un air qui en
disait long : « Oh ! c'est une chaude bataille ! » Quel
meilleur assaisonnement pour les quelques rogatons qu'on
peut m'apporter !
Vers 2 heures de l'après-midi, toujours circulant avec
mon échelle d'une lucarne à l'autre, pour observer tout
ce que je pouvais de la bataille, je vois, non plus des
cuisines roulantes ou des convois de ravitaillement,
défiler dans le bon sens, c'est-à-dire vers l'arrière,
en retraite, mais bien des troupes combattantes qui
viennent de la direction de Remenoville ou de Moriviller
(8). Et les bataillons se suivent, harassés, m'apportant
l'espoir de la délivrance. Quelle différence d'allure
avec les cris, les « Hoch ! » et les « Hurrah ! » de la
veille au soir ! Une ombre pourtant à ce spectacle
joyeusement réconfortant : en queue d'une colonne,
quatre de nos soldats, prisonniers et blessés, suivent
péniblement, désarmés et livides. Je pense au malheureux
évadé de l'hospice la veille. Est-ce là son sort ?
D'heure en heure, la retraite s'accentue. A la fin du
jour, sur le vieux banc de pierre des Guyon, un feldgrau
éreinté, le fusil entre les jambes, se repose l'oeil
morne et vide. La maison est bientôt envahie par des
fantassins allemands qui cantonnent dans notre quartier
intact, mais combien plus calmes que ceux d'hier ! Ils
ont l'air, ce soir, apprivoisés. Ce n'est pourtant pas
encore le moment de me montrer.
« Qu'il disparaisse pendant trois jours !... »
Quand la nuit achève de tomber, c'est par les routes de
Seranville et de Remenoville, non plus l'infanterie qui
se replie, mais l'artillerie au trot, lancée dans nos
rues obscures et encore enfumées, dans le tonnerre des
roues et les glissades des chevaux au milieu des culs de
bouteille brisées, des cris des conducteurs et des
à-coups d'une retraite effectuée « l'épée dans les reins
». Des tableaux de la Galerie des Batailles se
projettent dans mon imagination. Et je suis persuadé
qu'au bout de cette déroute, les nôtres vont déboucher,
vainqueurs et libérateurs. Dans la nuit de ma soupente,
j'écoute avidement ce tintamarre qui sonne à mon coeur
anxieux une fanfare de fête, annonciatrice de la
victoire et de la délivrance : « Saint Louis, saint
Louis ! » (9)
C'est pourtant encore un calme relatif qui règne à
nouveau quelques heures plus tard.
Le mercredi matin, après le départ des troupes
allemandes, qui nous ont quittés tôt dans la nuit, notre
quartier paraît désert. La bataille reprend, plus
proche, mais moins intense. Cette fois nous sommes en
pleine ligne de feu; il est manifeste que nous sommes
entre les deux lignes d'artillerie adverses. De mon toit
je distingue nettement les coups tirés au sud-ouest par
l'artillerie française des coups tirés au nord-est par
les pièces allemandes et les deux séries de trajectoires
de sens opposés que je m'amuse à suivre à l'oreille dans
le ciel, réalisant distinctement la voûte virtuelle dont
elles m'enveloppent. Je n'aperçois aucun point de chute.
De temps en temps un coup fusant éclate haut dans le
ciel, tantôt à droite, tantôt à gauche. Ce duel
d'artillerie ne s'intensifie à aucun moment. Nos rues
sont libres. Plus d'Allemands, sauf quelques
patrouilles. Je me hasarde à descendre à la cave.
Désagréable surprise pour quelques personnes réfugiées à
la maison qui dès lors ne leur paraît plus sûre et vont
camper ailleurs. J'éprouve une satisfaction, aussi vaine
que malicieuse, à me sentir compromettant. Mon oncle
Labrevoit, pourtant, estime que je commets une
imprudence et m'engage à remonter dans ma cachette. Des
patrouilles peuvent entrer d'un moment à l'autre. En
même temps j'aperçois par le soupirail ouvert les jambes
de quelques Allemands qui, le fusil à la main,
s'avancent avec précaution au milieu de la rue. Je
remonte au grenier, séjour d'ailleurs infiniment plus
agréable, car j'y suis comme à un observatoire.
L'après-midi, entre les coups de canon, on perçoit de
temps en temps des coups de fusil, plus ou moins
nourris, des rafales espacées de mitrailleuses. L'action
d'infanterie paraît très rapprochée. Il est bien tentant
de se rendre compte de la tournure que prennent les
opérations. Malheureusement mes vues sont très
restreintes. Vers la ville, rien que le champ des ruines
et son rideau de fumées. Deux maisons qui n'avaient pas
été incendiées le lundi, les maisons Hérique et Picot au
faubourg Saint-Pierre, et qui ont pris feu plus tard,
achèvent de se consumer. La tour de l'église,
terriblement mutilée, a pris une silhouette tragique.
Vers le Sud j'aperçois la plus grande partie de la
Christienne (10). Après de longues minutes
d'observation, je distingue enfin tout un détachement de
fantassins allemands, peut-être une demi-compagnie, dans
la position du tireur couché, en deçà d'une haie à
travers laquelle ils sont prêts à faire feu. L'uniforme
« feldgrau» quand le soldat est immobile le fait
vraiment disparaître dans le paysage. Sur le chemin qui
gravit la côte, un cavalier allemand s'avance au trot
vers le sommet. Il s'approche des fantassins, puis
repart comme il était venu. Deux hommes se détachent du
groupe et déroulent sur l'herbe un drap blanc, panneau
de signalisation pour l'aviation ou l'artillerie. Je
prolonge mon guet sur l'échelle dans l'attente de ce qui
va se passer, mais plus rien ne bouge.
On replie le panneau.

Gerbéviller. Eau forte de V. Prouvé.
En bas, dans le jardin de la maison voisine qu'habite le
successeur de mon père, Me David, notaire, je vois
passer le principal clerc, Joseph Bédé (11), à qui a été
confiée la garde de l'étude. C'est un familier de la
maison qui m'est resté très attaché et que je suis
heureux de voir sain et sauf. Mais je n'ose
l'interpeller, bien qu'il soit presque à portée de la
voix basse.
Au passage à niveau un cavalier allemand est en faction,
serré contre le mur des maisons qui bordent la droite de
la rue, observant la route de Remenoville et les crêtes
toutes proches. De ma lucarne, je vois de l'autre côté
de la crête, sur la pente qui descend vers le ruisseau
(12) de Haudonville, ou de Moranviller, (13), un
cavalier galoper pour aborder la crête de biais, sans la
dépasser, en se dissimulant, cherchant ostensiblement à
voir sans être vu. Son allure, la teinte foncée de son
uniforme, tout me dit que c'est un des nôtres. Mais il
disparaît avant que cet espoir puisse devenir une
certitude. J'en garde la conviction que nos troupes
approchent. Je les sens, je voudrais les appeler; il y a
maintenant près de 24 heures que je les attends.
Sur la fin du jour une batterie française qui paraît
toute proche se met à chanter de sa voix franche et
agressive, faisant éclater les carreaux subsistants du
sac de l'avant-veille. Je fais ma réapparition à la
cave. Elle redevient plus sûre au moment où le combat se
rapproche de nous et il y a de moins en moins de danger
à me montrer. L'attitude de l'ennemi est nettement
passée de l'offensive à la défensive.
Une nouvelle fois la nuit vient suspendre les opérations
et après une fusillade nourrie et prolongée qui nous
donne l'impression d'être au beau milieu de la bataille,
le combat s'arrête à quelque cent mètres de la maison,
aux lisières ouest de Gerbéviller. Quelques heures
après, dans la soirée, un groupe de 3 ou 4 soldats
allemands passe dans le quartier, cherchant on ne sait
quoi, quêtant des vivres, ou un gîte, peu hardis, tels
des maraudeurs qui craignent d'être pris en faute,
peut-être des candidats déserteurs ? Décidément, nos
affaires vont bien.
III
La vie cependant devient bien difficile dans Gerbéviller
en ruines et sous le feu. Les vivres se raréfient et le
ravitaillement est pour le moment impossible. Il faut
absolument abandonner un pareil séjour et profiter de la
nuit pour gagner, provisoirement, à l'arrière, une zone
plus habitable, hors du champ de bataille. Tous debout à
1 heure du matin, le jeudi 27 août, nous délibérons sur
l'opportunité du départ. La décision est bientôt prise.
En parcourant la maison, où je relève les traces du
passage de l'ennemi : confitures répandues sur les
meubles du salon, heureusement recouverts de leurs
housses, déjections alignées dans le vestibule et
marquant chacune des places occupées et le relent infect
qui s'en dégage, je retrouve ma bicyclette et je la
prépare. Mais on ne mobilise pas facilement des femmes
et des vieillards peu ingambes. Ce n'est qu'un faux
départ. Les hésitations reprennent. J'en retiens cette
belle déclaration de la domestique : « Si Madame ne s'en
va pas, je reste ! » Tout le monde redescend à la cave,
car les Prussiens avaient prévenu que la bataille allait
reprendre au petit jour. A quatre heures du matin, tout
est encore calme. Vers cinq heures, on sort les têtes
aux portes. Pour la première fois, depuis le lundi 24, à
4 heures et demie du soir, je me montre sur le trottoir.
Les ruines fumantes cessent à l'hospice et notre
quartier proprement dit n'a pas changé.Mais on ne voit
que des visages défigurés, pâles et amaigris, beaucoup
hagards, presque méconnaissables, tel M. Liégey (14)
poussant des bestiaux qu'il emmène je
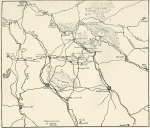
ne sais où. La rue est jonchée de verre pilé. Vers 5
heures un quart ou 5 heures et demie des cavaliers
apparaissent à la barrière du chemin de fer, comme
quinze jours plus tôt les chasseurs de Beaune. Je les
reconnais aussitôt pour des dragons français. La vue de
nos uniformes dans cette atmosphère empestée, puant le
prussien jusque dans la rue, c'est comme un courant
d'air pur et sain. Et me voilà courant dans la maison,
pour annoncer la bonne nouvelle et criant, dans une joie
folle, les larmes aux yeux : « Nous sommes sauvés !
Voilà nos dragons ! » Je ressors et mon oncle Labrevoit
me fait rentrer, croyant que ce sont encore des
Allemands. N'y avait-il pas une seconde plus tôt un
uhlan près de la mairie ? Mais le doute n'est plus
possible. Alors, brusquement, ma décision personnelle
est prise. Las de me cacher dans le grenier, de vivre
dans des transes inutiles, constituant un danger pour la
maison, je me résouds à fuir dans les lignes françaises,
avec l'idée de revenir derrière nos troupes en ne
restant séparé des miens que quelques jours, quelques
heures peut-être, le temps de préparer leur propre
retraite. Je cours à la cave pour les embrasser et leur
annoncer mon départ et après cet adieu rapide, un
dernier regard sur nos ruines pantelantes, laissant en
toute confiance ma maison dans les lignes françaises, je
m'éloigne, la bicyclette à la main. A la gendarmerie un
maréchal des logis de dragons m'arrête et me demande mon
identité. Je me déclare fugitif, désirant me mettre à
l'abri dans les lignes françaises. Il m'envoie au
colonel ou au général que je rencontrerai sur la route
et me recommande de fuir au plus vite si je ne veux pas
« recevoir des pruneaux ». Déjà l'instant d'avant mon
départ un coup de feu avait été tiré dans le bas de
notre rue. Je roule en bicyclette sur la route de
Remenoville, pensant gagner Charmes. Aux « Noyers de
Chappée (15) » peu s'en faut que je tombe dans le
cadavre d'un Prussien, étendu en travers de la route et
que, dans le jour un peu gris, je n'avais pas aperçu.
J'ai un double sursaut involontaire, d'abord parce que
je ne le crois pas tué, ensuite parce que c'est le
premier mort que je vois autrement qu'en un lit entre
deux cierges. Mon frisson s'est vite évanoui dans une
impression de soulagement en constatant qu'il est hors
d'état de nuire.
Je remarque bientôt d'autres cadavres allemands dans les
houblonnières et les champs voisins. Ce sont les traces
du combat qui a terminé la journée la veille au soir. Je
ne rencontre plus personne, ni morts, ni vivants,
jusqu'au Petit Mezan (16).
Là je rattrape le cantonnier Finot et son fils qui vont
à Charmes à pied et je leur donne un peu du chocolat que
j'avais pris la précaution d'emporter, car ils meurent
de faim. A partir de la Tuilerie (17), notre infanterie
s'avance lentement, en lignes de bataille échelonnées,
qui barrent tout le vallon. Sur la route de nombreuses
estafettes, des officiers, qui, tous, m'arrêtent et
m'interrogent. L'un d'eux, un commandant, me demande mon
nom, puis des nouvelles de ma famille, qu'il connaît
bien, car il est le gendre de Me Bertrand, l'ancien
notaire de Lunéville et, en cours de manoeuvres, a déjà
logé à la maison. Cette rencontre inattendue au milieu
de cette armée en marche, à deux pas de l'ennemi, dans
des conditions qui me rendent presque étranger un pays
familier, me met du baume au coeur (18).
J'ai fait à peu près jusqu'à Remenoville la route à
pied, sous la pluie qui commençait à tomber, car le
grand beau temps des jours précédents a fait place au
ciel gris. Des cadavres d'hommes et de chevaux dans les
champs. Des retranchements abandonnés la veille par les
Allemands.
Nos soldats me montrent les pins de la « Corvée du
Hérisson » (19) en me disant

Photo Bastien
Le champ de bataille entre Gerbéviller et Moyen. Le
viaduc et la passerelle sur la Mortagne.
que la veille au soir on s'y est beaucoup battu. Pauvre
Corvée ! Quelles promenades y ferai-je encore désormais?
A l'entrée de Remenoville, je rencontre les premiers
cadavres français. Nouveau frisson, combien douloureux
et prolongé ! Derrière un petit mur de jardin qui est à
gauche un peu avant l'entrée du village (20) des
fantassins, sur un rang, broyés par le tir ennemi, sont
là, crispés, ayant encore le fusil à la main. Plusieurs,
figés par la mort instantanée, le fusil en joue, sont
restés debout, soutenus par le mur auquel ils
s'appuyaient, l'oeil à la hausse, comme hypnotisés dans
un tir éternel (21).
En arrivant à Remenoville, je vais à la cure. Quelques
maisons seulement du village étaient brûlées. Je ne
trouve au presbytère que les parents du curé car
celui-ci, mon ancien maître, l'abbé Drouville, a été
arrêté la veille et prévenu d'espionnage dans les
conditions suivantes : à peine Remenoville réoccupée par
l'armée française au matin du 26, les Allemands se
mirent à canonner le village. Une maison prit feu. Un
habitant de Bonviller (22) réfugié à Remenoville chez
ses beaux-parents courut à l'église pour sonner le
tocsin. Il fut aussitôt arrêté comme espion et soupçonné
d'avoir voulu faire un signal à l'ennemi. Averti, le
curé, connaissant l'honorabilité de l'accusé et certain
de son innocence, s'interposa en sa faveur auprès du
colonel commandant le 333e R. I. (23). Pendant ces
explications un soldat s'écria : « C'est un faux prêtre
! Il n'a pas de tonsure ! » A ces mots le colonel mit
également l'abbé en état d'arrestation et le fit
emmener; ses parents ne savent ce qu'est devenu leur
fils et sont profondément désolés d'une pareille
aventure (24). Je leur demande un peu d'eau, car j'ai
très soif et n'ai sur moi qu'un peu de chocolat et des
oeufs durs.
Un soldat me conduit, en sortant de la cure, vers le
général de division installé à Remenoville, pour obtenir
un laissez-passer pour Charmes. On me fait entrer dans
la salle à manger de la maison Bailly où siège tout
l'état-major. Je me présente au général, décline mes
noms et qualités. Je lui dis que je compte m'abriter
derrière les lignes françaises pour revenir dans
quelques jours à Gerbéviller où est restée ma famille et
où doit me rejoindre ma feuille de route de la classe
14. Le général me fait raconter ce que j'ai vu depuis le
lundi matin et pour la ne fois depuis mon départ, avec
plus d'ordre et de détails cette fois peut-être, je
recommence mon récit. Un capitaine prend note de mes
déclarations. Le général se donne la peine de
m'expliquer que, la veille au soir, c'est la nuit qui a
arrêté le combat aux portes de Gerbéviller, au moment où
nous réussissions à repousser une contre-attaque des
Allemands, car, mis en confiance, j'avais terminé, avec
autant de toupet que de naïveté, en exprimant mon
étonnement que Gerbéviller n'ait pas été réoccupée dès
la fin de la journée précédente. Mais il ajoute que nous
continuons à avancer et que d'ici à quelques jours je
pourrai fort probablement retourner à Gerbéviller
complètement dégagée. Il me fait encore préciser
l'impression produite par les troupes allemandes et le
moral apparent de l'ennemi. Enfin, à ma grande
stupéfaction, il me demande à quel endroit, à mon avis,
se sont repliés les Allemands. Je lui indique comme
ligne ennemie probable la lisière des forêts sur la rive
droite de la Mortagne (25). A la fin de
l'interrogatoire, le général me demande : « Alors!
Qu'est-ce que vous avez mangé ces jours-ci ? » Et il
m'offre une tranche de viande froide sur un morceau de
pain que j'accepte avec plaisir. Il me signe ensuite le
laissez-passer qu'avait préparé sur une feuille arrachée
d'un bloc-notes un de ses officiers. J'apprends alors
que j'avais affaire au général Vidal, commandant la 31e
division d'infanterie du 16e corps. Ce papier me dirige
sur Clayeures (26) où le commandant de corps d'armée
doit m'en donner un autre.
La pluie a cessé. Me voilà parti vers Moriviller par un
chemin affreux, dans une boue liquide, au milieu des
convois et des troupes. Ce gentil chemin accidenté qui
relie Remenoville à Moriviller, que j'ai parcouru
plusieurs fois, à cheval, aux vacances dernières,
traverse une région où la lutte a été très dure,
notamment à la pointe du bois de Réthimont où une
batterie allemande a dû être prise sous le feu de nos
canons. Beaucoup de cadavres d'hommes et de chevaux.
D'immenses trous dans les champs, creusés par les obus.
Des caissons abandonnés, des roues brisées, des sacs,
des tranchées, de la charogne, des corbeaux et des
ramiers dans le ciel et, sur les arbres, des mirabelles
tranquilles et dorées. A chaque pas des souvenirs me
montent à la tête et me donnent le vertige. Quelques
années plus tôt, en suivant sur ce chemin les grandes
manoeuvres d'automne, nous avons vu ici, mon père et moi,
derrière cette crête une batterie d'artillerie en
action. Où est le simulacre ? Où est le rêve ? Une fois,
à bicyclette, j'ai réveillé là un renard qui dormait sur
la route et, plus loin, je me revois dans notre vieux
phaéton, attelé de « Coco », quand nous allions faire
des testaments...
La route est encombrée par tout un groupe du 3e régiment
d'artillerie lourde, prêt à remettre en batterie ses
gros canons de 155 court. Je raconte une nouvelle fois
mon odyssée à des officiers qui me disent que ce sont
eux, la veille au soir, entre 6 et 7 heures, qui ont
cassé nos carreaux. Avec bien du mal, j'atteins Moriviller où quelques maisons brûlent encore. J'y
trouve un encombrement de troupes de toutes armes et de
fugitifs de Gerbéviller et d'Haudonville. Je bois à
grandes lampées à la fontaine, car la soif ne me quitte
pas. Je monte ensuite la côte vers Clayeures. Là encore
on s'est beaucoup battu. Des tranchées abandonnées par
les Allemands sont utilisées par nos troupes; encore et
toujours des cadavres. Des fumées de bivouac, des autos,
des fourgons et des coups de canon tirés par les
Allemands dont on voit les obus éclater en l'air, au
milieu de leur trajectoire, au grand amusement de nos
soldats gouailleurs (27). Dans les champs, des petites
croix de branchages plantées le matin même sur les
tumuli tout frais où sont enterrés les nôtres. Quel beau
champ de bataille que ces collines et ces vallées et
quelle sublime et tragique auréole estompe leurs
contours familiers d'une lumière grise à la fois funèbre
et radieuse ! Car sous ce ciel de cendres et sur ces
tombes toutes chaudes fleurit la victoire de la France.
On viendra fièrement visiter ces coteaux glorieux, comme
nous avons été vénérer dans la tristesse et l'espérance
ceux de Woërth et de Reichshoffen, mais on n'y reverra
pas ce que, seuls, nous avons vu, nous, les témoins du
drame, gravé à jamais dans nos coeurs et sur la terre de
nos champs si chèrement reconquis.
Du haut de la côte de Clayeures, où je suis vers 10
heures, je me retourne pour contempler, comme j'en ai
l'habitude, chaque fois que je passe par là, le panorama
qu'on y découvre. On devine à peine les Vosges, quoique
le temps s'élève. Mes yeux sont immédiatement attirés
vers un point où je voyais toujours briller au soleil la
flèche d'ardoise du clocher de chez nous. Et je ne peux
distinguer que les ruines désolées et fumantes de la
tour que j'ai vue en flammes trois jours plus tôt. Je
repars vers Clayeures en faisant un effort pour
m'arracher à ce paysage et dans la brume, face à moi,
m'apparaissent la Côte et la Vierge de Sion (28).
Ensemble prenant, émouvant, qui m'arrache des larmes et
une prière : ce champ de bataille encore tout sanglant,
nos forêts et le grand ciel gris de Lorraine, piquetés
d'éclatements d'obus, Sion, le saint autel de la Patrie,
les tombes de ceux des nôtres qui, dans le don de soi,
ont abandonné les misères de la terre et les miens
là-bas, terrés au milieu de nos ruines !
La ferme de Roménil (29) été saccagée et pillée. Des
porcs éventrés sont étendus sous les mirabelliers.
A Clayeures l'état-major du 16e corps est installé dans
la grande maison qu'on appelle le château (30). Sans me
faire entrer, ni me demander quoi que ce soit, un
commandant bourru me vise mon laissez-passer pour Bayon.
Je songe du reste qu'il est préférable de gagner Bayon
plutôt que Charmes. L'éloignement est moindre et je
serai moins isolé à Bayon où la Supérieure de l'hospice,
soeur Madeleine, ne me refusera sans doute pas
l'hospitalité.
Passé Clayeures, la circulation est plus facile. Je sors
du champ de bataille.
La prairie de l'Euron à Froville (31) est encombrée par
un parc d'artillerie dont les sections de munitions
s'alignent le long du chemin. Au carrefour où la route
qui m'amène de Gerbéviller rejoint la route de Bayon à
Baccarat (32), je m'arrête pour consommer mes
provisions, mon chocolat, mes oeufs, le pain et la viande
du général, avec pour dessert des mirabelles; il n'y a
qu'à se baisser pour en ramasser; il en pleut sur la
route.
Je suis à Bayon à midi et demi, reçu à bras ouverts à
l'hospice, par nos « chères soeurs » de Saint-Charles. On
me donne une bouteille de bière que j'ai vite fait
d'avaler, tout en reprenant une fois de plus le récit
des trois journées précédentes.
Après les visions tragiques et les angoisses du champ de
bataille, les misères et les douleurs de l'hôpital. Des
morts partout, jonchés de fleurs, de bouquets et de
rubans tricolores. Des blessés. Des Prussiens
prisonniers. Des plaies, du sang, des gémissements. Je
me mets aussitôt au service des Soeurs et dès le soir
même, j'écris des lettres pour les blessés. J'écrivais
sous la dictée, au milieu des plaintes, mais pour la
joie de ces braves dont les yeux s'illuminaient de
reconnaissance. Quelques-uns pleuraient comme des
enfants. J'ai écrit des lettres à des pères... à des
mères... J'ai tracé ces mots que je n'avais jamais
écrits : « Chère Maman! » et j'avais peine à maîtriser
mon émotion. Certains n'écrivaient, et pour cause, qu'à
leurs grands-parents et je pouvais compatir à leur
deuil; d'autres à leur petit frère, à leur soeur,
beaucoup, des réservistes, à leur femme. Tous n'avaient
qu'un souci : éviter d'affoler leur famille.
Le vendredi 28 août, relativement aux jours précédents,
est une journée calme et reposante. J'ai l'espoir que
bientôt Gerbéviller sera libérée. On entend la canonnade
de ce côté-là, plus forte que la veille. J'en conclus
que notre offensive continue et que les Allemands sont
repoussés. Mes réserves d'optimisme ne sont pas
épuisées. Mais le soir, arrive un adjudant, blessé à
Gerbéviller même. Il me dit que le combat y est très
dur. Les Allemands sont retranchés sur la rive droite
et, à l'entendre, ils ont dû reprendre ce qui reste de
la localité !
Le lendemain, je tente, à bicyclette, une pointe vers
Gerbéviller. Elle échoue devant un flot de fugitifs qui
m'assurent qu'on ne peut aller jusque-là. J'ai vu alors
Louis Jacquemin (33) qui, pris par les Allemands le 24,
avait failli être fusillé, les Bombardier, Kislique
(34), etc. On amène à l'hospice le corps du colonel
Champion (35), commandant le 2e dragons, tué, me dit-on,
près d'un gué, en amont de Gerbéviller.
Le Gué Rudan! Là où nous allions si souvent nous baigner
dans un site délicieusement agreste et virgilien (36) !
Est-ce possible?
Le dimanche 30 août, après la messe, j'ai des nouvelles
de Gerbéviller et de la maison par les dames Boulanger,
Joly et Marin qui arrivent en voiture. J'essaie même d'y
faire aller leur voiture pour chercher les miens. Mais
le commandant d'étapes qui commande à Bayon et par
lequel il faut passer, le commandant du Theil (37), me
fait savoir avec la plus grande courtoisie que la chose
est absolument impossible. Tout angoissé, car les
nouvelles qu'on me donne ne me rassurent qu'à demi, je
cherche à me rendre utile. Je « touche » à la gare 200
boules de pain pour les soldats blessés de l'hôpital et
j'en amène une partie sur une charrette à bras.
Le lundi matin, je vais à bicyclette jusqu'à Rozelieures
(38) dont l'entrée m'est interdite par des sentinelles.
Impossible d'aller plus loin. Le canon tonne très fort,
en effet, au-dessus de chez nous. Et nos batteries sont
encore installées tout près du village. On n'a pas fini
d'enterrer les morts de la journée du 25. Je récite
quelques prières sur les tombes que je rencontre,
pendant que des soldats passent en chantant sur la
route. Je ramasse des éclats d'obus. Je mange des
mirabelles. Dans les bivouacs les soldats en font cuire
dans leurs bouteillons. Il fait extrêmement chaud.
M. Gauthier, de Bayon, dont l'automobile est
réquisitionnée, part avec des dragons pour la ligne de
feu et me promet de tâcher d'aller jusqu'à Gerbéviller
et d'en tirer ma famille. Je confie à un dragon du
lieutenant Ramasse un mot pour elle. Sera-t-il jamais
parvenu ? Ce cavalier me fait l'éloge de son lieutenant
qui a provoqué la veille l'admiration de ses hommes dans
les environs de Gerbéviller (39).
Je m'occupe encore d'amener de la gare le pain destiné
aux blessés de l'hôpital. La tentative de M. Gauthier
échoue, Gerbéviller demeure sous le feu, en plein
danger, inabordable.
Mardi 1er septembre. On procède, dit-on, à l'appel de ma
classe (40). Il me faut donc gagner Nancy, réclamer à
l'autorité militaire l'affectation qu'elle n'a plus le
moyen de me faire parvenir et partir bêtement vers
l'arrière, quand on se bat chez nous, quand les miens
sont encore en première ligne, quand il y aurait ici
tant de services à rendre. Discipline ! Je réfugie mon «
cafard » à l'ombre du grand marronnier du jardin de
l'hospice, pendant qu'au delà de l'horizon tout proche,
presque sous mes yeux, le canon tonne dans le grand ciel
bleu, au-dessus de Gerbéviller. Minutes douloureuses. Je
décide d'attendre jusqu'au surlendemain 3 septembre.
Le 2, rien de nouveau. Gerbéviller toujours inabordable.
La circulation de plus en plus difficile. Dans la
détresse générale les coeurs se resserrent et j'ai trouvé
à Bayon d'innombrables sympathies, auprès de M.
Belhomme, ancien notaire (41),

Gerbéviller. - Eau-forte de Victor-Prouvé.
de M. Gauthier, de M. Marchal, le vétérinaire (42),
auprès des Soeurs de l'hôpital et surtout de leur
excellente Supérieure, soeur Madeleine, qui connaissait
bien Gerbéviller où elle avait été avant d'être à Bayon,
auprès des émigrés de Gerbéviller, mes compatriotes, et
ce mot, en de telles circonstances, représente une
puissante réalité : les Jacob, Auguste Joly (43), les
dames Boulanger et Balland, institutrice, etc., auprès
des médecins de l'hôpital, les docteurs Mathieu et
Hanriot (44) (de Blâmont). Il y avait aussi à l'hospice
une infirmière de la Croix-Rouge, Madame Lagrésille,
femme du capitaine de vaisseau, commandant le
Charlemagne (45), cousin, je crois, du conseiller à la
Cour. Sans enfants, elle répandait libéralement sur nos
blessés avec un entrain enjoué une bonté toute
maternelle. J'ai vu les blessés l'appeler : Maman ! Et
c'était sa joie. Elle m'a demandé un jour, originale
composition française, de lui écrire une lettre à son
mari, n'ayant pas de temps à distraire à ses blessés. En
dehors de mes fonctions de secrétaire et de panetier, je
remplissais également celles de brancardier et c'était
une satisfaction pour moi aussi d'entourer un peu les
innombrables blessés qui nous arrivaient de Gerbéviller
où ils avaient été sauver ce que j'avais de plus cher au
monde. J'aidais souvent à les transporter, soit à leur
arrivée du champ de bataille, soit à leur évacuation
vers les hôpitaux de l'arrière.
Je me verrai longtemps avec, sur le dos, les bras autour
de mon cou, un capitaine de dragons, blessé à la
cheville que j'ai ainsi conduit du jardin à la voiture
qui allait l'emmener. Un autre jour j'ai suivi, avec
quatre autres personnes seulement, le convoi funèbre
d'un officier. On l'enterra en bordure de la route de
Lunéville, de l'autre côté de l'Euron, au bas des pentes
Sud de la croupe de Belchamp (46).
Jeudi 3 septembre. Jour fixé pour mon départ. « Rien de
nouveau. Toujours le beau temps et des mouvements de
troupes. Gerbéviller à 17 km. me semble toujours plus
loin ». Voilà sur les notes prises au jour le jour, à
l'aide desquelles je reconstitue ces journées, ce que
j'écris à mon réveil. Pourtant dès les premières heures
de la matinée, j'apprends que tous les étrangers à Bayon
et y résidant actuellement sont invités à évacuer la
localité. Je m'informe : c'est vrai, et cela cadre bien
avec mes propres projets. Avec deux réfugiés
gerbévillois, Georges Thomassin et Auguste Joly, je vais
chercher un laissez-passer pour Nancy. Il faut y aller,
à pied car, dit-on, les gendarmes brisent les
bicyclettes qu'ils rencontrent (47). En chemin de fer,
dans les conditions actuelles, c'est un voyage
invraisemblable, de durée indéterminée, via Epinal et
Mirecourt. J'ai pu me munir de vivres et de linge
renfermés dans deux musettes ramassées sur le champ de
bataille, provenant du 85e R. I. (48) et qui m'ont été
fournies par la gendarmerie. Mais avec le pardessus
étriqué qui m'a servi de matelas, de couverture et
d'oreiller dans mon grenier et mon vieux feutre de
vacances, ces deux musettes achèvent de me composer une
silhouette de chemineau assez réussie qui, en d'autres
circonstances, eût fait ma joie. Arrivés, non sans
peine, à cause des colonnes et des convois, à la Moselle
et, après avoir franchi le canal, au carrefour de la
rive gauche, nous lisons : Nancy : 29 km. - Vézelise
(49) : 19 km. Il est déjà midi. Pourquoi n'irions-nous
pas coucher à Vézelise où doit se trouver ma cousine,
Madame Boiselle. En route donc pour Vézelise, par Haroué
(50), Tantonville (51). Entre Laneuveville (52) et
Crantenoy (53), nous rencontrons René Xaillé (54) qui
avait quitté Gerbéviller l'avant-veille et pensait
pouvoir y retourner. Il me donne des nouvelles de notre
quartier et m'assure que, sur la rue, la maison
paraissait encore intacte quand il est passé devant. Un
peu plus loin, nous nous arrêtons près d'un cycliste du
15e corps, un Africain, qui, assis dans le fossé, dévore
à pleines dents et à pleines mains, ruisselantes
d'huile, le contenu d'une boîte de thon. Il nous dit que
son corps d'armée est retiré du front pour être dirigé
vers une autre destination (55). Voilà comment, si nous
avions été des espions, l'ennemi eût été renseigné.
Grâce à mes deux compagnons de route le trajet me paraît
très agréable; entre fugitifs, on se comprend et, à
communier à demi-mots dans le malheur de notre pays,
nous nous faisions réciproquement du bien.
A Haroué, nous franchissons le Madon. Puis nous
traversons Tantonville. Nous descendons ensuite sur
Vézelise, sous l'oeil protecteur de la Vierge de Sion que
je ne quitte pas des yeux. Là déjà on ne sent plus la
guerre. Plus de troupes; seule, la grande campagne
lorraine du Saintois. J'ai parfois l'impression de faire
une bonne promenade de vacances. A Vézelise, la table de
la famille Berbain nous est ouverte.
Je vais demander l'hospitalité à Madame Thouvenin
(56),chez qui je trouve Madame Boiselle et toutes deux
me font le plus affectueux accueil.
Le lendemain je prends à midi le train pour Nancy.
L'envie me brûle de faire un pèlerinage à Sion. Mais il
faut y consacrer une journée, le temps me presse et j'ai
la plus grande hâte de revoir mon Nancy. Le train nous
emmène lentement à Jarville (57) où nous débarquons car
les trains ne vont pas jusqu'à la gare de Nancy. Il est
environ 3 heures. Station à Bonsecours (58), pour y
brûler des cierges et prier pour Nancy. Le Journal de la
Meurthe, acheté dans la rue - car, chose inouïe, il a
maintenant des crieurs - m'apprend l'élection du pape
Benoît XV. Cette nouvelle me cause un vrai bonheur. Une
bouffée de souvenirs romains me monte au coeur et je rêve
au jour où j'irai m'asseoir à Saint-Pierre de Rome, sur
la marche de marbre où, cinq ans plus tôt, aux côtés
d'un père frémissant, j'écoutais, ravi, le Gloria de la
messe de la béatification de Jeanne d'Arc. Le même
journal m'apprend aussi que notre désastre de
Gerbéviller est connu des Nancéiens.
Vers quatre heures, j'arrive, exténué, rue de la
Salpêtrière, chez ma tante Thiéry-Bonneville, mais j'y
goûte aussitôt un bienfaisant repos et une paisible
détente dans une atmosphère familiale réconfortante. Et
c'est une nouvelle série du récit de nos épreuves qui
commence, car le lendemain, parents et amis, prévenus de
mon arrivée, viennent me voir et je fais moi-même
quelques visites. Dans l'après-midi, je vais à la Place
où je réclame ma feuille de route. Mais tous les
services du recrutement ont été repliés sur Troyes à la
mobilisation et l'on m'accorde un sursis pas très défini
: « Revenez dans quelques jours, quand vous serez reposé
et on vous dirigera sur Troyes ».
Malgré les grondements du canon qui maintenant me
paraissent à moi lointains, je goûte à Nancy une
impression de repos et de calme relatifs. Jamais
pourtant le canon n'a retenti si près de la ville. J'y
retrouve l'ambiance où nous vivions à Gerbéviller avant
l'arrivée des Allemands : pas le moindre affolement, un
optimisme sincère, allié au sens le plus aigu des
réalités et de la gravité de l'heure et en même temps
cette liaison étroite entre la population et la
garnison, où servent tant des siens, qui a toujours été
avant la guerre une note caractéristique de Nancy,
intègre maintenant toute la vie de la cité. Depuis
qu'elle a pris ses positions de couverture, dès avant la
mobilisation et la déclaration de guerre, la garnison ne
s'est guère éloignée et presque chaque jour les
Nancéiens ont pu faire parvenir aux régiments de la 11e
division où se trouvent leurs parents et leurs amis des
nouvelles et des ravitaillements supplémentaires. Ils
suivent leurs déplacements, tendent l'oreille au canon,
en tirent des conclusions stratégiques. Des potins
circulent, toujours contradictoires et toujours
démentis. La vie se poursuit, mais suspendue à l'issue
de la bataille et ne rappelant en rien l'activité
normale de la ville.
Le dimanche 6 septembre, j'assiste à la messe à l'église
Saint-Nicolas, puis, j'écris une lettre au préfet et je
vais la porter moi-même à la préfecture en demandant à
voir le préfet lui-même ou à son défaut le secrétaire
général. En se présentant comme Gerbévillois on était
sûr d'éveiller la sympathie, au moins la curiosité.
Aussi informe-t-on le préfet, M. Léon Mirman, de ma
présence et on me prie d'attendre. Gendarmes et
officiers d'état-major de l'armée Castelnau se croisent
dans l'antichambre où M. Paul Croctaine est assis aux
côtés du vicaire général Jérôme (59). Ce dernier qui ne
me reconnaît pas tout d'abord, mais qui a entendu dire
que

Le pont de Gerbéviller. - Eau-forte de V. Prouvé.
j'arrivais de Gerbéviller, vient me demander des
nouvelles de l'abbé Vanat. Je lui confirme l'arrestation
par les Allemands et la captivité de notre curé.
Introduit peu après devant le préfet, assis à son bureau
en uniforme, je lui expose le but de ma visite :
m'assurer, avant mon départ pour la caserne, que les
autorités s'occupent de mettre en sûreté les habitants
qui n'ont pu encore quitter Gerbéviller où la vie est,
momentanément, pour des vieillards surtout, impossible
ou périlleuse. Le docteur Louviot était déjà venu avant
moi, paraît-il, - et le général de Castelnau avait été
avisé par le préfet. Je pouvais donc m'en retourner avec
l'espoir qu'on ferait quelque chose pour ceux qui
n'avaient pu encore quitter Gerbéviller (60).
Avant de me congédier, M. Mirman me demande quelques
renseignements sur ce que j'ai vu et entendu et sur ce
qui s'est passé à Gerbéviller. Nous nous sommes quittés
sur une poignée de mains vibrante et fort cordiale,
comme tout le reste de l'entretien. La noble figure de
ce magistrat qu'on sent profondément pénétré de la
grandeur et de la gravité de sa mission, ses traits
fins, son regard aussi franc qu'énergique et lucide, la
flamme patriotique de ses paroles qui m'avaient déjà
heureusement frappé quand je l'avais aperçu peu de jours
auparavant à Bayon, lors de la visite qu'il avait faite
à l'hospice, me laissent sur une impression de confiance
et de réel réconfort que je vais, en sortant, parfaire à
la Cathédrale.
Un coup d'oeil distrait aux égratignures qui, sur les
façades et surtout sur la vespasienne de la Place de la
Cathédrale, témoignent du récent passage d'un « taube ».
Ce sont les deux premières bombes - et jusqu'alors les
seules - que la ville ait reçues et leurs traces
excitent la curiosité des passants. Avec une douce
émotion, je retrouve ma Cathédrale où la grand'messe se
célèbre normalement. C'est la fête de saint Mansuy.
Cette année je n'en aurai pas accompagné la prose au
Cavaillé-Coll de Gerbéviller, mais le grand orgue de la
Cathédrale a compensé, ce matin-là, les regrets amers
que je pouvais avoir, de toute la plénitude de ses 63
jeux et de son 32 pieds, renforcés en sourdine par tout
le clavier supplémentaire des bombardes du
Grand-Couronné. De là, bonne et excellente visite au
curé de la Cathédrale (61) qui avait manifesté le désir
de me recevoir. J'étais donc attendu à la cure et
l'archiprêtre m'a reçu de son lit, où le clouent ses
rhumatismes, et prodigué les plus chaleureux
encouragements. Je l'ai quitté tout ragaillardi pour
passer en famille le reste de la journée de ce dimanche,
au son du canon qui protège la ville.
Le lendemain, lundi, je consacre ma matinée à des
courses préparatoires à mon départ. Chez un coutelier de
la rue Saint-Dizier je fais l'emplette d'un couteau à
plusieurs lames et à multiples accessoires qui me paraît
indispensable pour entrer en campagne et même pour la
commencer dans un camp d'instruction. Pour payer, je
sors de mon porte-monnaie une belle pièce de 20 francs,
en or vert, de Louis XVIII, cadeau qui m'avait été fait
il y a plusieurs années et que j'avais réussi à
conserver depuis. A ma surprise indignée, le commerçant,
peu familiarisé avec le profil de Louis XVIII, la juge
suspecte et prétend me la refuser. Il me faut insister
pour le convaincre de l'accepter et j'ajoute : « Vous
n'en reverrez plus guère et vous vous souviendrez que
vous avez voulu refuser un louis d'or le 7 septembre
1914 ». Chez mon coiffeur, on m'entoure comme une bête
curieuse en me disant que l'Impartial avait parlé de moi
à propos du sac de Gerbéviller (62). Cette curiosité
m'était pénible. Entre temps je rencontre le docteur
Louviot dont l'appartement et les livres ont été
détruits dans l'incendie de la maison Picot, sous mes
yeux. Je ne peux que lui confirmer qu'il n'en reste
rien. Atterré, l'air hagard, il ne trouve qu'à me dire
et à me répéter : « Tous mes bouquins! Le pauvre
Gerbéviller ! » Que reste-t-il de la frémissante
curiosité qui l'animait à la veille de la déclaration de
guerre à la pensée des heures historiques que nous
allions vivre?
En fin de journée, je retourne à la Place pour réclamer
ma feuille de route. Un ordre de transport est établi
aussitôt : départ le lendemain pour Troyes où je
recevrai mon affectation.
8 septembre. Voyage triste et désespérément lent. Le
temps se couvre. J'implore en passant Notre-Dame de Sion
et dis adieu à la Lorraine qui s'éloigne. La lenteur du
train achève de m'abrutir au point qu'à l'arrêt en gare
de Vittel (63), vers midi, je ne reconnais plus la
station où, pourtant, quelques années plus tôt, nous
avions fait deux saisons et, tout dépaysé, je me demande
quels sont tous ces hôtels et où nous pouvons être
arrivés. A Merrey (64) deux infirmières de la
Croix-Rouge dirigent le poste sanitaire de la gare.
L'une d'elles est Mademoiselle Dubois, tante de mon
camarade Baillot (65) et ma voisine de la salle Poirel
aux concerts du Conservatoire de Nancy. Elle me présente
à sa compagne : Mademoiselle de Castelnau, une des
filles du général et soeur de mon ancien condisciple :
Hugues (66), qu'elle me rappelle d'une manière si
frappante par ses traits et son timbre de voix que je ne
me retiens pas de lui en faire la remarque. Double et
agréable rencontre sur ce trajet insipide qui me paraît
un peu le chemin de l'exil. En remontant dans le train,
je trouve dans mon compartiment Madame *** de
Gerbéviller et son fils, le poitrinaire. Il fait bon,
vraiment, être poitrinaire, quand on vient de voir
flamber son village. Il s'en allait, toussant, pour
mourir au soleil sur la Côte d'Azur, pleurant sa canne à
pêche, détruite dans l'incendie, son dernier plaisir.
Quelle lugubre tristesse !
A chaque instant, nous croisons des trains militaires,
des renforts, des ravitaillements, des munitions. Je
compte prendre à Chalindrey (67) la direction de Troyes
mais le commissaire de gare m'y fait savoir que Troyes
est évacuée par tous les services militaires qui y
étaient installés. Diable ! Mais j'ai vu trop de choses
depuis quelques semaines pour avoir la force de
m'étonner et je cherche d'autant moins à comprendre
qu'ignorant totalement encore l'invasion du Nord de la
France, je ne tire de cette nouvelle aucune conclusion
fâcheuse. Mon ordre de transport est modifié et je suis
envoyé par le commissaire militaire à Dijon. La nuit est
tombée, ralentissant encore, semble-t-il, cet
interminable voyage et c'est vers 8 heures du soir,
ayant quitté Jarville à 6 heures du matin, que je
débarque à Dijon. Inutile de songer à me rendre à la
Place à une heure aussi avancée. La gare va être mon
hôtel et, allongé sur une brouette, dans la salle des
Pas-Perdus, dans une ruelle qui sépare la bibliothèque
du bureau de tabac, je passe une nuit des plus mauvaises
qui me fait regretter singulièrement les heures
critiques de mon grenier. Au jour, mal réveillé et mal
lavé, après une toilette forcément sommaire à la
première borne-fontaine de la rue de la Gare, je me mets
à la recherche du bureau de la Place, très ennuyé d'être
hors de ma région militaire d'origine, la 20e, car Dijon
est de la 8e, et je me demande si mon voyage va se
terminer là. « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de
vous ? » Tel est le premier mot que l'on répond à
l'exposé de ma situation. C'était exactement ce que je
pensais. Et après un instant de réflexion : « On va vous
prendre comme engagé. Si on retrouve votre feuille de
route, vous recevrez votre affectation définitive; pour
le moment vous avez le choix entre les trois régiments
de la garnison : le 27e d'infanterie, le 26e dragons et
le 48e d'artillerie ». Le 48e d'artillerie ! Il me
semble, à l'idée d'y être incorporé, que je vais
récupérer quelque chose de Gerbéviller où nous l'avons
vu cantonner pendant trois jours il y a moins d'un mois
et peut-être pouvoir y retourner au plus vite. Le
régiment n'est-il pas encore tout entier en action, à
quelques kilomètres de chez nous, près de Giriviller
(68) ? Je n'hésite pas un instant et j'opte aussitôt
pour le 48e d'artillerie.
Une demi-heure plus tard j'entrais au Quartier Junot,
sur la route de Langres, où est demeuré le dépôt du
régiment à la mobilisation et, élevé à la dignité de 2e
canonnier conducteur, je commençais à chanter
l'Artilleur de Metz.
Jean GODFRIN.
(1) Notaire honoraire, 1829-1916.
(2) Son corps fut retrouvé dans la Mortagne, à 2 km.
environ en aval de Gerbéviller, au lieudit : la
Grande-Corne, quelques jours plus tard.
(3) 1846-1929.
(4) Voir : Lettre du docteur Labrevoit à l'Académie de
Médecine dans : Bulletin de l'Académie de Médecine ;
séance du 3 novembre 1914 et la presse de l'époque,
notamment le New-York Herald (Rédaction parisienne), 4
novembre 1914 « Pendant cette soirée du 24 août, alors
que, ma douleur dominant encore ma rage, je regardais
flamber ma maison, pensant à tous les précieux souvenirs
de famille que les flammes consumaient, un officier
allemand, jeune, correct, parlant bien français,
s'approche de moi et, joignant les deux mains dans un
geste de pitié compatissante, me dit par deux fois : «
Votre pauvre pays! » puis, se penchant à mon oreille : «
Ça ! c'est du vandalisme ! »
(5) Amélie Rigard (Landremont [Meurthe-et-Moselle, arr.
de Nancy, canton à et 11 km. S.-O. de Pontà-Mousson],
1854 - Nancy 1925), en religion soeur Julie, de la
Congrégation des Soeurs de Saint-Charles de Nancy.
Supérieure de l'hospice de Gerbéviller du 14 octobre
1908 au 24 février 1920. Le 24 août 1914, devant
l'incendie qui ne cessait de se répandre dans tous les
quartiers au fur et à mesure que les Allemands
avançaient dans la ville, soeur Julie, soucieuse de
sauver la maison dont elle avait la responsabilité et de
continuer à exercer sa mission de charité plus
nécessaire que jamais, demanda à parler à un chef. Un
officier se présenta qu'elle jugea de haut rang. Sans se
laisser intimider, avec son énergie coutumière et son
ton facilement impératif, elle lui explique « que
l'hospice était la maison du Bon Dieu, le foyer de la
Charité, qu'on y soignait indistinctement les Allemands
comme les Français, que s'ils voulaient des incendies,
ce qui brûlait alors devait leur suffire, qu'ils
n'auraient pas trop pour loger leurs troupes et leurs
blessés des maisons qui restaient debout et qu'elle le
suppliait de faire arrêter l'incendie et d'épargner
l'hospice ». L'officier s'éloigne après l'avoir écoutée
avec attention. Entre temps la Supérieure avait remarqué
qu'après avoir pénétré dans les maisons, les avoir
visitées et pillées, les Allemands déposaient sur les
fenêtres des petites lumières « des espèces de bougies
et que peu de temps après les maisons flambaient.
Quelques instants après le départ de l'officier, ces
petites bougies, au lieu d'être encore déposées sur les
fenêtres des maisons du quartier, furent alignées sur le
sol même, en travers de la rue de la Gare, à hauteur de
la Chapelle de l'Hospice. Soeur Julie qui nous a maintes
fois rapporté ces détails a toujours considéré cet
alignement de ce qu'elle appelait des bougies en travers
de la rue, au point où s'est arrêtée la marée de feu,
comme le signal et l'ordre de cesser les incendies, qui,
répétons-le, à l'exception de la Chapelle du Château, du
Château et du clocher de l'église paroissiale, ont tous
été allumés à la main et non par le feu de l'artillerie
qui n'est du reste pas par lui-même un moyen efficace de
provoquer des incendies, si l'on n'utilise pas des obus
spéciaux.
Après la retraite des Allemands, pendant toute la durée
de la bataille de la Mortagne et bien au delà encore,
soeur Julie, en l'absence des autorités civiles et en
liaison avec les autorités militaires françaises,
organisa la vie et le ravitaillement du petit noyau de
sinistrés demeurés à Gerbéviller et se multiplia pour
subvenir aux besoins des troupes françaises. Elle fut
citée à l'ordre de l'armée avec les religieuses de sa
communauté en ces termes : « Ordre général n° 71. - Le
général commandant la 2e armée cite à l'ordre du jour de
l'armée Mmes Rigard, Collet, Rémy, Maillard, Rickler et
Gartener, religieuses de l'ordre de Saint-Charles de
Nancy, qui ont, depuis le 24 août, sous un feu incessant
et meurtrier, donné, dans leur établissement de
Gerbéviller, asile à environ 1.000 blessés, en leur
assurant la subsistance et les soins les plus dévoués,
alors que la population civile avait complètement
abandonné le village. Ce personnel a en outre accueilli
chaque jour de très nombreux soldats de passage,
auxquels il a servi les aliments nécessaires. Le général
commandant de la 2e armée : Signé : DE CASTELNAU, P. A.
Le général d'Etat-Major : Signé : ANTHOINE ».
Elle reçut la croix de la Légion d'Honneur des mains du
président Poincaré le dimanche 29 novembre 1914 (R.
POINCARÉ, Au Service de la France. Neuf Années de
Souvenirs. V : L'Invasion, p. 468). Inhumée à Nancy, au
cimetière du Sud, dans la concession des Soeurs de
Saint-Charles.
(6) Cette enfant âgée de 10 ans devait mourir quelques
heures plus tard de la blessure par balle qu'elle avait
reçue dans la journée du 24 août.
(7) 1853-1932.
(8) Meurthe-et-Moselle, arr. de Lunéville, canton et à 6
km. S.-O. de Gerbéviller.
(9) C'est à 15 heures, le 25 août, que, de
Pont-Saint-Vincent, le général de Castelnau ayant vu
s'avancer la victoire, lui a tendu les bras en lançant
son ordre du jour fameux : « En avant, partout, à fond !
»
Voici d'autre part comment les Allemands racontent la
journée du 25 août dans le secteur qui nous intéresse;
on lit dans le récit des Archives du Reich, La Guerre
Mondiale, 5e partie, III, p. 587 et 588 : « Au sud de la
Meurthe, également, l'attaque française conduisit à une
dure crise. Là, le IIe corps bavarois et le XXIe corps
d'armée devaient continuer le mouvement vers le Sud. La
3e division devait attaquer le front Rozelieures-Vennezey.
Elle avait à peine entamé son mouvement que des signes
significatifs d'une attaque ennemie tout à fait
imminente, dirigée de l'Ouest et du Sud, contre tout le
front du corps d'armée se firent percevoir. La
progression de la 3e division s'arrêta dès devant Rozelieures et Vennezey. On eut le plus grand mal à
repousser les violents coups de boutoir que du Sud et du
Sud-Est l'ennemi nous portait. La situation du corps
devint critique. En vain le commandant du corps d'armée
se tourna-t-il, dans cette extrémité, vers le commandant
de l'armée en demandant des secours. Ce dernier ne
disposait plus de réserves d'aucune sorte. Il ordonne de
tenir à tout prix, à la dernière extrémité, sur la
Mortagne. Quoique à la 3e division bavaroise et au XXIe
C. A. la situation fût jugée avec assez de confiance, le
commandant de corps eut la conviction, vers 14 heures,
qu'inévitablement son corps serait amené à se dérober.
Il donna l'ordre aux divisions de reculer sur la ligne Mortagne-Gerbéviller. Une instruction du commandant de
l'armée, prescrivant de tenir les positions actuelles,
en considération de la situation meilleure sur le front
des corps voisins, arriva trop tard; on était déjà en
pleine retraite. La progression du XXIe C. A. en
direction du Sud fut, elle aussi, arrêtée le 25 aoùt au
matin par la contre-attaque ennemie. »
Voilà donc bien l'aveu officiel allemand de la victoire
française du 25 août à l'ouest de la Mortagne.
Mais le paragraphe qui relate ainsi la « dure crise »
provoquée chez l'ennemi par « les violents coups de
boutoir » de la contre-attaque française et la «
situation critique » où elle mit l'ennemi « en pleine
retraite » (§ 2 du chap. III) porte comme titre : «
L'échec de la contre-attaque française du 25 au 27 août
» !
(10) Lieudit, situé au sommet du versant occidental de
la vallée de la Mortagne, à 1 km. sud de Gerbéviller.
(11) 1876-1917.
(12) Affluent de gauche de la Mortagne dans laquelle il
se jette à Haudonville.
(13) Moranviller. Village détruit pendant la guerre de
Trente Ans, situé entre Remenoville et Giriviller, sur
les pentes sud-ouest du Haut-du-Mont, à 5 km. 500 au
sud-sud-ouest de Gerbéviller et dont le nom subsiste
dans la dénomination de ce ruisseau que portent encore
les cartes d'Etat-Major.
(14) Arthur Liégey (1853-1932), maire de Gerbéviller du
17 mai 1908 au 19 mai 1912. Président de la Commission
municipale du 13 novembre 1914 au 16 février 1915. Maire
du 9 octobre 1920 au 17 mai 1925.
(15) Lieudit situé sur la route de Gerbéviller à
Remenoville à 100 mètres de la sortie de Gerbéviller
(16) Écart à 700 mètres de la sortie de Gerbéviller.
(17) Écart à 1.200 mètres de la sortie de Gerbéviller.
(18) Il s'agit du Chef de bataillon Ernest Varaigne,
commandant alors un bataillon du 230e R. I. (74e D. I.
148e Br.). Blessé grièvement le lendemain 28 août 1914,
en avant de Gerbéviller, vers Fraimbois, et ramassé à
minuit sur le champ de bataille par une patrouille
allemande, il fut transporté d'abord à l'ambulance
allemande de Moncel, puis le 30 à l'hôpital de Lunéville
où il est resté jusqu'au 9 septembre. Emmené en
captivité en Allemagne au moment du repli des Allemands,
il fut ensuite interné en Suisse, comme grand blessé, à
la fin de 1916 et enfin rapatrié à Annecy en juillet
1917. Il devait mourir des suites de ses blessures à
Lunéville le 11 janvier 1923.
(19) Lieudit et reboisement situé sur le territoire de
Gerbéviller (à la lisière ouest du bois de Guilgnebois)
et appartenant à l'auteur.
(20) Mur aujourd'hui dissimulé sous l'amas de décombres
provenant du déblaiement des ruines du village.
(21) Adrien Bretrand qui semble être passé par là
presque à la même heure, le même jour, mais venant de la
direction opposée décrit ce spectacle de la manière
suivante : « A la sortie qui débouche vers Gerbéviller,
la lutte a dû être effroyable. Les corps s'amoncellent.
Un obus allemand est tombé dans un groupe de soldats et
a fait écrouler un mur. Les membres de ces hommes sont
épars et déchiquetés. On voit un malheureux dont les
entrailles ont été projetées à dix mètres sur les fils
de fer qui bordaient le champ. » (La Victoire de
Lorraine 20e édition, Berger-Levrault 1917 p. 77).
(22) Dép. de Meurthe-et-Moselle, arr. et à 5 km. 500 N.
de Lunéville, cant. de Lunéville-Nord.
(23) 74e - D. I., 148e Br.
(24) Je devais retrouver le lendemain l'abbé Drouville à
Bayon où il demeura consigné chez le curé doyen jusqu'au
jour où, reconnue la méprise née de la psychose de
guerre et d'un concours malheureux d'excès de zèle et de
manque de flair dont il avait été la victime, il fut
remis en liberté avec les excuses du général commandant
la IIe armée.
(25) C'est en effet aux lisières de ces forêts,
notamment aux lisières du Bois des Rappes (2 km. N.-E.
de Gerbéviller) et du Bois du Haut de la Paxe (1 km. 500
E. de Gerbéviller) que l'avance du 16e C. A.
s'est heurtée les jours suivants à la résistance d'un
ennemi retranché. Le 36e R. I. C. (74e D. I. rattachée
au 16l C. A.) en particulier fut décimé aux portes de
Gerbéviller, dans le vallon du ruisseau de Falenzey.
(Voir, pour le 222e R. I. Georges Kimpflin, Le Premier
Souffle, Paris, Perrin, 1919, p. 157 et suivantes).
L'ennemi n'abandonna cette position que le 12 septembre
sous la pression persistante des nôtres et le contrecoup
de la bataille de la Marne.
(26) Canton et à 6 km. 500 à l'est de Bayon. 8 km. S.-O.
de Gerbéviller.
(27) Il s'agissait sans doute de réglages de
l'artillerie allemande par coups fusants hauts. Cela
correspondait assez bien à la situation du moment :
organisation d'une position défensive à l'Est de la
Mortagne.
(28) Le principal sanctuaire marial de Lorraine, lieu de
pèlerinage fréquenté depuis le Haut Moyen-Age, au
promontoire Nord (30 km. S. de Nancy et 495 m. d'alt.)
de la côte de Sion-Vaudémont célébrée par Maurice Barrès
dans la Colline TnspirJe (Émile Paul, 1913).
(29) l km. E. de Clayeures.
(30) Propriété en 1914 de Mlle Caroline Teinturier.
(31) Canton et à 3 km. N.-E. de Bayon.
(32) Meurthe-et-Moselle, chef-lieu de canton de
l'arrondissement et à 24 km. S.-E. de Lunéville sur la
Meurthe.
(33) 1848-1935.
(34) 1848-1919.
(35) Auteur d'une remarquable étude historique sur la
chevauchée de Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc écuyère,
Berger-Levrault. 1901.
(36) Voir Adrien Bertrand, La Victoire de Lorraine, 20e
éd., Berger-Levrault, 1917, p. 89, et Georges KIMPFLIN,
Le Premier Souffle, Perrin, 1919, p. 158 et 159.
(37) Baron du Theil, ancien Président de la Société
hippique française.
(38) Canton et à 9 km. E.-S.-E. de Bayon.
(39) Lieutenant Henry Lamasse du 2e rég. de dragons.
Nice 1892. Mort pour la France en combat aérien le 2
septembre 1918. Voir Livre d'Or de l'Institution de La
Malgrange. p. 121.
(40) D'après la presse nancéienne la nouvelle de l'appel
de la classe 1914, a été publiée le 31 août.
(41) 1846-1927.
(42) 1869-1926.
(43) 1863-1936.
(44) 1859-1930.
(45) Capitaine de vaisseau Paul de Lagrésille commandant
le Charlemagne aux Dardanelles, mort pour la France le
18 septembre 1915 à l'hôpital de Remiremont et inhumé
dans le cimetière militaire de Bayon dont il est parlé
plus loin.
(46) C'est un terrain offert par la famille Lagrésille
qui fut ainsi consacré en août 1914 aux sépultures
militaires de Bayon. Ce cimetière subsiste toujours,
encadré par une haute haie de thuyas et fermé par une
petite grille, le tout très bien soigné. En son centre,
s'élève le monument élevé par Bayon à ses enfants morts
au champ d'honneur dont le souvenir est ainsi
heureusement rapproché de ceux qui, venus des plus
lointaines provinces et tombés sur les champs de
bataille de Rozelieures et de la Mortagne, sont morts
pour la France à Bayon. Derrière le monument, la tombe
du capitaine de vaisseau Lagrésille, donateur du
terrain; à sa droite et à sa gauche, bien alignées, les
croix de pierre du modèle adopté dans les cimetières
nationaux. En haut d'un mât en ciment le drapeau de la
France. En bas dans la vallée, sous la protection de ses
morts, Bayon, qui se rassemble autour de leurs tombes,
aux dates marquées par le culte du souvenir pour les
honorer et leur témoigner sa fidélité et sa foi
patriotiques.
(47) Du moins étaient-ils autorisés à les confisquer. Le
général commandant la 2e armée avait interdit, le 1er
septembre 1914, pour paralyser l'espionnage, la
circulation des automobiles et des bicyclettes civiles
dans le Grand-Couronné et sur toute la rive droite de la
Moselle, sous peine de confiscation. Le 4 septembre,
cette interdiction était étendue à toute la partie du
département de Meurthe-et-Moselle située sur la rive
gauche, au sud de la route de Pagny-sur-Meuse à Foug,
Écrouves et Toul. (Voir la presse nancéienne de l'époque
et notamment : Extraits de l'Est Républicain réunis en
brochure sous le titre : La Grande Guerre. La Vie en
Lorraine, septembre 1914, p. 16, 29 et 34)
(48) 8e C. A., 16e D. I., 31e brig.
(49) Chef-lieu de canton du département de
Meurthe-et-Moselle, arr. et à 29 km. S.-S.-E. de Nancy,
sur le Brénon, sous-affluent de la Moselle.
(50) Chef-lieu de canton du département de
Meurthe-et-Moselle, arr. et à 25 km. S. de Nancy, sur le
Madon.
(51) Meurthe-et-Moselle, arr. de Nancy, canton et à 3
km. O. de Haroué.
(52) Meurthe-et-Moselle, arr. de Nancy, canton et à 7
km. E. de Haroué.
(53) Meurthe-et-Moselle, arr. de Nancy, canton et à 4
km. E. de Haroué.
(54) Gerbéviller, 1880-Amiens, 1928. - Mobilisé au 57e
bataillon de chasseurs à pied et blessé grièvement le 28
juillet 1915 au Cabaret Rouge, près de Souchez
(Pas-de-Calais). Chevalier de la Légion d'Honneur et
président de la Section de Gerbéviller de l'Association
des Mutilés et Combattants. Mort des suites de ses
blessures.
(55) La IIe armée avait reçu en effet le 2 septembre
l'ordre du G. Q. G. de retirer du front le 15e corps et
de le diriger vers l'Ouest.
(56) 1841-1919.
(57) Canton de Nancy-Ouest et à I km. de Nancy.
(58) Notre-Dame de Bonsecours. Sanctuaire de la piété
mariale nancéienne.
(59) 1867-1934.
(60) Après être restés en première ligne, du 27 août au
8 septembre, sous le feu de l'ennemi (deux obus de 77
percutèrent sur la toiture de la maison qui fut
également criblée d'éclats par la chute d'un obus de 15
cm. à 6 ou 8 m. de la façade, côté jardin, tandis que, à
une distance analogue, côté rue, un autre obus tuait un
matin huit fantassins français), les parents que
l'auteur avait dû laisser à Gerbéviller purent, sous la
conduite du docteur Labrevoit, gagner le 8 septembre
Châtel-sur-Moselle et le lendemain 9 arriver à Nancy,
juste a temps pour y essuyer le premier bombardement par
canon subi par la ville, dans la nuit du 9 au 10
septembre au moment de la retraite allemande.
(61) Chanoine Geoffroy; Champougny (Meuse), 27 avril
1840. Champougny (Meuse) 22 avril 1918.
Curé de la Cathédrale de Nancy de 1889 à 1918.
(62) On avait pu lire en effet dans l'Impartial de l'Est
du jeudi 3 septembre 1914 les lignes suivantes : « Un
jeune homme de dix-huit ans était caché dans une maison.
La bonne, terrifiée, l'avoue à un officier qui lui dit :
« Cachez-le bien, car il serait fusillé. »
Résumé assez exact, si l'on tient compte que le jeune
homme avait vingt ans, que la bonne n'était certes pas
la plus terrifiée et que l'Allemand auquel elle s'était
adressée de sa propre initiative pour sauver le jeune
homme était un homme de troupe.
(63) Chef-lieu de canton du département des Vosges.
Ville d'eaux, arr. et à 17 km. de Mirecourt.
(64) Haute-Marne, arr. de Chaumont, cant. et à 7 km. 500
S.-E. de Clermont. Bifurcation des chemins de fer de
l'Est. Lignes de Langres à Nancy et de Chalindrey à
Toul.
(65) Pierre Baillot (1898-1918). Sous-lieutenant au 27e
B. C. P. Mort pour la France le 15 septembre 1918 au
Bois-Piquet (Vauxaillon, Aisne) (Voir Livre d'Or de
l'Institution de La Malgrange, p. 9).
(66) Hugues de Curières de Castelnau (1895-1915).
Sous-lieutenant au 8e R.A.C. Mort pour la France le 1er
octobre 1915 en Artois (Voir Livre d'Or de l'Institution
de La Malgrange, p. 52 et 53).
(67) Station de Culmont-Chalindrey, dép. de la
Haute-Marne, arr., cant. et à 10 km. S.E. de Langres.
Ligne de chemin de fer de Paris à Bâle. Bifurcations
vers Neufchâteau, Gray et Dijon par Is-sur-Tille.
(68) Meurthe-et-Moselle, arr. de Lunéville, cant. et à 5
km. S. de Gerbéviller. |













