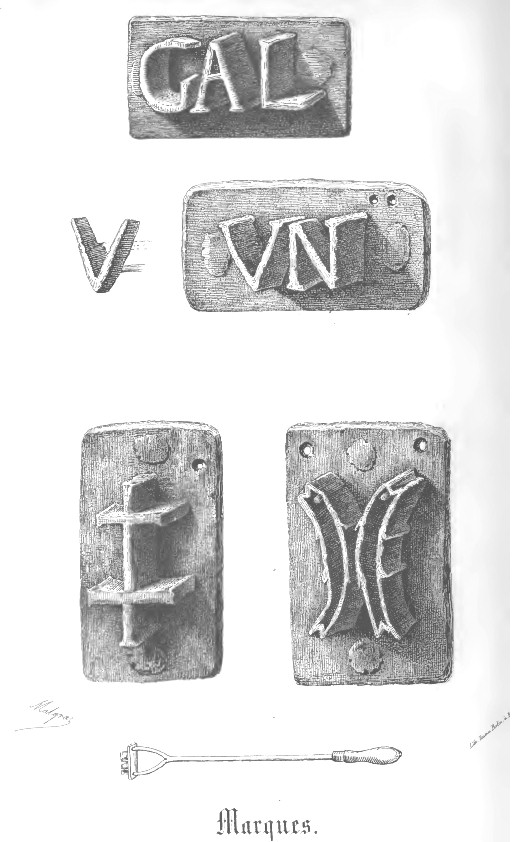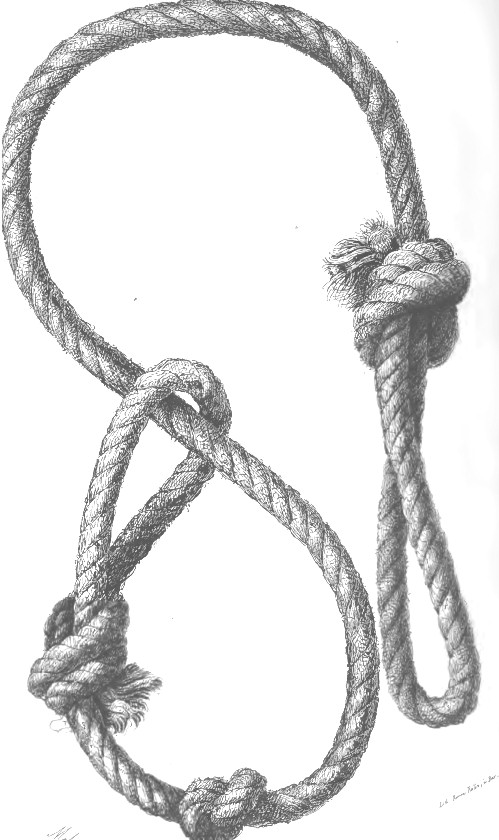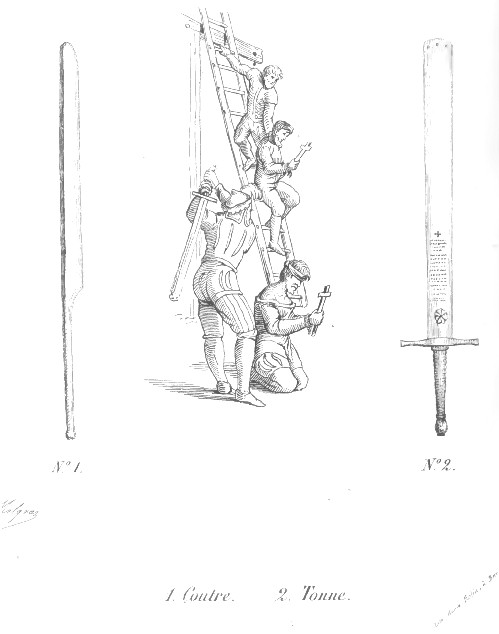A Barbonville (56), dont les jésuites de Nancy étaient hauts-justiciers, le maire faisait sortir le condamné delà prison,
située en la cave de la maison seigneuriale, et le conduisait à la porte du derrière de celle-ci. Après lui avoir fait mettre dehors un pied et une main, il criait à trois reprises :
Monsieur le prévôt de Rosières, monsieur le prévôt de Rosières, monsieur le prévôt de Rosières est-il ici, ou quelqu'un de sa part ? Alors le prévôt de cette ville, préalablement averti, s'approchant et demandant ce qu'on lui voulait, le maire lui répondait : Voici, monsieur le prévôt, un pauvre prisonnier que nous avons condamné à mort, à cause qu'il est convaincu de tel crime, lequel nous vous délivrons pour en faire faire l'exécution, duquel nous vous chargeons et nous nous en déchargeons.
A Leyr, dépendant de la justice de l'abbesse de Sainte-Glossinde de Metz, le maire de celle-ci remettait le condamné aux officiers du seigneur voué pour en faire faire l'exécution. On y observait la même formalité d'avancer un pied et de laisser l'autre dans la cour de l'abbesse, pour témoigner que c'était librement et sur son terrain qu'elle en disposait ainsi.
A Fraulautern (57) où la justice appartenait de même à l'abbesse du lieu, les échevins de la mairie ayant prononcé, l'accusé, porteur de la sentence qui lui était mise dans son sein, était délivré aux Leheleutres, On appelait de ce nom quelques-uns des sujets de la seigneurie chargés de l'office de le conduire sur le pont du château de Gruembrach
(archevêché de Trêves), où le gouverneur le recevait et se chargeait de
l'exéculion, moyennant deux bichets d'ognons que l'abbesse délivrait annuellement audit château. Cet usage ayant été contesté par le duc en 1594, à l'occasion d'un prisonnier, celui-ci, favorisé peut-être par l'abbesse, prit la fuite pendant le débat.
A Toul (58), dès que le maire était prévenu qu'une exécution était à faire, il allait prendre le condamné à la prison et l'amenait à l'Hôtel-de-Ville, à l'entrée de la salle où siégeaient les six échevins, le conseil de ville, le procureur d'office et le secrétaire, présidés par le maître échevin. Là le condamné, mis à genoux par l'exécuteur, tète nue et en chemise, portant une torche à la main, entendait lecture de sa sentence, qui était donnée par le maître échevin. Un sergent de ville lui faisait demander pardon à Dieu, à la justice et aux parties offensées, après quoi, au troisième coup de la bancloche, il était conduit au lieu du supplice par l'assemblée. Si c'était hors de la ville, le maître échevin et les échevins attendaient le maire sur un banc placé sous la porte, qu'ils ne quittaient que quand ce magistrat, de retour, leur annonçait que justice était faite.
Si le condamné était un sorcier, la lecture de la sentence ne lui était pas faite devant témoins, dans la crainte de souiller les oreilles de ceux-ci ; on se contentait de lui dire : Ton cas est jugé, que Dieu te conduise; c'était comme une continuation du huis clos.
Dans la justice du Val-de-Lièvre, à Sainte-Croix et Sainte-Marie-aux-Mines, lors de la troisième journée d'examen de l'affaire, quand déjà d'ordinaire à la seconde on en avait préjugé le résultat, les apprêts du supplice se trouvaient faits. Si la sentence projetée était maintenue, il en était donné lecture par le clerc juré, à haute voix, sur la place publique ; alors le maire du duc, empoignant de la main droite le condamné, et celui du seigneur en faisant autant de la main gauche, le délivraient au bourreau, appelé à l'avance. Le maire du duc proclamait que nul n'eût à faire mal au maître exécuteur, le mettant en la sauvegarde du duc, souverain
seigneur. L'exécution était faite à l'instant, sous les yeux de la justice qui venait de prononcer et qui n'avait pour toute indemnité qu'un repas payé par les deux seigneurs.
A Mirecourt, à la troisième journée, lorsque le mayeur donnait au prévôt communication de la sentence de condamnation, le terme sacramentel était : Il doit
amener ;
à quoi le prévôt répliquait : Comment ? Si la condamnation était capitale, le mayeur répondait : Il doit amener de corps, et l'exécution suivait immédiatement.
A Senones, le coupable, après avoir été condamné par la justice de l'Abbé, siégeant à l'abbaye, était délivré au seigneur voué, qui en faisait faire justice sur la pierre de la justice qu'estait en la cour du monastère. Le voué, pour sa peine, avait la confiscation des meubles, et le couvent, celle des immeubles.
A Remiremont, dès que le grand-échevin avait, en présence de ses collègues, prononcé la condamnation et que celle-ci avait été ratifiée par la commune, on prévenait les officiers des dames, qui, suivis des habitants en armes, conduisaient le coupable au ban de Moulin, en un lieu dit l'Épinette, devant une grosse pierre sur laquelle était gravé un signe patibulaire. Là se trouvait le prévôt d'Arches, convenablement escorté. Le condamné lui était remis avec déclaration verbale de la sentence rendue. Cet officier ayant manifesté, en 1542, quelque hésitation de faire de telles exécutions sur parole, les dames se pourvurent près du duc Antoine, qui reconnut qu'elles étaient en possession de cet usage de ne donner copie des sentences, et les y maintint : ce qu'il fit encore en 1564, sur de nouvelles contestations.
Lorsque le duc Léopold eut institué le recours en appel, le Parlement, saisi d'une sentence de Remiremont, ordonna que l'exécution aurait lieu au Val-d'Ajol ; mais les dames ayant réclamé l'antique usage, il fut fait droit à leur réclamation. En 1757, la même Cour ayant condamné un nommé Alexis Gravelin à être fouetté dans tous les carrefours de Remiremont, rapporta elle-même son arrêt, sur le pourvoi des dames, et ordonna l'exécution à l'Épinette. Cet usage se pratiquait encore en 1775, en vertu de plusieurs arrêts conformes, rendus en 1758, 1760 et 1773.
A mesure que les prévôts disparurent, la justice chargea l'un de ses autres représentants de surveiller l'exécution. Ce fut d'abord le lieutenant-général ou le lieutenant particulier du bailliage avec le substitut et le greffier ; ensuite, par l'ordonnance de 1707, ce soin fut confié, dans les prévôtés, au prévôt et à son greffier ; dans les bailliages, au conseiller rapporteur et au greffier. A la Cour, c'était au greffier, assisté de deux huissiers. Dans toutes ces circonstances, ils figuraient à cheval et en robes. A Metz, originairement le corps entier de la magistrature était présent ; il en était de même au Val-de-Lièvre, à
Sainte-Croix et Sainte-Marie-aux-Mines.
ESCORTE.
L'escorte de la justice était, dans ces temps anciens, composée de la garde civique de la prévôté, marchant à l'appel du seigneur, ou sur l'ordre du maire, si c'était dans les villes affranchies. Cette nécessité d'avoir recours à l'autorité municipale entraînait quelquefois des difficultés, quand il y avait entre ces différents officiers quelques conflits personnels. En 1596, le maître échevin de Pont-à-Mousson refusa des hommes au prévôt, sans autre motif apparent que de vouloir lui faire sentir son autorité; il allait jusqu'à le comparer à un valet, parce qu'il était tenu de mettre à exécution ses sentences : il oubliait ainsi que, sans lui, ces dernières n'eussent été que de vaines paroles.
L'appel par le seigneur avait quelque chose de plus solennel ; le service des habitants marchant sous sa bannière était nommé la féauté; il se faisait avec rigueur. Quand la féauté de Saint-Pierre (59) marchait dans le ban de Remoncourt, la Neuveville et Rozerolle, les manants des seigneurs de Saint-Pierre étaient tenus de suivre deux à deux, le maire en tête et les deux plus anciens après. Si, pendant toute la durée de la marche, aucun d'eux parlait à son voisin ou tournait la tête en arrière, il encourait
une amende de 7 fr. 1/2, payable au prévôt et pour lui ; On peut s'imaginer s'il surveillait !
Les gardes forestiers de Saint-Pierre étaient obligés, pendant ce temps, d'aller garder le bois de Mai, à Remoncourt ; pour justifier de leur surveillance, ils devaient rapporter chacun au prévôt un brin coupé dans ledit bois et que le prévôt pouvait ressoucheter. S'ils y manquaient, ils encouraient la même amende, assez considérable pour l'époque.
Dans les villes importantes où il y avait des arbalétriers, l'escorte était une de leurs charges, mais le plus souvent salariée. A Étain, leur droit était fixé à 5 fr. ; à Foug, il n'était que de 10 sous, comme à Saint-Mihiel, en vertu d'une charte spéciale datée de 1482 : « Toutes et quantefois que aucun larron ou meurtrier sera exécuté en notre ville, lesdits arbalétriers iront à la justice avec le prévôt et sergent, et iceux arbalétriers avèrent et emporteront, pour chacune fois qu'ils iront et que sera fait exécution d'une ou de plusieurs personnes, la somme de 10 sous tournois, tant seulement pour boire les compagnons à
leur retour ou en faire leur volonté. » Un siècle après, ils avaient mis à plus haut prix leur assistance ; en 1585, on leur donnait 4 fr. 8 gros pour un supplicié sur la roue. Cette dernière somme, comme les 10 sous, n'était pas allouée à chacun des hommes, mais pour toute la compagnie.
Il va sans dire que cette milice marchait au son de quelque instrument : ici un tambourin, là un fifre; à Épinal, c'étaient des ménestrels qui recevaient 1 fr., quelquefois 2 pour leur salaire.
Partout on sonnait la cloche de la même façon que l'agonie, ce qui ne manquait pas de faire accourir jusqu'au dernier des artisans, toujours avides d'un spectacle si plein d'émotions.
PREPARATIFS.
Le gibet, l'échafaud et autres appareils en bois étaient préparés par les charpentiers de la prévôté, réunis en corporation. Ils y étaient obligés, sous peine d'amende et même de prison. Dans quelques localités, on les payait : c'était ordinairement 3 fr. pour un gibet ; à Phalsbourg, c'était 1 florin ; à Épinal, 2 fr. Dans d'autres, comme à La Marche, ils étaient tenus de prêter leur concours gratis et même de fournir les bois nécessaires. En général, en cette circonstance, on regardait leur ministère et celui de tous autres dont le concours était appelé, tels que les charrons pour la roue, les maréchaux pour les chaînes et ferrements, comme un service public dont aucun d'eux ne pouvait s'affranchir impunément. En 1429, un nommé Jean, du faubourg de Poppey, traversant Bar-le-Duc au moment où l'on se disposait à exécuter Pernet Ancel, d'Aillecourt, prisonnier de guerre, les sergents, profitant de sa charrette, y placèrent l'échelle patibulaire, en lui ordonnant de la conduire. Mais, arrivé à Marbot, ce sournois détela ses chevaux en toute hâte et se sauva, refusant un concours qui lui semblait humiliant. Ce refus, qui retarda l'exécution de deux heures et mit la justice en péril, fut puni d'une condamnation à 70 fr. d'amende.
Il fallait un dernier et principal représentant de la force publique, l'exécuteur. Dans un temps où chacun mettait de l'importance à ses prérogatives personnelles, c'était à qui ne serait pas chargé de prévenir un homme qui n'était regardé qu'avec effroi ou dégoût. Dans l'origine, les prévôts avaient trop d'empire sur leurs sergents, et ceux-ci étaient trop habitués à la discipline, pour qu'il se rencontrât la moindre difficulté ; leur répugnance eût été peu comprise et encore moins tolérée. La Cour souveraine chargeait de ce soin son greffier ; mais, lorsqu'elle eut acquis plus d'importance, ce fonctionnaire, un beau matin de 1711, s'avisa de s'y refuser. Le Procureur général lui dépêcha l'huissier Belleau, pour lui enjoindre de venir, par lui ou l'un de ses commis, prendre ses ordres relativement à une exécution qui devait se faire le lendemain. Mais maître Lamesle, greffier, et Vautrin, fils de l'un des commis, répondirent fièrement à l'envoyé qu'ils iraient quand le temps en serait venu et qu'on leur aurait remis un arrêt de la Cour qui le leur enjoindrait; puis, avec la malice des gens de plume de leur confrérie, ils le traitèrent, en ricanant, de plaisant visage, et, pour conclusion, le mirent à la porte.
La ressource fut de se tourner vers l'huissier émissaire et de le charger de la commission refusée ; mais, fort peu flatté de la préférence et aucun de ses confrères ne se sentant plus d'inclination que les greffiers à faire cette corvée, le Procureur général se trouva tout à coup sans auxiliaire. Il se hâta de présenter requête à la Cour, qui, par arrêt du 20 février, ordonna que les huissiers obéiraient en cela, comme en tout ce que leur commanderait le Procureur général, à peine de 50 fr. d'amende et de destitution.
EXÉCUTEUR.
C'est que c'était un terrible personnage que l'homme chargé d'arracher l'honneur et la vie à ses semblables. Sa tâche était de flétrir, de torturer, mutiler, écorcher, étouffer, assommer, noyer et brûler des êtres humains désarmés. Son toucher, inséparable de la souillure, faisait horreur; sa personne inspirait d'autant plus l'épouvante, que sa résidence en un lieu retiré, la chambre du pilori, ordinairement adossée aux remparts des villes, jetait sur sa vie et ses moeurs un voile mystérieux. En quelques localités, les lettres scellées, c'est-à-dire les commissions de son
office, les ordres d'agir, ne lui étaient transmis que jetés à terre, sous le bureau, où ce bras redoutable, soutien nécessaire de la loi, devait cependant s'humilier avant de venir en aide à la société.
Inutile ici de dire qu'il n'y a pas grande comparaison à établir entre ces effrayants fonctionnaires d'autrefois et ceux d'aujourd'hui. Ceux-là, tirés de la classe la plus infime de la populace, étaient forcés de se montrer inhumains, et trop souvent ils semblaient ajouter par plaisir à l'atrocité de leur office. Ceux-ci, au contraire, presque tous excellents pères de famille, citoyens paisibles, de moeurs la plupart exemplaires, exercent leur ministère avec des formes et une douceur irréprochables. Ils sont d'ailleurs favorisés par un procédé mécanique qui les rend presque étrangers à leur action et les dispense même de fermeté.
Malgré les justes répugnances d'autrefois, ce métier ne manqua pas souvent de postulants, la misère y forçant les uns, l'inconduite et la férocité y poussant les autres.
Cependant, il faut croire qu'il y eut quelques exceptions, car on ne peut autrement expliquer la servitude imposée à certains hommes de remplir ces fonctions. Dans les droits de l'évèché de Metz, au XIIe siècle, il est dit ; « Au ban de Tury doit être pris le bourreau, tenu de pendre, crever les yeux, couper les poings, les pieds, les têtes
et faire toute justice. » Il avait pourtant le droit de mettre à sa place un larron, qui ne pouvait lui être refusé quand il le demandait. Celui-ci, qui rachetait sa vie à ce prix, ne pouvait, avant sa mort, être remplacé par un autre : c'était au Messin de Tury à le conserver de son mieux à la disposition de la justice.
C'était quelquefois une planche de salut offerte aux condamnés que d'avoir la vie sauve, à la condition d'exécuter des criminels, la plupart du temps leurs complices. A la prise du fort de Dulange par l'évêque de Metz, en 1349, quatorze des bandits qu'il renfermait furent pendus au toit, et ce fut l'un d'eux, le ménétrier de la bande, qui se chargea de l'exécution, à l'exemple du jardinier du couvent de Crémone, qui pendit tous les religieux, au nombre de cinquante, condamnés avec lui pour meurtre.
Le bourreau de Metz ayant été tué par un condamné en 1507, on chargea de l'exécution urgente de ce dernier un nommé Gérard Noirel, jadis banni de la cité, réfugié dans une cabane au milieu des vignes. De l'argent, une belle robe et sa grâce le décidèrent ; le lendemain, il coupait la tête au meurtrier de son prédécesseur. En 1621, à Bar, il suffit de 200 fr. pour déterminer Pierre Chapuzot à accepter ces fonctions. En 1443, à Gondrecourt, une nommée Isabelle se trouvant être à fustiger et à pendre, et les bourreaux étant, pour le moment, difficiles à faire venir des environs, à cause des guerres, on en chargea un coquin qui expédia la besogne pour 6 gros. En 1519, à Moyeuvre-la-Petite, on prit un mendiant de bonne volonté pour exécuter un porc qui avait dévoré un enfant. Quelquefois, le geôlier remplaçait aussi le bourreau, même pour donner le fouet autrement que sous la custode, c'est-à-dire en public.
A côté des serfs, voués, comme ceux de Tury, au jeu du glaive et de la corde, d'autres Lorrains, Barisiens et gens des Évêchés étaient assujétis à venir en aide aux exécuteurs.
Fournir les échelles patibulaires, les dresser contre la potence, avaller la justice, c'est-à-dire détacher le pendu, étaient des servitudes personnelles attachées à certains habitants de certains villages. Relange, Flavigny, Barisey, Norroy, Puzieux, Chaumouzey, Viviers-les-Offroicourt, Fontoy, Ambacourt, Pont-sur-Madon, Villiers, Girecourt et beaucoup d'autres y étaient soumis. A Sierck, il en était de même. De temps immémorial, les habitants de Gussainville subissaient ce joug; en 1407, Jean le Bel Jehan, prévôt d'Étain, leur ayant commandé de faire leur service à l'exécution de Jean Laflèche, ils refusèrent et prirent même les armes pour assurer le succès de leur résistance. L'affaire portée au conseil du cardinal de Bar, ce prince les affranchit de cette servitude, le 19 janvier 1427 (60).
A Remoncourt, les habitants du Val avaient cette charge, qu'ils rachetèrent en partie au duc moyennant une redevance d'un resal d'avoine par charrue, mais qui subsista contre eux pour les criminels du Val. A Foug, l'échelle était dressée par les mayeurs de la prévôté, pourquoi ils recevaient 5 sous chacun (61). A Conflans en Bassigny, ce service était fait par les bourgeois, qui avaient par exécution 10 sous à partager entre tous.
A Pont-à-Mousson (62), les habitants venus depuis la constitution de la cité en commune n'avaient pu se faire admettre dans les mêmes droits et franchises que les autres, ceux-ci, peu généreux, les abandonnant à leur misérable condition de serfs. Réunis sous le nom de la Centaine, ils vivaient à part, subissaient l'obligation ignominieuse de fournir les échelles, de les porter au gibet, d'y aider de leurs personnes. Impossible à eux, à leurs enfants de se marier aux bourgeois, d'acquérir leur sympathie ; traités de porteurs d'échelles, ils n'avaient de relations avec les privilégiés que par des disputes poussées jusqu'au meurtre. Et cependant ils venaient du duché de Lorraine, ils étaient sujets du prince ; aussi René finit par écouter leurs doléances, et les mit, en 1497, sous les mêmes lois que les bourgeois superbes ; mais la fusion véritable ne put avoir lieu qu'à la longue.
Le refus de lever l'échelle était puni d'une amende considérable, arbitrée suivant les circonstances, selon que le service en souffrait. On trouve qu'en 1427, le duc fit remise d'une partie de celle prononcée contre Jacquemin le Warault et autres de Marsoupe, qui s'y étaient refusés lors de l'exécution à Saint-Mihiel de J. Odin, suicidé (63).
La rétribution due au bourreau pour son office n'était pas très-élevée. Souvent il n'avait qu'un franc pour donner la question ; moyennant 10 à 15 fr., un homme pouvait être écharpé du haut en bas ou cuit à grand feu. Cela avait été réglé ainsi parce que les frais retombaient à la charge des seigneurs justiciers quand le condamné se trouvait insolvable, ce qui arrivait dans le plus grand nombre de cas.
Lorsqu'il fouettait, le condamné lui fournissait les verges et lui donnait une paire de gants ; cette dernière précaution était sans doute imaginée pour tourner le fouetté en dérision. Aux XVe et XVIe siècles, le prix de ces gants était de 2 gros. Il avait encore, dans les exécutions capitales, la dépouille, depuis la ceinture jusqu'en bas, droit souvent illusoire, car c'était un des privilèges de quelques justiciers de n'être tenus de délivrer le criminel que tout nu au seigneur suzerain qui devait en faire justice. C'est ainsi que cela se pratiquait au ban de Saint-Dié, en la prévôté d'Arches, etc. On en eut un exemple fameux en 1572, dans les réserves et protestations de la justice de Moyenmoutier, à raison de ce que délivrant au prévôt, pour
l'exécuter, un porc qui avait dévoré un enfant, ce criminel se trouvait, par exception, avoir au cou la corde indispensable pour le maîtriser.
En 1572, une difficulté plus grave se présenta ; il s'agissait de l'exécution de la veuve Georges, de la dame et la demoiselle de la Bruyère, condamnées toutes trois comme sorcières. Le maire, dans la crainte d'établir un précédent défavorable, se disposait à les présenter au prévôt de l'Abbé dans l'état le plus parfait de nudité, mais la pudeur alarmée de ces malheureuses finit par le toucher ; il leur céda, pour l'honneur et révérence de Dieu, de demeurer vêtues des habits étant sur elles, mais sous la réserve que cela ne pourrait préjudicier à ses droits.
Dans les privilèges de la justice de Barbonville, était celui de livrer de même au prévôt de Rosières le condamné tout nu ; néanmoins, l'usage avait admis pour ce dernier la faveur de demander au maire du lieu, représentant les seigneurs, sa chemise et sa corde, ce que l'on était également convenu de ne pas refuser.
Indépendamment de sa rétribution accidentelle, le bourreau avait des droits qu'il prélevait, non sur les seigneurs, non sur les condamnés, mais sur le public innocent. C'étaient le havage, la riflerie et la vidange, dignes fiefs de sa double seigneurie des hautes et basses oeuvres.
Le havage consistait à percevoir quelques deniers sur tous ceux qui apportaient des denrées aux marchés, ou à prélever une quantité déterminée de ces mêmes denrées, par exemple, un oeuf sur cent, un balais par charge, une poignée de pois, de haricots, etc., par corbeille. Ce droit était fondé sur ce que l'on prétendait que personne n'aurait consenti à recevoir d'argent de lui : force était donc qu'il prît ce qu'on ne voulait lui vendre. Quelquefois on se soumettait à cette perception sans trop murmurer, mais très-souvent c'étaient des soulèvements et de vraies révoltes, d'autant plus que ce singulier percepteur et ses agents n'y apportaient pas la discrétion et la délicatesse nécessaires, essayant volontiers de prendre au-delà de ce qui était dû. Dans l'ordonnance de police de Nancy du
12 juin 1497, sous le duc René, il est dit : « Item, pour ce que du passé sont été faits plusieurs torts et abus sur les vendants au marché dudit Nancy, touchant les ventes et le droit du bourreau, qui font payer aux bonnes gens plus qu'ils ne doient, dont plusieurs plaintes s'en font, pour ce qu'ils font exécution d'eux-mêmes, en mettant la main aux gens et à leurs biens, dont on ne requiert point de radresse, parce que la chose est petite, pour ce est bon que s'il advient question, que lesdits commis radressent les gens, pour en payer selon l'ancienneté, dont ils s'enquiéreront. »
Le havage devint de jour en jour plus difficile à supporter, l'antipathie de son exercice grandissant avec la civilisation. Il était pratiqué à l'aide d'un procédé bien fait pour déplaire et contre lequel se raidissaient avec indignation tous ceux qu'il atteignait ; Pour reconnaître ceux qui n'avaient pas payé, le bourreau ou ses aides marquaient sur l'épaule ou sur la hotte avec de la craie tous ceux qui étaient libérés. Cette empreinte, qui excitait l'hilarité des habitants de la ville, mettait en colère les honnêtes paysans, qui, pleins de répugnance pour cette apparente flétrissure, juraient de ne plus rien apporter à vendre, et trop souvent tenaient parole. L'inconvénient qui en résultait pour l'approvisionnement des villes engagea maintes fois à traiter de ce droit, converti alors en une redevance annuelle, à la charge de la caisse communale. Mais quand venait la guerre, la redevance était oubliée, non payée, et le bourreau reprenait son havage, qu'il fallait de nouveau contester.
Lorsque la France s'empara de la Lorraine, en 1666, elle confirma le bourreau dans ce droit, qui s'exerçait de même à Paris. Au retour de Léopold, les habitants engagèrent ce prince à y pourvoir, et il y eut de nouveau transaction pour Nancy avec l'Hôtel-de-Ville pour un droit annuel de 200 livres. Le règne de Stanislas n'y changea rien ; mais la province étant retombée sous la domination de la France, les exécuteurs Pierre Rheine, du Barrois, et Laurent Roch, de la Lorraine, se pourvurent et obtinrent le rétablissement de l'ancien droit, ainsi que la permission de marquer les personnes qui y auraient satisfait. Procès s'ensuivit avec les magistrats municipaux ; le 16 décembre 1767, intervint sentence conforme au bailliage. Mais, le 25 janvier suivant, la Cour souveraine, sans respect pour les lettres patentes, ordonna l'exécution de la transaction ancienne, qui eut lieu sans discussion jusqu'en 1775, que parut l'arrêt du conseil d'État du 3 juin, supprimant les octrois dans les villes, et, par suite, le havage, qui fut remplacé par un traitement fixe.
Le havage avait une annexe, qui était le droit des noces. A chaque nouveau mariage, à Nancy, le bourreau venait réclamer 9 gros des nouveaux mariés. Peut-être voulait-il par là leur présager que leur postérité n'aurait jamais affaire à lui, pourquoi il en demandait indemnité préalable ; mais, cet augure flatteur ayant cessé d'être apprécié, les honnêtes gens se révoltèrent contre cette odieuse perception, qui fut défendue, sur la demande des États, en 1614.
La riflerie était le droit d'abattre les chevaux hors d'état de servir, et de blanchir (dépouiller) les bêtes mortes. Le revenu de ce domaine était de 2 fr. par grosse bête et de 6 gros pour les autres, lesdits 6 gros valant, en 1600, 4 sous 1 liard. On pouvait s'affranchir de ce salaire en abandonnant le cuir. Comme le titulaire de l'office principal ne pouvait se trouver partout en même temps, il était tenu d'avoir dans les
localités, de deux lieues en deux lieues, des écorcheurs-adjoints, qui lui payaient une redevance et exploitaient à leur profit. Par arrêt de la chambre des comptes de Lorraine, la rétribution fut augmentée en 1772, et fixée, pour les grosses bêtes, à 5 fr. 6 gros dans les villes, et 3 fr. 6 gros dans les villages ; pour les petites, telles que brebis, chèvres et chiens, à 3 fr. 6 gros dans les villes et 2 fr. dans les villages. Dans les campagnes, le propriétaire de l'animal était tenu de conduire celui-ci au lieu désigné.
La vidange donnait au bourreau le droit de percevoir sur chaque fosse d'aisance, au moment où on la vidait, une rétribution en argent. Quoique cette occasion fût rare, on cherchait encore à l'éloigner. Ainsi firent les religieuses Annonciades de Saint-Mihiel, qui construisirent une énorme fosse se dégageant par un souterrain assez long dans une autre fosse encore plus grande. Mais l'affaire appelée devant la justice, il fut décidé qu'une porte serait établie au bas de la première fosse, que le bourreau en aurait la clé, et que chaque fois qu'elle serait ouverte pour le dégorgement prévu, le droit serait encouru. La révolution, qui vint peu après, combla la fosse, le couvent et encore mieux le bourreau.
Indépendamment de ces privilèges, casuel, rétributions et traitement, les bourreaux jouissaient personnellement d'une réputation scientifique, perpétuée jusqu'à nous, qui ne laissait pas d'être lucrative. Ils médicamentaient, ils saignaient, ils opéraient les malades ! Leur fameuse graisse de pendus était recherchée avec empressement, et ils excellaient, disait-on, à extirper les cancers des femmes à l'égal de ceux de la société. Ils passaient encore pour très-habiles à cicatriser les plaies, ainsi qu'à soigner les ulcères les plus dégoûtants. Leur habitude d'aborder sans hésitation ni répugnance les parties les plus sensibles du corps leur donnait probablement une certaine hardiesse qui inspire confiance au peuple, toujours entraîné d'ailleurs vers ceux qui compatissent à ses maux. Il est probable encore qu'ils donnaient jadis des soins aux lépreux; car on voit qu'à Paris ceux-ci leur payaient chacun une redevance annuelle de 4 sous.
Cet empiétement du bourreau sur les attributions d'Esculape donna lieu à quelques résistances, les médecins étant surtout peu flattés de la concurrence. En 1658, Bernard Braine et Jean Lus, chirurgiens à Saint-Avold, espérant éloigner maître Carpsf, bourreau du lieu, de la pratique de leur art sacré, lui intentèrent un procès. La justice, après maintes dissertations et discussions, décida que Carpsf resterait apothicaire et médecin, mais que les chirurgiens demeureraient seuls en droit de faire les opérations.
Le public a long-temps ajouté foi à deux contes sur le bourreau. Le premier, c'est que ses fils étaient contraints par la loi de lui succéder ; le second, c'est qu'il portait l'épée à droite au lieu de la porter à gauche. Les exécuteurs les plus âgés que nous avons eu l'occasion de consulter nous ont affirmé n'avoir conservé de leurs aïeux aucune tradition semblable, et nous ne l'avons rencontrée dans aucun auteur. Nous pensons que le conte relatif à l'épée a pris sa source dans ce fait, que ces fonctionnaires sont représentés de la sorte sur de vieilles estampes, par la faute du graveur, qui n'a su prévoir le renversement à l'impression, comme cela arrive aussi dans quelques gravures de batailles où les soldats semblent tenir leurs sabres de la main gauche. Quant à l'hérédité forcée de l'office, jamais les fils n'y ont été contraints, et rarement ils ont manqué de bonne volonté, car dans la sphère où ils se trouvaient placés, ce fut toujours un emploi lucratif.
Les pères, tout au contraire, tenaient pour avantageux de le transmettre à leurs enfants, et ceux-ci regardaient comme un droit d'y succéder. On trouve dans les minutes de Me Briquelot, notaire à Rosières-aux-Salines, à la date de 1743, un contrat de mariage de la fille du bourreau du lieu, qui dénote le prix que l'on y attachait de part et d'autre. Non-seulement l'apport de la future n'est autre que l'office de son père, mais pour lui conserver intacte cette dot enviée, sa mère avait soigneusement, depuis son veuvage, continué les fonctions de son mari, qu'elle faisait remplir par des aides, lorsque les oeuvres demandaient l'emploi d'une force masculine.
Loin de rougir de leur position, à l'exemple de ce qui se passe dans d'autres familles autrement puissantes, les futurs avaient appelé leurs pairs à cet acte solennel. Six bourreaux des plus notables du pays, les dignitaires de l'ordre, y figurèrent comme témoins honoraires. Et ce qui donne à penser que la joie n'était pas bannie de cette association d'artistes funèbres, c'est que le joueur de violon de l'endroit était témoin instrumentaire.
Cette place avait néanmoins ses désagréments. Un usage à Metz, en souvenir de la levée du corps de saint Clément, était de courir le baccon, le 2 mai de chaque année. Ce jeu populaire consistait à couper une corde à laquelle était pendu un quartier de lard (baccon) au-dessus de la porte de l'abbaye, dite la porte au baccon de saint Clément. Quand un prétendant s'avançait, la corde était subitement tirée au moment où il frappait, et il ne recueillait que des huées. C'était le bourreau de la ville qui avait la charge de faire danser le baccon, et Dieu sait s'il mettait de la malice à tenir la dragée haute à tous venants. En 1452, maître Didier, juché au-dessus de la porte, s'acquittait de son office avec tant de zèle, qu'il se laissa choir et fut tué. Ce fut grande joie pour une malheureuse fille qui essayait en ce moment de couper la corde, mais bien plus grande pour une certaine portion de la populace, qui ne voyait plus d'exécutions possibles puisqu'il n'y aurait plus de bourreau pour les faire ; mais subitement s'en vint présenter un autre qui fut reçu.
Cette fin tragique était rare : cependant, la mort lui arrivait quelquefois par une autre voie difficile à prévoir ; nous voulons parler de la résistance désespérée de quelques condamnés. Metz en eut un exemple en 1507 : Maître Walter, quoique très-habile, fut tué d'un coup de couteau par un prévenu au moment où il allait lui faire subir la question.
Il arriva plus d'une fois aussi que le peuple se mutina contre l'exécuteur, notamment lorsqu'il était négligent ou maladroit ; c'est ce qui eut lieu contre Paul Gueldre, à
Neufchâteau, en 1728 ; contre Jean-Pierre Bour, à Nancy, en 1721. Ce dernier, peu endurant, frappa de son épée un de ses agresseurs, mais il en fut puni par 25 fr. d'amende, 550 fr. de dommages-intérêts et l'amende honorable sur la place publique. Il lui fut, à cette occasion, fait défense de sortir de la ville sans permission, et la maréchaussée reçut l'ordre de ne quitter à l'avenir le lieu du supplice qu'après l'enlèvement du corps et des instruments. Il parait qu'il s'était fait attendre long-temps et que le peuple s'en était impatienté.
A côté du danger du métier se joignaient encore des inconvénients inévitables, comme de torturer ou exécuter un parent ou un ami. En 1453, le bourreau de Metz se vit dans la dure nécessité de fouetter publiquement son fils, âgé de douze ans, pour un vol qu'il avait commis ; il fit, au surplus, la besogne si consciencieusement, qu'il y usa deux faisceaux de verges. Cette exécution s'était faite en présence des enfants de toutes les écoles.
En 1507, maître Gérard Noirel, alors titulaire, fut appelé à noyer son parrain, condamné pour faux serment. Le pauvre homme en était si chagrin qu'il pleurait encore plus haut que le condamné. Mais autre tribulation : tout à coup grâce est faite à l'heureux parrain.... et voilà le filleul si saisi qu'il en meurt de joie.
CONSOLATIONS.
Les condamnés rencontrèrent long-temps une extrême dureté à leur dernière heure : les parents et les amis les fuyaient d'inspiration ou par ordre; l'Église les délaissait après les avoir frappés de ses foudres. Cependant, la religion s'était émue en France; elle avait ressenti quelque pitié pour des malheureux livrés au désespoir, ne demandant qu'à entrer dans la voie du repentir; elle venait d'ajouter à sa gloire en chargeant ses ministres de ce soin, lorsqu'on Lorraine un gentilhomme apparut aux pieds de l'échafaud. C'était en 1408. Romaric Bertrand, seigneur vosgien, quoique sorcier, devait-il périr comme un manant (64) ? N'avait-il pas une âme plus précieuse à sauver ? Il en fut jugé ainsi, car il eut la faveur d'être assisté d'un confesseur. Grâce à ce criminel de bonne maison, petits et grands scélérats furent désormais traités en chrétiens.
Les prêtres employés à ce pénible ministère étaient assez ordinairement des religieux ; ils étaient deux, quelquefois trois pour un condamné. Rien ne nous indique si leur nombre était calculé sur la difficulté de la conversion ou sur toute autre règle. Après l'exécution, quand surtout elle se faisait dans une localité éloignée de la prison d'où le condamné était parti, ils dînaient avec le prévôt et sa
suite, la justice, comme nous l'avons dit, ayant droit chaque fois à un repas qui se prélevait sur les frais. Dans plusieurs sièges, on payait les confesseurs à raison de 2, 3 et 4 fr. chacun, mais cet article était toujours rayé par les chambres des comptes ; l'abbé de Bouzonville, justicier pour partie à Siertzperg, refusa lui-même de les payer, prétendant que ce service devait être gratuit. On lui demandait un florin d'or.
Le condamné avait encore quelquefois d'autres témoins officiels de sa mort ; quand il avait un ou plusieurs complices, il était rare que ceux-ci ne fussent pas contraints de l'accompagner. D'ordinaire, destinés comme lui à mourir sur l'échafaud, c'était le plus coupable qui était réservé pour le dernier. En 1706, un père fut fouetté et marqué sous le corps de son fils pendu, et après l'avoir vu pendre. La Cour elle-même usa de cette punition de longue durée. En 1711, une femme de Rembercourt-aux-Pots, ayant assassiné son mari avec son amant et une de ses amies, celle-ci parut à la potence assistée des deux premiers, la femme fit ensuite amende honorable en présence de l'amant, après quoi il fut roué sous les yeux de sa complice, qui enfin fut pendue»
J'ai rencontré deux exemples de parents et d'amis dévoués jusqu'à l'échafaud. L'un est de la part d'une jeune fille de Saint-Dié, qui, méprisant tout danger personnel, ne voulut abandonner son père accusé de sorcellerie, et poussa la piété jusqu'à l'assister de ses consolations sur le bûcher. Nous avons un vif regret de ne pouvoir consigner ici son nom. L'autre exemple est relatif à Broche, militaire renommé à Metz. François le Gournais et Jean Chaverson, tous deux Treize et des plus grands seigneurs de la cité, non-seulement lui donnèrent des marques de leur sympathie, mais, placés de chaque côté de la brouette, ils l'accompagnèrent jusqu'au lieu du supplice en lui prodiguant les encouragements les plus affectueux.
Nous avons souvent trouvé parmi les frais de justice dans les campagnes, des dépenses qui font d'autant plus d'honneur à leurs habitants, qu'on ne les trouve que très-rarement dans les villes : A chaque exécution, un peu de bon vin et un gâteau ou une tartelette étaient achetés pour le condamné ; cette consolation, peu importante par elle-même, témoigne au moins que ces malheureux, alors si sévèrement traités, n'étaient pas partout privés de tous égards. A Nancy, au contraire, en 1421, le bourreau ayant porté en dépense un peu de vin pour un condamné, on lui objecta qu'il n'était dû que du pain et de l'eau ou six deniers.
LECTURE, TESTAMENT ET SUPPLICE.
La sentence de condamnation était lue de nouveau au condamné, au pied de l'échafaud ; il était obligé de l'entendre à genoux et tête nue ; on appelait cette formalité : lire le procès. S'il voulait faire une révélation, la justice présente s'empressait d'y déférer; il en était de même pour son testament. A Nancy, pendant le dernier siècle, s'il demandait à tester, on appelait un conseiller du Parlement qui se tenait, à cet effet, dans une maison peu éloignée du lieu du supplice.
Le confesseur donnait alors sa bénédiction et le bourreau faisait le reste.
Après la cérémonie, et pour ainsi dire pendant les derniers soupirs du mourant, l'un des religieux présents profitait de l'émotion générale pour adresser au peuple assemblé quelques réflexions salutaires ; mais l'agitation de la foule et le plus souvent ses lazzis en paralysaient tout l'effet. Dans les localités où les exécutions n'avaient lieu que très-rarement et par exception, l'assistance, terrifiée, était assez docile ; dans les villes, ce spectacle trop réitéré ne produisait souvent qu'une impression médiocre sur les esprits de ceux qu'il était destiné à moraliser.
EXECUTIONS EXCEPTIONNELLES.
SANS BOURREAU.
Dans les temps reculés, l'emploi, du bourreau était plus facultatif qu'obligatoire ; il dépendait des parents ou des amis du condamné de lui épargner cette souillure. Cet usage, qui est incontestable, ne nous est néanmoins apparu écrit que pour Metz, où il est consigné dans un atour du commencement du XIIIe siècle qui porte : Sei parent ociront luy.
C'est sans doute en conséquence de cette disposition législative qu'en l'an 1324, Colin Grognat, seigneur messin, condamné à être noyé, obtint la faveur d'être exécuté par ses amis, pendant la nuit, en présence de deux magistrats. Six amis, dont deux ses parents, lui rendirent ce triste service.
En 1354, une femme d'Amanty fut condamnée, en la prévôté de Gondrecourt, au jugement des jurés et bonnes gens, à avoir l'oreille coupée. Pour éviter le contact du bourreau, elle se la coupa elle-même.
BOURREAUX.
Il nous reste à donner les noms des bourreaux que nous avons pu découvrir; la plupart de ceux actuellement en exercice y trouveront leurs ancêtres : il n'en est peut-être pas un qui n'y ait des alliés, tant cette profession a été volontairement héréditaire.
1349. Jean de Dilla, à Châtillon-sur-Saône.
1399. A. Cochart, à Saint-Miliiel.
1406. Jean, à Bar.
1421. Simon, à Nancy.
1424. Jacques Tout au Long, à Bar.
1434. Jehan Sergent, à Nancy.
1440. Jean le Mitre, id.
1442. Nicolas, à Bar.
1452. Didier, à Metz.
1473. Jehan de la Plume, à Longwy.
1480. A. Collinet, à Metz.
1488. Nicolas, à Saint-Mihiel.
1490. Guillaume, à Nancy.
1493. Pierre le Picquart, à Hatrise.
1494. Nicolas le Picquart, à Bar. - Jehan, de Verdun, à Longwy.
1502. Didier, à Bar. - Guille, à Saint-Mihiel.
1503. Walter Lallemand, à Metz.
1504. Guillaume, à Verdun.
1506. Antoine Legier, à Bar.
1507. Gérard Noirel, à Metz.
1512. Jehan, à Pont-à-Mousson.
1516. Pierre Picquart, à Bar.
1517. A. Brounet, à Verdun.
A. Thiébaut, à Metz.
1518. Guillaume, à Nancy.
1523. Jean de Nancy, à la Chaussée.
1527. Anthoine de Stainville, à Bar.
1535. Pierre Cugny, à Bar.
Jehan Marcaire, à Nancy.
1542. Pierre Pitolet, à Bar.
1550. Claude, à Metz.
1556. Christophe, à Marville.
1559. Robert Robert, à Neufchâteau.
1562. Thomas le Gay, à Bar.
1569. Gérard Colson, à Étain.
1570. Jehan Chrétien, à Langres.
1587. id. id. son fils, id.
1571. Claudot Thiériot, à Pont-à-Mousson.
1574. Pierre Coustellier, à Bar.
1575. Nicolas Legrand, à Apremont.
Antoine Denis, à Nancy.
1577. Jean Roussel, à Saint-Mihiel.
1582. Didier Marchal, à Nancy.
1583. Nicolas, à Haulmecourt.
Jean Rouge Cul, à Foug.
1585. Didier Marchal, à Nancy.
1586. Bernard Euchentz, à Badonviller.
1587. Nicolas Martin, à Moyeuvre.
Nicolas Jeancolas, à Apremont.
Husson et le Bourguignon, à Viéville.
1589. Jean, de Bar, à Saint-Mihiel.
1592. Claude Jeannet, à Nancy.
André, à Sarrebourg.
Pierre La Loche, à Bar.
1594. Didier Gouvenot, à Nancy (65).
1595. Jean Gallois, à Vézelise.
1596. Henri Colson, à Étain.
1600. Mengin Hassoux, à Foug.
1601. Anthoine, à Metz.
Laurent Harbogatz, à Badonviller.
Nicolas Vinet, à Pont-à-Mousson.
1603. Didier Vouillaume, à Mirecourt.
1604. N. Mars, à Badonviller.
1606. Simon Matrot, à Conflans en Bassigny.
1607. Jean, à Verdun.
1610. Jehan Mesnage, à Chaumont.
Martin Hausser, à Nancy.
Antoine Pierson, id.
1612. Christophe Godin, id.
Nicolas Ravinel, à Bar.
Poirson Voirin, à Nancy (66)
Nicolas Vinet, à Pont-à-Mousson.
1614. Denys Daublan, à Conflans en Bassigny.
1616. Henri Colson, à Étain.
1618. Christmann, à Phalsbourg.
1621. Nicolas Morizot, à Mirecourt (67).
N. Martin, à Einville.
1624. Demenge, à Nancy.
Nicolas Vary, à Mirecourt.
Mansui Hilaire, à Bar.
1628. Demenge Marchal, à Mirecourt.
François Denis, à Pont-à-Mousson.
1629. Martin Houg, à Nancy.
1650. Humbert Carlé, à Toul.
1651. Pierre Chapuzot, à Bar.
1652. La Débauche, à Arches.
1660. Jean Georges, dit Duval, à Nancy.
1719. Claude Suisse, à Étain.
1721. Jean-Pierre Bour, à Nancy.
1723. Jean-Jacques Bour, à Saralbe.
1728. Paul Gueldre, à Neufchâteau.
1745. Pierre Wolf, à Gerbéviller.
Oswald Cané, à Sarrelouis.
François Roch, à Nancy.
Nicolas Barré, à Metz.
1745. Philippe Rheine, à Gerbéviller.
Jean-Pierre Duval, à Lunéville.
1750. Jean Herman, à Morhange.
1751. Jacob Rheine et Claude Herman, à Dieuze.
1758. Nicolas Thouvenin, à Morhange.
1765. Jean-Georges Grosholtz, à Phalsbourg.
1765. Claude Herman, à Morhange.
Nicolas Herman, à Dieuze.
1766. Jean-Georges Lander, à Lixheim.
Thiébaut Schnietzer, à Saralbe.
1768. Michel Hizeli, à Rambervillers.
1770. Laurent Roch, à Nancy,
1775. Pierre Wolf, à Gerbéviller.
1780. Jean-François Herman, à Lunéville.
Joseph Wolf, à Gerbéviller.
François Roch, à Toul.
1785. Christophe Piclerc, à Saint-Mihiel.
Pierre Rheine, à Bar.
PRISONS.
La maxime ancienne portait que la prison était faite pour garder et non pour punir, et il n'y eut jamais de maxime plus fausse, car à cette époque la prison punissait plus encore qu'elle ne gardait. L'obligation pour chaque seigneur d'avoir un lieu de sûreté pour le service de sa justice et pour ses prisonniers de guerre avait amené un genre de prison qui était à peu près partout le même. Le bas d'une tour, ordinairement la cave, était le lieu où gisaient les malheureux dont on voulait enchaîner la liberté; on y descendait par un trou pratiqué au sommet de la voûte et se refermant par une trappe. Le reste de la tour étant habité par les gardes du château placés aux divers étages, le prisonnier, chargé encore de chaînes, se trouvait suffisamment surveillé, sans nécessiter beaucoup de geôliers ; il lui était d'ailleurs impossible de fuir par la trappe, la voûte étant trop élevée pour qu'il pût y atteindre, et son mobilier ne se composant que d'un pot à l'eau. Il n'y avait possibilité de s'échapper qu'en agrandissant la faible lucarne par laquelle il recevait un peu d'air, ou en perçant le sol et les murs ; mais cette ressource, très-facile dans les romans, était peu usitée dans la pratique, aucun n'ayant les ongles assez puissants pour arracher (les pierres de taille bien cimentées, présentant des massifs de plusieurs mètres d'épaisseur ; et encore le plus souvent le trou creusé avec une patience surhumaine n'eût abouti qu'à faire entrer l'eau des fossés, toujours prête à faire irruption et à noyer l'industrieux détenu.
Aussi les évasions que l'on rencontre de la part de quelques prisonniers de choix paraissent-elles n'être que le résultat de connivences avec les geôliers.
Dans les castels des petites seigneuries, la cave était peu profonde et en proportion de la hauteur de la tour; mais dans les gros châteaux, elle s'enfonçait dans les entrailles de la terre avec autant de majesté qu'elle en mettait à s'élever au dehors. L'échelle pour descendre aux prisons de la Craffe, à Nancy, et dans celles du château à Saint-Mihiel, était de vingt-cinq pieds; celle de Bar, de vingt-trois. Avant d'arriver à l'orifice où commençait le premier échelon, celui du haut, on descendait un grand nombre de marches qui peut être évalué par le poids de la corde achetée en 1610 pour la prison de
Nancy, pour tenir à la main par MM. de justice pour aller visiter et interroger ; elle pesait trente-quatre livres. Dans ces tombeaux noirs et humides, la victime, frappée d'un froid de plomb, perdait toute énergie vitale ; ses vêtements moisissaient et pourrissaient sur son corps ; ses membres s'engourdissaient ; cette atmosphère empestée lui devenait un supplice plus cruel que la mort. Il suffît, en 1614, de sept mois de séjour dans la prison de Vézelise, à Mengin Voinier, de Vandelainville, pour en sortir les membres putréfiés. Quelquefois, et nous en avons vu encore des vestiges, le cachot communiquait par un étroit souterrain au puits du château dont le diamètre énorme et la profondeur pareille ne permettaient jamais l'évasion. C'est par là que le prisonnier recevait ses aliments, sans jamais communiquer avec personne, sinon par l'entremise de la ficelle qui servait à les lui descendre; et encore était-ce pour les prisonniers de guerre conservant un espoir de sortir un jour, mais non pour les criminels ordinaires, qui eussent été trop tentés de se jeter à l'eau pour en finir avec la vie.
Dans les villages où il n'y avait ni château, ni maison forte, le seigneur qui n'y avait pas d'habitation plaçait sa prison chez son maire ou autre officier de justice à sa solde. Là, les prisonniers étaient garrottés au moyen de ceps, qui étaient deux pièces de bois posées l'une à côté de l'autre, liées par des charnières et entre lesquelles les jambes, placées au moyen d'entailles, étaient emboîtées comme dans un étau. Cette entrave dispensait d'employer beaucoup de gardiens; mais le prisonnier ne pouvant changer de place, contraint d'y satisfaire à tous les besoins de la nature, endurait un véritable supplice.
L'usage d'expédier promptement les affaires ne permettait heureusement pas au prisonnier de languir long-temps dans ces lieux de désespoir, à moins pourtant qu'il n'y fût oublié. Il pouvait aussi arriver que la procédure amenât des lenteurs et des incidents imprévus pendant lesquels il avait à combattre une insupportable vermine léguée de siècle en siècle par ses prédécesseurs. Entre les horreurs d'un pareil séjour et les douleurs de la torture, on doit comprendre que l'accusé ne persistait pas long-temps dans un système de dénégation, surtout quand il n'avait à conserver qu'une vie déjà misérable au dehors. L'innocence elle-même rendait la tâche facile au juge, ne craignant pas d'outrager la justice en la faisant participer à son suicide.
On a pu remarquer, dans le cours de cet ouvrage, que la peine de la prison était extrêmement rare et n'était infligée d'ordinaire que pour un temps très-restreint, n'étant appliquée que dans des cas de délits peu graves ou en attendant une autre peine, comme celle du fouet ou de la réprimande. Nous en exceptons, bien entendu, les abus de pouvoir, qui étaient à l'entière discrétion des seigneurs ou de leurs justiciers. Il n'en était pas de même dans les officialités, où elle semblait une heureuse invention pour donner à l'homme le temps de réfléchir et d'expier sa faute par un long repentir. La détention perpétuelle y était une peine reçue et réputée égale à la mort. Reste à savoir si elle était toujours appliquée dans toute sa rigueur, si l'esprit de corps n'y mettait pas le plus souvent un grand obstacle ; il était alors trop facile de faire disparaître un individu, pour que l'on n'en usât pas vis-à-vis de pénitents que leur caractère sacré recommandait à l'indulgence de leurs égaux.
La peine de prison était si peu en harmonie avec les moeurs, qu'en 1545, un nommé Geoffroy et son fils, condamnés à garder prison pendant un an, dans leur propre maison, préférèrent le bannissement.
Ce mode singulier de séquestration ne fut pas employé dans cette seule occasion. Dans un temps où les peines étaient à la discrétion des juges, qui pouvaient modifier de mille manières celles en usage et même en inventer de nouvelles, la justice ne recula pas devant l'énormité de frapper des gens qui n'étaient à ses yeux ni criminels ni innocents, en un mot, des demi-coupables. Les justiciers de Toul en donnèrent plusieurs exemples dans des procès de sorcellerie (68) : En 1584, la veuve Bouillon fut condamnée à rester toute sa vie en une chambre sans en sortir et hors de la vue du peuple. Il en fut de même, en 1602, d'une sienne belle-soeur, Marguerite Houillon, veuve de Henri Parisel, sous peine contre toutes deux d'être chassées à perpétuité. En 1621, Babon Renard, soupçonnée du même crime, fut condamnée à être, par ses enfants, confinée en tel lieu le reste de sa vie, qu'elle parût aucunement en public ni en la cité à la vue du peuple, sinon d'être tenue pour suffisamment convaincue de son crime. Cette barbare confiscation de la liberté au préjudice de femmes que l'on n'osait condamner, était cependant un progrès !
Cette fois la sorcellerie semblait plus une folie qu'un crime; malheureusement cette exception, si dure encore, fut trop rare.
Les prisons les plus considérables étaient celles de Nancy, Saint-Mihiel et Mirecourt, les sièges supérieurs de justice qui y résidaient l'ayant nécessité ainsi. Celles du château de Condé ne l'étaient pas moins ; c'était là, à ce qu'il paraît, la Bastille des ducs. Indépendamment de MM. Desbordes et La Vallée, nous avons vu, à diverses époques, que l'on y envoyait des prisonniers de marque.
La place de geôlier était importante dans ces localités ; aussi ne doit-on pas s'étonner si elle fut demandée par le lieutenant du prévôt de Nancy, Bastien Camus, en 1612, lorsque dans cette ville cette place fut mise à la disposition des échevins. L'abus était trop facile de la part d'un homme tenant tous ses hôtes à sa discrétion, pour qu'il n'y eût pas de grands profits à tirer de cette position ; les malheureux y avaient alors peu de garanties contre les vexations. On ne dit pas quels étaient ses appointements.
A Ancerville, ils étaient de 100 sous, plus, est-il dit, les émoluments, honneurs et prérogatives, d'où il faut conclure que ceux-ci étaient grands et faisaient partout la partie la plus importante de leur rétribution. N'y avait-il pas, en effet, pour eux mille occasions de salaire ? Fourniture de paille, de pain, d'eau, d'aliments plus recherchés ou défendus, communication de livres à lire, de nouvelles du dehors, visite de parents ou d'amis, tours de faveur pour être jugé, même jusqu'au tour de justice. Aux États généraux du Barrois, en 1620 (69), les réclamations furent unanimes pour que les prisons de Bar fussent rapprochées
de l'auditoire, par le motif que, quand l'audience était terminée, les juges prétendaient toujours que l'heure était trop avancée pour s'occuper d'affaires criminelles, d'où il arrivait que les prisonniers étaient souvent oubliés.
A Épinal, le système cellulaire était adopté dans le but d'empêcher les prisonniers de se donner entre eux de mauvais conseils ; il en résulta un autre abus, c'est que le geôlier avait autant de règlements que de prisonniers, c'est-à-dire qu'il traitait chacun d'eux à sa guise, suivant son caprice ou son intérêt. Les gens du peuple acquirent la dure conviction que quand ils y étaient mis, non pour crimes, mais pour quelque peccadille de police, aucune distraction ne leur était permise, tandis que quand c'était un bourgeois aisé, tenant quelque peu au corps des notables, tout lui était permis jusqu'à y faire bombance. Cette distinction occasionna des plaintes et des murmures qui n'amenèrent malheureusement que des réformes momentanées (70).
Sous Charles IV, l'attention se porta, quoique tardive, vers le régime des prisons; par ordonnance du 23 août 1628, il fut prescrit de rédiger un acte d'écrou et d'en avertir le procureur général ou ses substituts : c'était un rempart contre les attentats à la liberté, mais il était insuffisant contre les abus intérieurs. D'autres règlements furent sans doute faits, quoiqu'ils nous soient inconnus ; car, en 1699, la Cour souveraine, voulant, dit-elle, les
refondre en un seul, rendit un arrêt qui prescrivit la séparation des sexes, obligea de changer la paille tous les quinze jours, autorisa des chambres particulières et des lits séparés, en fixa la rétribution, interdit le tabac à fumer aux prisonniers détenus pour crimes, et enfin proscrivit toutes les causes des abus que le geôlier pourrait faire de son autorité : ce qui n'empêcha pas qu'un mois après il fallut intervenir de nouveau pour y mettre ordre. En 1702, il fallait lui enjoindre de donner de l'eau fraîche à discrétion, d'où l'on peut conclure qu'il y avait encore de grands abus à attendre : aussi le ministère public reçut-il l'ordre de visiter les prisons une fois par semaine.
A Metz, sous l'autorité du Parlement, les mêmes abus donnèrent lieu aux mêmes prescriptions. A Toul, il y avait si peu d'ordre, que les sergents et archers gardaient souvent chez eux ceux qu'ils devaient écrouer, lorsqu'ils avaient le moyen de payer.
L'ordonnance criminelle de 1707 réglementa cette partie de l'administration de la justice avec autant de sagesse qu'il était possible d'en apporter ; elle prescrivit notamment de combler toutes les fosses et de mettre les prisons à rez-de-chaussée. C'était là une heureuse innovation qui faisait disparaître les tombeaux que la féodalité avait si impitoyablement creusés. Bien des seigneurs se dispensèrent d'obéir à cette injonction, ou du moins ne comblèrent pas leurs fosses, puisque l'on peut encore en voir des vestiges ; mais elles demeurèrent sans emploi : autrement, chaque fois que la justice en fut avertie, elle commanda l'exécution de l'ordonnance. C'est ce qui eut lieu à l'égard des dames de Remiremont. Par arrêt du 7 mars 1716, il leur fut enjoint de faire construire prisons convenables dans le délai de six mois, ou de réduire les anciennes à rez-de-chaussée. Il est triste de penser qu'il fallut qu'une victime fût découverte pour apprendre à l'Église qu'il était besoin de contraindre à l'humanité ces prétendues religieuses.
De nouvelles plaintes sérieuses furent portées, en 1744, contre le geôlier de Nancy : séduction des prisonnières, violences envers les prisonniers, refus d'eau, de paille et autres fournitures. La Cour informa et donna tort aux détenus, tout en morigénant le geôlier. L'année suivante, il y eut mêmes plaintes et même décision.
La nourriture des prisonniers ne fut jamais que du pain et de l'eau, l'un et l'autre fournis par le concierge. Dans les
officialités, qui avaient une tendance à poétiser les peines qu'elles infligeaient, cette nourriture était appelée pain de douleur et eau d'angoisse. En 1781, la Cour, usant du droit que lui accordait l'ordonnance de 1707 de faire des règlements en cette matière, décida que la fourniture du pain serait faite par adjudication ; il devait être de pur froment, entre bis et blanc, et chaque prisonnier devait en recevoir une livre et demie. C'était là un régime moins attrayant que celui qui rappelle actuellement sous les verroux, comme dans une hôtellerie, tous les vagabonds, à l'entrée de l'hiver.
Le bris de prison fut toujours puni : le code Léopold le considérait comme un crime; le récolement des témoins contre celui qui s'évadait valait confrontation.
(Art. 19, tit. 15 de la coutume,)
La conduite des prisonniers d'un lieu dans un autre se faisait, comme nous l'avons dit, par des entreprises particulières, en vertu d'adjudications au rabais. Plus tard, après l'organisation de la maréchaussée, celle-ci fut employée à cet usage toutes les fois qu'on put le faire, c'est-à-dire quand il y avait entre le point de départ et celui de l'arrivée une correspondance établie sans lacune.
AMENDES.
Le mot amende, vient d'emendare, qui signifie corriger. Ce fut et ce sera toujours, en effet, une correction que l'obligation de subir le retranchement d'une fraction, même légère, de sa fortune, pour la donner sans profit personnel à un tiers, celui-ci fût-il le trésor public. Cependant, en comparaison des peines corporelles, l'amende était une correction bénigne : aussi son application eut-elle originairement pour principale destination de punir les fautes peu graves. Mais bientôt on la vit indistinctement admise pour des délits importants, puis pour les crimes les plus grands, pénalité mal conçue, préparant à l'homme fortuné une impunité dangereuse et plaçant le pauvre dans une alternative injuste.
Les exemples de ces compositions moyennant argent pour des crimes méritant la hart se rencontrent fréquemment au XVe siècle. Ainsi, à Souilly, en 1401, Simonin de Monhéron, pour force par lui faite à Mariette Tupaine, telle qu'elle cria hahaye, en est quitte pour 60 sous, dont encore le seigneur lui fait remise. En 1429, à Bar, Didier le Bouge, pour avoir contrefait le scel de Henri des Massues, capitaine de Gombervaux, se rachette moyennant 40 fr. A Saint-Mihiel, en 1451, Alexandre Bugnaudel, de Flabéville, paie 8 florins pour le crime d'avoir bouté feu. A Bar, en 1452, J. Joly, charpentier à Vignot, compose pour 10 fr. pour forcement de demoiselle Jacquemelte Richier par son fils. En 1497, en la même ville, un voleur de grand chemin est libéré moyennant 20 fr., vu, est-il dit, sa pauvreté. A Mirecourt, en 1535, Jean Thiébaut donne 10 fr. par composition pour avoir emporté de la foire une paire de souliers sans la payer.
Il serait trop long de rappeler ici les divers cas où des amendes étaient prononcées par la justice ; on en a vu mille exemples dans le cours de cet ouvrage. Quant au taux de celles ordinaires, il était déjà fixé par l'usage avant la loi de Beaumont, qui en donna un tarif suivi à peu près par les autres chartes, et qui ne fut dépassé que plus tard, lorsque la valeur du numéraire en fit une nécessité, et encore ce fut toujours proportionnellement. Voici le taux des amendes maintenu jusqu'au XVIIe siècle par les habitants, soigneux d'invoquer une loi qui réglait à l'avance les conséquences de leur colère ou de leurs rancunes.
|
livres |
sous |
deniers |
| Bestiaux en délit |
|
|
12 |
| Menues bêtes en délit |
|
|
6 |
| Folle plainte |
|
5 |
|
| Injures |
|
5 |
|
| Id. publiques |
|
10 |
|
| Délit forestier |
|
10 |
|
| Coups |
|
5 |
|
| Coups étant ivre |
|
10 |
|
| Agression avec armes |
|
10 |
|
| Id. sans blessure |
|
45 |
|
| Id. avec blessure |
|
100 |
|
| Coups suivis d'effusion de
sang |
|
20 |
|
| Port d'armes non autorisé |
|
10 |
|
| Fol appel |
|
60 |
|
| Violation de domicile |
|
100 |
|
| Membre cassé |
|
100 |
|
| Attaque à force ouverte |
|
100 |
|
| Briser le marché |
|
100 |
|
| Id. par un étranger |
|
60 |
|
| Bourgeois qui bat un étranger,
et vice versa |
|
60 |
|
| Mal jugé |
5 |
|
|
| Accusation grave, non
justifiée |
9 |
|
|
On remarquera qu'entre la folle plainte, fixée à 5 sous, et l'accusation grave non justifiée, fixée à 9 livres, il y a une grande différence; mais, quelle qu'elle soit, cette dernière somme n'était pas fort élevée et peut servir jusqu'à un certain point à apprécier le degré de courage qu'il fallait pour se porter accusateur. On peut croire maintenant que si la peine eût été plus forte, on n'eût rencontré de bonne volonté nulle part.
L'amende de 3 sous était tombée en désuétude au XVe siècle ; le duc René, en réglementant la Cour des grands jours en 1497, le déclare expressément et prescrit de l'appliquer dans le Barrois.
L'accusation non justifiée de sorcellerie, quoique non prévue nominativement par le tarif, ne laissait pas d'être punie en raison de sa qualité. En 1484, un nommé Pierresson Grand Gérard, de Maxey-sur-Vaise, pour avoir ainsi accusé à tort deux femmes de ce village, fut condamné en 16 fr.; mais beaucoup furent bannis pour semblable fait.
Dans les agressions, la violence se calculait d'après les cris de l'assailli : dès qu'il avait crié hahaye, il était censé avoir couru un danger sérieux et l'offenseur puni en proportion.
Il y avait une amende appelée de ban brisé, contre les sujets de la seigneurie qui se battaient entre eux ; aux termes de l'article 30 de la coutume de Saint-Mihiel, elle appartenait au seigneur haut-justicier.
A Épinal, la coutume publiée en 1605 fixa le maximum des amendes variables à 60 sous, valant 4 fr. de monnaie lorraine, excepté pour les crimes ou les injures atroces. Les habitants ne manquèrent jamais l'occasion de s'en prévaloir, et toujours avec succès, quand l'indignation du juge la portait à une évaluation supérieure à ce taux. A Neufchâteau, suivant sa charte, la plus forte amende était de 100 sous, excepté pour rapt, vol et meurtre.
Mais, indépendamment du tarif, il y avait des actes non prévus réprimés par des amendes également non prévues, quoique non arbitraires ; l'usage en fixa le chiffre. En voici quelques exemples :
1427. A Étain. - Pour avoir pris un individu mis en assurément, 10 fr.
1429. A La Chaussée. - La femme Émon, de Bouillonville, pour, étant en pèlerinage à Saint-Pion-sous-Mousson, couchée dans la chapelle avec d'autres, s'être laissé choir sur un homme qui en mourut trois jours après, 10 fr.
1446. A Foug. - Merlin, dit le Grand, de Laneuveville-au-Rupt, pour un hahaye fait contre son père, 20 gros.
1451. A Saint-Mihiel. - Baudet, barbier, pour avoir castré un nommé Aubertin, qui en mourut, 20 fr. Il avait pratiqué la chirurgie malgré la défense qui lui en avait été faite.
1464. A Bar. - Alix de Lorme, femme de Nicolas de Clefves, épicier à Verdun, pour vente à faux poids, et en outre interdite de vendre aucun épice dans le duché de Bar.
1476. A Longwy. - Troëne, de Rodenges, pour avoir battu un jeune homme qui prenait ses poires, 10 sous.
1486. A Bar. - François Gilot, de Savonnière- devant-Bar, pour avoir marchandé avec un vagabond pour donner des coups de bâton à Jean Brahier, dudit lieu, 30 sous.
Idem. - Laurent le Maire, du même lieu, pour s'être couché sur le lit de la femme Aubriot, contre son gré, elle y étant, 4 fr.
1532. A Bar. - Jean Mazier, maire de Rembercourt-sur-Orne, pour n'avoir porté secours à un religieux que l'on battait, 60 fr.
1598. A La Mothe. - Jean Fouyn, tailleur à Graffigny, pour avoir mal façonné une jupe, 3 fr.
Les amendes pour délits ruraux étaient les plus nombreuses et aussi les moins élevées. Il n'y avait pas de condamnation particulière pour chacune. Tous les ans le prévôt, et plus tard un conseiller du bailliage, tenait une audience dite le plaid annal, où chacun était tenu de comparaître (71). Là, il était donné lecture des procès-verbaux des bangardes ou des sergents, et au troisième jour de cette assemblée, les délinquants étaient admis à présenter leurs justifications. Le procureur fiscal et le fermier des amendes approuvaient ou contredisaient; après quoi le président du plaid prononçait en fixant le chiffre, s'il jugeait que l'amende était encourue. Il dressait un rôle qui servait au recouvrement et devenait exécutoire.
Peu à peu le transport, regardé par les officiers des sièges comme une partie de campagne ou une occasion d'émolumenter, donna lieu aux plus criants abus. Au lieu de réunir plusieurs communes en une seule pour ne faire qu'une séance et une vacation, ils se rendaient dans chacune d'elles, à des jours différents, et augmentaient les frais
à tel point qu'un lieutenant-général de bailliage étant allé à deux lieues de sa résidence, reçut 56 livres, tandis qu'il n'y eut par lui d'amendes prononcées que pour 22 sous.
Ces plaintes ayant été adressées par les fermiers au gouvernement de Stanislas, il intervint, le 10 mars 1755, un arrêt de son conseil qui défendit ces transports et ordonna
qu'au contraire les délinquants se rendraient au chef-lieu où siégeait le bailliage.
Ainsi, ce fut par le fait des magistrats que les justiciables se
trouvèrent, en outre de l'amende, forcés à un dérangement
toujours coûteux, comme s'ils étaient faits pour la justice,
tandis que c'était le contraire. Dans l'origine, on avait
tellement voulu aller au-devant de ces incommodités, que, dans
plusieurs prévôtés, c'étaient les curés qui étaient juges de ces
amendes. Il en était encore ainsi notamment à Saint-Maurice et
plusieurs autres du ressort d'Hattonchâtel, au Val-d'Harol,
composé des communes de Remeicourt, Thiraucourt et Domvallier
(72).
Pour certains délits graves, il y avait des amendes non fixées dites arbitraires; ce n'était pas le juge qui en réglait le taux, à moins qu'il n'en eût reçu mandat spécial ; il condamnait simplement à payer une amende arbitraire, et alors le prince ou le seigneur la modérait (fixait), par lui ou ses officiers, selon la gravité du cas, presque toujours pesé d'après le crédit du délinquant ou celui de sa famille. Dans le Barrois, les amendes arbitraires furent modérées quelquefois par les baillis ; mais, le plus souvent, par la Chambre des comptes, réunie en conseil du duché : la même mesure fut le plus souvent suivie en Lorraine.
Les peines corporelles n'étaient pas exclusives des amendes ; dans les cas de crimes graves, les condamnés avaient encore à payer, à titre d'amende, une somme dont
le taux fixé par les précédents, qui formaient en cela une sorte de jurisprudence, s'élevait ainsi qu'il suit:
|
livres |
| Avec la peine du feu |
300 |
| ---- de la roue |
200 |
| ---- de la corde |
100 |
| ---- des galères ou du
bannissement perpétuels |
50 |
| -------- à temps |
30 |
| ---- du fouet |
50 |
| ---- de la réprimande et du blâme |
25 |
Toutes les amendes appartenaient de droit au seigneur justicier, qui, ayant à sa charge les frais de justice, devait y trouver une indemnité de ceux-ci. Cette organisation servit à plus d'un seigneur pour augmenter les revenus de son domaine, et à plus d'un juge complaisant pour gagner la faveur de son maître; mais, dans ce cas, la correction perdait toute sa valeur dans l'opinion publique.
A Saint-Mihiel, les gages des membres de la Cour des grands jours se payaient sur les amendes que ce tribunal prononçait, sauf, de la part du duc, à y ajouter; mais le public n'en était pas moins convaincu que ces messieurs faisaient en sorte qu'elles pussent suffire. Devant les États (73) cette organisation fut l'objet de représentations spéciales ; le prince les repoussa, en répondant que le taux des amendes étant fixé par les ordonnances, il ne pouvait y avoir d'abus.
Le Parlement de Metz prenait, sur les amendes qu'il prononçait, l'argent nécessaire pour payer les droits de sauvegarde que les gens de guerre imposaient à chacun de ses membres. Les justiciables étaient fort peu flattés de concourir à leur donner cette sécurité.
Le prince partageait les amendes qui lui étaient échues avec une classe de gens qui a toujours été flétrie par l'opinion, eu égard à la difiiculté de trouver des occasions de légitimer sa conduite : nous voulons parler des dénonciateurs. Presque toutes les lois rigoureuses et d'urgence accordaient le tiers des amendes pour prix de la délation ; n'ayant pas trouvé beaucoup de traces de leur application, nous aimons à croire que cet appât ne tenta que quelques infâmes.
Le discrédit tombé sur l'amende, comme moyen de correction, amena insensiblement l'usage d'en indiquer l'emploi ; on n'osait plus la laisser tout entière au seigneur, encore moins aux magistrats pour leurs honoraires ou autre profit personnel. Elle fut alors appliquée aux réparations de l'auditoire ou à ce que l'on appelait oeuvres pies, telles que la décoration de la chapelle du tribunal, l'achat d'un tableau pour l'église, la peinture d'une bannière. A Foug, en 1600, il fut décidé que le produit des blasphèmes servirait à faire un escalier de onze marches pour monter à l'église. Ce mode arbitraire d'expiation ne fut défendu que bien tard, par arrêt du conseil de France du 18 janvier 1781. Alors l'amende, une fois payée, ne reparut plus aux yeux du condamné sous une forme injurieuse.
Le défaut de payer l'amende par suite de mauvais vouloir ou d'insolvabilité n'était pas un moyen valable de s'en libérer ; la loi de Beaumont permettait de saisir les biens du coupable et ensuite le bannissait. Plus tard, on y substitua l'emprisonnement, suivant le prescrit des ordonnances. C'est à l'occasion de deux faibles amendes de fol appel que
Mengin Voinier, de Vandelainville, qui ne pouvait les payer, fut jeté dans les cachots meurtriers de Vézelise, d'où il fallut l'emporter au bout de sept mois (74).
Quelquefois le non paiement était prévu par la sentence : c'était quand on supposait la mauvaise volonté; alors l'alternative pouvait être fort rigoureuse. En 1492, à Metz, quelques jeunes gens de famille faisant partie d'une réunion joyeuse dite l'Abbaye des mal gouvernés, se prirent de querelle pendant une belle nuit, à la suite de quoi plusieurs passants furent gravement blessés. Cinq de ces mutins furent condamnés à payer 120 livres d'amende, sinon à avoir le poing coupé. Dix ans auparavant, il s'était présenté dans la même ville un exemple notable d'application de cette redoutable alternative. Le bourreau, maître Collinet, ayant frappé un homme d'un coup de couteau, fut condamné de même que les jeunes gens qui précèdent; mais il y eut cette différence qu'il eut le poing coupé. Il est à croire que ce fut avec intention que l'amende fut fixée à un taux tel qu'il ne pouvait l'atteindre, autrement c'eût été là une indigne barbarie.
A Saint-Dié, l'usage était d'exécuter les coupables lorsqu'ils ne pouvaient se racheter par le paiement de l'amende ou par le combat.
La loi de Beaumont et plusieurs autres chartes contenaient à l'égard des injures une alternative dont nous avons parlé: les femmes coupables devaient payer l'amende ou porter la pierre. (Voyez Injures.)
Les amendes pour simples délits étaient, surtout à partir du XVI siècle, récupérées par des fermiers, chacun suivant l'objet de son bail. L'un avait les amendes des mésus, l'autre celles des cabarets ; celui-ci des fêtes transgressées, celui-là des appels et sentences par défaut, etc. En 1560, Nicolas Luron était fermier de celles des amendes de la prévôté de Bar qui n'excédaient pas 60 sous, moyennant une redevance annuelle de 55 fr. En
1570, son successeur en payait 1,000; celles des mayeurs de la ville et du ressort de la prévôté étaient, en outre, affermées 1,200 fr. On se rappelle ce que nous avons dit de ce mode de perception (voyez Blasphèmes) ; l'immoralité de cette institution fut toujours sensible en Lorraine et ne servit le plus souvent aux adjudicataires qu'à s'assurer l'impunité ou à satisfaire de basses passions. L'abus en était porté au point qu'à Dompaire le prévôt se rendit lui-même adjudicataire des amendes qu'il prononcerait, d'où l'on est porté à penser qu'il ne dut négliger aucune occasion d'augmenter son profit (75).
CONFISCATION.
La confiscation était de deux sortes ; celle de corps et celle de biens. La première entraînait la libre disposition au profit du seigneur du corps du condamné, c'est-à-dire de sa personne vivante, car il n'était pas pour cela obligé de le faire mettre à mort, de ce principe ressortait la possibilité pour lui de composer pour le rachat. Cette confiscation, d'ailleurs, entraînait celle de biens, qui, dans ce cas, s'appliquait ou à la totalité ou seulement à une partie des biens du condamné. A Toul, en matière de viol, elle n'était que des trois quarts des biens du coupable, l'autre quart appartenait à la femme violée, à titre de dommages-intérêts. En général, elle avait lieu avec plus ou moins d'étendue selon la gravité du crime, dans les cas de mort, bannissement perpétuel, émigration, duel, forfuiance, formariage, etc. Elle emportait avec elle quelque chose d'odieux qui l'entachait d'injustice, le seigneur étant juge et partie dans sa propre cause. Avec des ofiiciers complaisants ou cupides, les prévenus couraient grand danger d'être trouvés coupables quand ils avaient de la fortune ; ils assuraient d'autant leurs gages et salaires, en même temps qu'ils enrichissaient leur maître. C'était du moins l'opinion qu'en avait le public et qui, comme nous l'avons déjà dit, motiva plusieurs fois des plaintes aux États. D'ailleurs, c'est que la confiscation ne pesait pas sur le condamné, qui, une fois mort, n'avait plus besoin de rien, mais sur ses enfants, toujours innocents de son crime ; et pourtant on les réputait procréés de sang improbe et méchant, héritiers du crime de leur père, poursuivants et insecteurs de sa témérité et audace.
La confiscation de biens ne se prononçait que contre les roturiers et les anoblis ; les gentilshommes de l'ancienne chevalerie en étaient exempts, ainsi que d'amendes, excepté en cas de crime de lèse-majesté. Dans d'autres cas graves, tels que fausse monnaie, empoisonnement, sortilège, vol, assassinat, ils pouvaient être momentanément privés de leurs biens, mais ce n'était qu'à titre de séquestre ; après leur mort, ces biens retournaient intégralement aux héritiers. C'est ce que la haute noblesse réclama avec insistance et qui lui fut confirmé par le duc Charles III en 1596. On voit, en 1502 (76), faire remise au fils du président des comptes, Huin Roynette, décapité pour ses démérites, des biens confisqués sur ce dernier; mais ce n'est pas forcément une exception : peut-être avait-il été condamné pour lèse-majesté, car nous n'avons pas trouvé l'indication de son crime, ou bien n'était-il pas noble de race et peut-être aussi, à cette époque, la noblesse ne jouissait-elle pas pleinement du privilège.
Ce n'était pas au seigneur que la confiscation, faite pour lui, profitait le plus, mais à ses représentants. La loi voulait qu'aussitôt qu'elle était encourue, il fût fait un inventaire des biens pour qu'il n'en fût rien diverti. Les officiers de justice, mal payés, mal surveillés, faisaient tant de séances, comptaient tant de vacations, quand encore ils ne s'entendaient pas avec les parents des condamnés, que le plus souvent il ne restait rien. Pour y obvier, dès l'an 1599, le duc Charles III leur prescrivit de n'y procéder qu'à l'assistance des receveurs de ses domaines : il fallut renouveler bien souvent cette recommandation.
Dans certaines parties de la province, la confiscation de biens n'avait pas lieu pour crime de la femme, par cette raison que le mari étant le maître de la communauté, c'eût été frapper sur lui. A Épinal, c'était la prétention des bourgeois, qui la maintinrent contre les entreprises des officiers de la France (77). La confiscation des meubles était d'ailleurs la seule qui y fût permise, excepté en cas de crime de lèse-majesté. La coutume de Metz, au contraire, admettait, pour crime de la femme, confiscation de ses propres et de sa part dans les acquêts. Celle du Bassigny n'autorisait que celle des propres du mari ou de la femme et la part des acquêts du mari. A Saint-Mihiel et à Bar, la confiscation ne portait que sur la part de l'époux condamné ; mais, dans les limites de son application, elle était inexorablement exécutée : On voit, en 1584, le seigneur partager
les meubles d'un père avec ses enfants mineurs, et les faire conduire d'Issoncourt à Souilly, sur la place publique, pour les vendre à l'encan.
A Toul, en condamnant le mari, on faisait réserve des droits de la femme : c'est ainsi qu'en 1583 il fut fait, en prononçant la peine de bannissement, avec confiscation, contre Mansuy Gouvyon, contumace, accusé de vol. Le douaire de sa femme fut expressément réservé.
Il y avait d'autres petites confiscations spécialement prononcées par les lois en matière de gruerie, de pêche, de chasse, de contrebande, fiefs tombés en roture, bois à brûler coupé trop court, etc. Elles étaient limitées à un objet particulier, mais non à la totalité ou à une partie des biens des condamnés ; par conséquent, elles n'avaient pas la même importance.
En matière de suicide ou de meurtre d'un inconnu, le cadavre et ce qui le couvrait appartenaient au seigneur haut-justicier où il était trouvé; la justice en prononçait la confiscation complète : c'était aux parents à les racheter s'ils voulaient en disposer. C'est ce que l'on voit, en 1586, au sujet d'un cadavre trouvé à Felsberg, qui fut racheté par ses parents au seigneur du lieu, moyennant 5 fr. (78)
BLAME, AVERTISSEMENT.
L'avertissement ou admonition était une menace destinée à détourner le condamné de récidiver. Il était conduit dans l'auditoire et placé derrière le barreau. Le juge président de l'audience lui disait à haute voix : La Cour vous admoneste et vous fait grâce; soyez plus circonspect à l'avenir. Retirez -vous, vous entendrez le reste de votre arrêt. Ce reste était ordinairement la condamnation à quelque aumône applicable aux pauvres, au pain des prisonniers ou à l'église.
Cette condamnation à l'avertissement n'était ni afflictive ni infamante.
Le blâme était plus sévère ; le condamné, conduit de même derrière le barreau, y était mis à genoux et tête nue dans un coin, sans épée ni canne. Le président lui disait : La cour vous blâme et vous rend infâme; soyez plus circonspect, ou vous serez plus sévèrement puni. Retirez-vous, vous entendrez le reste de votre arrêt.
Cette peine était ordinairement employée contre les officiers publics et entraînait l'infamie. Elle ne pouvait avoir lieu qu'en suite d'information à l'extraordinaire, c'est-à-dire après recolement et confrontation. On y avait recours quand l'accusé ne méritait pas de peine corporelle, mais n'avait pas droit d'être acquitté.
La Cour souveraine, pendant le XVIIIe siècle, usa souvent de ce mode de répression. Elle y condamna quatre cent six hommes et quarante-sept femmes. C'était ordinairement pour faux serments, vols simples, etc., contre des vagabonds, meuniers tortionnaires, tailleurs infidèles, escrocs, etc.
AMENDE HONORABLE.
Cette peine signifie littéralement réparation d'honneur.
Elle était de deux sortes, l'une appelée simple ou sèche, qui se faisait à huis clos, à l'audience ou en chambre du conseil, tête nue et à genoux, sans assistance de l'exécuteur et sans autre marque d'ignominie.
L'autre, appelée publique, avait lieu publiquement, soit dans l'auditoire, soit dans la rue, au devant d'une église ou du lieu du crime. Le condamné y était amené par le bourreau, en chemise, tête nue, ayant la corde au cou, une torche allumée à la main, un écriteau devant et un derrière. Là, les genoux en terre, il était tenu de dire tout haut ce qui était porté en la sentence comme étant la réparation imposée, qui se résumait toujours dans un aveu et, une demande de pardon à Dieu, au duc ou autre seigneur, et à la justice.
L'amende honorable était spéciale quand on avait fait injure à un homme revêtu d'une dignité, comme un magistrat, un gouverneur, un prêtre ou un ordre entier, par exemple une congrégation de religieux.
Elle était générale quand on avait commis un crime envers la société, tel qu'un outrage à Dieu, au prince, à la loi.
En 1499, un nommé Simonin Guandel, d'Éton, s'étant avisé de dire un peu haut que les chanoines de Verdun n'étaient pas seigneurs de son village, mais que c'était le roi, fut contraint d'en faire réparation en public, tête nue et à genoux. Le prévôt de Bouligny et Gouraincourt, messire Mengin Jennesson, partageant la même manière de voir, et ayant en conséquence molesté son confrère d'Éton et ses sergents, sévit réduit à la même humiliation. Son amende honorable, ordonnée par sentence rendue au buffet du duc, eut lieu en présence de plus de deux cents personnes que les vénérables avaient pris soin de convoquer.
Ces deux humiliés avaient, dans l'histoire, des précédents bien capables de les consoler, notamment les amendes honorables des ducs Simon et Mathieu, en 1132 et 1230, devant les reliques de saint Dié, derrière lesquelles se cachaient sans trop de précautions les puissants chanoines de cette ville.
Quelquefois la réparation était accompagnée de cérémonies particulières qui la rendaient plus significative. En 1538 (79), Claude Maillard, Claudon Guillemin et Colas Poirel,
de Labeufville, ayant empêché le sergent de Châtel de faire pour le duc le cri de la fête dans leur village, et lui ayant brisé sa verge, furent condamnés, à Bainville, par le lieutenant du bailli de Châtel, à être « conduits à Labeufville, à genoux, têtes et pieds nus, tenant une torche
ardente à la main, en présence des officiers de Châtel et Bainville; à dire hautement, chacun d'eux devant le sergent tenant la verge de son office droite en la main, que par témérité, insolemment et irrévéremment, contre l'autorité de notre souverain seigneur en l'état de son sergent, ils avaient empêché de faire le cri de la fête ; à crier merci à Dieu, à notre souverain seigneur et à justice, et, après ce, à baiser révéremment la verge dudit
sergent, et, ce fait, être bannis et exilés à toujours du pays de notre seigneur, et leurs biens confisqués. » Ils avaient plusieurs femmes pour complices, mais ayant été habilement désavouées par leurs maris, elles en furent quittes à moindre prix, c'est-à-dire sans bannissement ni confiscation.
Les sentences ne portaient pas de peine équivalente que le condamné fût libre de choisir. Il n'y avait pas d'alternative. Le refus, soumis de nouveau à la Cour de justice qui avait prononcé la sentence à exécuter, entraînait une condamnation des plus sévères, quelquefois la mort, en cas de persévérance à résister, ce refus étant considéré comme une insulte à la justice, une rébellion à la loi. En 1612, un nommé André, de Toul, voyant pendre son beau-frère, ne put s'empêcher de maugréer contre la justice. Condamné
à faire amende honorable pour cette licence, il refusa d'obéir. On décida qu'il serait mis dans le fond Estivon, qui était apparemment quelque trou bien sombre ; il n'en fallut pas davantage pour que, peu de jours après, il cédât.
En 1550, Nicolas Garnier, de Bar (80), pour avoir injurié Hugo Breton, lieutenant particulier, fut condamné à lui faire réparation. Sur l'appel par lui interjeté, le Parlement de Paris le condamna de même à faire amende honorable, à crier merci au lieutenant particulier en l'auditoire de Bar, à déclarer qu'il le tenait pour homme de bien et à lui demander pardon ; sans préjudice à 8 fr. de dommages-intérêts et 10 fr. d'amende. Garnier, ramené à Bar dans la prison de la tour Jurée, par J. Houchart, sergent et hacquebutier du roi, et Antoine de la Noie, venus exprès de Paris, fut conduit, le 14 février, au prétoire du prévôt
Philippe Prud'homme, où se trouvait une nombreuse assistance, entre autres, Thierri de la Mothe, lieutenant-général; Philippe Merlin, lieutenant particulier; J. de Rosières et Thiéry Cousin, auditeurs en la chambre des comptes; MM. Toussaint Lescarnelot, François Dramart, Henri Gruyer, Claude Guinod et Marie Guichard, avocats, etc. Garnier, interpellé d'exécuter l'arrêt, prétendit qu'avant son départ pour Paris, M. Breton lui avait fait remise des dommages et pardonné, pourquoi il se trouvait dispensé de lui faire la réparation requise. Messire Hugo Breton, présent, soutint le contraire. En vain l'auditoire, intercédant, l'engagea à se soumettre, le fier Barisien dit qu'on le pendrait et l'étranglerait plutôt que de l'y déterminer. Reconduit en prison et interpellé l'après-diner, il persista ; de sorte qu'il fallut reporter l'incident au Parlement, qui
arrêta que l'ordre lui en serait réitéré et qu'il l'exécuterait sous peine de la hart. Malheureusement nous ignorons la suite.
On conçoit que, malgré la rigueur de l'exigence et quelquefois son injustice, quelques hommes de caractère aient préféré céder à la force : c'était une conduite plus sage qu'une résistance disproportionnée avec le danger couru ; mais ce que nous avons peine à comprendre aujourd'hui, c'est que des hommes condamnés au dernier supplice, aggravé par les douleurs les plus atroces qui avaient pu y être ajoutées, aient consenti à s'humilier lorsqu'ils ne pouvaient encourir une peine plus grande. On ne trouve pas d'exemple de refus, et cependant des innocents s'y soumirent, ne fût-ce que les sorciers. Cette déférence ne peut s'expliquer que par l'état de prostration où la prison jetait le condamné, par la torture pendant l'information et celle préalable au supplice, enfin, par les mille morts qu'il lui fallait endurer avant la véritable, et qu'il était amené à désirer. Voici une de ces amendes honorables prononcée devant l'église d'Étival par un de ces hommes sans espoir ; elle est figurée ici comme en l'original :
Je ...
du village de
Condamné à Mort
JE DÉCLARE QUE MÉCHA
MENT ET SCANDALEUSEMENT
J'ai débauché et corrompu
Les jeunes filles
que j'ai outragé et battu Georgette Ilamo
Ma Mère
que j'ai donné tant et de si mauvais
exemples à tout mes co-habitants et au
publique
JE M'EN REPENS
J'EN DEMANDE PARDON
A DiEV
A LA JUSTICE
A MONSEIGNEUR LABBÉ
A MA MÈRE
ET A tous ceux et celles
que jay offensé
Et qui ont souffert les torts et les effets
DE MA MÉCHANTE VIE.
Il lisait cette pancarte à haute voix, ou, s'il ne savait lire, il répétait les mots après le sergent qui la prononçait. Il est à noter que, dans ce cas particulier, l'accusé qui demande pardon d'avoir outragé sa mère, avait nié ce crime pendant toute la durée de son procès ; de même les sorciers qui niaient se trouvaient contraints de s'avouer coupables de leur crime imaginaire.
Il y avait encore une amende honorable spéciale qui serait mieux appelée simple réparation. Elle avait lieu envers les particuliers. Nous la trouvons écrite dans les chartes, qui elles-mêmes n'avaient fait que consacrer l'usage ancien. En voici quelques exemples : En 1511, les frères Moreau, de Bar, ayant emmené de force messire Loupven, vicaire de Saint-Maxe, en leur tannerie, où ils lui ôtèrent de force son braquemart et sa cornette pour le tourner en dérision, furent condamnés à crier merci à l'offensé, à aller ensuite à Toul demander l'absolution à l'évéque, le tout à peine de 60 sous. Très-probablement ils préférèrent l'alternative, qui plus tard n'était plus admise.
En 1680, le lieutenant-général du bailliage de Toul, convaincu d'imputations calomnieuses contre le gouverneur, M. de Feuquières, lui fit réparation, tête nue et à genoux, en la chambre du conseil du Parlement, en présence de deux témoins.
En 1700, un sieur de Vidranges de la Rocherie fut ainsi condamné à faire réparation à un chanoine qu'il avait battu.
En 1726, un notaire, qui avait insulté le curé de Chavelot, fut condamné à se présenter chez le maître d'école, et là, chapeau bas, à faire des excuses à l'offensé.
En 1740, Me Liebault, avocat, fut condamné à même réparation, toujours sans alternative, envers M. Joly de Morey, conseiller, et à lui dire, en présence de deux personnes, « qu'il le reconnaissait pour un juge éclairé, un magistrat incapable de rien faire contre l'honneur. »
Les condamnés, toujours rancuneux, s'en tiraient souvent en jouant sur les mots, en faisant dans leurs discours des temps d'arrêt calculés pour prêter à l'équivoque. Ainsi,
Me Liebault dut avoir grande tentation, s'il n'y céda, de s'arrêter après le mot incapable. C'est ce que fit à Commercy un nommé Mezin, qui avait traité le bailliage plus que cavalièrement ; sa condamnation portait qu'il témoignerait du repentir et démentirait ses allégations ; il s'exprima, dit-on, ainsi : « J'ai eu tort de dire que vous étiez ceci et
cela; je m'en repens.... ça n'est pas vrai. » Il était à peine sorti que toute la ville savait par lui qu'il avait, par sa dernière phrase, ça n'est pas vrai, démenti d'intention et de fait, par l'expression de sa voix, les regrets qui lui étaient commandés. De la sorte, l'amende honorable ne faisait qu'ajouter au ridicule qui restait de la première offense.
Les juges de police n'avaient pas le droit de condamner à
l'amende honorable, qui n'appartenait qu'aux bailliages et à la
Cour. En 1786, les officiers de l'Hôtel-de-Ville de Dieuze ayant
condamné un bourgeois, dans le pot au feu duquel on avait trouvé
trois livres de viande, à aller, entre deux sergents, la
reporter chez un boucher qui se plaignait qu'on lui en eût volé,
le Procureur général dénonça ce fait à la Cour comme un excès de
pouvoir (81).
Les amendes honorables étaient encore moins faciles à obtenir de la part de corps entiers et surtout de corporations religieuses. Quand le bailli de Vosges voulut faire demander pardon par les dames de Remiremont à Pétronille de
Haraucourt, l'une d'elles, qu'elles avaient injuriée et molestée à l'occasion de sa grossesse, tant soit peu scandaleuse au surplus, il ne put l'obtenir, ces dames se retranchant obstinément sur ce que l'offensée devait se trouver trop satisfaite d'être rétablie dans son office de chantrerie (82).
Une peine ou plutôt une pénitence que nous ne pouvons ranger que dans la classe des amendes honorables, fut mise en usage plus d'une fois, grâce à l'arbitraire permis aux juges. En 1525, à Metz, le fils d'un des seigneurs de la cité voulant empêcher une querelle entre deux bouchers, en frappa un si fort qu'il le tua. La peine qui lui fut infligée, après toutefois qu'il eut réparé pécuniairement le préjudice causé, fut de faire un pèlerinage à Rome et à Saint-Jacques en Galice, ou à y envoyer quelqu'un pour lui, vu la difficulté de voyager, à cause des guerres.
EXPOSITION.
Les condamnés que le juge voulait exposer aux regards du public, soit pour les faire reconnaître par tous comme malfaiteurs avant de les lâcher, soit pour les livrer à la dérision et servir d'exemple, étaient mis au carcan ou au pilori.
Le carcan était tel que nous l'avons vu de nos jours. Devant le château, l'auditoire, ou sur la place publique de chaque haute justice étaient un ou plusieurs poteaux en pierre au haut desquels était scellé un fort anneau. On y passait une chaîne ayant au bout un collier en fer de trois pouces de hauteur, et le patient, ainsi tenu par le cou, tantôt debout, tantôt assis, restait immobile pendant plusieurs heures, ordinairement de onze heures à deux heures. Cette exposition était la plus humiliante et suivie ordinairement de la marque, du fouet ou du bannissement.
Quelquefois le condamné y était affublé des objets qu'il avait volés ; le bigame y portait à sa ceinture autant de quenouilles qu'il avait pris de femmes ; à Metz, une femme qui avait mis des étoupes dans son beurre fut exposée, portant au cou tous ses pains de beurre suspendus à des ficelles; en 1627, un soldat fut exposé avec un paquet de fil de laiton qu'il avait volé. On attachait des pièces de monnaie aux vêtements des coupeurs de bourse ; des sarments, des échalas, des légumes aux voleurs de ces objets. Les maraudeurs de volailles figuraient portant le produit de leur industrie : ce qui autorisait les enfants à leur jeter sous le nez ou dans les oreilles le cri du volatile soustrait. Souvent on les coiffait d'un grand bonnet de papier sur lequel était écrite la cause de leur condamnation ; quelquefois même on y peignait ou dessinait des allégories.
Le pilori était une grande cage en bois de six ou sept pieds de haut et d'autant de diamètre, tournant sur un pivot placé debout. Il était moins une peine criminelle qu'un châtiment de police. C'était la punition ordinaire des filles de mauvaise vie ; elles y étaient d'autant plus huées que personne n'en avait peur et que les femmes du peuple les voyaient d'assez mauvais oeil. Les écoliers, toujours fort disposés aux expéditions qui annoncent moins de réflexion que de pitié, les molestaient à qui mieux mieux ; ils s'évertuaient à faire tourner l'horrible cage au point de causer des vertiges à ces malheureuses et de leur occasionner des vomissements qui allaient quelquefois jusqu'au sang. Pour leur épargner ce supplice inhumain, plusieurs localités faisaient enchaîner la machine afin de l'empêcher de tourner.
Si l'on en croit la gravure de Callot, intitulée : Supplicium sceleri frenum, cette cage était de son temps placée sur le toit d'une maison. J'ai ouï soutenir qu'elle n'était si élevée que parce qu'alors on y exposait les femmes toutes nues, mais il est difficile d'y croire.
Les militaires avaient des expositions qui n'avaient d'autre règle que le caprice des chefs. En 1552, un soldat de l'armée de Guise ayant été trouvé endormi à son poste, fut exposé tout nu à l'ardeur du soleil pendant cinq heures, pieds et mains liés, le dos frotté de miel. Le cheval de bois était aussi fort usité parmi eux; il était fait d'une planche posée de champ sur quatre pieds et taillée en biseau. Quand les Français prirent la Lorraine, ils infligèrent cette punition aux femmes vénériennes. (Voyez Stupre.)
Un genre d'exposition qui n'était plus ni afflictive ni infamante pour le défunt, mais seulement pour sa mémoire, était l'exposition de sa tête ou de quelques-uns de ses membres après son exécution à mort par la décollation ou l'écartellement. D'ordinaire, c'était à l'endroit de la ville où se faisait l'exécution que le membre séparé du corps était exposé, mais quelquefois c'était à une grande distance. En 1567, Thiéry de La Mothe, lieutenant-général au bailliage de Bar-le-Duc, ayant été trouvé assassiné, la justice informa et découvrit que Pierre de Castel-Saint-Nazaire, seigneur de Morley, demeurant à Couvertpuis, était l'auteur de ce crime. Après de longs débats où Barbe de Nancy, son épouse, Antoine des Armoises, Claudon Lescarnelot et sa femme, ses domestiques et d'autres individus furent compromis et la plupart légalement convaincus, il fut condamné. par le prévôt de
Sainte-Menehould, Gilles Petit (commis à cet effet), et ensuite en appel par le Parlement de Paris, à être décapité au pilier des halles ; le corps à porter au gibet et la tête à Bar, pour y être exposée sur un poteau dressé au milieu de la place publique. En vain le roi lui fit grâce, le Parlement refusa de l'entériner (83). La tête fut donc apportée à Bar et exposée, comme il était prescrit, avec celle du domestique Gombert Chaffault. Ce transport eut lieu par un crocheteur de Paris, à qui il fut payé 15 fr. et 6 testons de France. Ce singulier commissionnaire, nommé Nicolas Liénar, fut lui-même l'objet d'une instruction criminelle peu de jours après, sans que l'on sache à quelle occasion. Peut-être que, gagné par la famille, l'identité des têtes put donner lieu à quelques doutes.
Dans le même temps et probablement par imitation, la justice de Bar fit exposer à Dagonville la tête de Gang Bouquin, condamné de cette localité, exécuté à Bar.
XIPPE OU ESCHAPPE.
La xippe était une sorte de bascule fort haute, au bout de laquelle le patient, solidement assis et attaché, se trouvait, dès qu'elle était lâchée, précipité dans une eau sale et profonde, dont il n'était extrait que quand le bourreau jugeait qu'il en était suffisamment souillé.
Nous ne voyons l'usage de cette machine qu'à Metz, où son application avait lieu avec grand appareil, en présence des Treize et de toute la justice. C'était une plus grosse punition que le pilori ; au moins, de ce dernier, sortait-on sans souillure extérieure, tandis que ceux qui sautaient la xippe étaient embroués du haut en bas d'un bourbier fétide et corrompu dont encore ils avaient bu et mangé à longs traits.
Il parait que ce saut avait quelque chose d'effrayant, indépendamment de l'ignominie
qui s'y attachait. En 1490, un soldat étranger qui y était condamné pour avoir battu son hôte, parut si à plaindre, que son capitaine intervint pour demander qu'en sa qualité de militaire on lui épargnât le saut, que l'on se contentât de lui abaisser le bassin et de l'asseoir simplement dans la mare. Cette prière fut exaucée, le coupable eut grâce du saut, mais il fut contraint de baiser le bassin embourbé, puis en outre mis au pilori pendant trois jours. Ses camarades présents juraient, dit la chronique, qu'ils aimeraient mieux avoir la tète coupée ou le foie percé, que de faire ce saut.
En 1550, un pauvre diable de Port-sur-Seille, appelé Jehan, qui partageait probablement cette opinion exagérée, fut conduit à l'eschappe, où il ne voulut pas se soumettre, jurant ses grands dieux qu'il aimait mieux mourir. Trois jours après, il était servi suivant son goût :
« Car il s'était de justice moqué
Qui pour un seul saut l'avait quitté,
Et aussi du commun populaire,
Pourquoi fut enseveli en l'air. »
FARDEAU.
Cette peine, dite le harnescar ou hachée imitée des usages des Francs, consistait à porter un fardeau quelconque pendant un temps plus ou moins long.
La première fois qu'il en est question en Lorraine, est en l'année 894, que l'empereur condamna les comtes de Toul, Etienne, Gérard et Mantfride, à porter angarias à la distance d'un mille, pour avoir ravagé les terres de l'évêché dont ils étaient voués. Ces angarias, dont nous est resté le verbe angarier, fort usité en Lorraine, étaient des portions de harnachements de chevaux, telles que le collier, la selle, etc. On les faisait porter pour entraver la marche du coupable humilié, de manière à ce qu'il ne pût se soustraire trop vite à sa punition.
Vers 1090, le clergé de Verdun fut obligé de porter un livre de choeur, la longueur d'une stade, en réparation d'avoir emprisonné Dudon, seigneur de Clermont en Argonne, qui était logé dans la ville, et ce, sous prétexte qu'il avait fait tort à l'évêché. Les gentilshommes du pays n'avaient pas souffert que cette insulte grave demeurât impunie.
Ici peut se ranger encore la peine dont nous avons déjà parlé, insérée en plusieurs de nos chartes d'afîranchissement, contre la femme qui en avait injurié une autre, de porter, en chemise, une pierre à la procession. (Voyez Injures.)
Comme il est facile de le remarquer, le harnescar était moins une peine qu'une légère correction infligée à l'amour-propre. On l'appelait peine militaire, parce que d'ordinaire elle était réservée aux gentilshommes, militibus.
FOUET.
Le fouet était de deux sortes : 1° Sous la custode, dans la prison, en secret ou devant quelques témoins. Il s'appliquait par le geôlier, le questionnaire ou autre personne pareille. C'était la punition des enfants ayant mérité plus grande peine, mais jugés avoir agi sans discernement ; s'il était donné à des femmes ou filles pour inconduite, on y appelait pour témoins deux femmes de bonne réputation prises dans le voisinage des condamnées et un commis du greffe. A Vézelise, on disait sous la courtine, au lieu de sous la custode, probablement de l'endroit du château où se faisait cette exécution.
2° Le fouet ordinaire, qui s'appliquait par la main du bourreau ; celui-là seul était infamant. Il était infligé en public, ordinairement après l'exposition du condamné au pilori, sur l'épaule nue, avec un faisceau de baguettes d'osier. Le plus ou moins de sévérité dépendait de la sentence, mais aussi un peu de celui qui frappait. Dans les derniers temps, il n'était plus qu'un simulacre entraînant plus d'ignominie que de douleur. Quelquefois on le donnait sur l'une et l'autre épaule alternativement, tantôt en un seul lieu de la ville, tantôt autour d'une place, le long d'une rue, ou en parcourant un long trajet, le condamné attaché au derrière d'une voiture.
En 1499, à Foug, au moment où le bourreau se disposait à fustiger un nommé Jomont, d'Épinal, il le reconnut pour lui avoir déjà donné pareille correction à Nancy. Ayant fait part à l'instant de ce cas de récidive au prévôt, l'exécution fut suspendue et l'on courut consulter à Saint-Mihiel MM. des Grands-Jours, qui conseillèrent de dresser un échafaud, d'y placer Jomont, de lui clouer l'oreille à un poteau et de le fustiger dans cette posture. Il fut fait ainsi qu'il était indiqué, en présence de tous les maires de la prévôté.
Un proverbe de ce temps disait : N'est pas fouetté qui veut, parce que cette peine, infligée de droit aux insolvables, ne pouvait pas être préférée par ceux qui avaient le moyen de payer l'amende. Qui non habet in oere luet in cute, disait le vieil adage. C'était la punition ordinaire des mendiants, vagabonds, filles de mauvaise vie, escrocs, etc. Elle était aussi l'accompagnement de plus grande peine, telle que la marque et le bannissement ; presque toujours l'exposition publique la précédait. Les nobles en étaient exempts ; mais, pour éluder cette disposition, on les dégradait préalablement de la noblesse, et alors ils étaient traités comme des vilains.
Souvent, pour ne pas appliquer à des enfants une peine excessive, eu égard à leurs fautes, on leur infligeait un fouet qui n'était ni le fouet sous la custode ni celui ordinaire. C'est ainsi qu'en 1613, une veuve Mansuy, de Toul, fut condamnée à faire fouetter sa fille par un de ses parents, pour s'être prostituée à certain chanoine de cette cité. En 1699, la Cour elle-même condamna un jeune homme d'Hattonchâtel à la réprimande et à être remis à son père pour être par lui fouetté en présence de quatre témoins.
Un fouet non infamant, quoique donné par la main du bourreau, fut mis en oeuvre à Metz d'une façon fort expéditive. C'était en 1624 : le tabac soulevait d'imposantes émeutes parmi les Messins, qui lui attribuaient la pluie et le mauvais temps. Un capitaine, nommé de la Hillière, chargé de rétablir l'ordre, fit empoigner et fouetter sur-le-champ par le bourreau les perturbateurs, qu'il expulsait ensuite de la ville. Cet étrange procédé redoubla le tumulte ; mais, ayant renforcé la garde et s'étant mis en position fort menaçante, personne ne bougea plus.
Le fouet comme punition militaire s'infligeait en faisant passer le condamné, les épaules découvertes, entre deux rangs de soldats, armés chacun d'une verge de coudrier; on l'appelait passer par les baguettes. Le nombre de ces promenades, qui se faisaient, bien entendu, en courant, était fixé par la sentence.
MARQUE.
La marque ayant pour principal but de faire reconnaître le repris de justice, était appliquée sur un endroit apparent de son corps, le front, les joues ou les mains. Plus tard seulement, elle se cacha sur les épaules, d'abord la droite, et, en cas de récidive, la gauche ; quelquefois les deux en même temps, même dès la première fois.
La marque, presque toujours appliquée après le fouet, était considérée comme une peine corporelle exclusive de toute autre de même importance; ainsi elle ne pouvait précéder le bannissement. Néanmoins, lorsque la peine des galères fut introduite, le principe contre ce cumul fut mis de côté. Cette innovation fut l'objet de remontrances de la part du procureur général à l'occasion d'un nommé Barbay, de Bruyères, qui avait été condamné à la marque et aux galères ; ce magistrat s'éleva contre cette application de deux peines pour un seul crime, et fit convertir les galères en bannissement. Mais cette opinion indulgente, qui n'était déjà elle-même qu'une transaction, eut peu de durée : tous les condamnés aux galères continuèrent à être préalablement flétris de la marque. (Voyez Galères.)
Le procédé suivi pour cette punition fut toujours un fer
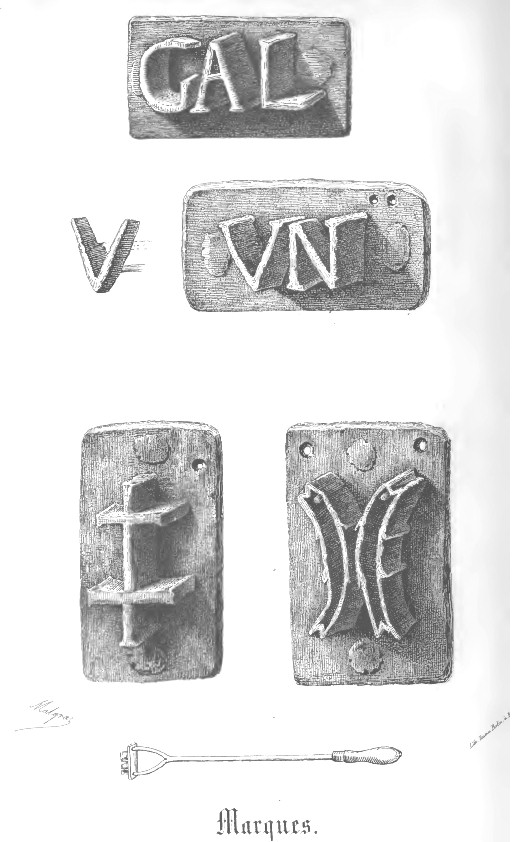
rougi au feu; mais sa forme varia considérablement. En Lorraine, c'était une croix dite de Lorraine ; à Metz, un M. ; dans le Barrois, avant le milieu du XVIe siècle, deux barbeaux ; à Remiremont, les clés de saint Pierre ; dans quelques seigneuries particulières, les armes des seigneurs. On introduisit ensuite les lettres V. pour les voleurs, V. N. pour les voleurs de nuit, GAL. pour les galériens, et, après l'invasion de la France, la fleur-de-lis.
Ces fers, fabriqués quelquefois au moment de l'exécution, après de longues années, lorsque l'occasion de marquer ne s'était pas fait sentir, n'étaient, faute d'un modèle uniforme, astreints à d'autres dimensions qu'à celles que le caprice d'un maréchal ferrant de village voulait bien leur donner. Ainsi, ce même Barbay, dont nous avons parlé plus haut, fut marqué avec un fer si grand que ses deux épaules en furent couvertes : ce qui émut également le Procureur général, qui fit enjoindre par la Cour aux justices de son ressort d'avoir un fer pareil à celui de Nancy.
Les fers à marquer dont nous donnons ci-contre les dessins, sont exactement copiés sur ceux de notre cabinet.
Dans l'origine, quand l'objet volé le permettait, il servait lui-même de marque. En 1544, un serrurier d'Étain, qui avait volé, fut marqué avec les fausses clés dont il s'était servi pour la perpétration de son crime.
BANNISSEMENT.
Cette peine était perpétuelle ou pour un temps limité ; elle comprenait interdiction de reparaître dans une ville, dans une prévôté ou dans toute l'étendue de la province.
Elle était fort en usage dans les villes fermées, parce qu'il était facile de s'assurer de son exécution parfaite et qu'en général la bourgeoisie de ces villes, qui n'étendait pas le monde au-delà de ses murs, considérait comme une grande punition la privation de participer à ses avantages et à l'honneur de lui appartenir ; ainsi faisaient Toul, Metz et
Verdun. Dans la première de ces villes, aux termes de la charte de 1306, il y avait plus de vingt cas de bannissement, depuis un mois pour les coups de pieds et de poings, jusqu'à soixante-un ans pour viol, incendie, etc. (84)
Dans les cas qui ne méritaient pas la mort et qui cependant nécessitaient de mettre le coupable hors d'état de nuire, le bannissement était considéré comme très-utile et comme un châtiment plus humain. Pour des filles
perdues ou des gens sans aveu, c'était peu de chose : ce monde vagabond trouvait partout la
même situation ; mais, pour des familles aisées, solidement établies, c'était une véritable peine qui les privait de biens et d'amis, quelquefois l'un et l'autre chèrement acquis, sans compter les habitudes et l'attachement au sol natal.
La manière d'infliger cette peine n'avait pas beaucoup de variantes. Après que le condamné avait subi le carcan, le fouet ou autres humiliations portées en la sentence, il était conduit, quelquefois la corde au cou, par la force publique, à l'une des portes de la ville. Là, en présence de la foule ou des polissons qui l'avaient accompagné, il lui était déclaré qu'il était chassé. On lui remettait cinq sous pour qu'il pût aller plus loin, après lui avoir rappelé que s'il reparaissait avant le temps fixé en son arrêt de bannissement, il serait pendu. Et cette menace n'était pas vaine, surtout avant l'introduction de l'appel. En avril 1552, un nommé Démange Desprès, d'Essey, près Nancy, avait été banni pour avoir contemné la justice ; il lui avait été fait défense de revenir, sous peine de la hart. Ne regardant cette redoutable alternative que comme une simple formule de style, trois mois après il reparut, mais il fut étranglé comme on le lui avait promis.
La menace de la hart était le cas le plus ordinaire ; cependant elle n'était pas obligée. En 1698, un sieur de Lafond, chevalier d'industrie, surpris la main dans la poche d'un bénédictin qui s'extasiait devant un feu d'artifice, fut condamné au fouet et au bannissement perpétuel, avec la défense ordinaire de reparaître. La Cour, plus polie, en réformant son arrêt, ordonna qu'il se retirerait incessamment des États du duc, à peine de conviction des cas à lui imposés. Ce fut néanmoins le bourreau qui lui donna la clé des champs.
En 1706, un chirurgien condamné pour meurtre fut également banni ; la Cour, prenant de même en considération sa naissance et sa position, lui fit enjoindre, simplement par son huissier, de sortir des États.
Le bannissement des États comprenait la Lorraine, le Barrois, le Bassigny et généralement tout ce qui était soumis au duc. Celui de l'État ne s'étendait qu'à la partie où la sentence était rendue. Ainsi, en Lorraine ou dans le Barrois, ce n'était qu'à l'une ou à l'autre de ces provinces. Celui des villes comprenait l'enceinte des remparts et quelquefois aussi les villages du ressort de la justice de la ville. A Metz, le bannissement pour meurtre obligeait le condamné à s'expatrier au-delà de Saint-Jean-d'Acre ; après quinze jours accordés pour mettre ordre à ses affaires, il devait s'éloigner de cinquante lieues, et, après six semaines, il devait s'embarquer. Le bannissement pour blessure n'était que de six mois ; le coupable devait aller outre la mer d'Angleterre (Irlande). Les autres bannissements n'exigeaient que de rester hors de la ville à une distance plus ou moins grande selon la faute (85). L'expulsion de Toul
s'entendait de tout le territoire compris entre Manonville, Foug, Barizey, Villey-le-Sec et Gondreville. Les alentours, quoique légalement non prohibés, n'étaient pas toujours sûrs pour le banni. Un estafier zélé qui se serait avisé de l'y appréhender l'exposait à un sort fâcheux, le seigneur du territoire violé ne se donnant pas toujours la peine de lui accorder sa protection ; il y avait d'ailleurs, le plus souvent, entre les gouvernements voisins une entente convenue ou tacite pour l'extradition de leurs malfaiteurs respectifs. En 1398, un nommé Hannès, banni de Metz, s'était réfugié à Toul ; vendu par un bourgeois de cette dernière ville, il fut ramené aux Treize et pendu. Rien n'explique s'il fut pris légalement à Toul ou aux environs, attiré dans quelque guet-apens. Ce qu'il y a de consolant, c'est que le Toulois, nommé Perrix, qui l'avait vendu 500 florins, fut pendu à son tour pour cette trahison, à la requeste d'aulcuns seigneurs de France.
Il y avait d'autres bannissements beaucoup plus limités. Un sieur Pierre François, de Cirey, fut condamné, par les mayeurs de Hattigny, au bannissement des terres de
Turquesteim, pour avoir été présent à un meurtre sans l'empêcher. En 1605, des coupeurs de bourse, à la foire de LaMothe, renvoyés faute de preuves, furent bannis à jamais de la foire de cette ville.
Un bannissement qui rappelle l'interdiction du feu et de l'eau, fut celui infligé en 1612 à un nommé Henri Simon, à Barbonville : la justice défendit à tous les habitants de l'employer, l'aider, lui donner lieu pour coucher et demeurer parmi eux. En vain il se pourvut au duc, sa demande fut rejetée (86). On agissait de même contre les prévenus en fuite, poursuivis par la clameur publique. Quand l'orfèvre Hainzelin, de Borgoigne, eut commis son meurtre
(voyez Asile, tome I, page 62), « on fit un huchement, que nul ne nulle ne parlast à lui, et ne lui donnast à boire ne à mainger et ne lui fist faveur ne confort, et ne lui donast outil, baston ne coustel, ne autres ferrements, sus peine d'estre acquis de corps et de biens et d'estre traistre à justice. »
La Cour souveraine, qui adopta le bannissement, ne mit pas la même rigueur que les justices particulières contre les infracteurs de ban ; elle en augmentait la durée en cas de récidive, s'il était possible ; elle ne lâchait les contrevenants qu'après une adjonction de fouet, de carcan, etc. ; mais nous n'avons pas vu d'exemple que la hart ait été par elle mise impitoyablement enjeu. En 1711, un homme de Blâmont, banni à perpétuité, ayant reparu pour revoir sa femme, sans autre crime, le Procureur général demanda que, sans le faire venir à Nancy, c'est-à-dire sans l'entendre, pour éviter à frais, il fût simplement de nouveau fouetté et marqué à Blâmont, puis congédié avec menace de mort. Il fut fait comme il avait été requis, mais on n'eut pas l'occasion de vérifier si l'exécution aurait suivi la menace en cas de nouvelle infraction.
En 1776, un nommé Didier Chaillon, banni à Saint
Maurice-sous-les-Côles, n'ayant pu trouver à s'y loger, se pourvut à la Cour, qui l'autorisa à choisir un autre lieu du ressort.
Les crimes graves méritant peine de mort n'entraînaient, dans certaines justices, que le bannissement perpétuel contre les contumaces ; il semblait injuste de prononcer plus grande peine contre ceux qui n'avaient été soumis ni au recolement ni à la confrontation. Ce châtiment, accompagné de la confiscation de biens, ne manquait pas de gravité; d'ailleurs, pour le condamné placé hors de portée, que pouvait-on faire de plus ? la sentence plus ou moins sévère n'était qu'un mot. Cependant, il y eut quelques exceptions, notamment pour Claude Huraut, parricide, qui, en 1652, malgré sa noblesse, fut pendu en effigie. Derrière le bannissement se trouvait toujours la hart, qui, en définitive, malgré la rareté de son application dans les derniers temps, ne laissait pas d'être possible et par conséquent fort redoutée.
Le bannissement perpétuel fut prononcé par la Cour souveraine, pendant le XVIIIe siècle, dans les circonstances suivantes :
|
Bannissement perpétuel. |
|
|
|
Vol en général |
306 hommes |
81 femmes. |
|
Vol à main armée, domestique, sacrilège, etc |
40 |
5 |
|
Meurtre |
9 |
1 |
|
Assassinat |
11 |
|
|
Débauche |
10 |
38 |
|
Infanticide |
|
24 |
|
Vagabondage, blasphèmes, adultère, viol, incendie, usure, etc. |
45 |
15 |
|
Totaux |
421 hommes |
162 femmes |
|
Total général 583 |
|
|
A partir de 1757, époque de l'introduction des galères, le bannissement perpétuel devint à peu près nul; on n'en compte pas un cent jusqu'à 1790; il ne s'appliquait plus aux grands crimes, mais à ceux de mince importance.
|
Bannissement à temps. |
|
|
|
Vol |
156 hommes |
29 femmes. |
|
Excès |
30 |
|
|
Débauche |
1 |
31 |
|
Adultère, incendie, meurtre, usure, viol, etc |
28 |
2 |
|
Totaux |
215 hommes |
62 femmes. |
|
Total général 277 |
|
|
Ce châtiment diminua de même vers la fin du Parlement, mais cependant dans une proportion beaucoup moindre que le bannissement perpétuel.
GALERES.
La Lorraine n'ayant pas de ports de mer, n'avait pas besoin d'hommes pour y travailler ou manoeuvrer ses vaisseaux ; elle n'avait pas non plus cette ressource pour châtier ses criminels. Point de galères, point de prison perpétuelle ni temporaire, mais un moyen plus
expéditif et plus radical : le bannissement ou la mort. Il semblait au pays qu'à défaut du premier châtiment, le second était préférable à l'embarras d'entretenir à chers deniers des condamnés dans une situation misérable pour eux et inquiétante pour les autres. Peut-être essaya-t-on d'une peine analogue ? Je n'en ai trouvé qu'un exemple : Deux hommes des environs de Bitche furent, en 1702, condamnés à travailler pendant six ans aux mines de S. A.
Dans le Barrois et le Bassigny mouvants ressortissants au Parlement de Paris, la peine des galères m'a aussi paru appliquée une fois ou deux, mais si vaguement qu'il ne m'a pas été possible de savoir si c'était par les premiers juges ou seulement sur appel par ce Parlement, qui a bien pu quelquefois abuser de son autorité, au mépris de la coutume locale, vis-à-vis de criminels qui n'étaient peut-être qu'accidentellement dans le pays. J'en ai ainsi trouvé un exemple en 1584.
Dans les Trois-Évêchés, après leur soumission au Parlement de Metz, la peine des galères devint la loi commune. Lorsque la Lorraine fut réunie de même à la France,
celle-ci n'eut pas de peine à insinuer dans quelques esprits que le bannissement était trop doux, qu'il consacrait l'impunité, laissant le condamné vivre libre à quelques pas de la justice qui l'avait banni et que trop souvent il narguait. Le chancelier La Galaizière, qui ne négligeait aucun moyen de confisquer les hommes et leurs opinions au profit de sa nation, imagina de s'emparer des prisonniers en donnant pour prétexte que nous n'avions point de châtiment proportionné à la noirceur de certaines actions, la mort étant pour elles trop sévère, le bannissement trop doux. Il lui suffit d'écrire en ce sens au Procureur général
Bourcier, pour que ce magistrat fit ordonner par la Cour souveraine qu'à l'avenir, dans les cas qui le mériteraient, les criminels lorrains pourraient être envoyés sur les galères de France, le souverain de la Lorraine ayant l'assurance du consentement du roi très-chrétien, ces deux majestés s'étant entendues à cet égard en vue du bien du pays. Et il arriva, chose monstrueuse ! que, sans édit, sans ordonnance, sans décret du souverain, sans aucune loi, les sujets purent être condamnés à une peine atroce et à la subir à l'étranger, et que ce fut la justice qui le proclama sur la provocation du gardien des lois !
Non-seulement la Cour souveraine sanctionna cette marche inconstitutionnelle, mais, trois semaines après, le 27 juillet 1737, la Chambre des comptes en fit autant, consentant comme elle que, le jour même du jugement, les condamnés fussent marqués publiquement par le bourreau, même dans les cas de galères à temps. Ainsi, il allait suffire d'avoir passé en fraude un paquet de tabac ou une poignée de sel et de ne pouvoir payer l'amende, pour être envoyé au bagne et enchaîné sur un vaisseau à un banc de rameurs. L'amende la plus mince étant de 500 livres en ces cas de contrebande, le roi très-chrétien pouvait être sûr d'avoir promptement la provision de rameurs dont il paraît qu'il avait besoin. Si le contrebandier, ruiné par un premier sacrifice, tombait en récidive, la perpétuité était encourue.
La Chambre des comptes de Lorraine essaya, par un arrêt du 1er juin 1740, d'amoindrir cette rigueur, en ordonnant que la marque pour contrebande n'aurait plus lieu qu'en cas de condamnation à perpétuité. Mais l'opinion publique, plus émue qu'elle d'une législation si impitoyable, contraignit à une concession plus radicale. Par déclaration du 22 juillet 1756, Stanislas accorda que les galériens pour contrebande ne seraient plus flétris ni marqués; qu'en tout temps ils seraient admis à payer l'amende pour sortir du bagne. La courtisanerie fit grand honneur au Roi Bienfaisant de cette preuve d'affection paternelle, mais le jurisconsulte n'y vit qu'un adroit moyen de sanctionner les décisions jusqu'alors illégales des cours de justice, et de légitimer cette entreprise de la France.
L'usage de marquer tous les galériens sans distinction, dès le jour même du jugement, conformément aux arrêts de la Cour et de la Chambre des comptes de 1737, subsistait toujours. De là il arrivait que la grâce du roi, eût-elle eu de fortes raisons d'être entière, ne pouvait racheter de la flétrissure. Le Parlement de Metz s'aperçut seulement en 1781 de cette énorme sévérité; il lui sembla que l'édit royal de 1724, portant que les condamnés seraient flétris avant d'être conduits aux galères, n'exigeait pas que ce fût si long-temps à l'avance; et, après soixante ans d'abus, il interpréta ces termes dans le sens qu'ils ne seraient marqués que quinze jours avant leur départ. La Cour souveraine, ou, en d'autres termes, le Parlement de Lorraine, cependant plus porté à l'indulgence, ne fit rien de semblable, en sorte que, dans son ressort, l'abus demeura.
Les bailliages apportèrent dans l'application des galères un empressement et une exagération que l'on s'expliquerait
difficilement si on ne se disait que la nécessité de purger le pays des vagabonds qui l'infestaient se faisait sentir de très-près pour eux. La Cour, sans cependant faiblir, y apporta, comme je l'ai déjà dit, le plus d'adoucissement qu'elle le put. Sa manière de procéder donne lieu de croire qu'elle y voyait aussi un heureux moyen de diminuer les occasions de prodiguer la peine capitale, car ces dernières condamnations devinrent très-rares dès que la voie des galères fut ouverte.
Voici le résumé de ses travaux en cette matière :
Galères à perpétuité.
De 1737 à 1759 13
De 1740 à 1749 31
De 1750 à 1759 43
De 1760 à 1769 25
De 1770 à 1779 38
De 1781 à 1790 53
Total 203
Dont cent quarante-huit pour vols, trois pour incestes, quatorze pour excès, cinq pour faux, trente-deux pour crimes divers.
Galères à temps.
De 1737 à 1739 25
De 1740 à 1749 40
De 1750 à 1759 37
De 1760 à 1769 44
De 1770 à 1776 67
De 1781 à 1790 61
Total 274
Dont deux cent sept pour vols, trente-sept pour excès et violences, neuf pour faux, le surplus pour autres crimes.
STRANGULATION.
Chacun connaît l'instrument de supplice que la justice employa si souvent pour corriger les hommes par ce châtiment sans rémission. Il y en avait de deux sortes : la potence proprement dite et le signe patibulaire.
La potence était composée d'une poutre élevée, plantée en terre perpendiculairement, ayant à son extrémité supérieure un bras, quelquefois deux, ce qui la faisait appeler potence brasselée. On l'élevait ordinairement, pour chaque exécution, sur la place publique ou au lieu fixé en la sentence, qui était, autant que possible, celui où le crime avait été commis. Sur l'emplacement consacré aux exécutions, il y avait un trou pratiqué en un massif de pierres de taille, dans lequel s'implantait le bas de la potence, qui
y entrait à quelques pieds de profondeur.
Le signe patibulaire se composait d'une colonne carrée en bois ou en pierre, avec ou sans bras au bout ; il était garni de chaînes et crochets d'un mètre de long pour attacher plusieurs cadavres à la fois. Son élévation était d'environ vingt-cinq pieds. Celui de Biencourt, par exemple, renversé en 1625 par le vent, et qui fut rétabli comme il était auparavant, avait trois piliers à vingt-cinq pieds de haut, distants entre eux de dix-huit.
Pour empêcher de renverser ces piliers, ils étaient solidement fichés en terre. Leur nombre se réglait selon l'importance de la seigneurie, comme en France, où le simple haut-justicier en avait deux, le châtelain trois, le baron quatre, le comte six, le duc huit. Il ne paraît pas qu'en Lorraine il y en ait eu à plus de quatre piliers ; dans les cas de nécessité, on y ajoutait les arbres penderets, dont alors les arbres les plus voisins tenaient lieu.
La destination de la potence était d'y suspendre vivant le condamné jusqu'à ce que mort s'ensuivît; celle du signe patibulaire était l'exposition perpétuelle du pendu pour servir d'enseignement au public et d'avertissement aux malfaiteurs. Dans ce but, il était placé non loin de la commune, le long du haut chemin (grande route), autant que possible sur une hauteur, afin qu'on l'aperçût de plus loin. Cet endroit a conservé, dans chacune de nos bourgades, la dénomination de lieu dit à la Justice ; il était d'ordinaire fermé d'une petite enceinte en murailles. Les cadavres y restaient pendus jusqu'à ce qu'il plût au temps de les en détacher pour en faire la proie des chiens ou des animaux carnassiers. Souvent ils y étaient en grand nombre ; en 1429, les Lorrains en trouvèrent trente- deux au gibet de Metz, qu'ils abattirent. Quelquefois on était forcé de les enlever avant qu'ils se détachassent d'eux-mêmes, en raison des émanations infectes qu'ils répandaient, selon les saisons. C'est ainsi que nous voyons 10 fr. payés en 1644, à deux hommes de Bar, pour avoir enterré quatre voleurs, six semaines après leur exécution, vu qu'ils infectaient la contrée. On les enterrait au pied et non en terre sainte.
Sa taille imposante et l'idée terrible qui s'y rattachait, firent considérer le gibet comme une marque d'honneur et d'autorité; de là cette importance accordée au droit d'en avoir, droit réclamé par quelques seigneurs et envié par tous. Il n'appartenait qu'aux hauts-justiciers ayant la connaissance des crimes, et encore fallait-il qu'ils eussent aussi le droit d'exécution, car le premier pouvait être séparé du second, ce qui arrivait fréquemment, le duc s'étant réservé souvent cette attribution de la souveraineté. Pour en avoir un, il fallait un titre ou longue possession. En cas de chute par vétusté ou accident, il était besoin d'une autorisation pour le rétablir, et l'on ne procédait à la nouvelle érection qu'avec la plus grande solennité, en présence du Procureur général ou de son substitut, les habitants sous les armes. Tout rétablissement clandestin était frappé de nullité, car il n'était pas rare que, pour éviter contestation, les seigneurs incertains de leurs droits
y fissent travailler à la sourdine. Ainsi firent, en 1600, les chanoines de Nancy (87) en leur qualité de seigneurs du Val-de-Lièvre, qui profitèrent de la journée la plus mauvaise du plus fâcheux temps d'un rude hiver. En 1626 (88), le couvent de Morimont, seigneur du village des Gouttes et de Romain-aux-Bois, s'étant hâté de relever le sien pour
une exécution pressante d'infanticide, le Procureur général, consulté,fut d'avis que le gibet devait être abattu, sauf a le relever après sans modification. A Broussey-en-Blois, en
1586, le substitut du Procureur général du Bassigny vint en personne, avec la force publique, abattre celui que Mme de Gombervaux et ses co-seigneurs avaient fait ériger sans permission du prince.
Quand un seigneur n'avait pas de signe patibulaire, mais qu'il avait le droit d'en avoir, il empruntait celui du voisin ; alors on en tenait note bien exacte, dans la crainte que le préteur ne réclamât un jour cette complaisance comme un titre à la possession. En 1481, le seigneur du ban de Sciey emprunta ainsi un coin de terre aux chanoines de Metz, propriétaires du ban de Saint-Paul, audit lieu de Sciey, pour brûler une sorcière, ne trouvant sur son territoire aucun lieu qui ne fût cultivé.
La concession d'un gibet, comme attribution de la justice, était une faveur entourée de solennité. Voici en quels termes on la trouve énoncée au contrat d'échange que
Christophe de Lignéville, seigneur de Tumejus, fit avec le duc Charles III pour les terres de Brouvillers et Belrup, contre celle d'Houelcourt, en 1577 : « Et en considération des bons, fidèles et loyaux services que notredit seigneur a dit avoir reçus dudit sieur de Tumejus, et qu'il espère il fera à l'avenir, afin de lui en donner les occasions et accroitre le courage, de sa grâce et libéralité spéciale, il a donné et par ces dites présentes il donne audit sieur de Tumejus, ses hoirs, etc., pouvoir, puis sance et autorité de faire construire, ériger et élever au ban et finage dudit Houelcourt, où il lui plaira, pour signe et marque de haute-justice, un gibet et signe patibulaire, et au village de Houelcourt, un carcan, et
en son château et maison dudit lieu, des prisons et ceps pour y incarcérer et justicier tous malfaiteurs audit lieu, par sa justice dudit lieu. »
Le gibet d'une localité n'était pas toujours exclusivement destiné aux criminels de cette localité, ni même du ressort judiciaire; quelques-uns avaient, non pas la charge, mais le privilège de desservir d'autres ressorts, et l'on y tenait comme à une marque irrécusable d'ancienne suprématie. Nous avons montré celui de la prévôté d'Arches tendant ses grands bras sur un pays immense. Dans le seul ressort du bailli de Saint-Mihiel, en 1592, nous trouvons Norroy-le-Sec desservant Mouaville et Puxe; le mayeur de cette dernière commune délivrait le bacon (le criminel) au prévôt de Norroy, en un lieu dit les Écluses, entre Puxe et Jeandelize. A Longwy venaient les villages de Saint-Pancrey, de Laix et Baslieux ; à Conflans en Jarnisy, ceux de la Ville-aux-Prés, Ville-sur-Iron et Jeandelize. Et cependant, chacune de ces localités avait une haute-justice particulière, mais point de signe patibulaire, le duc se l'étant réservé.
A Sancy, dont les chanoines du lieu avaient la justice en commun avec le duc de Lorraine, les procès s'instruisaient et se jugeaient dans la localité, mais les exécutions avaient lieu à Seramville, qui n'était pas siège de justice, qui dépendait même de Sancy, chef-lieu de la prévôté, mais où le duc avait seul la souveraineté (89). Les procès criminels de la Bresse se faisaient à Solsback, où le sieur de Hastadt les faisait encore exécuter. Le prieur de Salonne délivrait ses condamnés au prévôt d'Amance, en un lieu dit à Saulcirupt, faisant séparation des bans de Salonne et de Chambrey.
Il n'eût pas fallu aller ailleurs, ni qu'un prévôt s'avisât d'usurper sur un gibet voisin, il en eût été demandé réparation comme d'un grave attentat. On y tenait même dans les cas où la justice ne faisait que le semblant : En 1554 (90), le prévôt du seigneur de Mehoncourt s'étant emparé, pour le pendre, d'un porc qui avait mangé un enfant, l'abbé de
Bclchamp se hâta de prévenir le duc, qui contraignit l'usurpateur à le ramener où il l'avait pris, afin qu'il en fût fait justice par ses officiers.
La manière d'utiliser la potence brasselée était à peu près la même en tous pays. Avant de sortir de la prison, l'exécuteur, après avoir lié les mains au condamné, lui mettait au cou une corde appelée tortouse par les gens du métier, et décorée du nom célèbre de hart par les gens de justice. A chaque bout elle formait un anneau, l'un pour être accroché au bras de la potence, l'autre pour faire noeud coulant. Présentée en long sous le menton, l'exécuteur passait l'un des bouts dans l'anneau de l'autre, de sorte que le cou se trouvait entouré de la corde. On se
mettait ainsi en route, tantôt à pied, tantôt en voiture, selon l'usage du lieu ; dans ce dernier cas, la voiture était un tombereau, où le condamné était placé à rebours. A
Metz, on le menait en brouette, par dérision.
Arrivés au pied de l'échelle, qui était forte et large, liée à la potence pour ne tourner ni glisser, le bourreau montait le premier, ensuite le condamné, tous deux à reculons, c'est-à-dire le dos contre l'échelle, ce dernier tenu par la tortouse et le dessous du bras. Le confesseur montait derrière, tourné du bon sens, de manière à pouvoir exhorter le patient qu'il avait ainsi en face. Une fois sur l'échelle, il n'y avait plus guère de rémission ni de délai à espérer ; si le condamné parlait de révélation, le juge la recevait sur le lieu même, craignant trop quelque ruse de sa part. Lors donc que le bras de la potence était atteint, le bourreau se hâtait d'y accrocher la tortouse, ce qui se faisait très-lestement, puisqu'il suffisait de passer l'oeillet du bout dans un crochet ; alors, à un signal imperceptible donné au confesseur, celui-ci descendait à reculons de quelques échelons, et aussitôt lancé par un coup de genou dans le dos, le condamné se trouvait suspendu et le noeud coulant faisait son effet.
Cette simple suspension ne paraissant pas suffisante pour donner la mort assez promptement ni assez sûrement, l'exécuteur, se glissant sur le bras de la potence, où il se tenait à la force des poignets, mettait ses pieds sur les mains liées du pendu, puis, ainsi soutenu, il lui allongeait dans l'estomac de grands coups de genou pour hâter sa fin. Dans
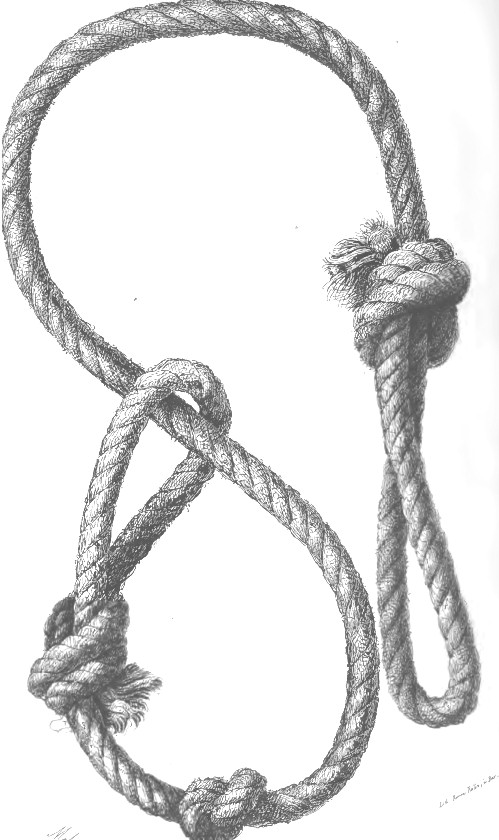
quelques localités, la tortouse était laissée assez longue pour permettre au bourreau de monter sur les épaules du supplicié, auquel il donnait dans la poitrine de violents coups de talon.
Mais cette méthode avait un grand inconvénient qui était d'exposer la corde à se rompre, comme cela est arrivé quelquefois, notamment à Metz, en 1490. Pour y parer dans quelques justices, on mettait deux tortouses, la seconde plus longue que la première, de sorte que si celleci se cassait, l'autre la suppléait. Cette corde, beaucoup moins grosse qu'on ne le croit généralement, était faite en chanvre de première qualité ; le dessin que j'en donne ici, exactement copié pour la grosseur, la longueur et la forme, sur l'une de celles de mon cabinet, présente une singularité qui n'existe pas sur d'autres : c'est le noeud qui se trouve après la boucle, vers le milieu du noeud coulant ; destiné à agir sur l'épiglotte, il domptait de suite, par son puissant effet, les hommes les plus robustes.
Après un temps donné, ordinairement deux heures, lorsque la mort était bien constatée, le cadavre était descendu pour être exposé au signe patibulaire, comme nous l'avons expliqué plus haut. Cet usage est en grande opposition avec les anecdotes que chaque grande ville a conservées de pendus ayant échappé à la mort et ressuscites sur les tables de dissection. A Nancy, on se souvient encore d'une femme appelée la Mal-Pendue, dont le cou, resté de travers, attestait, disait-on, cet incident de sa vie, qui n'était peut-être dû qu'à une tentative de suicide. En effet, il serait difficile de concilier ce récit avec les formalités que nous connaissons, avec les précautions prises par des bourreaux très-rudes et très-expérimentés ; en les supposant de connivence, la justice était toujours là pour faire recommencer l'expiation. Cependant, on doit avouer qu'un concours de
circonstances extraordinaires, mais non impossibles, a pu se rencontrer, et qu'une fois par hasard cet événement a pu se réaliser.
Il faut dire aussi qu'à Nancy une confrérie de pénitents blancs, autorisée en 1731, était dans l'usage, depuis cette année, de donner aux suppliciés les premiers soins de la sépulture, quand l'arrêt ne s'y opposait pas. Pendant le supplice, ils étaient réunis à l'église, dans la chapelle de leur confrérie, où ils priaient pour le salut du patient.
Après l'exécution, quatre d'entre eux se rendaient sur la place, et, s'il s'agissait d'un pendu, un cinquième, armé d'un grand sabre, montait à l'échelle et coupait la corde ; les autres, restés au bas, recueillaient le corps et l'emportaient en silence. Cette coutume charitable se pratiqua jusqu'à la révolution.
Il y avait un genre de pendaison qui n'entraînait pas la mort : c'était celle par-dessous les bras. Cette peine, appliquée aux impubères coupables de crimes capitaux, ne pouvait être endurée plus d'une heure sans danger de mort, comme il arriva au jeune frère du fameux Cartouche.
La superstition populaire a jadis attaché quelque vertu à la corde de pendu ; il suffisait, à l'entendre, d'en avoir un brin dans sa poche pour être favorisé du sort, heureux au jeu, etc. La chronique de Metz rapporte qu'en 1324 des troupes barisiennes décrochèrent les pendus du gibet et emportèrent les chaînes et crochets, sans doute, dit l'auteur, pour faire des charmes et sorceries.
Aujourd'hui, la corde de pendu a encore toute sa valeur, mais seulement en proverbe : il en est de même de la graisse de pendu.
Inutile de dire que le supplice de la hart était le plus ignominieux, celui réservé aux roturiers. Quand on l'infligeait à un noble, il était préalablement dégradé de sa noblesse. Pour rendre la défense du duel plus fructueuse, le gentilhomme fut menacé de la hart : il eût en effet consenti à bien des affronts avant celui-là, qui ne lui était infligé que par mesprison.
La mort par la corde n'avait rien d'effrayant pour le public, qui ne s'étonnait pas de voir au même lieu et à la même heure exécuter plusieurs condamnés. On ne craignait pas ce que l'on appellerait aujourd'hui une boucherie, dont on fait un épouvantail aux jurés, qui a pour effet dans une même affaire, quelque grave qu'elle soit, d'amener des distinctions injustes entre les accusés. Une partie échappe à la mort par cette seule raison que c'est assez de verser le sang de quelques-uns. Jadis, il n'y avait qu'un poids et qu'une balance : plusieurs condamnés à exécuter ne faisaient pas reculer la justice : En 1529, à Briey, huit voleurs furent pendus à la fois, assistés de vingt-deux confesseurs; à Étain, en 1542, il en fut de même de douze vagabonds ; et à Saint-Mihiel, de dix-huit.
Mais, à côté de cette manière assez logique de procéder, se trouvait un usage que nous ne pourrions tolérer, c'était le tirage au sort, comme si, entre criminels de même acabit, il fallait une proie limitée à la justice. En 1651, à Bar, il fut fait ainsi à l'égard de cinq soldats voleurs de grands chemins; un seul, tiré au sort, fut pendu.
Nous donnons ici le résumé de l'application de la peine de la hart par la Cour souveraine, depuis 1698 jusqu'à 1790.
| Vols ordinaires et qualifiés |
190 hommes |
7 femmes |
| Vols sacrilèges |
12 |
|
| Vols en bande, à main armée |
25 |
1 |
| Vols domestiques |
37 |
8 |
| Vols de chevaux |
10 |
|
| Meurtre |
17 |
1 |
|
Vie scandaleuse
|
9 |
|
Assassinat
|
27 |
7 |
|
Viols
|
7 |
|
|
Libertinage, séduction
|
6 |
1 |
|
Infanticide
|
|
31 |
Vagabondage
|
15 |
1 |
|
Faux
|
6 |
|
Fausse monnaie
|
14 |
|
|
Parricide
|
1 |
|
|
Inceste
|
6 |
|
|
Incendie
|
4 |
|
|
Blasphème
|
4 |
|
Excès
|
10 |
|
| Duel, un soldat, en effigie |
1 |
|
|
Totaux |
401 hommes |
57 femmes |
|
Total général 458 |
|
|
Les femmes, comme on le voit, ne figurent que pour un dix-septième dans les meurtres et pour un quart dans les assassinats; la plupart de ces derniers crimes sont commis sur des maris. La proportion pour leur participation au vol n'est que de trois pour cent, excepté pour le vol domestique, où elles figurent pour près d'un quart.
Le tableau suivant permettra d'établir la progression du supplice de la hart. Comparé avec le tableau relatif aux galères, il justifiera ce que nous avons avancé, que la répression, à l'aide de l'un de ces châtiments, diminua en proportion de ce que l'autre augmenta.
|
De 1698 à 1709 |
103 hommes |
10 femmes. |
|
De 1710 à 1719 |
73 |
11 |
|
De 1720 à 1729 |
86 |
11 |
|
De 1730 à 1739 |
55 |
12 |
|
De 1740 à 1749 |
27 |
3 |
|
De 1750 à 1759 |
25 |
3 |
|
De 1760 à 1769 |
22 |
3 |
|
De 1770 à 1776 |
4 |
1 |
|
De 1781 à 1790 |
6 |
3 |
|
Totaux |
401 hommes |
57 femmes. |
|
Total général 458 |
On n'oubliera pas qu'il ne s'agit ici que des condamnations du ressort et de la juridiction de la Cour. Les pendus en vertu de sentences prévôtales, bien autrement nombreux, n'y sont pas compris, ces sentences étant rendues sans aucun recours.
MUTILATION.
Cette peine, imitée de la loi du talion, si elle n'en est un reste, s'entend de toute exécution qui privait le condamné d'une partie ou de la totalité d'un membre, quelquefois de plusieurs.
POINGS.
La section du poignet était la mutilation la plus ordinaire : c'était le lot des faussaires, des faux monnayeurs, des meurtriers, des sacrilèges, etc. Le poing du condamné, placé sur un billot, en l'y attachant avec une corde ou une chaîne, ou simplement tenu par la main vigoureuse d'un valet du bourreau, était enlevé à l'aide d'une hache, d'un seul coup, ou bien à l'aide d'un couperet sur lequel on frappait un coup de massue. Si, après cette opération, la sentence ordonnait une amende honorable ou un supplice préalable à la mort, le bras mutilé était fourré lestement dans un petit sac rempli de son, afin d'arrêter la perte du sang, qui eût bientôt soustrait le condamné au surplus de sa peine.
Cette avulsion des poings eut lieu très-souvent en Lorraine, même sous l'empire de la Cour souveraine au XVIIIe siècle; c'était, aux yeux des juges, le moyen le plus logique de mettre l'accusé dans l'impossibilité de nuire. Elle se pratiquait encore par le feu contre les criminels de lèse-majesté divine. Avant de les mettre à mort, ils avaient le poignet brûlé à un feu de soufre. La Cour elle-même l'ordonna, notamment en 1761, contre un nommé Kaiser, de Moushoffen, qui avait profané une hostie consacrée.
PIEDS.
Il en était de même pour les pieds, c'est-à-dire que l'exécution se pratiquait comme pour la section des poignets ; mais cette peine était rare et réservée à ceux dont la mort suivait immédiatement, comme les roués ou les brûlés.
LANGUE.
La mutilation de la langue avait lieu de plusieurs sortes :
On la perçait avec un canif ou instrument analogue ;
Ou bien à l'aide d'un fer chaud.
On la fendait avec un tranchant.
On la coupait en partie ou en totahté.
Dans les uns et les autres cas, le bourreau la saisissait avec une tenaille à crochets, la tirait dehors et la maintenait ainsi hors de la bouche, jusqu'à ce qu'il eût fait l'exécution.
Du temps de la sévérité contre les blasphémateurs, ce genre de peine fut très-souvent pratiqué.
JOUES.
Le percement des joues contre les blasphémateurs avait lieu avec un fer chaud.
LÈVRES.
La mutilation des lèvres, qui eut aussi le blasphème pour cause, consistait dans le percement ou la section de l'une ou de l'autre lèvre, quelquefois des deux; elle s'opérait avec un tranchant, de manière à mettre les dents à découvert.
OREILLES.
Celle des oreilles se pratiquait de même avec un tranchant ; on la trouve fort en usage en Lorraine, dans le Barrois et les Évêchés, où le coupable était le plus souvent obligé de fournir lui-même le couteau à l'exécuteur : c'était donc à lui à prendre soin qu'il coupât bien. Elle était la punition des voleurs, principalement de ceux non domiciliés, afin que l'on pût les reconnaître et s'en méfier ailleurs. Quelquefois on ne leur en coupait qu'un bout ; c'était l'usage à Toul. Dans ce cas, à la première récidive, l'oreille entière y passait ; à celle suivante, c'était le tour de l'autre oreille. C'est ce qui arriva en 1535, à Foug, à
Bastien Cornille, de Domjermain ; mais la troisième fois, n'ayant plus d'oreille à fournir, il fut pendu, A Mirecourt, l'essorillement était encouru par les maraudeurs de jardins quand ils ne pouvaient payer l'amende, qui, en 1235, était de 5 sous.
NEZ.
La mutilation du nez, pratiquée une fois à Metz, eut lieu à l'aide d'une tenaille rougie au feu. Cette peine et celle de la castration n'étaient usitées que comme accessoire préliminaire du dernier supplice.
YEUX.
La mutilation la plus atroce, du moins par la manière dont elle fut exécutée, fut celle qui eut lieu à Metz, en 1466, sur un brigand convaincu d'avoir crevé les yeux à un prêtre. Conduit au lieu du supplice et couché sur un banc, le bourreau se saisit d'un fer préparé exprès, et lui furent les deux yeux raiés et tirés hors de la tête devant tout le monde, qui fut une chose bien piteuse et cruelle.
La Cour souveraine prononça très-peu de peines de mutilation ; c'est tout au plus si elle ordonna plus de six fois celle du poing.
DÉCOLLATION.
Es crimes qui méritent la mort, le vilain sera pendu, le noble décapité. C'était, en effet, un supplice réservé aux privilégiés que celui d'avoir la tète tranchée ; on y trouvait plus de noblesse, parce que la mort par le glaive participait de la mort du guerrier, parce que la figure n'était ni endommagée ni souillée ; enfin, parce que le condamné n'exposait pas sa dignité aux moqueries du public, comme le pendu qui tirait la langue ou faisait des grimaces devenues proverbiales.
Cependant, plus d'un vilain eut l'honneur de la hache. En 1559, Claude, habitant de Tifferdanges, eut la tête tranchée à Briey pour meurtre : l'exécution eut lieu sur un bloc. En 1586, un nommé Peltre le Poullain fut exécuté par l'épée à Longuyon. A Briey, en 1389, Rouxel, condamné pour trahison, fut d'abord pendu et ensuite on lui coupa la tête. A Étain, en 1541, un soldat, appelé Bon Jehan, eut la tête tranchée pour vol.
La décollation ne se faisait pas partout de même. Le condamné, conduit au lieu du supplice, y était déshabillé par le bourreau, qui lui coupait les cheveux et achevait en public ce que l'on appelle aujourd'hui la toilette. Après ces préliminaires et l'exhortation du confesseur, le patient attendait le coup fatal, qui lui arrivait par derrière. Tantôt il était assis, tantôt à genoux. Ici on frappait avec une hache sur un bloc, là en l'air avec un glaive, horizontalement ou de haut en bas; le tout dépendait plus de l'habileté de l'exécuteur que de la coutume du pays.
Le glaive, appelé aussi tonne, était un sabre très-mince, droit, long de quatre-vingts centimètres, large de cinq centimètres en haut et six en bas, tranchant des deux côtés; la poignée, longue de vingt-quatre centimètres, se prenait à deux mains. Quand l'exécuteur n'était pas assez sûr de son coup, il mettait au bout un morceau de plomb pour avoir plus de force par l'entraînement du poids (91).
A Metz, la tête du condamné était passée à travers un bloc qui s'ouvrait en deux, comme la lunette de la guillotine ; de sorte que le cou, ayant un point d'appui, était plus sûrement tranché ; on l'appelait la Quenegatte. Quand le condamné était trop gros ou avait le cou trop court, la décollation était fort difficile, ainsi qu'il arriva lors du supplice de Broche, l'un des plus fameux défenseurs de la cité ; il fallut lui donner sept ou huit coups de glaive avant que la tête fût séparée. Cet inconvénient résultait de ce que le bloc était trop épais.
Ce bloc, vissé au plancher de l'échafaud, mettait le patient dans l'impossibilité de se relever ni de remuer. Un
jour, en 1494, le bourreau ayant négligé cette précaution et ayant à couper préalablement le poing du condamné, celui-ci, quoique ayant les yeux bandés, s'aperçut de son intention et fit un mouvement qui lui décela que le poids seul du bloc le retenait. Colère et désespéré, il essaya de fuir, portant cette masse sur son cou ; mais, l'énorme entrave l'empêchant de se dresser debout, il ne pouvait que se débattre, ce qu'il faisait en se roulant et en hurlant à tel point qu'il jeta dans l'assemblée une épouvante générale, chacun craignant sa fureur. C'était un homme des plus vigoureux, ayant déjà perdu une main et une oreille à la bataille, mutilations qui ne lui faisaient que mieux redouter celle dont il était menacé. Les Treize, fort émus eux-mêmes, lui crièrent de rester tranquille, lui promettant grâce du poing. Aussitôt il s'apaisa, leur en fit ses remercîments, et, de lui-même, se mit à genoux, se prêta à se bien placer, et sa tête tomba.
Cette scène donna lieu à une remarque pour laquelle il ne s'était peut-être jamais présenté d'occasion : c'est qu'au contraire des autres condamnés dominés par l'effroi, son sang, agité par le mouvement qu'il venait de se donner, jaillit si fort et si loin que l'assistance en fut couverte.
La décollation sans dégradation préalable, réservée aux très-grands crimes, n'emportait pas note d'infamie ; dès lors les enfants du condamné conservaient leur noblesse, cette exécution n'étant considérée dans leur généalogie que comme un accident.
ROUE.
Ce supplice vient d'Allemagne, où il paraît être encore en vigueur dans sa sévérité primitive, c'est-à-dire que les membres du patient sont brisés à l'aide de la roue
elle-même. En Lorraine, où les moeurs allemandes subsistèrent long-temps, la même manière de rouer fut suivie, sans que cependant on explique comment au juste on y procédait. Plus tard, après que François Ier l'eut introduite en France, on adopta en Lorraine le même mode d'exécution, à l'aide de la croix de saint André.
Voici comment on procédait : Le condamné, n'ayant d'autre vêtement que sa chemise, était couché la face au soleil sur une croix en X, formée de deux solides morceaux de chêne entaillés à chaque extrémité, à une distance correspondant aux coudes et aux poignets, aux genoux et aux pieds. Après avoir relevé sa chemise aux jambes et aux bras, il était attaché sur la croix, à toutes les jointures, de manière à laisser découverts les bras, les cuisses et les jambes. Sa tête reposait sur une pierre dans l'entre-deux de L'X. Alors, le bourreau, armé d'un coutre qui était fait d'une barre de fer carrée du poids de vingt livres, ayant les angles arrondis, large de quarante-un
millimètres, longue d'un
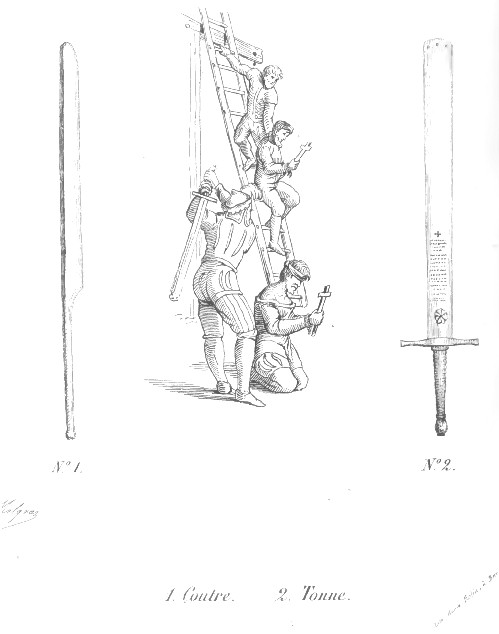
mètre, conforme, du reste, au dessin ci-joint où elle est réduite au dixième, le frappait vigoureusement d'un coup entre chaque ligature, de manière à lui rompre les os, puis il terminait par trois coups sur l'estomac. A Gondreville, en 1602, l'exécuteur n'ayant pas de coutre pour rompre deux voleurs, se servit d'un coutre de charrue pesant
vingt-quatre livres.
Ainsi broyé, le condamné était détaché puis transporté sur une roue placée horizontalement et tournant sur un pivot. Il y était étendu en cercle, les membres gênés, les cuisses repliées en dessous et liées aux jantes de la roue ; là, le visage tourné vers le ciel, il attendait qu'il plût à Dieu lui retirer la vie. En 1593, Guillaume Lallemant, dit le sergent Lacroix, fut roué à Blâmont, pour meurtre, larcins, etc. ; par grâce spéciale, le bourreau le poignarda dès qu'il fut rompu.
Quand l'arrêt ne voulait pas qu'il mourût rompu vif, cette disposition, qu'il ignorait, était insérée en forme de retentum : alors un tourniquet, placé sous l'échafaud à l'endroit de sa tète, serrait subitement une corde qui lui avait été placée sur le cou sans qu'il s'en doutât. Son corps était ensuite mis de même sur la roue pour y rester le temps prescrit par la sentence.
Cette peine ne s'appliquait pas aux femmes, qui, en échange, avaient la corde, la décollation ou le feu.
La Cour souveraine, dans l'espace de quatre vingt-huit ans, prononça soixante-quinze condamnations à la roue, qui doivent être ainsi réparties :
Vols à main armée, en bande, par des vagabonds, etc.. 16
Meurtre 1
Assassinats 56
Bestialité 1
Sans motif indiqué 11
Total 75
La première période de dix ans figure dans ce chiffre pour 18
La seconde, finissant à 1790, pour 21
Total 39
De sorte qu'il n'en reste que trente-six pour les soixante-huit autres années.
La clause de retentum eut lieu en faveur de dix-sept, principalement à la fin du siècle.
ASPHYXIE PAR IMMERSION.
Ce supplice n'est pas démontré avoir été fort usité en Lorraine après le XIIe siècle, époque où il était d'usage contre les blasphémateurs ; les exemples n'en sont trouvés depuis qu'en petit nombre, excepté à Metz, où il fut fort tard en grande vogue. Il avait lieu de deux manières : dans l'eau froide et dans l'huile ou l'eau bouillante.
L'exécution à l'eau froide se faisait, à Metz, sur le pont des Morts. Le criminel y était conduit à pied, portant sur ses épaules, en forme de manteau, le sac dans lequel il devait être enseveli. Il arrivait là les mains liées ; on lui garrottait ensuite les pieds et on lui passait par-dessus la tète le sac, que l'on fermait par le bas, de telle sorte qu'il lui était tout-à-fait impossible de s'en échapper. Alors il était précipité dans la rivière. Soit que l'on attachât une corde au sac pour le repêcher, soit que le corps fût autrement empêché d'aller plus loin, on le retirait peu après, et on l'enterrait sous les roues d'un moulin, de manière à le priver de la terre sainte.
En 1482, ce supplice fut exécuté d'une manière exceptionnelle ; le coupable, qui était un militaire, fut noyé en prison, dans une cuve pleine d'eau. Il n'est pas dit pourquoi
il ne fut pas mené à la rivière; peut-être craignit-on quelque soulèvement de ses camarades en sa faveur, peut-être voulut-on lui épargner l'ignominie de la mort en public.
Cette peine, infligée arbitrairement comme la plupart des autres, était appliquée à toutes sortes de crimes. En 1431, ce fut à des bouchers qui avaient comploté contre la cité, par conséquent coupables du crime de lèse-majesté; en 1442, un des Treize de la justice, convaincu de vol, périt de la même manière. En un mot, il n'y avait pas d'application spéciale.
Les autres cas d'asphyxie par immersion dans d'autres localités ne se sont pas présentés nombreux pour nous. A Longwy, en 1433, un nommé Cloux, de Trerpelay, fui noyé par le bourreau de Marville pour ses démérites. En 1479, il en fut de même de la femme Leloup, à Laxou. En 1556, Jeannette Coffin, de Saint-Ligier, fut noyée dans le ruisseau de ce village, où elle avait volontairement noyé son enfant.
Ce supplice, dans un liquide bouillant, de l'huile ou de l'eau, était spécialement réservé aux faux monnayeurs. Le 19 septembre 1510, ce spectacle douloureux nous apparaît pour la première fois. A Metz, le condamné, nommé Bernard, fut mis au pilori à dix heures du matin, portant, cousus sur ses vêlements, des échantillons de monnaie de sa fabrique ; il y était placé la figure tournée de manière à voir les apprêts qui se faisaient à son intention. Une chaudière montée dans un fourneau en maçonnerie, bâti exprès, chauffait six quartes d'huile mêlée à une quantité d'eau deux fois plus grande.
Deux heures étant sonnées, il fut détaché du pilori et amené, après ces quatre heures d'angoisses, sur un petit échafaud touchant la chaudière et un peu plus élevé qu'elle.
Là, le visage tourné vers le peuple, il subit la lecture de sa condamnation, après quoi le bourreau lui lia les mains par-dessous les genoux avec une chaîne qu'il portait au cou. Tirant alors cette chaîne avec force, il lui ramena la tète contre les genoux. En cet état, il le saisit par les pieds, et, lui faisant faire le cul tumerel, il le précipita la tète en bas, comme un paquet, dans le liquide bouillant, où il le retint plongé à l'aide d'une fourche. Retiré bien cuit, on l'enterra en terre profane.
Le second est un condamné de la prévôté de Bouconville, en 1531. Extrait du château de ce village, où il était emprisonné, il fut conduit à Essey, lieu de sa résidence, par le prévôt et son escorte. L'exécution eut lieu le même jour et de la même manière, par le bourreau de Bar. La chaudière avait été fournie par le curé de Bouconville, messire Laurent, à qui elle fut payée 8 fr. Comme il n'est, dans la dépense, rien porté pour l'huile, il y a tout lieu de croire que l'on ne se servit que d'eau.
Les autres sont : 1543, à La Mothe, Nicolas de Luxembourg.
1571. A Nancy, Nicolas Lebdeval ; Antoine Braconnier; Pierre de Leffond ; Nicolas Lamoussatte, de la côte
Saint-Antoine, près le château de Passavant.
1574. A Waldevranges, Guillaume Holligen et Henri, tous deux orfèvres.
1577. A Waldevranges, François Laine; Nicolas Bullot.
1584. A Nancy, Jean Lyonnet, du village de Ligniville.
1588. Idem, Jean Rozet, d'Igney.
1598. Idem, Juston.
1610. Idem., Jean Morice dit Menard et son fils.
A Nancy, pour se dispenser des difficiles apprêts usités à Metz, on se servait d'une sorte de bascule que l'on appelait balance, dans le genre de celle de l'eschappe. Le condamné, attaché au bout, pouvait être plongé et retiré plus commodément pour l'exécuteur.
ECARTELLEMENT.
Ce supplice était en usage dans la Lorraine et les Trois-Évêchés, notamment à Metz, où l'on en trouve plusieurs exemples. Il était, par son atrocité, considéré comme de première classe.
Le condamné, après avoir été soumis à la question extraordinaire, pour avoir révélation de ses complices, et fait amende honorable, était conduit au lieu de l'exécution sans autre vêtement que sa chemise. Un échafaud de trois ou quatre pieds de hauteur était dressé à l'avance ; le condamné y était couché sur le dos, attaché par deux liens de fer solidement fixés, l'un passant autour de la poitrine vers le cou, l'autre autour des hanches, à la hauteur du bassin. S'il s'était servi d'une arme ou autre instrument, elle lui était attachée à la main droite que le bourreau lui brûlait sur un réchaud ardent entretenu par du soufre. A l'aide d'une tenaille à crochets, il lui arrachait des morceaux de chair aux seins, aux bras, aux cuisses et aux mollets, et aspersait ensuite chacune des énormes plaies qu'il avait faites, avec un liquide bouillant composé de plomb, d'huile, de poix-résine, de cire et de soufre.
Venait seulement le supplice principal, pendant les préparatifs duquel ces atroces déchirements produisaient leurs douloureux effets. Le bourreau attachait alors à chacun des quatre membres du patient, savoir : aux jambes, depuis le genou jusqu'au pied, aux bras, depuis l'épaule jusqu'au poignet, une forte corde qu'il liait par trois noeuds dits d'emballage. A chacune de ces cordes il accrochait le palonnier de chaque cheval, et ceux-ci, après avoir tiré par plusieurs petites secousses, se lançaient enfin ensemble, excités par le bourreau et ses valets, ainsi que par la populace, trop souvent avide de leur voir produire quelque effet.
Rarement les membres retenus par les ligaments se détachaient; quand le bourreau jugeait que le supplice avait assez duré, il y aidait en coupant les membres aux jointures avec un couperet. Alors chaque cheval entraînait sa part, qui quelquefois, après avoir été exposée aux quatre coins de la ville, était réunie au corps avec les autres, pour être brûlées ensemble et les cendres jetées au vent.
Le régicide français, Damiens, résista ainsi deux heures.
Nous avons trouvé plusieurs écartellements sans indication du crime auquel ils étaient appliqués : En 1479, à Nancy, Didier d'Averocourt, de Blâmont, et Jeannot Chagnart, de Pierreviller ; en 1569, à Mirecourt, Jacques le Borne ; en 1573, à Vézelise, Didier Didot, de Viterne : les membres de ce dernier furent exposés sur les hauts chemins de Tantonville, Nancy, Joinville et Vaudémont.
FEU.
Ce châtiment s'infligeait de la manière suivante : Un poteau sortant de sept à huit pieds était fiché debout en terre. Tout au tour, en carré, étaient posés un rang de fagots, puis un rang de bûches, et ainsi de suite jusqu'en haut, en laissant, à partir de la seconde couche, un intervalle sur la face principale pour arriver au poteau. Le condamné, les mains liées derrière le dos, sans autre vêtement qu'une chemise soufrée, montait sur le plancher, formé, comme je viens de le dire, d'un rang de fagots et d'un rang de bûches, pour atteindre le poteau, après lequel le bourreau l'attachait par les pieds et par le cou avec des cordes, par le milieu du corps avec une chaîne de fer. Le feu était ensuite mis et entretenu jusqu'à ce que le corps fût réduit en cendres ; puis, l'exécuteur s'approchant du poteau, à l'endroit où était le corps, en prenait une pelletée qu'il jetait au vent.
Pour un bûcher bien conditionné, il fallait 3/4. de corde de bois et 75 fagots, le tout entremêlé de paille. Souvent on y jetait une ou deux livres de poudre à canon.
Lorsque le condamné ne devait, d'après l'arrêt, sentir que légèrement l'ardeur du feu, le bourreau prenait soin de laisser entre deux fagots un intervalle suffisant pour passer une perche munie d'un dard qu'il lui enfonçait vigoureusement, au moment voulu, à la région du coeur.
Le patient, enveloppé de flammes et de fumée, expirait alors aussitôt, sans que personne s'en doutât et avant que lui-même s'y atendît.
L'arrêt, toujours sévère dans sa rédaction apparente, portait quelquefois un retentum dont l'exécuteur avait seul connaissance, par lequel il était ordonné que le condamné serait au préalable secrètement étranglé. Pour cette opération, le bourreau, en le liant au poteau, lui passait sans affectation autour du cou une corde qui semblait destinée à l'attacher comme les autres ; alors, au moment où il mettait le feu, avant que le condamné eût pu le sentir, un bâton, passé dans cette corde pour servir de tourniquet, suffisait, à la plus simple impulsion, pour l'étrangler subitement.
La chemise de soufre était une faveur, tout en paraissant devoir augmenter les souffrances, comme le peuple le croyait. Aussi quelquefois l'arrêt, portant que le condamné subirait le feu revêtu d'une chemise non soufrée, était corrigé par un retentum accordant que sous sa chemise ordinaire il aurait une chemise de soufre. Celle-ci avait l'avantage de l'asphyxier plus vite. Mais quelle que fût la douceur du retentum, le supplice et ses apprêts n'en étaient pas moins barbares.
Ainsi périt une foule d'hommes et de femmes qui, n'ayant guère qu'un peu d'hérésie à leur charge, ne méritaient pas celle rigueur. Ce fut le supplice de plusieurs milliers de sorciers et sorcières victimes d'une absurde ignorance ; celui de Jean Châtelain, religieux de l'ordre de Saint-Augustin, dont tout le crime était d'avoir prêché que les moeurs des hommes d'église de son temps ne l'édifiaient pas. Ce zélé réformateur fut brûlé à Vic, en 1524, sur l'avis d'un concile de docteurs et d'abbés, juges et parties dans leur cause.
Un hérétique dont l'exécution par le feu fut un vrai martyre, est J. Leclercq, dont j'ai déjà parlé. (Voyez Sacrilège.) Conduit au lieu du supplice, coiffé d'un grand bonnet de papier sur lequel étaient peintes les images qu'il avait brisées, il essaya de protester et de proférer quelques paroles tendant à la justification de sa foi. Mais la justice, qui avait des motifs de suspecter son éloquence persuasive, se mit à bruire, tellement qu'il ne put se faire entendre ; ce que voyant, il se résigna. Invité à recommander son âme à
Dieu et à demander à chaque assistant un Pater et un Ave, il fit cette prière quant au premier, mais de
l'Ave ne parla point. Remarque lui étant faite de cette réticence hérétique, il dit modestement : « Le dise qui le veut, il ne nuit point au Pater. » L'exécuteur lui ayant demandé pardon de sa mort, il le lui accorda et le baisa sur la bouche.
Cela fait, ce bourreau, sans le prévenir, lui approcha du visage une grosse tenaille rougie au feu, à l'aide de laquelle il voulait lui enlever le nez ; mais le patient, surpris, ayant jeté sa tête en arrière, y perdit les lèvres, qui lui furent arrachées rôties jusqu'aux dents. Mieux instruit de ce que lui voulait cet homme, il lui tendit aussitôt bénignement la figure, offrant ainsi à Dieu en sacrifice le déchirement de son corps. Le bourreau ayant réparé sa faute et continuant, reprit sa tenaille qu'il lui posa sur la tête, et, la lui promenant par trois fois sur le front, il lui imprima jusqu'à l'os une triple couronne. Puis, saisissant un couteau et un maillet, il lui abattit la main droite. Pendant ce temps, le martyr ne poussait la moindre plainte, se contentant de dire en souriant : Mon Dieu, prenez encore ceci. Enfin, le feu s'alluma et le condamné disparut dans les flammes et la fumée, en chantant des psaumes d'une voix claire et forte, qui ne s'éteignit que peu à peu avec sa vie.
Ce fut là, dit un manuscrit contemporain, « un acte vraiment extraordinaire et qu'il ne faudrait imiter légèrement. »
En 1503, une jeune fille, condamnée pour avoir laissé mourir son enfant, donna à la même ville de Metz un affligeant spectacle. Trop pauvre peut-être pour bien payer le bourreau, celui-ci avait tellement ménagé le bois, que le feu n'atteignit que lentement la malheureuse patiente, qui poussait force gémissements, lorsque tout à coup ses contractions désespérées ayant fait rompre les cordes, elle se vit en liberté sur le bûcher, mais essayant en vain de se tenir sur des pieds et des jambes déjà consumés jusqu'aux os ! « Et se desgectait tellement, que devant tout le peuple elle monstrait sa pouvrelé.... » Il faut noter que le reste de son corps était intact. La justice présente fut grandement émue, et cependant le parcimonieux bourreau en fut quitte pour être privé pendant un mois de sa prébende à l'hôpital.
Le public n'était probablement pas plus satisfait que ses magistrats, car il aime avant tout que ceux qui ont les charges publiques s'en acquittent sans broncher ; outre cela, il aime les supplices complets ; c'était donc lui voler la moitié de son spectacle que d'en changer la forme. Pour satisfaire à cet instinct féroce, un des Échevins, Nicole Dex, imagina un fauteuil à claire voie, s'accrochant en haut du poteau et s'y emboîtant par derrière de manière à pouvoir glisser sans verser d'aucun côté. Le patient était assis dessus
à une certaine élévation, de manière à subir peu à peu et long-temps l'atteinte des flammes qui le dévoraient pardessous. Quand elles arrivaient à la hauteur de la corde suspendant le fauteuil, celle-ci se rompait, et alors ce dernier, glissant le long du poteau, descendait jusqu'à trois pieds du foyer, de manière à ne pas étouffer le feu, qui continuait sans obstacle jusqu'à ce que tout fut consumé. Cette machine, inventée pour une autre infanticide, en 1526, eut l'approbation des amateurs du genre ; au moins pouvait-on, grâce à l'ingénieux échevin, atteindre au comble de la barbarie.
La Cour souveraine, pendant le XVIIIe siècle, ne fit pas usage du supplice du feu plus d'une vingtaine de fois ; ce fut dans des cas d'incendie, inceste, sodomie, bestialité, vols sacrilèges, etc. Dans quatre ou cinq circonstances seulement, le condamné dut sentir vivant les atteintes de la flamme ; dans les autres, il y eut toujours un retentum.
Après le supplice, le poteau restait debout, à demi-consumé, jusqu'à une prochaine exécution. II était sévèrement défendu d'y toucher, parce qu'il était pour le droit de brûler comme le signe patibulaire pour le droit de la hart ; il maintenait le seigneur en possession paisible de ce fleuron de sa couronne. On l'appelait l'étoc a brûler. Les parents du dernier supplicié avaient une grande propension à l'arracher; aussi malheur à eux s'il venait à disparaître, ils ne pouvaient pas répondre que les douleurs de la torture ne leur feraient pas avouer cet attentat, malgré leur innocence.
CASTRATION, ÉTRIPEMENT.
Le supplice de la castration ne paraît pas avoir été souvent pratiqué, sans que néanmoins l'on puisse se rendre compte des motifs qui ont fait s'en abstenir, puisque d'autres exécutions plus cruelles furent mises en oeuvre. Cependant, l'inflexible logique de nos pères, tenant en main la distribution arbitraire des châtiments, eût dû trouver plus plausible d'appliquer celui-là au viol et autres crimes analogues, que le fouet ou la mutilation des oreilles ou du nez. Quoi qu'il en soit, on rencontre deux cas de castration qui sans doute ne sont pas les seuls, et encore ils n'étaient pas, il faut le dire de suite, une punition, mais une dégradation du coupable, puisqu'il ne devait pas y survivre.
C'était en 1491, en la ville de Metz, qui comptait pour cette année au nombre des Treize le seigneur Jean de Landremont. Un certain Jean de la Molize, chevalier lombard, agent secret du duc de Lorraine, avait su gagner les bonnes grâces de Landremont et lui faire partager les vues secrètes qu'il avait de mettre la puissante cité sous la dépendance de ce prince. Un portier, nommé Charles Cauvelet, Breton venu à la suite des Bourguignons, consentait à fermer les yeux et à faciliter ainsi l'introduction de l'ennemi. Jean de Landremont espérait des honneurs et de grands emplois ; Cauvelet espérait, faut-il le dire, d'être débarrassé de sa femme, que la Molize lui promettait de faire tuer dans la mêlée. Tout allait pour le mieux, chacun faisant ses projets : la Molize rêvant des récompenses, Landremont se croyant déjà sénéchal, Cauvelet épousant à l'avance une jeune cousine qu'il avait en son logis. Mais, par scrupule, peur ou trahison, le Breton jugea plus prudent de tout révéler, et il parla si bien, que J. de Landremont fut arrêté ; quant à J. de la Molize, plus heureux, il s'évada.
En vain le duc de Lorraine écrivit en faveur de son agent; prières et menaces, rien ne put fléchir la justice, émue du danger qu'avait couru la cité. L'instruction de l'affaire fut promptement faite et la sentence bientôt connue. Le 5 janvier, J. de Landremont conduit devant la grande église, lecture de son procès lui fut faite par maître Gille Pierson, secrétaire des Treize, assisté de trois notaires. De là, hissé sur un cheval, il fut mené avec grand appareil dans tous les carrefours, où, après avoir sonné trois fois de la trompette, un crieur proclama la sentence, avec annonce de l'exécution pour deux heures de l'après-midi.
Ce moment arrivé, le condamné, nu en chemise, brouetté par le bourreau, fut conduit sur la place de Chambre, où la justice l'attendait réunie. Un échafaud, plus haut qu'à l'ordinaire pour que l'on pût mieux voir, y était préparé comme si ce fust pour juer ung jeu; Landremont y monta, escorté de l'exécuteur, de quelques hommes d'église, des sergents et de plusieurs médecins et apothicaires, ceux-ci venus pour tirer du supplice un peu de profit pour la science. Conduit près d'un poteau, il y fut bientôt lié par le cou, par les bras et les jambes, la figure tournée vers l'église, et de nouveau lecture lui fut donnée de son arrêt. A cet instant, Conrard de Serrières, l'un de ses ex-collègues, lui demanda s'il avait du repentir d'avoir projeté la mort du peuple qu'il voyait assemblé, à quoi il répondit que non, que jamais il ne s'en avait repentu et qu'il avait été délibéré de faire son cas tout joliettement.
Sur ce, les prêtres l'exhortèrent au repentir, à crier merci à Dieu, et enfin à prendre courage à cette heure suprême ; mais il les rassura en souriant. Alors le bourreau, faisant son office, s'approcha, lui fendit la chemise, plaça un baquet entre ses jambes et semblait à plusieurs qu'il lui eust coppé le membre viril et les génitoires, et qu'il les getta au cuveaul; subitement lâcha une détente qui, à l'aide d'un poids, lui serra le cou et l'étrangla, pendant qu'il lui enfonça dans le bas-ventre un tranchant à l'aide duquel il lui fendit le corps en long, puis en croix, et, plongeant son bras dans l'intérieur, il lui arracha le coeur, qu'il lui mit devant le visage; enfin, tirant à lui tous les intestins, il les jeta dans le cuveau, et le patient rendit le dernier soupir.
Le cadavre ayant été détaché et avisé par les médecins et apothicaires, la tète fut séparée du tronc et fichée au bout d'une lance garnie de fer-blanc pour plus de durée, devant demeurer plantée à la tour du pont Thiffroy dont Landremont était capitaine. Le corps, coupé en quatre quartiers, fut de même exposé aux quatre portes, et les entrailles brûlées avec le baquet.
Cette émouvante exécution avait attiré une foule plus considérable que de coutume : il y avait des gens de tous les environs, de la Lorraine, du Barrois, du Luxembourg, etc. Le portier breton était aussi présent; on s'attendait à le voir également payer de sa personne, mais il ne monta sur l'échafaud que pour entendre la sentence qui le graciait, ce dont l'assistance, ennemie de tous les genres de trahison, murmura très-fort, au point qu'il fallut bientôt faire prêcher dans les églises que la révélation de Cauvelet était une inspiration de la vierge Marie, et défendre de lui en faire reproche, sous peine de mort et confiscation de biens. La ville, en outre, le récompensa magnifiquement, sans aucun doute au-delà de ce qu'il méritait.
Voici maintenant l'autre cas analogue. En 1512, à Boulay, un homme convaincu du même crime que le seigneur J. de Landremont, fut condamné au même supplice, probablement par imitation, mais avec aggravation. Le bourreau, après lui avoir coupé les parties sexuelles et fendu le ventre jusqu'à la poitrine, lui ouvrit si subitement et si largement le corps avec les deux mains, que ses intestins s'échappèrent tous. Il n'était pas étranglé, il n'était pas mort, mais très-vivant, au point qu'il parlait.
Entre autres choses, il demanda à voir son coeur, qui, dit la chronique, lui fut mis devant le visage jusqu'à ce qu'il dît qu'il le voyait bien. Alors le bourreau, par pitié ou par ordre, ayant percé ce coeur qu'il tenait, le martyr expira. La tête fut aussi coupée et le corps mis en quatre quartiers.
ASPHYXIE SOUS TERRE.
Nous finissons cette série de punitions impitoyables par la moins connue, mais non la moins dure.
En 1505, Catherine, femme de Barthel, portier de Sierck, pour avoir tué ses trois enfants, fut condamnée à élre enterrée vive, et la sentence fut exécutée audit Sierck.
En 1644, Marion, fille de Jean Hocqual, de Menal-Ruy, au ban de Vagney, fut condamnée à être enterée vive et ainsi exécutée à Arches, pour avoir « étranglé ou enterré vif son enfant. »
Ce supplice, réservé aux mères infanticides, pouvait avoir lieu de deux manières : La condamnée, ayant les membres garrottés, était jetée en terre, où elle voyait la mort menaçante arriver peu à peu, jusqu'à ce que les pelletées, se succédant, lui couvrissent entièrement la tête ; ou bien, enfermée dans un cercueil, la mort ne la frappait qu'après qu'elle avait subi les plus horribles angoisses.
GRACE.
Ce droit, qui est réputé l'un des plus beaux apanages du souverain, mais dont il lui est si difficile d'user sans faiblesse ou sans erreur, s'étendait alors jusqu'à mettre des entraves au cours ordinaire de la justice. Les lettres de grâce se divisaient en des catégories qu'il est indispensable de rappeler.
Lettres de rémission ; s'accordaient dans les cas d'homicide involontaire ou en légitime défense, ordinairement avant la condamnation.
- de pardon; quand le crime n'était pas excusable et eût entraîné la peine de mort.
- d'abolition; pour les crimes non rémissibles, tels que rapt avec violence, assassinat, outrages et excès envers les magistrats.
- de rappel de ban ou commutation; pardon après la condamnation.
- de révision; pour faire examiner de nouveau le procès quand la cause n'étail pas susceptible d'appel ou que ce recours était épuisé.
- de purger la mémoire ; en deux cas : 1° Quand le condamné avait été exécuté. 2° Quand, en cas de contumace, il était mort avant les cinq ans qui lui étaient accordés pour comparaître.
- d'ester à droit; quand le contumace était mort après les cinq ans.
- de réhabilitation; quand le condamné était encore vivant et avait réparé par sa bonne conduite la faute d'un instant.
La disposition de ces lettres appartenait au souverain, c'est-à-dire, en Lorraine et Barrois, au duc, dans les parties de ces provinces relevant directement de lui ou sur lesquelles, quoique n'ayant ni la seigneurie, ni la justice, il s'était réservé la souveraineté. C'est ainsi qu'en 1420, Érard du Châtelet et Burnequin de Vendières, seigneurs de Vendières, demandent au duc la permission de gracier un nommé Rémi, leur sujet, coupable d'avoir commis un vol de blé dans un moment où la misère accablait sa famille. Dans le reste de ses états, la disposition de ces lettres appartenait aux seigneurs dont les privilèges jadis concédés ou usurpés comprenaient ce droit.
Dans les Trois-Évêchés, le droit de grâce appartenant aux empereurs d'Allemagne, demeura dans leurs mains, puis il passa aux évêques et enfin aux justiciers, comme nous le verrons.
Les motifs qui avaient déterminé les catégories qui précèdent avaient fait admettre certaines règles qui, en général, étaient observées. Ainsi, les lettres de pardon devaient contenir l'exposé fidèle des faits et circonstances du crime, afin qu'il fut notoire à tous qu'elles n'avaient pas été surprises par le mensonge. Mais, comme elles étaient toujours, en définitive, un acte de bon plaisir du maître, s'il s'écartait de l'usage, personne n'avait autorité pour l'y ramener. Nous avons l'exemple d'un cas où le prince faisant grâce, ne sait pas même de quoi était coupable l'accusé : C'était en 1610 ; le capitaine de Siersperg ayant été changé, son successeur trouva dans les oubliettes du château un pauvre malheureux qui y languissait depuis huit mois. Touché de sa position, il demanda sa grâce, qui lui fut accordée. Le duc, en la lui envoyant, lui recommande de s'informer de son crime, dans la crainte qu'il ne soit trop grave. Il se trouva qu'il était bigame et avait fait un juron où le diable prenait place. La circonstance qu'il était militaire ayant été, par le bienveillant capitaine, jugée atténuante, il fut mis en liberté.
La grâce mettait le gracié à l'abri de toutes poursuites, même du paiement des frais qu'à ce moyen on était encore empêché de faire contre lui. Cette faveur de paralyser la justice ou d'empêcher l'exécution de ses arrêts s'obtenait, comme toutes les faveurs, par ceux que leur crédit personnel ou celui de leurs amis protégeait. C'était l'espoir de la noblesse et des privilégiés dans leurs excès d'outrecuidance, au grand mécontentement des roturiers, qui n'y voyaient qu'un encouragement à les vexer. Nous avons parlé de la grâce faite par le duc René, en 1453, au seigneur de Beffroimont, pour fausse monnaie ; il la lui fit encore plus éclatante en 1462, ainsi qu'à ses valets, pour avoir battu un prêtre; il y fut dit que toutes les poursuites faites devant le bailli de Saint-Mihiel étaient annulées (92).
On sait par tradition combien ces grands seigneurs se gênaient peu pour maîtriser leur courroux et frapper dédaigneusement ceux que la loi désarmait. On l'a peut-être répété avec exagération ; mais, dans la pratique, les cas étaient plus nombreux qu'on ne le croit communément. Voici quelques exemples de ces événements graves qui n'avaient d'issue que l'impunité : Le 4 septembre 1573, le comte de Salm visitant ses écuries pendant la nuit, un de ses palefreniers, empressé d'accourir, ne le voyant pas dans l'obscurité, vient à heurter sa seigneurie, qui tire à l'instant son épée et la lui passe à travers le corps. Deux ans auparavant, il lui avait été fait grâce du meurtre du sire de Gombervaux (voyez Duel), parce qu'il avait eu affaire à un gentilhomme ; cette fois, il lui est fait grâce parce qu'il à eu affaire à un manant. Il faut dire cependant que le maréchal de Lorraine n'était pas très-rassuré, car le duc, qui
avait un pressant besoin de lui, l'ayant fait demander, il refusa de s'y rendre avant de tenir en mains ses lettres de rémission, ne se fiant pas même à un sauf-conduit.
En 1541, Érard du Châtelet, sieur de Cirey, faisant route avec sa suite, eut en rencontre l'Abbé de Muraux, escorté de même. Ces fiers voyageurs n'ayant pas jugé à propos de se prévenir par quelques salutations, passaient sans mot dire et sans se connaître, lorsqu'un domestique du premier fit observer rudement qu'une javeline d'un valet du second allait l'atteindre en passant, l'avertissant de la relever, ce qui ne fut pas fait. Du Châtelet, courroucé de cette insulte, envoie demander à l'Abbé quel est le nom du chevalier discourtois qui l'insulte ainsi ; mais l'Abbé, froissé à son tour de cette curiosité téméraire, lui fait répondre qu'il vienne le savoir s'il l'ose. Du Châtelet retourne, fond sur la paisible caravane, et, en quelques coups de haquebutes et de masses, devient maître du champ de bataille sur lequel l'Abbé gît sans vie, ainsi que l'un de ses suivants. Ce double meurtre est gracié sans difliculté.
En 1524, Claude de Vaudémont, sieur de Pesche, se trouvant à Bar dans une hôtellerie, était descendu à la cuisine où, en attendant le dîner, il faisait à deux jeunes filles l'honneur de les agacer. Trois jeunes gens sortent d'une chambre et traversent la cuisine sans saluer autrement qu'en disant : Dieu vous garde ! - Qui sont ces grosses bêtes ? ils sont bien sauvages de ne pas saluer des gens de bien, s'écrie le noble seigneur. A ce mot, les jeunes gens se retournent, demandant qui les à appelés grosses bêtes. - Eh, vilain, veux-tu savoir qui c'est? dit le sieur de Pesche saisissant un grand couteau ; et courant sus à Nicolas Séguin, l'un d'eux, il le met en fuite, se fait apporter son épée et le poursuit à travers l'église Saint-Antoine, et enfin l'atteint dans une maison bourgeoise où il pénètre après lui. En vain le malheureux demande grâce à deux genoux, le dédaigneux spadassin le transperce froidement pour lui apprendre la politesse. Ce meurtre révoltant n'est pas moins gracié avant jugement.
Indépendamment de ces grâces spéciales, il en était d'autres qui s'accordaient dans des circonstances extraordinaires et à leur occasion. C'est ce qui avait lieu à l'avènement des ducs, dont il semblait que ce dût être le premier acte de souveraineté. François de Vaudémont, père de Charles IV, eut soin de le faire ainsi, pour constater son règne d'un jour. A l'avènement du duc Antoine au duché de Bar, il fut fait grâce à Servais, de Savonnières-devant-Bar, pour meurtre du nommé J. Leclerc. En 1711, le duc Léopold, à l'occasion de la promotion de sa fille Charlotte à la dignité d'Abbesse de Remiremont, fit grâce à plusieurs prisonniers détenus à Nancy. Cette puissante souveraine, qui n'avait pas onze ans, pouvait, en sa nouvelle qualité, user du même pouvoir lors de certaines processions usitées par son chapitre. Le commandement qu'elle était autorisée à faire à tous les prisonniers de suivre la procession, ce qui leur valait la liberté, n'avait lieu probablement qu'après quelque préparation ; comme les exécutions suivaient de près les sentences, il est à croire que ceux qui restaient pouvaient être libérés sans danger ni scandale, autrement cette haute-justicière eût attenté de ses propres mains au plus assuré soutien de son pouvoir.
Chacun sait que les rois de France prétendaient à l'exercice du droit de grâce dans toutes les villes où ils entraient. La Lorraine en était à l'abri, mais il n'en était pas de même dans le Barrois et le Bassigny mouvants, sur lesquels ils avaient conservé certaines prétentions à la souveraineté. Aussi Charles IX ayant fait son entrée à Bar en 1564, voulut-il user de ce privilège, qui pouvait servir par la suite à en réclamer d'autres. Le célèbre Jacques Amyot, son grand-aumônier, fut chargé de cette exécution dont le procès-verbal, que nous sommes heureux de pouvoir donner ici en entier, en révélant le mode de cet usage, nous apprend que cette délivrance générale ne s'étendait pas aveuglément sur tous les prisonniers.
« (93) Le mardi, 9e jour de mai, l'an 1564.
Nous, Jacques Amyot, Abbé de Sainte-Corneille de Compiègne, conseiller du roi notre sire et grand-aumônier de France, par commandement de sa majesté, nous sommes transporté es prisons de Bar-le-Duc, pour, à cause de sa nouvelle entrée en ladite ville, que sadite majesté y fit le lundi, premier jour dudit mois audit an, délivrer et
mettre hors desdites prisons les prisonniers y étant, ce que nous avons fait signifier au prévôt dudit Bar, procureur de M. le duc audit lieu, et autres officiers d'icelui, à ce qu'ils se trouvassent pour être par eux instruit de la qualité du crime dont lesdits prisonniers seraient atteints, selon le contenu es informations sur ce faites, et délivrer iceux prisonniers ainsi que verrions être à faire par raison.
Lesquels, à savoir ledit prévôt étant en sa maison, à table, nous aurait fait réponse de ce que tôt après ne fauldrait à faire le devoir pour le service de M. le duc, son seigneur, et selon que nous désirions. Depuis, après l'avoir attendu quelque espace de temps, et ayant renvoyé par devers lui, nous aurait fait dire qu'il n'y pouvait venir, pour être empêché à bailler chawey pour le roi.
Et le procureur ayant été mandé par deux fois en son logis où l'on aurait parlé à sa femme, laquelle aurait répondu qu'il était allé en un sien jardin et qu'il n'y était, mais qu'on lui dirait quand serait venu.
Ayant de rechef attendu quelque temps et ne se trouvant aucun d'eux, avons néanmoins procédé selon le commandement de S. M. et étant assisté de M. l'Abbé de Lestcop, conseiller et confesseur de sadite majesté, de M. de Saint-Martin et de Baulne, Abbé de Coulombes, conseiller et maître des requêtes ordinaires de l'hôtel de sadite majesté; ayant fait venir devant nous le geôlier et garde desdites prisons, fait représenter son registre d'écrou des prisonniers qui sont mis es dites prisons et poser les clefs d'icelles devant nous ; pris aussi le serment de lui, lequel solennellement fait, nous aurait juré et protesté qu'aucun desdits prisonniers n'aurait été transporté desdites prisons pour les frustrer et priver du bénéfice de sadite majesté, à sadite nouvelle entrée, avons audit geôlier enjoint de faire venir l'un après l'autre par-devant nous les prisonniers desdites prisons, ce qu'aurait fait comme s'ensuit :
Et premièrement.
François Mercier et Gillot Mairel, pauvres laboureurs du village d'Erise-la-Brûlée, prévôté de Pierrefitte, lesquels, après nous avoir dit qu'ils étaient détenus es dites prisons pour avoir laissé échapper un soldat à eux baillé en garde par le procureur de la seigneurie dudit lieu, étant en une taverne, lequel soldat se serait sauvé de nuit, lesdits Mercier et Mairel étant endormis. Avons iceux délivrés et mis hors desdites prisons, à la charge toutefois de lever lettres de pardon dudit cas dedans trois mois.
Fremin Matelin, de Levoncourt, laboureur, prisonnier es dites prisons depuis quatorze semaines, à la requête d'un nommé Vanne du Moulin, procureur en ladite seigneurie de Levoncourt, pour avoir brûlé une table et quelques saulaigeaux étant des appartenances d'une maison vendue par le père dudit Matelin, à charge de réméré de douze ans, lequel réméré ledit du Moulin aurait acheté dudit père, contre le vouloir et consentement dudit Matelin, lequel tenait à louage dudit du Moulin icelle maison pour neuf années, dont restait huit audit Matelin ; aussi prisonnier pour dettes de la somme de 70 fr. barrois, envers ledit du Moulin, pour vendition d'une queue de vin et d'un muid de blé, lesquels il aurait revendus tout incontinent audit vendeur pour le prix et somme de 49 fr. barrois, laquelle somme ledit Malelin reprit encore à intérêts dudit du Moulin pour 8 fr. barrois qu'il lui doit payer par chacun an.
Ce que par nous entendu et nous ayant été par ledit Matelin présenté pour caution un nommé Jean Bouton, marchand drapier de ladite ville de Bar, réservant et solvable au récit de plusieurs illec assistants, avons ledit Matelin élargi et mis hors desdites prisons, à charge de ladite caution.
Jean Radouan, marchand drapier dudit lieu de Bar, prisonnier es dites prisons depuis cinq semaines, et ce, comme il disait, pour s'être trouvé en compagnie, lorsqu'un sien serviteur excéda la personne d'un nommé Breton, sergent audit Bar, n'ayant trouvé autres charges sur lui. A icelui avons ouvert lesdites prisons.
Germain-Charles Chartier, du Pont-à-Mousson, prisonnier deux jours en çà, pour avoir été trouvé saisi d'une arquebuse, et être soupçonné d'avoir lâché un coup d'icelle en tirant au gibier, dont une femme aurait été blessée, ce que toutefois n'avouait avoir fait. Et pour ce, lui avons fait ouverture desdites prisons, à la charge de lever lettres de pardon, pour à l'égard du port d'armes défendues seulement.
Pierre, de Sorcy, demeurant à Sommelonnes, marchand laboureur, prisonnier à la requête d'un religieux moine, pour la somme de 8 fr. barrois et de restitution de quelque bois qu'il emportait. Avons icelui délivré et mis hors desdites prisons, à la charge toutefois de satisfaire à partie.
Girard Menon, demeurant à Contrisson, prisonnier es dites prisons, pour la somme de 150 fr. barrois, dus au receveur de Commercy, pour partage et accord fait entre eux, passé par obligation, lequel n'avons élargi, sinon que au cas qu'il baille à sa partie caution resséante.
Fait à Bar-le-Duc, les an et jour dessus dits.
Jacques Amyot,
Grand-Aumônier. »
Les refus mal déguisés du prévôt et du procureur fiscal de participer à cet acte de souveraineté de la part du roi, au préjudice du duc, leur maître, et les représentations qu'ils crurent devoir adresser, donnèrent lieu à l'acte qui suit (94) :
« Sur ce que M. de Lorraine, duc de Bar, et ses officiers audit Bar, ont remontré et se sont plaints au roi de
l'exploit fait par son grand-aumônier et maître-des-requêtes de son hôtel es prisons de cette ville de Bar, S. M. a déclaré et déclare que ce soit sans aucun préjudice des droits et possessions prétendus par le sieur duc es cas souverains, et jouissance d'iceux en ladite ville, bailliage et prévôté de Bar, et sans aussi que par cette présente déclaration il se puisse attribuer nouveau droit, ne qu'elle puisse préjudicier aucunement aux droits de sadite majesté.
Fait au conseil privé tenu audit lieu de Bar, le 9e jour de mai, l'an 1564, auquel étaient présents la reine, sa mère ; MM. les cardinaux de Bourbon, de Lorraine et de Guise ; les ducs de Montpensier et d'Aumale ; M. de Montmorency, connétable de France; M. le chancelier; le sieur de Bourdillon, maréchal de France ; l'évéque d'Orléans et autres.
Signé: Charles. »
Nous avons dit que le droit de grâce avait été conservé dans les Trois-Évêchés par les empereurs d'Allemagne. A Toul, en 1544, Charles-Quint fit grâce à Abraham de Matain, son tripier, qui avait tué un habitant, nommé Gérard Masset. Les officiers municipaux intervinrent eux-mêmes pour l'obtenir. A Metz, chaque fois que les empereurs vinrent, ils ne manquèrent pas de réclamer ce privilège et d'en user. En 1492, le fils de l'un d'eux, Maximilien, gracia plusieurs détenus au nom de son père, notamment une sorcière enfermée depuis quatre ans, et un nommé Fumière, condamné à la prison perpétuelle; ce malheureux, qui était séquestré depuis dix ans, avait déjà perdu les pieds et les jambes, de sorte que c'est à peine si on lui accordait la vie.
La venue des empereurs étant fort rare, ce n'était donc que par exception que ce droit était exercé par eux ; en temps ordinaire, les officiers de la cité en usaient souverainement, sans que l'on puisse dire s'ils l'avaient obtenu des empereurs ou s'ils l'avaient usurpé.
Les évêques, de leur côté, y avaient des prétentions auxquelles il ne manquait peut-être que la force pour être les meilleures. A Toul, ils essayèrent nombre de fois de les faire valoir, mais la résistance des justiciers s'y montra toujours fort obstinée: En 1564, l'évêque, Pierre du Châtelet, gracia vainement Waltrin Gatefroi, ils le bannirent pour six ans. En 1569, un autre Toulois, Claudin Paris, dit Galetier, ayant été tué à la fête de Chaudeney, par Claudin Poirel, le même évêque, appréciant les circonstances, s'empressa d'absoudre ce dernier, mais « ce nonobstant, MM. de la justice le bannirent ; » et, comme s'ils n'avaient voulu que montrer leur puissance et se maintenir en possession, ils lui permirent de rentrer après quinze jours de supplications, mais encore après amende honorable, qui fut faite devant la porte Maupertuis.
Les justiciers de Metz en usaient de même, et n'étaient pas toujours inaccessibles aux influences de leurs proches : En 1491, l'un d'eux, Claude Baudoche, mariant sa fille, celle-ci refusa d'entrer à l'église avant que son père lui eût fait obtenir la grâce d'un boulanger et celle de sa femme, ce qui lui fut accordé. Dix ans auparavant, pareil exemple avait été donné par la fille de Jeoffroy Coeur-de-Fer, aussi l'un des seigneurs de la cité. Elle avait de même refusé d'entrer dans l'église, si l'on ne faisait auparavant grâce à deux réfugiés qui s'y trouvaient. En cette dernière rencontre, la surprise de ces pauvres diables dut être grande, car on les emmena
déjeuner à la noce.
Les personnages importants qui visitaient la fière cité demandaient et obtenaient quelquefois des grâces que la justice, de son côté, n'était peut-être pas fâchée d'avoir l'occasion de donner sans paraître fléchir. En 1471, le comte de Roucy oblint ainsi le pardon d'un meurtrier réfugié depuis sept semaines dans l'église. Heureux de procurer une si grande joie à un homme qui ne s'y attendait pas, il se rendit près de lui et l'engagea à sortir en lui annonçant ce qu'il avait fait pour lui. Mais le réfugié, n'osant ajouter foi à une telle faveur, refusait d'avancer, lorsque le comte lui dit de le prendre par le pan de son habit et de le suivre, lui jurant que personne n'oserait le toucher; il obéit et fut sauvé.
A l'entrée du duc de Guise, plus de vingt bannis faufilés à sa suite obtinrent leur grâce à sa demande. L'archevêque de Trêves entrant dans la cité en 1433, au moment où l'on allait pendre un larron déjà sur le haut de l'échelle, le fit descendre et obtint sa grâce. En 1495, Jehan Ancillon, sergent des Treize, attendant du vin et près de rentrer en ville, ayant ouï dire qu'il n'arriverait pas avant la fermeture des portes, se mit à jurer contre les ordres donnés et contre ceux qui les donnaient. Condamné pour cette irrévérence, il allait avoir la tète tranchée, lorsque le chevalier Jacques, député du roi des Romains, se trouvant en ville, sollicita sa grâce. L'imprudent sergent en fut quitte pour avoir la langue coupée et perdre son office. Autant valait faire justice entière, car « depuis fut, toute sa vie, un homme vaulcabondant par le pays. »
Des protecteurs moins élevés jouissaient d'un privilège aussi puissant ; il leur suffisait de l'acheter par un grand dévouement: En 1457, on allait pendre un jeune homme pour vol, lorsque tout à coup se présente une jeune fille qui offre de l'épouser. La justice accepta le marché proposé, sous la condition du bannissement après le mariage, qui eut lieu incontinent. En 1475, un orfèvre était si près d'être pendu, que le bourreau le tenait déjà par l'épaule pour le pousser dans l'abîme ; une fille dévouée le sauva de la même manière. Il y en eut encore un autre exemple en 1512; mais, trois ans après, pour nouveau méfait, on pendait le même malfaiteur au même lieu.
Le beau sexe ne jouissait pas seul de cet avantage. En 1500, deux servantes ayant battu un domestique au point qu'il en mourut, furent condamnées à être noyées : c'était en hiver ; il gelait si fort qu'il fallait casser la glace épaisse de deux pieds, ce qui ajoutait, s'il est possible, à la tristesse du tombeau qui s'ouvrait sous leurs yeux. Elles attendaient là, en effet, dans l'attitude de la plus profonde désolation, en présence de 3,000 spectateurs, placés aussi sur la glace, lorsque deux jeunes gens, touchés de leur malheureux sort, fendirent la foule et les rachetèrent en se laissant fiancer sur le lieu même.
Nous ne savons si cet usage, pratiqué dans quelques justices seigneuriales et les Évêchés, eut lieu dans les états des ducs de Lorraine, comme nous l'avons ouï dire par tradition ; il n'y était pas toutefois aussi facile, le prince, maître des grâces, n'assistant pas, comme les justiciers des Évêchés ou des petites seigneuries, aux exécutions. Néanmoins, il ne serait pas impossible que ce fait se fût présenté sous l'autorité de ses officiers, les grâces ayant été fort nombreuses et leurs motifs n'en étant pas toujours très-graves. Dans l'intervalle de 1473 à 1626, c'est-à-dire un siècle et demi, les ducs René II, Antoine, François Ier, Charles III, Henri II, François II et Charles IV accordèrent, suivant le dépouillement que nous en avons fait, 2,765 grâces, dont 2,643 rien que pour meurtre; 70 seulement pour larcins ; 18 pour fausse monnaie ; le surplus pour tous genres de crimes les plus énormes.
Lorsque la législation et la justice furent centralisées sous la puissance d'une Cour souveraine, les lettres de grâce ne furent plus valables, à l'imitation de la France, qu'après leur entérinement; du moins la justice était officiellement instruite des motifs qui empêchaient l'exécution de ce qu'elle avait décide. Il y avait encore une raison de cette formalité : c'est que le plus souvent il n'était pas fait grâce des frais ; dès lors il fallait que le fisc fût aidé à les récupérer. Charles III, pour arrêter un abus qui s'était glissé là, défendit, en 1599, de prononcer l'entérinement avant que les frais fussent entièrement payés, l'expérience ayant démontré que la plupart des graciés s'empressaient de s'y soustraire dès qu'ils étaient à l'abri de la peine corporelle.
L'entérinement remonte, dans le Barrois, avant le XVIe siècle ; on en trouve plusieurs cas devant la Cour des hautsjours de Saint-Mihiel. Celui des lettres accordées à Servais, de Savonnières, en 1508, le fut aux assises de Bar. Ceux du Barrois mouvant étaient faits au Parlement de Paris, où, comme nous l'avons dit (95), malgré la grâce du roi, les assassins de M. de La Mothe échouèrent.
Après le code de 1701, qui exigeait l'entérinement devant les bailliages ou devant la Cour, selon le siège saisi de l'affaire et la qualité roturière ou noble du gracié, il fut apporté à cette formalité une attention plus minutieuse, ces tribunaux exigeant à la lettre les conditions portées en la loi. Il fallait que la poursuite en entérinement eût lieu dans les trois mois, à peine de déchéance; l'impétrant, préalablement écroué, était conduit à l'audience la plus solennelle par le geôlier et un huissier ; il y comparaissait tète nue et à genoux, et en cette posture affirmait par serment qu'il avait obtenu les lettres présentées et qu'il entendait s'en servir. On le reconduisait en prison, et l'affaire
s'instruisait en la forme ordinaire, avec plus ou moins de célérité, à la volonté des juges. Si les lettres de pardon n'étaient pas conformes aux charges, l'entérinement était refusé ; le prince était censé avoir été trompé. Pour celles d'abolition y le tribunal saisi pouvait adresser des remontrances, mais pour celles de commutation, il n'y avait rien à examiner; c'était un acte de bon plaisir qui devait recevoir son exécution.
En 1752, des lettres d'abolition ayant été, à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne, accordées par le roi à quatre Lorrains condamnés aux galères perpétuelles, le Procureur général, en demandant leur entérinement, fit observer qu'il ne pouvait être refusé, encore qu'il n'y fût pas fait mention, ni qu'elles eussent été sollicitées, ni que les impétrants voulussent s'en servir, ayant été accordées proprio motu.
Les lettres de grâce n'étaient pas toujours à l'abri de reproches quand elles voulaient, bon gré mal gré, trouver des motifs de leur concession ; il eût été quelquefois beaucoup mieux de n'en pas donner : En 1728, le greffier de la justice de Waldevranges ayant blasphémé contre le pape, les prêtres et le duc, avait été condamné à faire amende honorable, à avoir la langue percée, au bannissement perpétuel et à la confiscation de tous ses biens. Ses services auraient pu, sans étonner personne, motiver quelque adoucissement à une si grande rigueur, mais non, il lui fut fait grâce, parce qu'il avait le vin mauvais.
La mémoire de la victime n'était même quelquefois pas ménagée pour justifier les coupables : Dans des lettres (96) accordées par le duc Antoine aux nommés Bunatte et
Guinat, meurtriers d'un nommé Poirel, de Mehoncourt, prévôté de Rosières-aux-Salines, on ne craint pas de donner pour motif de la faveur accordée, que le défunt était un homme fier, de mauvaise nature, mal raisonnable. Et ils étaient deux pour le tuer !
L'avertissement par le prince à son Procureur général de son intention de faire grâce, était donné en termes assez peu polis ; il lui imposait silence : du moins, pour arrêter ainsi le cours de la justice, devait-on y mettre des formes moins dédaigneuses. Dans les lettres qui furent adressées en 1734, par la duchesse régente, au Procureur général, à l'occasion d'un meurtre par imprudence commis par un révérend père jésuite qui tirait au blanc, elle lui impose silence perpétuel sur cette affaire. Il est vrai qu'elle se chargea elle-même de la punition, qui fut de... cent messes pour le repos de l'âme du défunt. Pour en être quittes à aussi bon marché envers la partie civile, les bons pères se donnèrent beaucoup de mouvement, et réussirent à faire accepter 50 fr. à la mère, pour tout prix du sang de son fils ; mais la duchesse, justement mécontente, les contraignit à doubler la somme.
La grâce des condamnés ou accusés encourant d'autres
peines que celle capitale, pouvait arriver assez à temps ; mais, pour celle-ci, l'usage étant d'exécuter incontinent, le recours n'était pas facile. En 1772, dans une affaire de meurtre, la Cour renvoya l'affaire à trois mois, dans le seul but de permettre à l'accusé ou à sa famille de se pourvoir près du roi. C'était juger l'affaire à l'avance.
Telle fut la justice des siècles précédents. Tant de sang et de larmes répandus pour la civilisation ne peuvent rester sans enseignements salutaires. Cette page instructive manquait à l'histoire ; simple et justifiée par des exemples authentiques, elle doit inspirer confiance ; dépouillée, à dessein, de commentaires et de comparaisons, elle laisse au lecteur toute hherté de penser, au sage toute latitude de choisir, sans influence, entre la faiblesse et la cruauté, le système de répression le mieux gradué pour garantir l'ordre social. Puisse-t-elle être utile au présent et méditée par l'avenir !
FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.
(suite)
(55) Arch. de Lorraine, Pont-à-Mousson, fiefs, 3.
(56) Idem.
(57) Arch. de Lorraine,
(58) Mémoires de du Pasquier, bibl. de MM. Noël et Marchal.
(59) Arch. de Lorraine, Mirecourt, 2, 29.
(60) Chambre des comptes de Bar.
(61) Idem.
(62) Arch. de Lorraine, Pont-à-Mousson, Ecclés., 52.
(63) Chambre des comptes de Bar.
(64) V. suprà, page 58.
(65) Fut pendu.
(66) Banni, puis rappelé en 1614.
(67) Pendu à Nancy en 1629, pour avoir fait mourir Jean Gaudel, accusé de sorcellerie, en lui réitérant la question pendant la nuit, de complicité avec les dénonciateurs de cet accusé, sans permission ni assistance des juges. V. Lyonnais, Hist. de Nancy, t. 2, p. 360.
(68) Arch. de l'Hôtel-de-Ville.
(69) Arch. de Lorraine, États généraux, 46.
(70) Arch. de Lorraine, Épinal, 3, 20.
(71) Au premier jour du plaid annal d'Épinal, les maires des villages du ressort couchaient sur de la paille en signe d'obéissance et de réparation envers le duc, à cause de leur
ancienne rébellion contre lui. Arch, de Lorraine, Epinal, 3, 20.
(72) Arch. de Lorraine, Mirecourt, 2, 29.
(73) Arch. de Lorraine, États généraux, 29.
(74) Voyez Prisons, page 239.
(75) Arch. de Lorraine, États généraux, 10.
(76) Arch. de Lorraine, Nancy, 2, 6.
(77) Arch. de Lorraine, Épinal, 87.
(78) Arch. de Lorraine, Bouzonville, lieux, 21.
(79) Arch. de Lorraine, Châtel, 31.
(80) Arch. de Lorraine, Bar, bailliage, 31.
(81) Arch. de la Cour.
(82) Arch. de Lorraine, Remiremont.
(83) Arch. de Lorraine, Louppy-le-Chastel, 2, 72.
(84) Voir cette charte, imprimée, pour la première fois, par M. H. Lepage dans sa Statistique de la Meurthe, art. Tout, supplément.
(85) Metz depuis dix-huit siècles, par M. Bégin, t. 3, p. 229. Atourd u XIIIe siècle.
(86) Arch. de Lorraine, Barbonville,
(87) Arch. de Lorraine, Val-de-Lièvre, 3, 17.
(88) Idem, La Mothe, 18.
(89) Arch. de Lorraine, Rosières, 2, 92.
(90) Idem, Abbaye, S4.
(91) Voir le dessin exact que nous donnons de celui de notre cabinet, réduit au dixième.
(92) Arch. de Lorraine, Foug, 5 ; confirmation, 39.
(93) Bibl. d'Epinal, manuscrit, 151.
(94) Extrait, à nous communiqué par M. V. Servais, du carton 81 de la chambre des comptes de Bar.
(95) Arch. de Loiraine, Louppy-le-Châtel, 2, 72. Voyez aussi Exposition.
(96) Arch. de Lorraine, Rosières, 2, 56.
(97) Près Sarrebourg.
|