|
La Bibliothèque de
Documentation Internationale Contemporaine vient de mettre à la
disposition du public la copie numérique des trois carnets «
Un de la territoriale 1914-1918 » de Gaston Lavy, réalisés à
partir de 1920.
Nous en avons en extrait les pages concernant le Blâmontois
Qui est Gaston Lavy ?
En premier lieu, l'auteur ne se prénomme pas réellement Gaston,
mais Jean, unique prénom de son état civil. On peut supposer que
« Gaston » est son prénom d'artiste, et on voit d'ailleurs sa
signature évoluer à compter de 1898, ce qui apparait comme un G
dans les carnets de 1920, n'étant qu'un L alambiqué en 1898 :
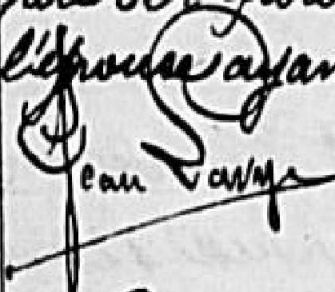
Acte de mariage 1897
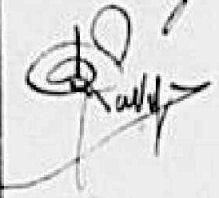
Acte de naissance de sa fille 1898

Avant propos des carnets 1920
| On voit d'ailleurs aussi dans le
dessin de son carnet de mobilisation, en début du 1er
volume, que ce qui apparait comme une tâche noire
pourrait fort bien masquer le prénom « Jean ». |
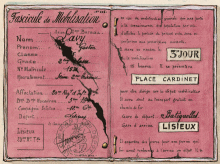 |
Jean Lavy est né à Vergt (Dordogne) le 9 août 1875, fils de Eugène
Lavy, plâtrier (et peintre en bâtiment).
Il se marie à Levallois le 12 octobre 1897 à Alphonsine Victoire
Couturier (née le 6 mars 1877 à Paris 17ème).
Sa fille unique, Suzanne, nait le 25 juillet 1898.
Il est mobilisé en août 1914 en tant que 2ème
classe dans le 3ème bataillon, 12ème compagnie,
du 20ème régiment d'infanterie territoriale de Lisieux. Après le
front de Moranville en Woëvre en 1915, et l'offensive allemande
sur Verdun, il est versé au 37ème régiment d'infanterie
territorial et envoyé à Vého (c'est cette partie de son journal
que nous reproduisons en version texte et images).
Dans les
dernières pages, on constate sa déception de ne pas être accepté
dans la section de camouflage : mais il obtient finalement
d'être affecté à cette section du 1er Génie à Paris jusqu'à la
fin de la guerre.
Il demeure alors au 81 rue d'Asnières à Courbevoie. Le 5 octobre
1921, sa femme (44 ans) et sa fille (23 ans) périssent lors de
la collision entre deux trains sous le tunnel des Batignolles (28
morts, 74 blessés. L'Humanité du 7 octobre 1921 nous indique «
En découvrant les cadavres de sa femme et de sa fille, M. Lavy
faillit être pris d'une syncope »).
Remarié le 9 novembre 1922
(Paris 18ème, à Eulalie Augustine Désirée Caillard), Gaston Lavy
meurt à Paris (12ème) le 14 janvier 1949.
La photographie de territorial figurant sur la page de
couverture du premier carnet est certainement la sienne. |
 |
Quel était réellement sa profession ?
Dans ses mémoires, il se dit « Métreur en bâtiment ».
Or, sa profession sur l'acte de mariage du 12 octobre 1897 est «
dessinateur », domicilié à Levallois-Perret, 19bis rue Danton.
L'acte de naissance de sa fille Suzanne, le 25 juillet 1898, 15
rue Poccard à Levallois, porte aussi comme profession du père :
« dessinateur ».
Pourtant, son carnet finit par « je ne suis ni peintre ni dessinateur
et n'ai jamais de ma vie pris une leçon de dessin ». Aux pages
99 et 100, Gaston Lavy nous indique qu'il envoie au ministère de
la guerre un projet de camouflage de canons, qui semble
expliquer son affectation finale à la section de camouflage :
mais les canons sont déjà camouflés (voir p. 104 : « une
batterie de 155 longs repose sous ses camouflages »), il
n'ignore pas que la section de camouflage emploie des « peintres
et dessinateurs » (p. 100), et la réponse qu'il obtient à sa
demande est « cette section m'avise qu'elle a plus besoin
d'hommes de peine que de peintres ou dessinateurs » (p. 100).
Pourquoi avoir pris tant de soins dans ses carnets à dissimuler
sa véritable profession ? Peut-être estime-t-il peu
glorieux que pour échapper aux misères du front, il ait usé du
privilège de son métier pour être sélectionné à l'arrière par
Lucien-Victor Guirand de Scevola, qui regroupe peintres et
dessinateurs au 1er Génie...
Les carnets de Gaston Lavy
La rédaction de ces carnets « Un de la territoriale 1914-1918 »,
en trois tomes est commencé en novembre 1920, et semble s'être
prolongée jusqu'à la seconde guerre mondiale. Ils sont agrémentés de
dessins dont certains croqués au jour le jour (c'est le
cas par exemple du dessin de Vého p. 62, ou d'Herbéviller p.
101).
Dans la version texte, nous avons corrigé principalement la
ponctuation, quasi absente de l'original, et quelques fautes
(notamment de grammaire), dans le seul but de rendre la lecture
plus fluide.
Car le témoignage de Gaston Lavy est une extraordinaire
description du secteur de Vého en cet hiver 1916, secteur calme
certes en terme d'attaques, mais complètement dévasté et soumis
à d'incessants bombardements.
On note (p. 78 et 79) une visite aux entonnoirs de Leintrey créés par l'explosion de quatre mines le 10
juillet 1916 : ce que voit Gaston Lavy confirme l'état dans
lequel on retrouvera les entonnoirs longtemps après guerre (voir
ainsi 1925 - Souhait d'un monument aux entonnoirs de Leintrey), mais on perçoit bien la difficulté de rétablir
l'histoire lorsque les témoignages sont indirects : ce que lui
explique le sous-officier du génie sur ces entonnoirs ne
correspond pas à la réalité. Il n'y a pas eux deux mines
explosant décalées, mais quatre simultanément, et ces « deux
compagnies de chasseurs à cheval » engloutis par la seconde
explosion est pure légende. Il n'y a aucune trace d'intervention
d'un régiment de cavalerie, et immédiatement après l'explosion,
c'est une section du 162ème régiment d'infanterie sous les
ordres du lieutenant Chotin, qui se précipite pour empêcher la
progression des Allemands.
Puis, une fois Gaston Lavy passé au 47ème régiment d'infanterie,
ce sont quelques pages sur Herbéviller (« Erbévillers ») et
Saint-Martin, mais le journal de Gaston Lavy s'arrête, puisque
parti en permission et affecté dès son retour à la section de
camouflage, il n'a fréquenté ce secteur qu'une seule journée.
CAUCHEMAR
Jambes dans l'eau et les pieds dans la boue,
Les membres las, l'âme en désespérance,
Le corps brisé de multiples souffrances,
...
Il faut tenir et aller jusqu'au bout.
Pendant quatre ans pour aller à ce bout
Nous avons tous subi cet anathème
Pas de pitié pour ceux que la mort mène
...
Morts et vivants ont tenu jusqu'au bout.
Les renforts du 20ème, rassemblement.
En avant marche...
Et sous la conduite d'un adjudant, inconnu de nous, à l'air
fermé et plutôt rébarbatif, nous nous mettons en marche dans la
vaste plaine nue, où les mares de boue jaunâtre reflètent la
marche des gros nuages amoncelés dans le ciel.
Nous avons rejoint notre nouveau régiment. Partout têtes
inconnues ; à notre équipe s'est jointe une partie de la 17ème
Cie de notre ancien bataillon, mais par malchance pour nous,
c'est la partie la moins intéressante de notre ancien groupe.
Composé de paysans de la basse Normandie, croquants n'ayant
jamais quitté leur glaise, épis, rustres, bornés, jaloux et
méchants, c'est avec une telle promiscuité qu'il va falloir
vivre maintenant. Où sont nos bons camarades du début. Enfin,
encore heureux que notre petite équipe est entière, sauf Lamuré,
notre caporal, parti dans l'autre régiment.
Après une heure de marche dans cette plaine sinistre, quelques
marches nous accueillent, c'est l'entrée d'un boyau. Dieu que ce
boyau est interminable ; on n'en verra jamais la fin. |
[p. 58]

|
VEHO - FIN SEPTEMBRE
A la tombée du jour nous sortons enfin, le boyau est terminé,
nous entrons au village. Une fausse haie dissimule les allées et
venues, nous la suivons. Vého est plus abîmé que ce que nous
avons vu jusqu'alors. L'église éventrée dresse le squelette de
sa tour décapitée mais encore debout.
C'est le sale secteur, paraît-il. A gauche de nous se trouve
Reillon, à droite Leintrey, deux très sales coins. Joli début.
A cette nuit tombante, sous les derniers rayons d'un soleil
rouge sans qui descend à l'horizon, l'aspect de ce village nous
fait passer un frisson. Est-ce l'appréhension de ce qui nous
attend ?
Parallèle à la route nous suivons un petit passage établi sur
les ruines mêmes des maisons, entre deux grands parapets de
pierres entassées et édifiées pour protéger la traversée du
village, la route sans doute étant dangereuse.
Suivant ce même passage nous passons derrière l'église et, au
bout du village, on nous indique comme campement une maison,
d'un rez-de-chaussée surélevé d'un grenier mis à nu, car la
toiture n'existe plus. Seuls trois chevrons calcinés dressent en
l'air une supplique au Très Haut, sans doute pour implorer la
charité divine.
Dans les trois pièces que comporte cette maison, il fait nuit
noire car toutes les ouvertures sont bouchées au moyen de sacs
de sable, sauf la porte bien entendu.
Des charpentes soutiennent deux étages de lits superposés.
J'entends comme lit un grillage épais tendu tout le long, sur
lequel une paille pourrie infecte et humide forme litière. |
[p. 59]
 |
Bougrement démoralisés, nous nous installons tant bien que mal
dans les coins restés libres. Le lendemain aucun ordre pour
nous. Nous en profitons pour prendre contact avec le village.
Complètement démantelé, ce n'est qu'une suite de ruines qui
borde la grand-rue. Aucune maison debout, si ce n'est de grands
pans de murs déchiquetés qui laissent passer le jour par leurs
ouvertures béantes.
Le surlendemain, nous sommes en route dès le matin pour aller
faire des travaux de réparation en première ligne, dans les
tranchées en mauvais état.
A l'extrémité du village, une déclivité du terrain permet le
passage au grand air, jusqu'à l'entrée d'un boyau qui conduit
aux tranchées. C'est le boyau de Belgique, deux kilomètres de
long, et l'on débouche en première ligne. Au cours de nos
travaux, nous prenons contact avec les occupants de ces
positions. C'est un régiment d'active dont la Cie qui est en
ligne ne tarit pas d'éloges pour son capitaine qui, tout jeune,
parait à peine vingt deux ans. C'est un as, disent les hommes «
vous parlez d'un mec qui a du cran ». Effectivement, il y a
trois jours, au cours d'un bombardement intensif, je l'ai vu
grimper d'un bond sur le talus, et sans souci des marmites qui
arrivaient en trombe, braquer |
[p. 60]
 |
sa jumelle et inspecter longuement la plaine avec un sang-froid
imperturbable. Ceux là sont vraiment des officiers. Quel écart
entre eux et les nôtres.
Retour d'une corvée ; reste en arrière avec Gouachet. L'envie
nous prend de jeter un coup d'oeil hors du boyau. Grimpant sur
les clayons, nous voyons une multitude de trous d'arbres
décapités à demi brulés indiquant qu'à cet endroit était un bois
ou une forêt.
Quel spectacle lamentable. Sous un ciel gris sale, la terre
noirâtre est toute calcinée, fouillée de trous et d'excavations
remplis d'une eau jaunâtre. Les quelques futs d'arbre encore
debout dressent vers le ciel leurs pauvres bras desséchés,
semblant crier miséricorde.
Paysage de guerre, image de désolation où la furie de détruire
s'imprime en cette nature désolée. Terre, tu souffres toi aussi
en tes entrailles de cette tuerie.
Presque régulièrement, un quart d'heure avant de descendre pour
la corvée de soupe, les artilleurs, je ne sais sur quel ordre
sonnent les boches ; cela dure environ vingt minutes.
La réaction ne se fait pas attendre, et comme nos boyaux doivent
être repérés, il faut à tout moment s'accroupir contre le talus.
Le bout du boyau n'étant plus clayonné les débris tombent dans
les gamelles à soupe, et cette terre n'étant pas comestible, il
en résulte que le rata est loin d'y gagner, indépendamment du
danger de se faire bouziller. |
[p. 61]
 |
En rentrant des lignes ce soir, profitant de quelques moments de
jour, je pars prendre un coin du village. Un peu en arrière de
l'église, je termine de faire le croquis ci contre, lorsque
j'entends un sifflement caractéristique. Je me colle contre le
talus. L'obus vient éclater sur une pile de gravats. Ai-je été
le jouet d'une illusion, mais j'ai distingué en une vision
rapide la forme oblongue de l'obus.
Peut être étant à son point de chute, ai-je pu en effet le
distinguer l'espace d'un millième de seconde. En tous cas si je
l'ai réellement vu, le cas n'est pas banal.
Je n'attends pas le second projectile et me glisse dans un abri
proche où m'ont précédé quelques poilus et un capitaine. Les
rafales de mitraille continuent, et sans doute très proches, car
l'abri tremble sur ses bases. Cela dure vingt minutes puis tout
cesse. Nous remontons. C'est l'heure de la soupe et je regagne
ma charmante crèche.
Quinze jours se passent ainsi, puis brusquement m'arrive la pire
des choses à laquelle je pouvais m'attendre. Tous mes camarades
de notre petite équipe sont nommés téléphonistes au régiment. Je
reste seul sur le carreau. Je ne sais qui a procédé à ce choix.
Nous étions cinq il ne fallait que quatre hommes on a pris par
lettre alphabétique.
Le lendemain matin ils me quittent pour aller prendre leur
poste. Ce n'est pas sans un déchirement que je me retrouve seul,
tout seul maintenant au milieu de tous ces paysans en lesquels
je devine plus des ennemis que des amis. Plus de sincères
camarades, plus de réconfort, mais des mines chafouines qui me
regardent en dessous. Les camarades ont bien promis de s'occuper
de moi et de me faire nommer à la première vacance, mais quand
?... |
[p. 62]
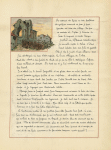 |
SOLITUDE -DECEMBRE
Mes camarades partis, je reste bien seul.
Comme les souffrances vont me paraitre dures à supporter. Les
Normands me regardent en dessous d'un petit air narquois, et
semblent heureux de ma déconvenue. Ils ne me disent rien, mais
je sens leur hostilité dans le regard et certes, il ne faudrait
pas que j'ai besoin d'eux ; et c'est pourquoi je suis si seul.
La bise est venue. La pluie tombe chaque jour. Nous sommes gelés
dans notre maison. Les baies sont bien bouchées avec des sacs à
terre, mais non suffisamment pour éviter les courants d'air, et
les vents coulés s'infiltrent à plaisir dans les interstices.
D'ailleurs pas suite des allées et venues continuelles, la porte
est constamment ouverte.
Les premiers jours de pluie, nous n'avons pas été incommodés à
l'intérieur. Quoique la toiture soit absente, le grenier est
abondamment garni de foin, lequel absorbe la pluie. Mais au bout
de quelques jours, ce foin saturé d'eau laisse filtrer la pluie
qui macule le plafond de grandes tâches brunes. Bientôt |
[p. 63]
 |
les gouttes apparaissent, se condensent et se mettent à tomber,
d'abord en quelques endroits, puis ensuite un peu partout, et
cette eau qui a traversé ce fourrage pourri s'écoule en gouttes
noirâtres, mixture répugnante.
Entassés dans ces trois pièce, impossible de trouver un coin
pour s'asseoir. Aussi, on mange debout. L'eau sale du plafond
tombe dans les gamelles, sur le pain. On s'écarte pour éviter
une goutte, deux autres éclaboussent le rata, et on finit par ne
plus y faire attention. Bah... ca colorera le bouillon. Quant au
café, comme c'est de la même couleur, si ca n'améliore pas le
goût, ca augmente la quantité.
En général le repas est vite expédié car la nourriture est en
concordance avec le logis. Depuis huit jours nous touchons
invariablement des lentilles, lesquelles pourraient être très
comestibles si elles ne contenaient pas une quantité exagérée de
menus cailloux qui craquent sous les dents. Comme les cailloux
sont en nombre au moins égal aux lentilles, sinon plus,
impossible d'y mettre la dent et c'est la rage au coeur et la
faim au ventre que nous allons vider notre gamelle dans le trou
aux ordures pour le plus grand bien des rats.
Notre repas se compose alors d'une boîte de sardines ou de pâté
et du traditionnel jus, et quel jus, plus clair que celui qui
tombe du plafond.
Comment pouvons-nous tenir avec une telle nourriture : je me le
demande. |
[p. 64]
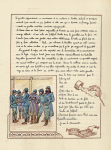 |
TOTO
Il vient d'arriver quelques hommes en renfort. Parmi eux, un
grand gars, sec, noueux, le képi de travers, l'air passablement
gouape et qui dès le début s'impose parmi nous. Paraissant doué
d'une force peu commune et d'un caractère du moins patient,
après quelques engueulades et menaces de bagarre les normands
mâtés le craignent comme le feu.
J'en ai fait mon copain.
Oh, il n'y a aucun rapport entre lui et les bons camarades
partis, mais malgré ses allures de voyou, je le sens d'une autre
pâte que les croquants de la Manche. D'ailleurs lui même, dans
sa jugeote de gavroche, les a jugés et s'est tourné vers moi.
De ce fait l'air hostile des Normands vis à vis de moi s'est
fortement atténué. Le Copain les fait réfléchir.
Enfin j'ai quelqu'un à qui causer.
Natif d'Epernay, il se dit caviste. Je le crois plutôt
contrebandier ou braconnier peut être les deux.
En effet, quelques jours d'intimité, et dans son langage trivial
et argotique il me raconte ses pêches à la lanterne et ses
poursuites dans la nuit avec les gendarmes au cul.
Dans ce cantonnement infect et glacial, couchés côte à côte sur
la paille pourrie, ce sont de longues histories souvent
amusantes, qui sont de puissants dérivatifs à mes idées noires.
Je devine sous sa rude écorce une âme simple mais un bon coeur.
Avec ces pluies continuelles, cette habitation déplorable, ces
visages fermés autour de moi, je me laisserai aller à la plus
noire mélancolie si je n'avais ce brave Toto pour me soutenir,
ses nombreuses anecdotes pour m'occuper l'esprit et sa franche
camaraderie comme réconfort.
Grande gouape, bon type, cher Toto, comme je béni le hasard qui
t'a fait échouer auprès de moi. |
[p. 65]
 |
BAIN DE PIED
Oh merde alors... comme bain de pied je crois qu'on est fadé.
Et Toto, pataugeant dans cette eau jaunâtre qui nous monte au
dessous du genou, s'est tourné vers moi comme pour me prendre à
témoin.
Le fait est, lui-dis-je, que comme bain de pied on ne devrait
trouver mieux.
Nous sommes partis après la soupe pour réparer une nouvelle
tranchée inoccupée.
Empruntant le boyau de Belgique nous avons bifurqué à gauche et
suivi un nouveau boyau aussi long que ce dernier. Bien clayonné
au début, le milieu et la fin s'avèrent en piteux état. Les
terres éboulées, les caillebotis noyés dans la boue, c'est un
désastre.
Nous voici dans la tranchée à réparer en question. Comme
réparation en effet le travail ne manque pas, elle est
complètement envahie par les eaux.
Se trouvant en contre bas du boyau, elle a du être noyée par les
infiltrations.
Avec nous pas de chefs, si ce n'est quelques sous-officiers qui,
sans ordres, attendent qu'il leur en parvienne.
Nous somme tous les jambes ankylosées dans cette eau glacé,
situation saumâtre, car comme dit Toto même pas moyen de battre
la semelle.
Il y a exactement une demi heure que nous somme là à attendre et
rien ne vient. Nous avons suivi la tranchée espérant trouver un
endroit sec |
[p. 66]
 |
mais ceci en pure perte. Elle est partout dans le même état.
Encore un quart d'heure, puis un autre, toujours pas d'ordres.
On commence à la trouver mauvaise lorsqu'enfin, après dix
nouvelles minutes, un officier du génie fait son apparition.
Gagnez les abris tout de suite, nous dit-il, notre artillerie va
faire des tirs d'essai et l'ennemi fera surement réaction ; et
il nous guide vers un grand boyau parallèle à la tranchée
inondée.
C'est un grand couloir boisé, bien propre et camouflé, c'est à
dire couvert d'une toile de jour avec découpures simulant le
feuillage à travers lesquelles nous apercevons le ciel gris et
bas.
L'officier qui vient de nous indiquer les abris disparait ;
aussitôt tous les polis s'éparpillent dans la direction de ces
abris.
Je cherche Toto. Je ne le vois pas.
Où est-il passé cet animal ? J'ai beau l'appeler, pas de
réponse. Me voyant seul, je me dirige vers l'abri où j'ai vu
tout à l'heure s'engouffrer un sergent de chez nous et ses
hommes.
Puisqu'on va faire des tirs d'essai, nous ne verrons pas mais du
moins nous entendrons. |
[p. 67]
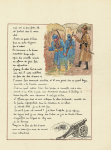 |
TIRS D'ESSAI ET REACTION
De moins en moins partisan de m'enfermer dans un abri, je suis
descendu quelques marches et j'aperçois dans le coin le plus
obscur le sergent qui n'a pas l'air de briller par le courage.
Il me fait signe de venir le rejoindre, mais sans souci de son
injonction, je remonte au contraire sur la dernière marche où
j'y trouve un tout jeune caporal d'infanterie. Nous lions
conversation.
Il m'apprend qu'il est incorporé de la dernière classe. C'est le
fils du Général Anthoine commandant l'armée du Nord.
J'étais loin de supposer à ce moment que plus tard, en Belgique,
j'aurai à faire à son père.
On dit que bon sang ne peut mentir : en effet ce jeune blanc bec
à l'air d'avoir un beau courage et n'engendre pas la peur. Il
paraît très simple et ne semble tirer aucune vanité d'être si
haut apparenté.
Un quart d'heure se passe, puis quelques coups de canon
résonnent, mais si peu inquiétants que le sergent et quelques
hommes quittent le fond de l'abri et montent quelques marches.
J'ai moi même envie de quitter la place, quand une détonation
formidable ébranle la terre. Comme une nuée de lapins, le
sergent et ses hommes dégringolent au fond de l'abri. |
[p. 68]
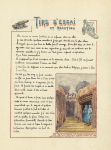 |
Je reste abasourdi par cette terrible dénotation. Jamais, même à
Verdun, je n'avais entendu pareil vacarme. Ils nous sonnent avec
des torpilles, me dit le jeune caporal, toujours aussi
imperturbable car lui et moi n'avons pas bougé et sommes seuls
au bord de l'abri.
Il pense comme moi que sous une pareille charge d'explosifs cet
abri ne résisterait pas. A chaque arrivée de ces grosses
torpilles, nous nous contentons de tressaillir et de courber la
tête.
Si le tir d'essai de notre artillerie a été modeste, la réaction
allemande est bougrement corsée. Leurs Minenwerfers ne cessent
pas le feu, c'est un roulement continu avec des explosions
infernales. La terre tremble et l'abri répercute un bruit de
tonnerre. C'est littéralement terrifiant.
Cela dure une heure mais combien cette heure nous a paru longue.
La chute des grosses torpilles cesse et fait place au
bombardement ordinaire. On s'en trouve soulagé comme si ce
dernier était normal. Il est tout aussi meurtrier mais agit
moins sur les nerfs.
Il est trois heures : c'est le moment de descendre au village
pour la soupe de 4 heures. J'en fais part au sergent mais il ne
se soucie pas de partir avant la fin du bombardement.
Mais si ca dure toute la soirée, lui dis-je, mais comme je le
vois buté, je n'insiste pas, car d'après son état et sa face
blême, je juge que ca serait inutile ; et avec trois types moins
craintifs nous décidons de ne plus attendre et de descendre à
Vého. Nous laissons donc le sergent qui nous adjure de rester,
et sans nous soucier de son ordre, nous filons.
Le jeune caporal qui, amusé, a assisté à cette petite scène part
lui aussi, et en souriant, il me serre la main et part dans une
autre direction. |
[p. 69]
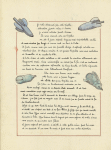 |
RETOUR
Nous descendons le boyau. Un sifflement passe. Une courbette au
long du talus et la marmite passe en avant de nous. Une autre
arrive sur la gauche. Nous prenons le pas de course.
Second tournant, nous somme arrêtés ; le boyau est bouché.
L'avant dernière marmite est tombée juste là.
Accroupis nous grimpons le talus, crac, un fusant éclate
heureusement plus loin que nous puis, un obus un peu à droite.
Nous faisons corps avec la terre pour offrir moins de prise aux
éclats. Serrant les fesses nous n'en menons pas large, et à part
soi on se demande si nous sortirons intacts de ce funeste boyau.
Enfin l'éboulement est traversé sans accrocs ; nous respirons
mais nous venons d'avoir quelques minutes d'émotion. |
[p.70]
 |
| |
[p. 71-72 à supprimées par Gaston Lavy] |
Plus loin nouvel éboulement mais moins grave à franchir car le
tir est allongé. Ca doit tomber maintenant au bout du boyau. Ca
va être pour nous tout à l'heure ; aussi, on hésite à avancer...
mais quoi, ici ou là bas, si on doit y rester, c'est bien kif
kif... et nous reprenons notre marche le corps cassé en deux.
Le tir s'espace et nous franchissons enfin les derniers cent
mètres pour déboucher près de la route où sont installées les
roulantes de l'active.
Ici au moins on peut se redresser ; nous sommes à l'abri d'un
haut talus où, comme seule marmite, il n'y a que celle du
cuistot, laquelle est beaucoup plus sympathique.
Nous apprenons que le village lui aussi a été sérieusement
sonné. Il y a eu de la casse. Effectivement quand nous y
arrivons plusieurs corps sont déjà déposés dans l'église en
attente des cercueils que fabriquent les sapeurs.
Sur notre route un brancard est posé à terre.
Sur cette civière une face hilare... nous interrogeons «
qu'est-ce que tu as toi »
Le rire s'accentue et le blessé nous répond « Tu parles vieux,
de la bonne blessure, un éclat dans la cuisse. Juge si je suis
verni. » Et nous le voyons partir avec envie enlevé par les bras
robustes de deux brancardiers.
Le soir à 6 h le sergent resté dans l'abri rentre |
[p. 73]
 |
avec sa section. Ils ont attendu le dernier coup de canon pour
sortir de leur trou. Ils ne trouvent qu'un restant de soupe
froide et immangeable. Toto, qui lui, le sacré bougre, était
rentré bien avant nous, les charrie gentiment c'est à dire à sa
manière gouape mais ils ne répondent rien.
NOUVEAU VISAGE
Nous sommes gratifiés d'un nouveau sergent. Il est arrivé hier.
Bonne figure, longue moustache, il a l'air bon frère.
Au bout de trois jours nous nous connaissons mieux. C'est un
employé aux Finances. Pas sot du tout, mais affligé d'un
terrible défaut. Il a un goût immodéré pour la dive bouteille,
en l'occurrence pour le bidon de deux litres, et les jours de
pinard remboursable, nous le trouvons ivre mort sur sa paille.
Dommage, car au demeurant c'est un charmant garçon.
Nous avons sympathisé dès les premiers jours et c'est pour moi
un réel plaisir d'avoir quelqu'un avec qui converser, car Toto
est bien gentil mais un tantinet trop simple et trop trivial.
Cependant, à eux deux nous formons un petit groupe qui se
détache de la mentalité par trop terre à terre des Normands.
Je catéchise fort souvent cet aimable ivrogne, mais il m'avoue
humblement ne pouvoir se corriger. Cela lui a fait d'ailleurs
beaucoup de tort dans sa carrière de fonctionnaire.
Je me retrouve donc en compagnie, mais au cantonnement
seulement, car aux travaux, Toto ne fait pas partie de la même
équipe que moi ; quant au sergent en question, je ne sais pas
comment il s'arrange, mais comme il est en surnombre, je ne le
vois jamais de service. Encore un qui se débrouille. |
[p. 74]
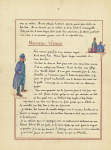 |
AMBIANCE
D'après de nouveaux ordres le travail du jour a cessé. Nous
allons maintenant marcher de nuit. C'est hier soir que nous
avons commencé un nouveau service.
Par un froid très vif et une pluie battante, nous avons suivi la
grande route et faisant un léger crochet, nous trouvons face aux
roulantes un dépôt d'outils. La traditionnelle pelle-pioche, et
chacun muni d'un de ces ustensiles, nous reprenons la route.
C'est le travail de terrassier qui va recommencer. Que de mètres
cube de terre auront été remués dans cette guerre. Suivant la
route qui dévale dans un vallon, nous traversons une rivière sur
un pont de bois, lequel pont doit être bien repéré par l'ennemi
car de nombreux trous d'obus l'encadrent de toute part.
Ensuite le terrain remonte une pente douce et après une demi
heure de marche, un boyau s'amorce dans lequel on s'engouffre en
file indienne. La montée s'accentue, le cheminement est dur dans
ce boyau si raide, et malgré le froid et l'humidité on est en
nage. |
[p. 75]
 |
De temps en temps une fusée éclairante lancée par les Allemands
colore le ciel d'une lueur blafarde, projetant ses nombreuses
étincelles qui s'éparpillent au fur et à mesure de la descente
de la fusée.
Nous montons toujours ; dans un recoin une masse sombre attire
notre regard : dans un réduit de terre une sorte de petite pièce
couverte d'une bâche laisse passer un fin canon qui dresse sa
pointe vers le ciel. C'est un lance fusée qui est pour le moment
en inaction.
Au bout du boyau, arrêt, nous sommes arrivés, on grimpe le
talus. La pluie a cessé mais nous sommes trempés.
Des ordres chuchotés passent d'homme à homme. « Ne pas se
déséquiper, garder son fusil à portée, éviter les claquements
d'armes et se coucher à chaque fusée éclairante. »
L'ouvrage est tracé il n'y a plus qu'à commencer une nouvelle
tranchée. |
[p. 76]
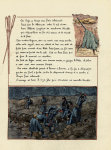 |
Dans le silence de cette nuit, troublé par le seul bruit des
pelles et des pioches et de nos respirations haletantes,
quelques coups sourds éclatent au loin. Au fur et à mesure que
les travaux s'avancent la terre s'amoncelle sur les parapets.
Une fusée monte en l'air dans un sillage lumineux puis éclate de
mille gerbes et la chandelle blanche descend en zigzaguant.
Tout le monde est couché. Soulevant légèrement la tête je jette
un regard dans la plaine.
Quel tableau.
Cette rampe de terre grise qui dévale jusqu'à l'horizon étale
sous la clarté de la fusée des tons de cendres ; ça et là
quelques piquets à moitié enterrés dressent leurs têtes
embroussaillées de volutes barbelées. De multiples taches brunes
accusent les contours de nombreux trous d'obus dont les blocs de
terre en saillie se sertissent d'une ligne blanchâtre.
Un silence lugubre et glacial. Aucune vie ne semble exister à la
surface de ce décor funèbre. De la terre, rien que de la terre
remuée, fouillée et à la lueur de cette fusée tremblante, ce
spectacle n'a plus rien de réel et fait penser à une vision
lunaire ou à quelque planète inconnue.
Ce silence pesant qui lui même enveloppe cette scène est
agressif, plein de réticences, le léger souffle qui balaye ce
vallonnement charrie du danger. On ne sait pourquoi les doigts
se crispent sur le sol, le coeur chavire. |
[p. 77]
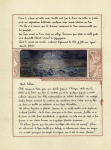 |
Cela dépasse en tragique l'entendement humain.
Pourquoi...
Ce n'est après tout qu'une colline de terre dont nous entamons
les flancs comme nous l'avons fait déjà si souvent dans la
Meuse.
Simplement de la terre remuée.
Pourquoi cette ambiance de mort me prend-elle si au coeur et à la
gorge ? Pourquoi ce coin de terre si normal en somme,
emprunte-t-il à mes yeux une telle ampleur tragique ?
N'avons nous pas fait d'autres fois et dans d'autres lieux de
semblable labeur ?
Pourquoi cette emprise de frayeur sourde ?...
Sous cette terre que nous foulons un lent travail de destruction
est en cours qui, d'un moment à l'autre, menace de nous
anéantir.
Sou cette terre que nous foulons, à une cinquantaine de mètres
en contre-haut s'ouvre un cratère. Immense entonnoir, sombre
charnier, terrible fosse commune où s'empilent pèle mêle de
nombreux cadavres.
A cinquante mètre de nous est un gouffre béant qui a dévoré
trois cents hommes. |
[p. 78]
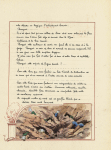
|
GUERRE DE MINE
L'Entonnoir
Tu n'as pas vu l'entonnoir ?
Ma foi non, j'ignore même qu'il y en ait un. Nous venons ici
chaque nuit, mais ne bougeant pas des tranchées en cours
d'exécution, j'ignore tout du secteur.
Eh bien vieux, je vais te faire voir ça, viens. Et le
sous-officier du génie me fait signe de le suivre.
J'ai fait sa connaissance cette nuit même. C'est lui qui dirige
les travaux que nous exécutons et au cours de quelques paroles
échangées, j'apprends qu'il est parisien et, qui plus est, comme
moi du bâtiment et métreur en électricité. Heureux de se
retrouver entre collègue nous parlons métier, puis des
événements actuels et enfin du secteur où nous sommes.
C'est ainsi que j'apprends que sous nos pieds s'effectue un lent
travail souterrain. Des êtres tels des termites fouillent le sol
en longues galeries. La colline où nous travaillons est minée de
toute part et que d'un moment à l'autre cette colline pour
sauter... et nous avec. Charmante perspective.
En rampant nous gagnons une éminence un peu à notre gauche. Je
vois bientôt un rempart de terre accumulée. En reptations lentes
et continues nous arrivons aux lèvres de cet entonnoir. |
[p.79]
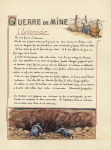 |
Enorme creuset sur les pentes duquel la terre éboulée forme de
vastes sillons, d'où sortent des choses informes qu'on ne peut
pas dans la nuit identifier.
Ce sont des bras, des jambes, des torses, des crânes à demie
ensevelis dans ce chaos monstrueux et sinistre.
Une fusée éclairante s'élève. Vite à plat ventre, me dit mon
guide. Je n'ai pas besoin de cette recommandation et tous deux
la tête enfouie sous les bras, nous ne remuons pas plus qu'une
souche ; et pour cause, les boches sont de l'autre côté de la
crête.
La pénombre revenue, nous redescendons courbés en deux la pente
de l'entonnoir, et lorsque cachés par la déclivité du terrain
nous pouvons nous redresser, il me fait l'historique de ce
cratère.
Il y a quelques mois les allemands avaient établi deux fourneaux
de mine, et le moment venu les firent exploser. Aussitôt une
compagnie Bavaroise s'élance pour occuper les lèvres. De notre
côté deux compagnies de chasseurs à cheval, cavaliers
transformés en infanterie, se précipitent elles aussi pour
s'incruster sur l'autre bord.
Sur les deux mines une seule avait explosé. L'autre pour une
cause inconnue avait eu du retard. C'est à ce moment qu'elle
sauta provoquant une nouvelle explosion, qui, en agrandissant
l'entonnoir, enterra les trois cents hommes dans |
[p. 80]
 |
un pèle mêle affreux.
Actuellement les lèvres de cet entonnoir sont occupées sur notre
front par une section de fusils mitrailleurs, espacée dans des
alvéoles creusées à la hâte et formant une chaine de
tirailleurs, lesquels n'y séjournent que la nuit.
En face, la seconde portion des lèvres est aux mains des
allemands.
En somme, les nouvelles tranchées que nous creusons en avant des
anciennes représentent l'avance conquise par l'explosion de
l'entonnoir, soit environ cent mètres. C'est à peu près la
proportion gagnée par la guerre de mine, et cela représente
quatre à cinq mois de labeur acharné.
Travail de titans pour gagner quelques mètres... Curieuse guerre
!
Toutes ces explications m'étant données par mon collègue, nous
coupons la colline en droite ligne, et après une descente qui
dure environ cinq minutes, une grande excavation nous accueille.
C'est l'entrée de la mine.
LA SAPE
Des marches taillées à même le sol et maintenues par des
contremarches en bois, bloquées par de gros piquets qui les
coincent, nous offrent une descente assez rapide. Le boisage est
fait au moyen d'arbres très grossièrement équarris. Un palier
nous arrête.
En contre haut de trois marches, une excavation éclairée d'une
bougie fichée en terre, dont la lueur tremblotante laisse
deviner un corps allongé.
Je m'approche. C'est un sergent du génie qui un micro à
l'oreille est à l'écoute.
- Ils grattent toujours, demande mon compagnon.
- Oui, répond l'homme accroupi et c'est heureux pour nous. |
[p. 81]
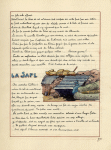 |
C'est un poste d'écouteur. L'appareil de transmission est relié
par un fil à la terre et muni de son micro. Le sous officier
écoute et guette le lent travail des allemands qui besognent
sous lui.
Il nous a fallu, m'explique mon petit guide, que nous
établissions une contre mine au dessous des leurs, tu vas voir
ce travail, et nous continuons la descente. Mon dieu, que de
bois enterré pour boiser tout ça ; des forêts entières ont du y
passer.
Cette descente est tellement longue que je me demande si nous en
verrons le bout.
Enfin au bas des marches un couloir s'avance. Nous sommes à
trente mètres du sol, me dit le jeune sergent.
Trente mètres ça me parait fabuleux. N'exagère-t-il pas ? Il est
vrai que depuis le temps que nous descendons...
Au bout du couloir un sapeur est accroupi, et une truelle à la
main, il gratte sans bruit emplissant de terre des sacs qu'une
corvée monte vider sur le talus pour redescendre les sacs vides.
Quel travail, et comme je comprends que de nombreux mois se
passent avant qu'une mine soit établie et en état de sauter. Ce
qui fait dire à ceux de l'arrière « mais qu'est-ce qu'ils
foutent au front, ils ne bougent pas. »
Et à nouveau, je me dis en moi-même : « Quelle curieuse guerre » |
[p. 82]
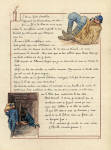 |
TENTATIVE DE CHAUFFAGE
La neige a fait son apparition et le thermomètre est descendu de
plusieurs degrés. Nous avons si froid que ce matin, Toto et moi
décidons coute que coute de faire du feu dans la maison. Deux
autres poilus plus dégourdis que la masse se joignent à nous.
Pas de cheminée, pas de poêle, pas de foyer, il faut imaginer
quelque chose.
Dehors le matériel agricole abonde, mais comme ustensile de
chauffage, il y a pénurie. Le siège d'une herse représente assez
bien une grille. Nous la scellons dans le mur au moyen de tiges
de fer coincées. Nous voilà en possession d'un foyer. Reste le
bois. Il y en a, certes, mais enfoui dans les moellons et
recouvert de quelques vingt centimètres de neige.
Dans la plaine nous avisons un petit arbre. Abattu aussitôt,
transporté à pied d'oeuvre, il est débité en rondins.
L'allumage est plus laborieux. Après une heure d'effort, ce bois
commence à prendre, mais étant vert et de plus tout mouillé, il
dégage une fumée telle qu'il est impossible de tenir. C'est pire
que le froid. Tous les types rouspètent et il faut l'autorité de
Toto et ses menaces pour éteindre toute révolte. C'est que ce
sacré Toto est bâti en force et en état de calmer les plus
récalcitrants.
Tout le monde est sorti, le dedans est intenable. Enfin la sève
et l'humidité du bois étant évaporées |
[p.83]
 |
le bois veut bien bruler, mais ne produit qu'une chaleur
relative car il faut être sur le foyer pour sentir un tant soit
peu de bien-être.
Qu'importe, nous sommes contents du succès, succès d'estime de
notre part, car à défaut de bois sec il nous faut abandonner ce
mode de chauffage, et les jours suivants nous grelottons de
nouveau.
BRONCHITE
Je suis en possession d'un fort rhume qui tourne à la bronchite.
Je tousse éperdument ce qui m'attire, à nos travaux de nuit, les
pires insultes des travailleurs qui craignent que je les fasse
repérer car l'ordre est toujours de ne faire aucun bruit. J'ai
beau étouffer ma toux avec mon cache-nez, rien n'y fait, et je
me vois forcé d'aller à la visite. Si j'allais avoir la chance
d'être évacué...
Résultat de la visite : ventouses, exempt service et deux
comprimés que l'infirmier me remet pour prendre tout à l'heure,
mais pour l'évacuation, bernique. Il faut pour cela avoir un
degré de fièvre que nous n'atteignons pas car trop anémiés.
Je voudrais que mon cas s'aggrave pour sortir de là. Je ne puis
couper aux ventouses, mais les comprimés je me garde de les
prendre et les balance, puis je reviens m'étendre sur la paille
humide de notre boîte à courants d'air où j'y reste frigorifié
toute la nuit.
Dans des conditions d'hygiène impossible, dans l'humidité, les
courants d'air et un froid continuel, sans autres soins que
quelques jours de ventouses, sans doute vexé d'être traité par
le mépris, mon mal m'abandonne.
Allons, il est dit que je dois continuer le cauchemar. J'ai un
cafard monstre, pas de nouvelles des bons copains, et une seule
perspective : finir la guerre ici, à moins qu'un obus... ? |
[p. 84]
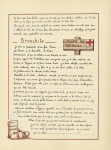 |
BEUVERIES
L'ivrognerie règne en maitresse, c'est un fait. Pas de jour où
les conversations ne s'aiguillent sur la gnôle, le bouillage de
cru, les pommes et le calvados. On voit alors la face de ces
bons Normands s'épanouir et les yeux pétiller. Près de moi un
vieux pêcheur de la côte m'entretient souvent de ses
embarquements, qui ne se font que dans un état d'ébriété total.
Il est heureux de me détailler ses soulographies, et celle de
ses aides, mais nous venons d'avoir un exemple typique de ces
intempérances dont tous ces individus sont fiers. Un gros
gaillard à face rougeaude qu'à St Cyr, et je ne sais pourquoi
d'ailleurs, on avait surnommé « Von Kluc », s'est installé dans
un petit réduit qui donne dans le couloir de notre habitat.
Ces jours ci il a reçu un colis comportant un litre de calvados.
Au lieu de le partager avec ses camarades comme nous aurions
fait, il s'est vautré sur sa paille et s'est mis à boire jusqu'à
extinction du litre. Il est resté trois jours ivre mort au
milieu de ses déjections et excréments. Le quatrième jour, il
s'est réveillé et s'est senti pas très d'aplomb. Je vais à la
visite, a-t-il dit. Le plus fort c'est qu'il a été reconnu
malade, comment donc, et exempté de service deux jours. Beauté
du service médical règlementaire. Ses copains ont trouvé tout
cela très naturel.
Leurs conversations ne portent que sur leurs beuveries et plus
d'un se vante de ne pas dessouler durant toute leur permission.
Ces propos si terre à terre ne sont guère pour me remonter le
moral et je ne cesse de regretter amèrement le départ de mes
bons camarades dont je n'ai aucune nouvelle. |
[p. 85]

|
TRAVAUX FORCÉS
Sur nouvel ordre nous avons abandonné à un autre groupe le
travail des tranchées, et sommes mis à la disposition du génie
pour les corvées de transport du matériel nécessaire aux travaux
de mine. Chaque nuit ce sont, dans un terrain bouleversé, dans
une boue épaisse et gluante qui vous emprisonne les pieds, ou
sur un verglas terrible, qu'il faut transporter sur des
distances d'un millier de mètres des charges effarantes.
D'abord un paquet de rondins, soit une dizaine de pieux de deux
mètres gros comme un poing. C'est le moins pénible. Le lendemain
ce sont des rails de chemin de fer, puis des éclateurs, en
l'espèce blocs de ciment armé de soixante-dix centimètres carrés
et de vingt centimètres d'épaisseur, qui doivent chacun peser
dans les cinquante à soixante kilos.
A la corvée d'hier soir, il y avait sur la note du génie,
transport d'un tas de rondins ; nous les cherchons mais en vain,
nous en référons au caporal chef du génie qui nous indique un
monceau de troncs d'arbres de près de quatre mètres de long sur
quarante centimètres de diamètre.
C'est pas les rondins, alors ça va pas mieux.
Nous nous mettons à douze pour les coltiner. Représentez-vous
douze types pliant sous une telle charge |
[p. 86]
 |
montant cette colline où les pieds glissent dans la boue et vous
échappent à chaque pas, où dans la nuit noire ceux de devant
s'enfoncent dans les trous et ornières, les continuels détours
pour éviter les trous d'obus, seulement visibles par le reflet
de l'eau dont ils sont pleins, buttant contre mille obstacles :
piquets, madriers, bobines de barbelés, etc... ou lorsque deux
d'entre nous s'enfoncent dans un trou, la charge augmente pour
les autres, le passage des tranchées sur un caillebotis, petite
passerelle de soixante centimètres de large où la boue accumulée
forme un dos d'âne dangereux, la pente du terrain qui augmente
la charge de ceux qui sont à l'arrière, les cris, les
imprécations pour ce travail au dessus des forces humaines, et
vous aurez tant soit peu l'idée de ce travail titanesque.
Pour corser ce travail infernal, les obus tombent à droite et à
gauche. Mais ce bombardement peut-il aggraver nos efforts et
notre peine ? Non, car les larmes aux yeux, la rage au ventre,
les chairs meurtries, nous espérons la marmite qui viendra nous
broyer sous sa masse. Le bombardement, nous le désirons, mais
sur nous. Crever, crever une bonne fois, et que ca soit fini de
ce cauchemar, de cette galère.
Oh, une nuit seulement comme celle là pour ceux qui, à
l'arrière, confortement installés dans leur vie bourgeoise, nous
crie « jusqu'au bout, on les aura. »
Cinq heures de travail titanesque et nous ne sommes plus que des
loques. Le sergent du génie arrive et nous engueule. Il a en
main le compte-rendu du travail de la nuit que lui a remis le
caporal et qui comporte « transport de huit rondins ». Furieux,
il nous agonise de sottises. Il y aurait de quoi le bouffer, les
pauvres types ne disent rien.
Exaspéré, j'élève la voix, je proteste et emmène le sergent voir
les soi-disant rondins. Il reconnait qu'il y a eu erreur
d'interpellation et se calme, et |
[p. 87]
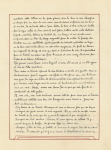 |
me montrant le compte-rendu qu'il tient à la main, il me dit :
« Vous avez raison, mon vieux, mais c'est moi qui vais me faire
engueuler. Le lieutenant, lui, est dans sa cagna ; il a marqué
sur le rapport « transport de rondins » et ne voudra pas en
démordre. J'aurai beau lui dire qu'au lieu de rondins ce sont
des arbres, il verra simplement qu'il y en a eu huit de
transportés dans la nuit et que nous n'avons rien foutu. Voilà
ce qu'il constatera et ça c'est bien militaire. »
Ecoeuré et à cran, je lui réponds : « si votre lieutenant était
ici à voir les travaux au lieu de rester dans sa cagna, il ne
rouspéterait pas tant. Mais chez vous, c'est comme chez nous :
ce sont les sous-officiers qui marchent tout le temps, et ce
sont les officiers qui touchent la solde. »
Oui mon vieux, c'est comme ça, et il n'y a rien à faire, me
dit-il en s'en allant. Rompus, les os brisés, nous regagnons
Vého.
AVATAR
Chaque soir, ces corvées atroces se renouvellent. Hier en
portant une longue planche, j'ai glissé et suis tombé dans un
trou d'obus où j'avais de l'eau jusqu'au ventre et de la boue
jusqu'au genou. Deux poilus m'ont aidé à me tirer de ce trou, ce
que je n'aurai pu faire moi-même. J'étais tellement à cran que
j'ai tout lâché, corvée, matériel, section, etc, etc. |
[p. 88]
 |
suis rentré seul à Vého, glacé par ce bain forcé. Dans la nuit
personne ne s'est aperçu de mon départ. Je soupçonne d'ailleurs
une bande de tireurs au flanc de se planquer chaque soir dans
quelque trou, car au cours de nos transports, ce sont toujours
les mêmes types que l'on voit, et certaines physionomies restent
invisibles. Je n'ai pas été seul à m'en apercevoir, car les
caporaux, sans doute avertis, font la chasse, et depuis trois
jours nous nous trouvons plus nombreux que précédemment.
Nous les engueulons copieusement, mais quoi, dans le fond, nous
les envions d'avoir le culot de la faire, c'est tellement
humain, et puis ces travaux sont si rudes.
A titre indicatif, voilà comment se compose une entrée de sape
comme celle où nous sommes employés :
1° Un rang d'arbres de quarante centimètres de diamètre collés
côte à côte et rangés en long. Un second rang au dessus en
travers.
2° Une couche de terre d'environ soixante à quatre vingt
centimètres d'épaisseur.
3° Un rand de rails de chemin de fer en long et au dessus, un
second rang en travers.
4° une couche de terre comme la précédente.
5° Des blocs de ciment nommés éclateurs de 70 centimètres carrés
et de vingt d'épaisseur, à chaque angle un anneau dans lequel on
glisse une fiche et on coule du ciment dans ces intervalle ;
cela représente un bloc de ciment armée de vingt centimètres
d'épaisseur et pour parachever cette défense, un mètre de
terres.
Certaines grosses torpilles ont entamées de ces abris. Quelle
force de pénétration devaient-elles avoir. |
[p. 89]
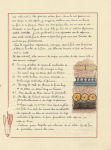 |
LE FROID AUGMENTE
Devant la nouvelle arrivée du gel, nous avons du abandonner
notre maison car ce cantonnement devenait intenable ; nous y
serions tous morts de froid. Chacun s'est débrouillé.
Avec le sergent et Toto, nous avons fait bande à part. Ayant pu
trouver de l'autre côté de la route, sous une maison
complètement rasée, une cave en bon état, nous nous y sommes
installés.
Accompagnés de Toto, dont la force peut commune nous sert
efficacement, sous l'amas de décombres des maisons écroulées
nous sortons du bois en quantité suffisante pour la fabrication
d'une carcasse de sommier, d'un semblant de table et d'un banc
boiteux.
C'est un peu primitif, mais nous sommes chez nous et dépoisonnés
de ces croquants et de leurs conversations oiseuses.
Le sergent touche au ravitaillement suffisamment de bougies pour
éclairer notre tanière. Notre sort se trouve amélioré d'autant.
Et lentement les jours s'écoulent.
La lueur de la bougie éclaire à peine la cave, deux ombres qui
se profilent en silhouettes bizarres sur le ton brun de la terre
s'interposent par intervalles dans la lueur et la pénombre.
Plongé dans un engourdissement comme dans un paquet d'ouate, mon
cerveau béate, mes pensées s'estompent, et je me laisse aller à
ces doux moments d'oubli qui précèdent le sommeil.
« Eh Lavy il est l'heure ».
Brusquement arraché à ma torpeur par cette voix qui résonne
lugubrement dans cette cave, je me |
[p. 90]
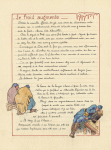 |
soulève et immédiatement, mes pensées réveillées elles aussi, me
plongent avec une terrible lucidité dans l'horreur de l'heure
présente.
Il faut aller au labeur.
Avec des mouvements d'automate, accroupi, un pied sur la
traverse des couchettes, je m'enfoui les jambes dans des sacs à
terre qui, ficelés jusqu'au genou, me protègeront de la boue
liquide et m'éviterons des chutes trop fréquentes sur le
verglas. Il fait un froid terrible.
Par dessus ma capote, je mets mon imperméable, souvenir des
chasses d'antan, sanglé d'une courroie, engoncé d'un cache-nez
qui fait plusieurs tours, coiffé du casque, petite boule ronde
qui couronne cette masse de vêtements, je franchi derrière mes
deux copains les quelques marches de notre cave.
Dans cette nuit glacée, la montée de ces trois formes bizarres
qui n'ont plus rien d'humain, s'échappant des entrailles de la
terre, a quelque chose d'étrange et de sinistre. Ce cheminement
au milieu des ruines enfouies sous la neige, la traversée de la
large rue déserte où se profile la carcasse de la vieille église
démantelée, le rassemblement de tous ces individus silencieux
aux formes aussi grotesques qu'inquiétantes, tout cela a quelque
chose d'irréel et de tragique. |
[p. 91]
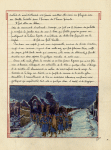 |
L'appel se fait à voix basse et cette masse s'ébranle que la
terre glacée au milieu des pas traînants.
Séparé de Toto qui est branché sur une autre équipe, je chemine
dos voûté, abimé dans mes pensées.
Dire qu'il y en a en ce moment qui, près des leurs, reposent
béatement dans un lit chaud et moelleux, ignorant nos transes
d'inquiétudes et sans souci de l'existence que nous menons ;
cela me remplit d'amertume.
Les papillons noirs affluent à mon cerveau, et pour dériver à
cet assaut de neurasthénie, je me mêle à la conversation de mes
deux voisins qui discutent alcool et bouillage de cru.
Il gèle de plus en plus, le sol est un véritable verglas et les
chûtes sont nombreuses. La route est coupée de larges fondrières
recouvertes d'une mince couche de glace qui craque sous nos pas,
et nous engonçons alors jusqu'à mi-jambe dans une boue liquide
et glaciale.
De place en place, d'énormes trous crèvent le sol et prouvent
l'acharnement de l'ennemi à bombarder cette route, ce qui
s'explique d'ailleurs car c'est sur elle que se fait tout le
charroi du matériel nécessaire à l'aménagement des ouvrages
fortifiés.
Nous arrivons près d'un pont. Une masse noire est là, qui barre
ma route ; autour, des ombres s'agitent. Très surpris, nous
avançons. C'est la voiture |
[p.92]
 |
pleine de matériel qui se trouve bloquée ; le pont de bois est
écroulé dans son milieu. Il est tombé une trentaine de 240.
C'est le bombardement que nous avons entendu dans la soirée. Des
sapeurs du génie ont en hâte réparé ce pont au moyen de planches
et de madriers pour permettre notre passage, mais la voiture,
elle, va demander une réparation plus sérieuse et le matériel
n'est pas prêt d'être rendu sur place. Certes, nous devrons
attendre avant qu'il nous parvienne.
Encore trois kilomètres de marche et nous atteignons le but.
Comme nous le pensions, en l'absence de voiture et par suite du
matériel, il nous faut attendre son arrivée.
Pendant deux heures, nous piétinons sur la neige et le verglas,
sans arriver à nous réchauffer un tant soit peu. Enfin, nous
voyons poindre la voiture et, quoique le labeur qui nous attend
soit écrasant, nous ne sommes pas fâchés de cette arrivée pour
échapper à ce froid qui paralyse les membres.
Secteur agité. Cette nuit pendant que nous travaillons, une
terrible canonnade éclate, mais ce n'est pas pour nous. Nous
entendons siffler les grosses marmites qui passent au-dessus de
nous pour aller porter la mort à l'arrière.
C'est Vého qui prend. Dominant la plaine, nous voyons au loin
les lueurs des éclatements dans la direction du village. |
[p. 93]
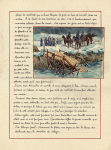 |
Ce secteur est vraiment moche, disait l'autre jour un poilu.
Effectivement, il l'est, moche. Où nous nous en rendons le mieux
compte c'est chaque soir, lorsque nous arrivons aux tranchées,
et que quittant la route il nous faut franchir les quelques
marches pour emprunter le boyau qui nous mène sur le terrain
d'opérations.
Invariablement, cette descente est encombrée de cadavres qu'il
est impossible d'éviter et que nous sommes tenus de piétiner ou
d'escalader.
Tous les pauvres diables tués dans les lignes sont transportés
au bord de la route, où des voitures viennent les prendre pour
les ramener au village où se font les funérailles. Mais les
brancardiers chargés de ce transfert, côtoyant chaque jour la
mort et de ce fait cuirassés par la manipulation de cadavres,
ces types n'ont qu'un souci, c'est de se débarrasser au plus
vite de ces corps encombrants, et au lieu de les monter et les
accoter sur le talus de la route, ils les jettent pèle même sur
les marches du boyau.
Oh, le respect de la mort est inconnu ici.
Nous enjambons ces pauvres corps raidis, piétinons les dos ou
les ventres et leur en voulons par surcroît de, dans leur
dernier sommeil, nous tendre des embûches avec leurs membres
raidis qui dépassent le charnier, nous accrochent les jambes et
quelquefois nous faisant choir sur eux ou dans la boue du boyau.
En somme, eux, ce sont les heureux, au moins ils ne souffrent
plus, tandis que nous ... ? |
[p. 94]
 |
ATTAQUE IMMINENTE
J'ai pu me sortir intact de Verdun mais c'était reculer pour
sauter, car je n'espère pas me tirer d'ici en entier, ça barde
trop. D'abord cette colline qui peut sauter d'un moment à
l'autre, ce sonnage si fréquent, ces coups de main à droite et à
gauche. Reillon, Leintrey, noms sinistres.
Oui, je le crois, mes pauvres os vont blanchir, une de ces nuits
ou un de ces jours, ce coin de Lorraine.
Grande effervescence hier soir aux lignes. Nous avons dépassé
sur la route de nombreuses voiturettes de l'artillerie de
tranchées remplies de munition. Dans les tranchées, c'est un
va-et-vient d'artilleurs transportant des torpilles à ailettes.
Qu'est-ce que ca veut dire ?
Cette nuit, nouveaux transports de torpilles. Les tranchées et
boyaux en sont garnis, il y en a partout. Elles s'empilent sur
les banquettes de tir. Dans les cagnas, on ne voit que ces
cylindres peints en bleu ; ca devient une véritable obsession.
Ca ne tardera pas çà barder dans ce con là. Une attaque se
prépare.
Nous venons de l'apprendre par les artilleurs arrivés ce matin.
Ils ont commencé l'installation des crapouillots. L'ennemi a du
repéré quelque chose car ils n'ont pas cessé de tirer toute la
journée.
« Y a pas mal de viande amochée » nous dit l'artilleur qui nous
renseigne.
Trois crapouilloteurs qui s'étaient abrités |
[p. 95]
 |
dans un petit gourbi couvert de tôle ondulée ont été tués sur
place.
A peine avons nous faut quelques pas dans la tranchée qu'un
groupe sinistre arrive. Nous nous collons contre le parapet pour
laisser passer. Défilé lugubre.
Trois groupes de deux brancardiers portent sur leur épaule un
grand rondin soutenant un paquet fait d'une toile de tente. Ce
sont les restes des trois pauvres artilleurs tués dans la
journée. On devine les corps broyés empilés à la hâte.
Détail macabre : sur un de ces funèbres colis, une jambe guêtrée
de cuir et coupée au ras du genou, sans doute ramassée les
paquets faits, repose sur le colis et à même le dessus de la
toile.
Voilà ce qui reste de trois jeunes gaillards ce matin encore
pleins de vie...
Pauvre de nous.
SAC AU DOS
Ce soir, un ordre singulier nous arrive.
Partir sac au dos, dans la tenue règlementaire. Jusqu'ici nous
avions la latitude de nous affubler à notre guise et de laisser
le sac au cantonnement. Quelques-uns, sachant toucher pelle ou
pioche ne prenaient même pas le fusil et dans la nuit noire
personne ne s'en apercevait d'ailleurs. Nous n'avons jamais vu
un officier sur place. L'adjudant rassemblait les hommes,
faisait l'appel et disparaissait ; nous partions sous la
conduite d'un sergent ou d'un caporal.
Ce soir, cet ordre nous intrigue. Je m'informe auprès de mon
copain le sergent. Nous montons en ligne comme troupes de
soutien pour l'attaque très prochaine. Ma foi, être ici ou
là-bas, c'est bien pareil et cela va nous changer de ces travaux
éreintants. |
[p. 96]
 |
Nous arrivons aux positions. Les tranchées et boyaux regorgent
de poilus. Notre sergent de section s'informe de notre
destination. On lui indique un abri provisoire. Nous nous
déchargeons de nos sacs et attendons l'arrivée de la deuxième
section qui est commandée par l'adjudant et que nous précédons.
Ne la voyant pas venir, le sergent nous détache à six pour aller
au devant d'elle. Nous voici donc partis à sa recherche, mais
pas facile à se guider dans cette nuit et avec cet
enchevêtrement de boyaux où à chaque moment on se trouve indécis
devant plusieurs bifurcations. Finalement, on se perd. On essaye
bien de se renseigner, mais tous les polis qui sont là,
nouvellement arrivés en renfort, ne connaissent pas le secteur.
On bagotte depuis une demi-heure sans être plus avancés. Cette
marche est dure car les tranchées sont pleines d'hommes et il
faut des prodiges d'adresse pour se faufiler étant donné la
faible largeur du passage. Tous, malgré le froid, nous suons à
pleine goutte.
Les tranchées sont en mauvais état et à plusieurs reprises les
caillebotis faisant bascule, nous enfonçons les pieds dans des
trous pleins de boue. Un boyau s'offre à nous qui paraît être le
bon. Nous le suivons, il est bien clayonné, c'est bon signe.
Mais après environ un kilomètre, le clayonnage cesse et c'est la
terre à moitié écroulée. Là alors nous sommes bel et bien
perdus, cette fin de boyau est complètement déserte.
Nous rebroussons chemin et après un nouveau et long parcours, un
autre boyau s'annonce. Voyons, essayons celui-là, nous devons
être dans la bonne voie, et nous suivons péniblement ce nouveau
chemin.
La fatigue commence à nous prendre et nous sommes anxieux de
savoir si, oui ou non, nous retrouverons notre abri. Nous
n'avons pas fait cinquante mètres que nous sommes arrêtés par
une masse sombre accotée au talus. |
[p. 97]
 |
En avançant, nous reconnaissons un poilu. Il nous interpelle à
voix basse « qu'est-ce que vous venez foutre ici, vous n'êtes
pas un peu loufs ». On s'explique ; lui-même est un guetteur qui
occupe et surveille un épi. Si je n'avais pas été là et que vous
ayez continué à suivre ce boyau vous alliez droit chez les fritz
qui certainement vous auraient sucrés.
Il nous explique le chemin, très simple ma foi, et vingt minutes
après nous arrivons à notre abri. La deuxième section était
arrivée cinq minutes après. Nous avons marché une heure un quart
pour rien, après avoir fait un tour formidable.
Trois jours se passent en attente de l'attaque. Comme ces nuits
nous semblent longues et ces jours interminables. Le quatrième
soir, on nous rassemble, et surpris mais pas fâchés, nous
partons.
Les artilleurs déménagent leurs torpilles et sur la route
chargent leurs voitures. L'attaque n'aura pas lieu.
L'avant-veille un sergent et sa section ont passé chez les
boches. Craignant qu'ils n'aient été cuisinés, un contre-ordre
de l'Etat major est arrivé. D'ailleurs, ajoute le poilu qui nous
renseigne, tous les jours il y en a qui se débinent pour faire
camarade. Ca dure trop, vous comprenez, on en a marre.
|
[p. 98]
 |
Nous sommes bien de son avis. On en a marre, marre, marre. Oui,
ca dure vraiment trop. Et pendant que les artilleurs finissent
d'enlever leurs munitions, nous regagnons notre cantonnement.
PROJETS & DEMANDES
La neige est tombée en abondance et le gel a repris. Le froid
devient intenable. Notre cave sans feu est une véritable
glacière étant donné que la température voisine les vingt degrés
au-dessous. Mon cafard s'augmente ; je n'ai plus qu'une idée :
sortir d'ici à n'importe quel prix, car je sens mon courage qui
m'abandonne de jour en jour.
Les troupes qui font les attaques ou tiennent les lignes, elles,
donnent un bon coup puis vont au repos à l'arrière. Nous,
toujours sur la brèche. Nous ne faisons pas d'attaques
évidemment, mais si les risques sont moindres, ils durent plus
longtemps. Depuis trois mois que nous sommes ici, le repos est
illusion, si ce n'est les trois jours passés aux positions dans
une complète inaction ; mais étant donné la tension d'esprit
afférente à cette éventuelle attaque, je ne sais jusqu'à quel
point on peut les qualifier de repos.
Je rumine des projets pour me sortir de cette géhenne.
Sur les conseils de mes anciens téléphonistes qui m'ont fait
remettre un mot, j'ai fait une demande pour passer dans la
section de repérage par les lueurs ; ce n'est pas précisément le
filon, mais cela me sortira d'ici. Il parait que notre ancien
camarade Sicot y est entré et ne s'en trouve pas mal. Je leur
fait parvenir cette demande afin qu'ils l'acheminent par la voie
hiérarchique.
Depuis plus de nouvelles. C'est sans doute un coup d'épée dans
l'eau. L'esprit tendu sur ce que je pourrai élaborer pour
m'évader de ce coin, j'ai une idée.
Je conçois un système pour dissimuler les pièces de canon.
J'établis dans mon projet une sorte de cage en toile métallique
peinte |
[p. 99]
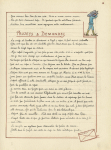 |
qui, laissant la vue complète aux artilleurs, dissimulerait la
pièce à une certaine distance ; en effet, la toile métallique
peinte vue de loin forme corps opaque.
Avec mes faibles moyens, dans notre cave éclairée d'une mauvaise
bougie, les doigts gourds par le froid, j'établis tant bien que
mal un détail avec croquis à l'appui, et envoie le tout au
Ministère de la guerre service des inventions, et j'attends le
coeur plein d'espoir.
Dans ma candeur naïve je ne doute pas du succès et me vois à
Paris même expérimentant mon invention.
Pau après je reçois la réponse. Hélas, trois fois hélas, elle
est loin d'être ce que j'espérai.
Le bureau des inventions, tout en me remerciant des mes efforts,
m'avisait que ce projet était déjà employé sous une autre forme
par les sections de camouflage, mais que je pouvais à tout
hasard faire une demande à cette section qui employait des
peintres et dessinateurs.
Enfoncés mes projets d'inventeur. Qu'importe, comme l'essentiel
pour moi est de quitter d'ici, je fais cette demande, mais sans
succès, car en réponse, cette section m'avise qu'elle a plus
besoin d'hommes de peine que de peintres ou dessinateurs, mais
que néanmoins ma demande était prise en considération et que, le
cas échéant, on me ferait appeler. En somme, une fin de
non-recevoir très polie. J'abandonne tout espoir et mon
découragement s'en accroit.
JANVIER 1917
1916 a chu dans la boîte aux oublis et la nouvelle année est
apparue. On ne s'en est pas aperçu, nous vivons comme des
brutes. Mes deux compagnons eux aussi n'échappent pas au cafard |
[p. 100]
 |
et couchés tous trois sur nos poussier, nous restons de longues
heures anéantis, n'ayant pas la force de prononcer un mot, à
peine la force de penser. C'est lamentable. L'emprise de cette
vie déprimante nous tient chaque jour davantage.
ADIEU VEHO.
Coin sombre ou j'aurai vécu de si cruelles heures.
Je te quitte pour une destination inconnue. Puisse-t-elle être
plus clémente que les jours lamentables qui ont marqués mon
séjour en ton sein... Adieu Vého.
ERBEVILLERS (HERBERVILLER)
Notre groupe isolé est dissous. L'incorporation dans les
compagnies du 47ème où nous sommes affectés, est une chose faite
maintenant.
Je pars rejoindre la mienne, qui se trouve à Erbevillers, en
compagnie d'un pauvre diable de Normand. Petit gars tout
noir, effacé, paysan de la Manche, pour qui cette guerre
est un évènement formidable, car jusqu'ici il n'avait
jamais quitté son village et ne savait pas que ce que
c'était de voyager en chemin de fer |
[p. 101]
 |
Durant tout le trajet pour gagner notre nouvelle destination,
nous n'échangeons, le petit copain et moi, que quelques paroles
car le pauvre type n'est pas avide de conversations. Je sais
bien qu'il n'a pas encore réalisé sa présence dans ce métier
infernal, et ce nouveau changement qui le déroute davantage
n'est pas fait pour le rendre loquace.
A notre arrivée au village, nous allons au bureau de la
compagnie. Le sergent major n'a pas le temps de s'occuper de
nous. Il nous envoie rejoindre, dans une maison sur la place du
village, d'autres poilus qui comme nous viennent d'arriver. Nous
sommes là, huit, qui ne se sont jamais vus, mais la connaissance
est bientôt faite. « Qui es-tu, d'où que tu viens » et le glace
est rompue.
Il fait un froid terrible, l'instant de sortir dehors et les
glaçons se forment à la moustache.
Dans la maison où nous sommes, nous nous groupons naturellement
dans la cuisine, vaste pièce où existe une cheminée où l'on
pourrait cuire un boeuf entier. Le feu est allumé et il ne s'agit
que de l'alimenter. Chose facile : un tour derrière dans les
jardins, et nous ramenons des arbres entiers qui entrent
aisément dans cette cheminée monumentale, et ceci pour le plus
grand bien de nos corps transis, quoique on se rôti la face et
le derrière est gelé, et alternativement nous nous retournons
afin que chaque côté de notre individu ait sa part de chaleur.
Malgré le froid, je n'ai pu résister à aller faire un croquis
rapide de l'église du village, mais j'avoue que quand je
reviens, je suis heureux d'aller présenter mes devoirs à la
belle flambée de cette bien bonne et sympathique cheminée. |
[p. 102]
 |
L'après-midi, nous sommes appelés au bureau où le sergent major
nous donne l'indication de nos escouades. Pour moi, il y a deux
nouvelles : une excellente, c'est que mon tour de permission est
arrivé et que je pars demain matin. L'autre nouvelle est bien
moins agréable : notre compagnie monte en ligne ce soir pour
occuper la tranchée près de la forêt de Paroy. Le doublard nous
ayant indiqué nos escouades que nous devons retrouver ce soir au
rassemblement, nous expédie en vitesse.
Je réfléchis : voyons, la Cie monte en ligne ce soir ou demain.
Je pars en permission, je ne vois pas l'utilité de monter aux
tranchées juste pour une nuit, de faire ce soir plusieurs
kilomètres pour les faire en sens contraire demain matin, ce que
je soumets au sergent major, lequel me répond que les ordres
sont formels, et qu'il n'y a rien à faire. Je pivote avec un
salut et vais préparer mes affaires pour ce soir.
La nuit arrive, il fait si froid qu'on ne se décide pas à aller
coucher. Tous groupés devant la grande flambée, nous causons
longtemps ; enfin, s'enveloppant dans toutes nos frusques, nous
allons nous étendre sur la paille dans la pièce où la
température est plutôt fraiche ou pourrait même devenir glaciale
; mais malgré cela nous ne tardons pas à dormir.
|
[p. 103]
 |
PAR 22 AU DESSOUS NOUS MONTONS EN LIGNE
Nous partons un peu avant la nuit chargés comme des mulets de
bâts, couvre pied, toile de tente, peau de mouton, etc, etc.
Nous atteignons St Martin, village proche ; au bout du patelin,
une batterie de 155 longs repose sous ses camouflages, chaque
pièce dressant sa longue gueule dans la direction où nous
allons.
Nous arrivons à la nuit aux positions. Nouveaux cheminements
dans les boyaux, puis ma section enfilant une tranchée, arrive
devant un abri où elle s'engouffre.
L'abri est vaste et il y règne une douce chaleur ; et pour
cause, au milieu un poêle rougi à blanc y répand une douce
chaleur qui nous fait bien augurer du confort des lieux, et deux
étages recouverts de tôle métallique nous offre un primitif
plumard, qui semble nous inviter à un repos bien gagné.
Le sergent nous rassemble :
Etant donné le grand froid qui sévit, l'Etat Major laisse à
chaque troupe la faculté de réduire à sa guise les deux heures
de garde règlementaires, et les hommes peuvent être relevés
toutes les heures, les demi-heures, voire même tous les quarts
d'heure.
Je suis dans un régiment de Bourguignons, tous grands gars
solides et bien membrés, auprès desquels ma modeste structure et
faible anatomie fait bien pâle figure. Ils ne veulent rien
savoir pour réduire la faction et sont |
[p. 104]
 |
tous d'accord de la maintenir à deux heures. Penses-tu, dit l'un
deux au sergent, se faisant l'interprète de tous ses copains, on
aime mieux faire ses deux heures d'un coup et plus être emmerdés
après ; comme ça au moins on peut roupiller. Je n'ai qu'à me
ranger à cet avis ; d'ailleurs peu m'importe, je n'ai qu'une
idée : je pars demain en permission et me tire d'ici quelques
jours.
Le tour de rôle des sentinelles est donc établi. Les premiers
partent avec le sergent faire la relève, et les autres, dont je
suis, en attendant leur tour, s'étendent sur le sommier
métallique.
Je ne dors pas, je sommeille par petites tranches. Tout-à-coup,
j'entends mon nom. Je me dresse, c'est mon tour ; un poilu m'a
devancé qui déjà s'apprête. Tu sais mon vieux, il faut se
couvrir, car pendant deux heures on ne va pas avoir chaud. Nous
allons au poste d'écoute. Il est minuit, nous en avons jusqu'à
deux heures sans bouger.
Sur le chandail que nous avons gardé pour coucher, nous mettons
la veste, puis la capote, la peau de mouton par dessus, le passe
montagne dans le casque, un couvre pied sur les épaules, l'autre
sur le bras, et ainsi échafaudés, nous quittons l'abri. Nous
suivons le sergent qui nous guide. Le froid est rigoureux. Mes
pieds chaussés de bottes de tranchée frappent le caillebotis
gelé donnant l'impression de claquettes. C'est le seul bruit
d'ailleurs, car il règne un silence absolu, qui est
particulièrement impressionnant, mais je n'y attache pas
autrement d'importance car je pense que, demain matin, je pars. |
[p. 105]
 |
POSTE D'ECOUTE
Longeant les chevaux de frise, nous traversons une chicane et
échappons un premier réseau, puis cinquante mètres plus loin, un
second réseau ; nous voici en dehors des deux barbelés.
Au diable, s'il nous fallait seuls faire demi-tour, il serait
difficile de s'y retrouver. Nous gagnons une excavation creusée
dans le sol et descendons au fond de ce trou de deux mètres de
long environ sur un mètre cinquante de large ; une banquette
taillée à même la terre permet de s'asseoir, la tête dépassant
le sol juste assez pour voir devant soi. On pose le fusil sur le
talus, et après avoir chargé le magasin et une cartouche dans le
canon, on étale quelques autres en vrac devant soi et l'on
commence sa garde de guetteur.
Devant nous, un réseau brun, seule défense contre l'ennemi ; ses
piquets se profilent en noir sur le ciel bleu sombre piqué de
diamants qui scintillent.
C'est une de ces rudes nuits d'hiver, au ciel étoilé, où la bise
vous coupe la figure. Rester par cette température deux heures
immobiles, sera-ce possible ?
Un grand silence règne sur cette longue plaine qui dort sous la
neige et le verglas. J'ai toujours été impressionné par ces
silences durant ces longues nuits glaciales ; or, dans ce trou
je le suis davantage. Deux réseaux nous séparent maintenant de
nos lignes, nous nous trouvons isolés dans une zone de périls et
de dangers et sans secours possibles. La même réflexion effleure
mon voisin qui me dit à voix basse « Crois-tu qu'on serait bon
s'il y avait un coup de main. Avant de retrouver les chicanes et
gagner les lignes, on serait bouzillés dix fois ; en somme, on
est un peu sacrifiés, quoi. » Evidemment, mon vieux,
répondis-je, |
[p. 106]
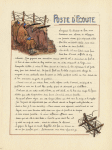 |
mais deux hommes, est-ce que ca compte dans le tas de morts qui
s'accumulent chaque jour. Cependant pour nous ca compte au
suprême degré car cette longue guerre a tué l'enthousiasme, a
abattu les courages et fait naître une vague d'égoïsme où chacun
ne cherche qu'à sauver sa peau.
Nous fixons le réseau d'un oeil attentif, mais il se produit
alors le phénomène naturel et inévitable. A force de regarder le
même point, la rétine se fatigue, et on croit voir l'objet
remuer. J'observe depuis un moment un gros piquet qui me parait
louche... mais nom de dieu... il bouge. Ma main se crispe sur
mon fusil que j'épaule lentement, prêt à tirer à la moindre
alerte. Mon voisin se penche : « tu vois quelque chose ?
- Ce gros piquet là-bas je l'ai vu bouger. Il fixe et me répond
non, ça te fait comme à moi : à force de regarder, on
s'illusionne. Je détourne mon regard sur un autre point et le
ramène à mon premier but. Placide, je retrouve mon gros piquet
immobile. Ainsi, avec un peu d'affolement, comme il serait
facile de commettre une dangereuse bévue...
Combien y-a-t-il de temps que nous sommes là ? Peut-être une
heure, peut-être un quart d'heure, nous n'avons aucune notion du
temps. En tout cas, le froid commence à nous gagner les jambes
dans cette immobilité complète.
Sous l'engourdissement de ce froid, on serait tenté de
s'endormir, et cependant ça n'est guère le moment quoique ça en
soit bien l'heure. |
[p. 107]
 |
Tout à coup, je dresse l'oreille : j'ai entendu un faible bruit,
mon camarade l'entend aussi... Qu'est-ce que c'est ? me dit-il.
Je ne sais, le bruit se continue et s'accentue. C'est un
claquement sec, un peu métallique. Nous sommes anxieux,
l'oreille tenu. Le bruit se fait de plus en plus fort. C'est les
boches qui coupent les réseaux, murmure mon voisin dans un
souffle. On entend en effet distinctement un petit claquement,
le bruit des pinces. Nous avons saisi le fusil et groupé les
cartouches.
Ca y est... le moment fatal approche. Mille visions me passent
devant les yeux. Nous guettons, croyant voir arriver des ombres
le dos courbé et la pince à la main. Mais rien ; aussi loin que
peut aller notre regard, rien de suspect ne s'offre à nos yeux
dilatés. Le bruit cependant augment ; alors, quoi ?...
Mais ça vient derrière.
Oui, en effet, ce bruit vient de derrière nous. En nous
retournant, nous voyons deux masses grises qui suivent un réseau
pour gagner la chicane, et en même temps le bruit se précise.
Parbleu, c'est une relève, et ce bruit qui nous a tant
inquiétés, c'est tout bonnement le claquement des semelles des
bottes en caoutchouc frappant le caillebotis gelé.
Nous respirons... Mais c'est égal, nous avons eu chaud, car
l'illusion était vraiment forte. Comme il fait bon garder son
sang-froid, tout de même. Tout à fait rassurés maintenant, nous
reprenons notre garde.
Le froid nous gagne de plus en plus dans ce trou glacé, mais moi
j'ai un réconfort étonnant, c'est ma permission de demain.
Du temps s'est écoulé : combien ?
Tout est calme, puis brusquement le ciel s'illumine à notre
gauche. C'est une fumée verte qui part de nos lignes, suivie
d'une blanche, ce sont des signaux pour l'artillerie ; en effet,
nos pièces commencent à tirer, quelques coups d'abord. Nous
distinguons au son les départs, et voyons en face de nous les
éclatements ; notre tir s'intensifie et devient un roulement
continu. Je suis terriblement |
[p. 108]
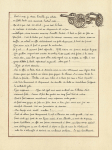 |
inquiet pour ma permission de demain : ca me parait être une
attaque qui se prépare.
Des lignes ennemies s'élèvent alors des fusées rouges et
blanches : ils demandent des tirs de barrage. Ca ne traine pas
chez eux, car aussitôt le bombardement commence.
Nos batteries de 155 longs, que nous avons vues en passant à
Saint-Martin, mêlent leurs grosses voix à ce concert infernal.
C'est alors pour nous un coup d'oeil saisissant et
impressionnant. D'où nous sommes, nous dominons toute l'action
et sans danger aucun, pour le moment du moins, les projectiles
nous passant tous au dessus de la tête.
Partout où se portent nos yeux, ce ne sont que lueurs. Lueurs
fauves des départs, lueurs rouges des éclatements, fusées
blanches, rouges, vertes, autant de signaux pour les tirs,
autant de clarté diverses dans des gerbes d'étincelles.
Le roulement des pièces allemandes, le sifflement continu des
obus des deux camps qui passent au dessus de nous sans arrêt,
ceux aigus des petits calibres, le grincement ou le ronronnement
des grosses pièces, les détonations des départs, les explosions
à l'arrivée des obus, forment un concert terrible.
Bientôt, là-bas à gauche, le crépitement des mitrailleuses s'en
mêle.
Nous sommes tellement pris par la grandeur et la majesté
tragique de cette scène, que nous sommes tous yeux et négligeons
de guetter ; et cependant, il faut ouvrir l'oeil, car il n'y a
pas à s'y tromper, devant l'envergure de ce bombardement qui |
[p. 109]
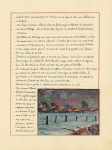 |
a gagné tout le front : c'est surement une attaque générale dans
notre secteur. C'est bien là ma veine... adieu permission, et
cette vache de sergent major qui m'a fait monter en ligne pour
une nuit, juste pour me coller la dedans. En admettant que je
m'en tire, quand partirai-je maintenant...
Oh posse, poisse quand tu nous tiens.
Cela dure environ une heure, puis le bombardement s'espace pour
cesser tout à coup. Quelques coups de mitrailleuses, des coups
de fusil isolés, puis silence complet... Que va-t-il se passer ?
Rien... Nous attendons, nous guettons : le calme est revenu. Je
respire. Par bonheur, me serais-je trompé et aurais-je tout de
même la chance de partir demain ?
Songeant à la scène grandiose et tragique à laquelle nous venons
d'assister, je me dis qu'il y a à l'arrière des tas de gens qui
payent cher un fauteuil au théâtre ou bien au Music-hall pour
assister à des pièces à grand spectacle, qui s'extasient devant
les féeries et jeux de lumières, et tressaillent aux bruits de
coulisse. Que ne viennent-ils ici, ils auraient tout cela
gratis. Mais voilà, la salle n'est pas chauffée, les fauteuils
inconfortables, mal placés et des plus dangereux ; aussi, pas
d'amateurs.
Toutes ces émotions ont occupé nos heures de garde et nous ont
fait oublier l'engourdissement complet de nos membres, malgré
l'amas de vêtements dont nous sommes affublés. Mais les derniers
moments de cette garde sont vraiment durs. On frisonne
longuement ; il semble que la chair est nue et exposée aux
rigueurs de cette température glaciale. On ne sent plus ses
jambes et des éblouissements vous passent devant les yeux. La
notion des choses disparait ?
Verra-t-on la fin de cette terrible faction ? |
[p. 110]
 |
Enfin nos deux heures sont écoulées ; nous entendons derrière
nous les pas de la relève. Impossible de sortir de notre trou.
Les suivants sont obligés de nous hisser. C'est courbés en deux
sur des jambes mal assurées que nous gagnons l'abri où la bonne
température qui y règne nous remet dans la normale, et nous
avons droit maintenant à dormir jusqu'au jour.
Au réveil, ma joie éclate. Rien maintenant ne peut s'opposer à
mon départ. Lestés de notre fret, nous sommes trois qui partons
à Bénaménil, rendez-vous des permissionnaires. Nous passons aux
cuisines prendre un coup de jus. Le ravitaillement vient
d'arriver. Dans un coin, le cuistot est en train de scier les
boules de pain pour la distribution de ce ravitaillement, car
tout ce qui arrive est gelé, pain, vin, viande, etc... Le vin a
été transporté dans une toile de tente, plus besoin de
récipients. Nous l'apercevons sur un coin de la table, grosse
masse de glace rouge, vague illusion d'un énorme rubis que tout
à l'heure les cuisiniers feront fondre pour permettre la
distribution.
Après avoir ingurgité ce café, pas très fort, mais du moins bien
chaud, sur un regard un tantinet jaloux de tous ceux qui
restent, nous partons d'un bon pas et le coeur léger. |
[p. 111]
 |
RENCONTRE IMPRÉVUE
Après voir franchi le dernier boyau, la route ne nous semble
plus longue pour arriver au point de jonction des
permissionnaires.
Près d'atteindre Bénaménil, en traversant un petit bois,
j'aperçois quelques baraques, et de l'une d'elles je vois sortir
une silhouette qui ne m'est pas du tout inconnue.
Ce petit casque tout rond, ces épaules en lentilles de St
Galmier, cette petite taille, ces grosses jambes... mais je ne
me trompe pas.
- Eh, Gauthier. Ce poilu se retourne
- Ah, Lavy, mon vieux Lavy, comment ca va, qu'est ce que tu
deviens depuis qu'on t'a quitté ?
Comme il m'accompagne jusqu'à Bénaménil, je lui conte mes
avatars et mes souffrances, auxquelles il compatit grandement.
Il me donne des nouvelles des copains qui sont disséminés dans
divers postes.
Au village, il me présente un lieutenant téléphoniste, lequel me
dit que son équipe est au complet, mais comme le Colonel doit
prochainement nommer des signaleurs, il s'arrangerait pour me
mettre le premier en tête de liste, ce dont je le remercie
grandement, et je pars donc avec une lueur d'espoir.
Toujours en compagnie de Gauthier, qui ne veut me quitter qu'au
dernier moment, nous cheminons pour rejoindre le point de
rassemblement des permissionnaires.
Le détachement étant formé, nous nous dirigeons vers la gare.
Sur une solide et cordiale poignée de main, le lui dis « au
revoir mon petit Gauthier ».
C'est adieu que j'aurais du lui dire. Il fut tué quelques mois
après. |
[p. 112]
 |
TROISIEME PERMISSION
Dans le train qui nous dirige sur Paris, nous voyageons avec des
chasseurs à pied qui racontent l'affaire d'hier soir, à laquelle
ils ont pris part et dont j'ai été le témoin. Il s'agissait d'un
simple petit coup de main sur un ouvrage isolé, afin de faire
quelques prisonniers, et c'est pour cette simple affaire qu'il y
a eu cette débauche d'artillerie qui me faisait craindre une
attaque générale.
Comme nous sommes loin de l'époque où, à Verdun, nous n'avions
que deux 75 sur les hauts de Meuse pour soutenir l'attaque de
Ronveaux.
On ne plaint plus les munitions aujourd'hui, on les gâche ce me
semble. Que d'or parti en fumée sans résultat appréciable. Il
est vrai que c'est la guerre d'usure. Nous abusons, enrichissons
les profiteurs de guerre. Faut pas s'en faire, on ne s'en fait
pas, et on use... on use les munitions, on use le bétail
humain... et la guerre continue.
A coté des joies morales et matérielles que nous procure cette
détente, combien de sujets d'écoeurement, comme aux précédentes
permissions, nous assaillent, et plus encore peut-être au fur et
à mesure que s'éternise cette guerre.
Dans cette capitale qui fut nôtre, comme on se sent étrangers,
gênés, déplacés ? Nous n'arrivons pas à comprendre, en regard à
notre existence du front, cette vie intense, ce luxe ces
musiques, ces théâtres, ces cinémas où les gens font la queue,
cette nouba journalière, ce je m'enfoutisme profond, toutes
choses qui font de nous des épaves au milieu de cette mer de
plaisirs. |
[p. 113]
 |
Sans doute tous ces plaisirs, ces théâtres, ces concerts, ces
cinémas sont-ils utiles pour le gagne-pain de tous ceux qui en
vivent, artistes, machinistes, ouvreuses, etc. Mais nous
n'arrivons pas à réaliser : c'est à notre point de vue trop
d'insultes pour ceux qui là-bas souffrent et meurent.
Et puis tous ces gens à la face hilare qui vous répètent à
satiété : « Ah comme vous avez bonne mine. On voit que vous ne
manquez de rien au front. Vous avez tout ce qu'il faut, tandis
qu'ici c'est la pénurie complète, carte de pain, carte de
charbon, nous sommes bien privés, allez. » Privés et dans les
marchés les poulets s'enlèvent à n'importe quel prix. Enfermés
dans leur tour d'ivoire, ils se boucheraient les oreilles à nos
plaintes, mais, dieu merci, nous avons devant leur impudeur, la
fierté de ne pas nous plaindre. Ils ne voient la guerre qu'à
travers les journaux, que par ce bourrage de crâne intensif qui
montre le poilu dans la tranchée comme un coq en pâte. Ils ne
tarissent pas sur les amusements du front, les nombreux concerts
donnés par les poilus. Ils ne se rendent pas compte que si nous
cherchons à rire, c'est pour ne pas pleurer.
Ces fameux articles de journaux qui représentent le boche
crevant de faim, toujours les bras en l'air en criant « kamarad
». Et ca les étonne, les gens de l'arrière, que devant un ennemi
qui ne cesse de se rendre, nous n'avancions pas plus vite.
Quelques-uns ont même l'impudeur de nous dire « mais vous ne
bougez pas là-bas, qu'est-ce que vous faîtes donc ? » O malheur,
stratèges de chambre qui échafaudez des plans d'attaque et des
mouvements tournants sur les tables de cafés, nous n'avançons
pas... ce que nous foutons ?... nous nous faisons tuer par
petits paquets, c'est la guerre d'usure, il faut user le bétail
humain comme le matériel, l'un ne va pas sans l'autre. |
[p. 114]
 |
Ah, malheur, une nuit de front, une nuit seulement les pieds
dans la boue, la faim au ventre et la mort dans l'âme, et vous
changeriez de refrain. Nous verrions si ce cri « jusqu'au bout »
traverserait encore les lèvres blêmies par la peur.
Pourquoi ce mot d'ordre à la presse, cette funeste manie de
déprécier un ennemi pourtant formidable ? N'est-ce pas du même
coup amoindrir l'effet gigantesque des combattants. Pourquoi
n'avoir pas la franchise de dire ce qui est, clamer la
résistance farouche des allemands, leur force offensive, cela
mettrait mieux en relief l'effort de nos armées au lieu de
l'abaisser. Sand doute pour ne pas effrayer l'arrière, pour ne
pas le troubler dans sa quiétude. Avons-nous peur de la vérité ?
Un peuple fort ne la craint pas. Serions-nous dissolus à ce
point, je commence à le craindre. C'est complètement écoeuré par
ce court séjour que nous remontons. C'est avec soulagement que
nous quittons cette Babylone qui ne nous comprend pas plus que
nous la comprenons, et cependant, nous remontons là-haut le coeur
glacé d'épouvante.
ENFIN
Le train file, les décors changent au cours de route, et au fur
et à mesure du voyage, le paysage change. Bientôt les villages
en ruine nous accueillent et nous revoyons les visions d'horreur
dont notre rétine était si habituée.
Le train s'arrête. Nous voici rendus. Bénaménil.
Mon premier soin est d'aller au poste téléphonique m'inquiéter
de Gauthier, pour savoir si je vais être casé enfin dans un
emploi quelconque.
Il arrive bientôt, mais je lis sur ses traits mon arrêt et mon
coeur se serre. La nomination des signaleurs a été faite, mais le
colonel a choisi les anciens téléphonistes, et a complété par
ceux qui avaient déjà été signaleurs. Gauthier cherche à
m'encourager par des promesses de s'occuper de moi à la première
occasion. Je ne l'écoute plus et le quitte les larmes aux yeux. |
[p. 115]
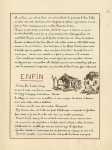 |
Ainsi, il va falloir remonter là-haut seul et recommencer cette
vie de misère. Ah, c'est trop trois ans et demi de souffrances
sans un véritable camarade près de moi. Un jeune serait
peut-être moins sensible, car plus je m'enfoutisme, mais à mon
âge l'isolement est dur, et je sens le besoin d'une solide
camaraderie qui me fait défaut. Les permissionnaires de retour
comme moi errent dans le village. Ils ont bien le temps,
disent-ils, de remonter dans la merde.
Pour moi, à quoi bon traîner ici ; comme il faut y aller, un peu
plus tôt, un peu plus tard, et puis risquer de rencontrer les
anciens camarades qui, eux, sont casés, cela pour me désemparer
davantage. Non. Je préfère de suite rejoindre ma Cie. Je passe
au bureau du Colonel déposer ma permission.
Une face barbue et souriante m'accueille. Je reconnais avec
surprise ce bon caporal Mercadier, copain du 20e, qui lui aussi,
je le vois, a pu se caser comme secrétaire du colonel.
Ah ce bon Lavy, me dit-il, ce veinard de Lavy, et il me serre
copieusement les mains. Voyons ajoute-t-il, où veux-tu aller : à
Nancy ou à Versailles ?
Je ne comprends pas...
Que choisis-tu, voyons, et sa face s'épanouit.
Je n'y suis plus du tout ; plaisante t'il ? Ce serait cruel de
sa part. Je t'en prie, Mercadier, n'ironise pas. Amusé, il me
laisse patauger un moment, et il m'annonce, il en est heureux
pour moi, qu'en mon absence deux demandes sont arrivées :
L'une pour la section de repérage par les lueurs, direction
Nancy, et l'autre pour la section de camouflage à Versailles.
Je parie que tu choisis Nancy, me dit-il d'un air taquin.
Caporal bienfaisant, inscris-moi tout de suite pour Versailles,
répliquais-je avec un large sourire. Je ne me sens plus de joie,
j'éprouve là une rare minute de bonheur, |
[p. 116]
 |
d'autant plus que,
désespéré, je ne comptais plus sur rien. Je quitte Mercadier et
monte à ma Cie établir la paperasserie nécessaire à cette
mutation.
C'est le coeur léger et le sourire aux lèvres que je pars. Je
croise en route des poilus avec qui j'ai voyagé : ils flânent
sur la route, peu soucieux d'arriver.
« Eh mon pote, t'es bien pressé de monter », me crient-ils, «
t'as le feu au cul ».
Je me retourne et d'une voix claironnante, je leur crie : «
penses-tu, je monte pour redescendre, je fous le camp à
Versailles. »
« Oh, le chameau... ce que t'es verni... Versailles, quel filon
», et ils me regardent grimper la route à long pas.
Cinq minutes au bureau, le sergent major me remet mon livret e,
me disant : « vous avez une sacré chance vous. » Eh oui, cette
fois je l'ai, la veine. Je l'ai assez attendue.
Le cuistot me donne des vivres, scie une boule de pain gelée
dont il me donne la moitié et je redescends pour m'embarquer.
Je dis au revoir à Gauthier en passant, en lui communiquant la
bonne nouvelle. « Bien des choses aux copains, et bonne chance à
toi ». J'étais loin de prévoir le sort qui l'attendait... Pauvre
petit copain.
INCERTITUDE
Pendant que le train roule, il me vient un scrupule, un doute et
une crainte. Vais-je être à la hauteur de ma tâche pour les
travaux d'art que je vais être appelé à exécuter dans cette
section. C'est que je ne suis ni peintre ni dessinateur et n'ai
jamais de ma vie pris une leçon de dessin. Evidemment, j'ai
toujours crayonné, j'ai ça dans le sang, mais entre un artiste
et moi, il y a un fossé.
Enfin, espérons en ce fameux filon |
[p. 117]
 |
VERSAILLES
Je franchis la grille de la caserne du 1er génie.
Au bureau, le sergent major m'envoie au magasin d'habillement
pour changer mes effets. Pure formalité, car en l'absence des
anciens uniformes, on me remet le même genre de frusques, sauf
les écussons du col qui sont en velours noir avec un chiffre
rouge.
De retour au bureau, le sergent major qui a fait mon affectation
au 1er Génie me dit : « vous n'avez plus qu'à rejoindre votre
unité. Section de camouflage, rue du Plateau à Paris... » PARIS,
je ne peux en croire mes oreilles.
Cette fois la guerre est pour moi virtuellement finie.
Du moins je le croyais, mais je devais revoir le front et ses
dangers, mais cependant dans toute autre condition que les
années passées dans cette funeste infanterie. |
[p. 118]
 |
|













