|
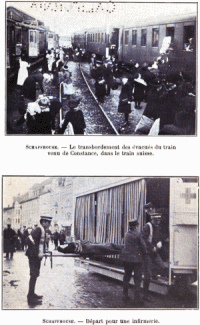
Noëlle Roger
LE CORTÈGE DES VICTIMES
LES RAPATRIÉS D'ALLEMAGNE 1914-1916
Avec une notice historique par Eugène Pittard
Paris Librairie Académique Perrin et Cie, Libraires-Éditeurs
1917
A ceux qui ont dirigé, aidé, soutenu cette entreprise du
rapatriement des internés civils et des évacués, je dédie cet
ouvrage, à ceux qui les ont soignés et aimés, à tous ces
anonymes, à cette foule généreuse qui venait les accueillir, et
qui, mêlant ses larmes aux larmes des victimes, offrait le
meilleur réconfort que l'on puisse attendre en ces heures
troublées.
N. R.
LE CORTÈGE DES VICTIMES A
SCHAFFHOUSE
Les mois d'octobre 1914 à
février 1915 compteront dans les annales de la ville de
Schaffhouse.
Petite ville souriante au bord du fleuve qui semblait diriger
vers l'Allemagne ses pensées et sa sympathie, petite ville
crédule, brusquement elle fut tirée de son rêve et de ses
illusions. Lorsque, jour après jour, nuit après nuit, elle
assista au défilé des internés et des évacués français, elle
prit un soudain et terrible contact avec l'horreur de cette
guerre.
Au début, ce furent les internés civils, familles surprises en
Allemagne par la déclaration de guerre et emmenées dans les
camps de concentration, touristes, pèlerins de
l'Alsace-Lorraine, jeunes gens qui achevaient leurs études ou
passaient leurs vacances dans les villes universitaires
d'outre-Rhin. Bientôt ils furent remplacés par les habitants de
la France envahie, emprisonnés en Allemagne et qu'on rapatriait
: vieillards, femmes, enfants, malades, impotents. Les hommes,
de dix-sept à soixante ans, demeuraient retenus là-bas. C'était
l'exode de toute une population secouée, mélangée au hasard de
la catastrophe, un pêle-mêle de malheureux appartenant aux
conditions les plus diverses, arrachés à leurs maisons, souvent
sans avoir pu rien emporter, ne possédant plus que les pauvres
hardes qui les couvraient; il y avait des maires, des
conseillers municipaux, des prêtres, saisis comme otages, des
familles ayant perdu la moitié de leurs membres, des enfants
sans parents, des vieillards hébétés, de pauvres grand'mères qui
n'avaient jamais quitté leur village; des bourgeois et des
ouvriers, des forains et des paysans, des femmes d'officiers
supérieur de magistrats, de médecins, des soeurs de charité et
des prostituées, des enfants de l'Assistance publique, des
aliénés, des paralytiques qu'on emportait sur des brancards, des
civils qui avaient reçu des blessures...
Et dans ce désarroi inouï, on voyait ces êtres entassés,
voyageant comme des troupeaux, allant ils ne savaient où,
emportés ensemble par la tourmente sans précédent qui, chaque
jour, rejetait de nouvelles vagues, misères toujours semblables
et toujours différentes, pauvres sinistrés, stupéfaits, dociles,
qui obéissaient à la destinée, sans comprendre et sans
protester.
Schaffhouse fut témoin de ce défilé.
M. Henri Moser, commissaire fédéral, chargé avec M. Spahn
d'organiser le comité de réception, disposant de peu de
ressources pécuniaires officielles, - les charges sont lourdes,
en Suisse, depuis la guerre ! - et sentant qu'il s'agissait de
donner au peuple, en quelque sorte, une inoubliable leçon de
choses, permit à tous venants l'accès des quais. Lorsque le
train d'évacués arrivait, clos et lugubre, et que les portières,
enfin ouvertes, laissaient s'écouler lentement cette foule de
malheureux aux joues blêmes, aux attitudes accablées, les bons
Schaffhousois atterrés, croyaient voir passer l'évocation
saisissante de toutes ces tragédies dont les voyageurs
promenaient avec eux l'abominable souvenir.
Il y eut un mouvement spontané, irrésistible. Les vêtements, la
nourriture affluèrent.
Les plus pauvres apportaient leurs offrandes.
Ouvriers, bourgeois, paysans venaient ensemble. M. Moser voulut
qu'ils eussent la joie de donner eux-mêmes. Ces dons n'étaient
pas enregistrés. Les donateurs refusaient de mentionner leurs
noms. Les écoliers réunissaient leurs petits goûters et les
distribuaient.
Les villages les moins favorisés du canton s'associèrent à
l'oeuvre commune. Leurs habitants apportaient tour à tour des
vêtements, des sacs de pommes de terre, des fruits. De toute la
campagne environnante des charrettes arrivaient remplies de
provisions. On faisait des collectes dans les mairies et dans
les églises. Des commerçants fermaient leurs magasins
l'après-midi pour venir aider à recevoir les internés.
Depuis la jeune fille qui, dans la rue, se dépouillait de sa
fourrure, la jetait sur les épaules d'une évacuée, et répondait
à M. Moser : « Je la donne parce que c'est l'objet que j'aime le
mieux, je l'ai reçue à Noël... » jusqu'aux ouvriers les plus
dénués, tous participèrent à cette collaboration d'un peuple
essayant d'en consoler et d'en soulager un autre.
A partir de ce temps-là, Schaffhouse nous est devenue doublement
chère.
M. Moser et M. Spahn avaient réuni un comité de cent trente-neuf
personnes, leur demandant avant tout de la douceur, de la bonté,
comprenant bien que ce qui importait avant tout, ce n'étaient
pas les objets distribués, mais la tendresse et le réconfort
moral : il s'agissait de donner à nos hôtes l'impression qu'ils
avaient retrouvé une famille.
Le convoi arrivait entre trois et quatre heures de l'après-midi.
Lorsqu'on avait effectué le transbordement des bagages dans le
train suisse, les internés, répartis en plusieurs escouades,
étaient confiés aux membres du comité, qui les emmenaient
goûter.
Gentiment on les conduisait le long des rues; les jeunes
Schaffhousoises se chargeaient des enfants, donnaient le bras
aux vieillards, et la population les escortait. Les voyageurs
regardaient autour d'eux les chaussées pavées si propres et si
tranquilles, les maisons aux grands toits, cette figure honnête
et soignée de la petite ville, cet aspect de bonhomie souriante
et ils répétaient, songeant à leur propre village: - Comme c'est
calme par ici !...
A leur passage, les portes des magasins s'ouvraient. De braves
gens leur offraient quelque friandise, leur serraient les mains.
Des femmes se tenaient sur les seuils. Des mouchoirs
s'agitaient.
Non, ce n'étaient pas des rues étrangères, ces rues que les
exilés voyaient pour la première fois. Il leur semblait revenir
dans quelque endroit aimé naguère où des gens qui n'étaient pas
des inconnus les accueillaient de tout leur coeur. Eux qui,
depuis des semaines et des mois, se heurtaient à l'hostilité des
êtres et des choses, il leur semblait s'éveiller d'un long
cauchemar, sortir brusquement de ce malheur où ils étaient
enfermés.
Les conductrices arrêtaient leur escouade devant l'auberge qui
lui était désignée, une de ces auberges qui gardent, à la mode
antique, une enseigne balancée au-dessus de la porte, et qui,
semblables aux auberges d'autrefois, conservent quelque chose de
la maison familiale, un air de dignité, une hospitalité affable.
On entrait. Dans la grande salle claire aux boiseries luisantes,
d'une irréprochable netteté, la table était dressée. On
installait tous les hôtes, on leur servait le café au lait, on
les encourageait à manger avec des propos gentils, et beaucoup
étaient si émus à ce premier repas affectueusement offert,
qu'ils se mettaient à pleurer. Les jeunes filles s'efforçaient
de leur rendre mille petits services nécessaires : lettres,
télégrammes à envoyer, renseignements à donner.
Il fallait surtout, avait recommandé M. Moser, que les rapatriés
se sentissent libres.
Alors, après le goûter, on les promenait dans les plus jolies
rues anciennes de la cité. Et à chaque pas c'étaient de
nouvelles marques de cette sympathie discrète qui s'exprimait
par un geste, un mot, un don furtif...
Si le temps était beau, on allait jusqu'aux chutes du Rhin. Et
les voyageurs muets contemplaient l'admirable paysage. On
prenait le tramway pour rentrer. Et quelques-uns, penchés aux
portières, se retournaient, regardaient encore. Ils emporteront
dans leur coeur la chère silhouette de Schaffhouse... ils
conserveront avec leurs souvenirs tragiques, ce souvenir riant.
« Ce voyage, écrivait une fillette de retour à Paris, restera
gravé dans ma mémoire toute ma vie, car j'ai eu l'occasion de
visiter des choses qui m'étaient inconnues ; j'avais bien
souvent entendu parler de la Suisse, si jolie, mais mon
imagination ne pouvait voir ce que mes yeux ont admiré. Je suis
bien heureuse de retourner à l'école pour recommencer à
travailler et raconter à ma maîtresse et à mes compagnes tout ce
que j'ai vu d'intéressant en Suisse. Je me représente encore le
Mont-Blanc et la chute du Rhin et toutes les montagnes de la
Suisse... » Et elle signe : « Votre petite rapatriée, Madeleine.
» Une évacuée écrit d'Annemasse: « Ce voyage ne s'effacera pas
de mon coeur... » Une autre: « Jamais j'ai rencontré du monde
aussi aimable que dans cette Suisse... » Ah ! toutes les lettres
qui sont venues: écritures élégantes, billets bien tournés,
formules impeccables exprimant des sentiments sincères, et
pauvres et touchantes missives sans orthographe, où des mains
malhabiles se sont efforcées de traduire l'émotion
persistante... Nous ne pouvons les citer ici.
Mais elles prouvent, une fois de plus, combien M. Moser avait eu
raison de chercher dans notre peuple son principal collaborateur
et de lui laisser toutes les facilités d'accomplir son oeuvre
modeste, obscure et si douce: aider à consoler.
L'une après l'autre, chaque escouade passait au vestiaire
admirablement organisé. On faisait défiler les évacuées devant
de longues tables chargées d'objets triés et étiquetés.
Chacune pouvait indiquer les vêtements qui lui étaient le plus
nécessaires et choisir. Il y avait des trousseaux d'enfants et
des layettes. Et il y avait aussi du linge et des habits pour
les hommes.
Ceux-ci se montraient souvent fort discrets.
- Il ne faut pas me donner tant de choses, disait un vieux
paysan qui avait perdu tout ce qu'il possédait. Il ne restera
plus assez pour les autres...
Le plus beau moment de la journée était le repas du soir. Chaque
escouade revenait à l'auberge désignée, retrouvait la salle, la
table déjà familière. Les victimes s'habituaient à cette
atmosphère nouvelle, à ces visages qui, si vite, leur étaient
devenus chers.
Elles se sentaient à l'aise, au milieu d'amis.
Et beaucoup se reprenaient à sourire. M. Moser leur adressait
quelques mots d'affectueuse bienvenue. Il leur disait la joie
que le peuple de Schaffhouse éprouvait à les accueillir. Un
Français se levait et lui répondait. Parfois, c'était un vieux
paysan malhabile aux paroles et qui, tout de même, tenait à
exprimer son remerciement.
Une société chorale ou quelque orchestre survenait au dessert.
On jouait un air suisse.
Et souvent on chanta la Marseillaise. Les rapatriés souriaient.
Et beaucoup se détournaient pour pleurer.
Lorsqu'à dix heures, on les installait dans le train qui les
emmènerait à Genève, ils emportaient l'impression d'une fête
intime, d'une réunion de famille sérieuse et douce, une famille
attristée par ses deuils, mais qui retrouve dans l'affection de
ses membres le courage de vivre. Penchés aux portières, ils
cherchaient, une dernière fois, à travers l'obscurité, la
silhouette de la ville. Et ils apercevaient, massés sur le pont
de fer, des groupes de Schaffhousois qui étaient venus leur dire
adieu.
On avait organisé dans la gare même une infirmerie. Un seul
convoi amena cinquante-six tuberculeux. Lamentable défilé des
brancards.
C'était à la fin d'octobre 1914. Le train venait d'arriver.
Plusieurs civières avaient déjà pris le chemin de l'infirmerie.
On sortit d'un wagon un pauvre hère d'une maigreur effrayante,
blême, le visage inondé de gouttes de sueur. Il paraissait
mourant. On l'emporta. On le coucha sur un des lits. Un peu plus
tard, une infirmière fut très surprise de retrouver « le mourant
» en train de dévorer tout ce qu'on lui présentait. Il était
réveillé de sa prostration. Il montrait sa casquette où le mot
de sourd-muet était inscrit, et il remerciait par signes. Il
n'avait plus qu'un bras et il était tuberculeux. Sur le lit
voisin, on avait couché un vieillard phtisique, à qui une
infirmière faisait boire une tasse de cacao. Lorsque réconforté,
il put enfin parler, il déclara qu'il serait mort en route si on
ne l'avait secouru.
Il était de Soissons et il s'informa de sa ville. Là-bas... on
lui disait que Paris était pris, que la France était vaincue.
Mais personne ne voulait le croire.
L'infirmière, craignant qu'il ne se fatiguât, lui recommanda de
dormir jusqu'à l'heure du départ. Alors le vieillard répondit: -
On n'a pas sommeil en si agréable compagnie ! Le pauvre vieux
moribond, apporté là comme un triste bagage, trouvait une
aimable parole à donner
En a-t-elle vu passer des vieux, cette infirmerie de
Schaffhouse ! Paysannes ratatinées, ayant gardé leur bonnet, un
fichu noir croisé sur leur poitrine, traînant leurs sabots, et
portant à la main, conservant soigneusement quelque objet
hétéroclite sauvé dans la bagarre, défendu pendant tout le
voyage: celle-ci, sa chaufferette, celle-là une terrine
contenant du beurre fondu. Les unes demeurent présentes et
loquaces. Elles ne savent point lire. Elles n'avaient jamais
quitté leur village. Elles n'auraient jamais pensé qu'il y eût
tant de pays dans le monde. Elles connaissent toutes sortes de
vieilles coutumes d'autrefois, invoquent l'autorité du meige ou
du rebouteur, appellent le docteur, « M. le vétérinaire », ou
encore « M. le curé... » énumèrent des remèdes bizarres auxquels
elles croient de tout leur coeur.
Et elles énoncent sur les événements qui bouleversèrent leur vie
des jugements inattendus:
- La guerre... on n'aurait jamais cru que c'était si terrible...
- L'autre fois, les Prussiens ne nous avaient pourtant rien
fait...
- L'autre fois, ça ne peut pas se comparer. ..
Quelques-unes ont l'air démentes : la catastrophe a chaviré leur
esprit, les jetant dans une enfance dont elles ne sortiront
plus.
Un paysan voûté, à l'allure cassée, n'avait emporté que la clef
de sa maison détruite, tout ce qu'il possédait désormais, une
clef monumentale et compliquée. Il la tenait à la main, et
lorsqu'il mangeait, il la posait à côté de lui. Et cette clef
inutile était la seule chose qui fût encore précieuse pour ce
vieil homme tragique dont les yeux semblaient toujours
contempler la figure de son malheur.
La plupart de ces désemparés se taisent, s'enfermant dans une
tristesse résignée. Ils ne savent plus bien où ils sont. Depuis
si longtemps on les transporte, on les parque comme un bétail !
Ils gardent seulement le souvenir confus d'un désastre
inexplicable tombé sur leur tête, les arrachant à tout ce qu'ils
ont aimé pendant trois quarts de siècle et davantage, les
arrachant aux mille petites choses qui composaient leur
existence, les maintenaient encore debout, agissants et vivants.
Désormais, ils ne sont que des épaves. On ne pourra plus les
rendre à eux-mêmes. On ne réparera pas le mal qui a été fait.
Ils ne reprendront racine nulle part.
On les amène. On les remmène. Ils sont dociles comme de tout
petits enfants. Ils remercient avec politesse. Ils semblent
perdus dans un rêve et ne savent pas clairement où commence la
réalité. Ils avaient autour d'eux des visages hostiles. A
présent, par un juste retour des choses, ils rencontrent des
visages amis qui leur sourient. On leur donne le bras dans la
rue s'ils peuvent encore marcher. Ils voient emporter sur des
civières les plus faibles d'entre eux. Ils vont, tassés,
courbés. L'un d'eux me dit en tournant vers moi son visage aride
où la chair semble déjà morte: - Ma femme, elle est restée au
pays...
Est-ce que je la retrouverai ? On ne s'était jamais quittés...
Ils ont assisté au pillage, et puis à l'incendie de leur ferme.
Ils ont vu leur bétail, si bien soigné, qui s'enfuyait. Ou bien
ils ont vu emmener leurs vaches et leurs boeufs.
L'un d'eux, éleveur de chevaux, à qui l'on avait pris toutes ses
juments, tous ses poulains, est devenu fou.
Un autre, dans le train qui l'emmenait en Allemagne, répétait à
chaque station: - Je veux descendre... Il faut que j'aille
donner à manger à mes bêtes.
Pauvres vieux paysans des Ardennes, de la Meuse ou de Lorraine
dont le geste, répété jour après jour pendant un si long espace
de temps, devient comme un rite... Ils ont semé leur blé et
soigné leur bétail. Peu à peu, la prospérité est venue. Les
petits-enfants grandissaient autour d'eux. C'était l'humble
bonheur humain, si nécessaire. Et tout cela fut en quelques
jours dispersé, détruit...
Alors ils cessent de comprendre.
Dans un village près de Saint-Mihiel, une grand-mère tenait sa
petite-fille de trois ans sur ses genoux. Un éclat d'obus
éventra l'enfant et blessa les deux mains de la vieille.
Hébétée, elle regardait le cadavre, qu'elle n'avait pas lâché,
tout ce sang auquel le sien se mêlait. Le lendemain, il fallut
partir pour l'Allemagne, on la mit dans le train avec sa fille,
la mère de l'enfant morte, une malheureuse qui ne cessait pas de
pleurer, et qui, toute seule, avait soigné les mains blessées,
les avait bandées comme elle avait pu. La grand-mère, pétrifiée,
revoyant sans cesse le petit corps saignant sur ses genoux, ne
versait pas une larme.
A Metz, les Allemands la firent descendre, tandis que sa fille
était forcée de poursuivre jusqu'à Rastadt. Et ce fut là, à
Rastadt, après de nombreuses démarches faites par un officier
allemand qui se montra humain, que cette femme apprit la mort de
sa mère, quelques jours plus tard.
Toutes ces souffrances que personne ne saura, souffrances
obscures et déchirantes...
Jamais nous n'aurons trop de pitié...
Un rapatrié me dit: - J'avais avec moi mon garçon de dix-huit
ans... Il est mort là-bas... Je reviens tout seul...
Une vieille femme déclara: - Je sais bien qu'on ne devrait pas
rester si près des frontières... Mais qu'est-ce que vous
voulez... puisqu'on est né là-bas ! Les faits se brouillent dans
leur mémoire.
L'interminable voyage actuel se confond déjà avec l'affreux
voyage qu'ils ont fait à travers l'Allemagne, lorsqu'ils furent
arrachés à leur sol. Les noms des pays se mêlent. En Allemagne ?
en Suisse ? en France ? Ils ne savent plus. Ils savent seulement
que leur « pays », leur ferme, le clocher de leur village
n'existe plus, qu'ils ne reverront pas l'horizon familier.
Une vieille femme sourde, voyant des sourires, des mains tendues
vers elle, ne comprenant pas qu'elle était en Suisse, criait de
toute sa force: - Vive l'Allemagne ! On essayait en vain de la
faire taire.
Une autre dit: - Dans cette ville de « Eingang » on a été bien
bon pour nous...
Tous ces vieux hommes, ces vieilles femmes que nous avons vus
défiler à Schaffhouse, à Zurich, à Genève, se traînant aux bras
de nos commissaires, portés dans l'automobile, charriés sur des
civières, inertes, jambes pendantes, visages figés, minables
paquets humains, à qui la souffrance arrache parfois un cri,
vieux perclus, vieilles paralysées, phtisiques, asthmatiques,
les uns à demi aveugles, d'autres sourds, d'autres égarés,
toujours pareils et toujours nouveaux, flot lamentable qui ne
cessait de s'écouler, ah ! qui donc saura évoquer cette misère
incomparable et sans précédent ? Nous les retrouvions à
Annemasse, écroulés dans un coin de la salle d'attente: - Où
allez-vous ? - Je ne sais pas...
Ou bien ils ne répondaient pas, branlaient leur morne figure.
- Mais n'est-ce point par ce train-là que vous partez ? Un
hochement de tête, -i- Je ne sais pas...
Indifférence du désespoir. Une fatalité les jette ici, les
renvoie là... Pauvres vieux que l'on prenait sous le bras, que
l'on hissait dans les wagons, un passant charitable poussant,
d'autres tirant, et qui tombaient affalés sur une banquette et
dont le silence hébété semblait dire:

- Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand irons-nous ainsi
? Ah ! tout ce
peuple des vieux que nous avons vus passer... leurs larmes
lentes, leur effrayant mutisme... S'ils s'étaient plaints, on
aurait pu du moins chercher à leur donner s un peu d'espérance.
Mais ils ne se plaignaient jamais. Quelques-uns avaient une
parole enfantine, un remerciement naïf, comme s'ils n'en
revenaient pas de trouver un peu de douceur éphémère au milieu
de cette catastrophe qui n'en finissait plus.
Et nous qui les contemplons, étendus sur les matelas de
l'infirmerie, ou assis dans un coin, la tête basse, les épaules
voûtées, leurs mèches grises en broussaille, les membres gourds,
leurs mains noueuses devenues toutes molles, nous ne pouvons
nous figurer qu'ils furent un jour, il y a quelques mois, des
vieilles alertes et actives, de beaux vieux solides qui
conduisaient leur charrue, et qui, arrivés au bout du champ, se
redressaient et souriaient à leur sillon, et le soir, fumaient
leur pipe, sur le banc devant leur ferme, et, le dimanche, se
promenaient par groupes en discutant les affaires du village,
tout en suivant de l'oeil les gars qui les devançaient.
Villages de France aux noms harmonieux, dont les seules syllabes
évoquaient de vieilles maisons sereines, des fermes d'autrefois,
des clochers aux lignes pures, et, tout autour, les champs qui
gravissent les collines, des horizons mesurés, tant de douceur
et tant de grandeur, des profils d'arbres qui se suivent le long
des calmes rivières où les femmes courbées lavaient le linge en
chantant, villages ignorés dont les noms sont tout à coup
devenus célèbres et tragiques, lorsque vos églises, sonnant le
tocsin, se répondirent à travers la campagne, lequel de vous a
pressenti le sort qui l'attendait ? Qu'êtes-vous devenus
aujourd'hui ? Maisons éventrées, fermes détruites, débris
calcinés, clochers abattus, vous êtes pareils à vos vieux
paysans ruineux : silence et désespoir. Corps à demi détruits.
Corps d'où l'âme, pour avoir trop souffert, s'est évadée. Leurs
familles sont dispersées; leurs enfants sont perdus.
Les villages, on les reconstruira sans doute. Et dans les
campaniles neufs les cloches sonneront de nouveau. Au flanc des
troncs brisés monteront les jeunes futaies.
A côté des souffrances anciennes et inoubliables, des bonheurs,
peu à peu, patiemment, se reprendront à vivre.
Mais parmi ces vieux coeurs, combien demeureront inconsolés ?
Combien s'en iront à la mort, jusqu'au bout, muets et navrés ? L'infirmerie de Schaffhouse a vu défiler des misères sans nom.
Beaucoup d'enfants étaient malades. Ils toussaient. Ils avaient
de la fièvre. D'autres étaient épuisés. Et c'était une pitié que
ces pauvres corps minables que les mères, au cours de leur
exode, n'avaient pas pu soigner. Beaucoup de rapatriés
arrivaient avec une angine, une infection qui a particulièrement
sévi dans les casemates de Rastadt, et dont les infirmières schaffhousoises furent atteintes à leur tour plus ou moins
gravement. Aucun des cent trente-neuf membres du comité n'en fut
entièrement indemne. Plusieurs en souffrirent pendant des
semaines. Une jeune femme n'était pas encore guérie huit mois
après. Une jeune fille, Marguerite Biedermann, en est morte.
Lorsque je contemple, sur le quai de la gare, ce groupe de
jeunes filles aidant les évacuées à porter leurs bagages, ou,
dans les rues, conduisant le lent cortège, j'évoque toujours au
milieu d'elles, la silhouette de Marguerite Biedermann.
Elle avait vingt-quatre ans. Elle était l'unique enfant du
président du Conseil des bourgeois de Schaffhouse. Jeune fille
ardente et modeste, elle se détournait déjà de la vie trop
facile et rêvait d'être une artiste.
Elle a laissé la peinture pour devenir infirmière7 Et tandis que
son père assumait la responsabilité du lourd service de
l'hospitalisation des internés, et que sa mère s'occupait du
vestiaire, elle se consacra aux arrivants malades. Pendant
quatre mois, chaque jour, elle fut à son poste. En outre, très
souvent, elle accompagna à Genève les convois, passant les nuits
au travail, ne cessant d'aider et de consoler les misérables
voyageurs.
Lorsqu'elle fut atteinte de ce mal que connaissent tous ceux qui
ont soigné les internés, elle continua sa tâche, oubliant sa
santé, luttant jusqu'au bout. Elle dut s'arrêter enfin, et
souffrit plusieurs semaines avant de mourir.
Elle est tombée sur un champ de bataille, accomplissant son
devoir, pareille à tant de jeunes héros obscurs qui meurent en
défendant leur sol.
Nous ne pouvons pas énumérer ici tous les drames dont cette
infirmerie de gare fut le témoin. Nous en retiendrons un seul.
Un soir, le commissaire fédéral de Schaffhouse fut averti qu'à
l'infirmerie se trouvait une malade qu'il serait dangereux de
laisser partir, car elle menaçait de se suicider. Il se rendit
auprès d'elle immédiatement. Il trouva une très jeune femme
étendue sur un des lits et que des crises de sanglots secouaient
toute, un pauvre être affolé qui s'abandonnait. Alsacienne, elle
ne parlait pas le français. Il réussit à la calmer un peu, à
obtenir des paroles entrecoupées, et il put reconstituer son
histoire.
Elle avait épousé à dix-sept ans le comptable français d'un
grand établissement industriel en Alsace. Au début de la guerre,
son mari, comme tous les Français de la ville, fut convoqué à la
mairie. Le lendemain, ils partaient pour Rastadt. Les femmes et
les enfants assistèrent à ce départ. Il y eut des embrassements
déchirants. Les hommes montèrent en wagon. Le jeune comptable,
bouleversé par cette scène atroce, - il avait fallu arracher sa
femme de ses bras, - donna déjà des signes d'une surexcitation
que ses compagnons essayaient vainement de calmer.
A une station allemande, où l'on fit descendre les prisonniers,
personne ne sut très bien ce qui se passa, mais on vit le
désespéré lutter contre des sous-officiers allemands.
Une bagarre s'ensuivit. Le prisonnier reçut un coup de
baïonnette. On l'entraîna. Le lendemain, ses compagnons
apprirent qu'il avait été fusillé. On renvoya à sa famille ses
vêtements perforés.
Cependant, la petite veuve, qui ignorait son malheur, était
envoyée en Allemagne et internée. Dans le train qui la
rapatriait, par un compagnon de son mari, elle venait
d'apprendre la vérité... Elle ne connaissait personne en France;
elle n'avait là-bas que sa belle-mère, qui s'était opposée à son
mariage.
Elle ne voyait plus devant elle qu'une perspective : la mort.
Le commissaire écouta tout cela. Il comprit qu'il n'y avait
qu'un seul moyen de sauver cette enfant. Il la prit avec lui et
l'amena à sa femme. Et la petite veuve est devenue l'enfant de
la maison. Elle a rappris à sourire.
A dix heures du soir, tout le monde est installé dans les
wagons. On fait étendre les enfants. On tâche de donner quelque
confort aux vieux.
Un peu avant onze heures, le convoi s'ébranle au cri de : Vive
la France, jeté par les Schaffhousois, penchés sur le pont. Les
mouchoirs s'agitent. Des saluts s'échangent entre inconnus qui
ne sont plus des inconnus; gestes d'affection lancés dans les
ténèbres et reçus par ceux qui s'en vont.
Le train roule à travers les campagnes toutes noires. Lorsqu'on
passe dans les wagons, on s'arrête, ému, devant tous ces petits
endormis. Ces familles nombreuses des départements du Nord,
cinq, six, sept, dix enfants... On les a groupés comme on a pu.
Ces petits frères et soeurs, couchés deux à deux sur les
banquettes, mêlent leurs cheveux. Parfois, les mères réunissent
sur leurs genoux deux têtes blondes, deux ronds visages presque
semblables, confondant leurs calmes haleines. Elles nous
adressent un signe de tête, un sourire au passage : « Oui, ils
dorment bien. Ça va, merci. » Et elles reprennent leur rêverie
somnolente, la tête appuyée contre la paroi, les yeux clos, au
milieu des petits immobiles. Les ombres creusent leur visage,
accusent les plis de chagrin et d'angoisse. Elles pensent au
père qui se bat, et dont enfin elles auront des nouvelles... Ah
! quelles nouvelles ? Elles pensent aux vieux restés dans le
village envahi, au fils aîné que les Allemands ont retenu...
Nous allons d'un wagon à l'autre, et c'est toujours le même
tableau, des mères qui songent, des vieillards qui sommeillent,
et des nichées de tout petits, dont les mines heureuses mettent
comme un sourire au milieu de toute cette détresse.
Parfois une femme solitaire, qui ne peut pas dormir, encouragée
par ce silence du wagon, se met tout à coup à parler à voix
basse. Elle raconte son histoire, histoire confuse et tragique,
toujours la même et toujours nouvelle, avec des détails
inattendus, et des mots qui vous font tressaillir... Souffrances
inédites, drames vivants, récits de captivité ou de mort,
journées de terreur, visions de massacre... La vie humaine ne
comptait plus... dans la rue la voisine gisait, trouée par les
balles; de braves gens paisibles, qu'on avait toujours connus,
fusillés contre le mur...
- Le ciel était gras de fumée noire et rouge par place...
- A trois heures du matin, tous les habitants étaient sur pied,
soignant leur bétail au plus vite, pour partir...
- Nous nous étions arrêtés sur une petite montagne, près d'un
poste de la Croix-Rouge.
Les soldats nous faisaient voir que l'armée française avançait,
caria cavalerie disparaissait à nos yeux à l'horizon dans une
étendue incalculable. Mais vers onze heures, on voit
réapparaître la cavalerie, le ravitaillement venait vers nous,
nous ne savions ce que cela voulait dire. Les soldats de la
Croix-Rouge ne disaient plus rien...
C'est une paysanne qui raconte, d'une voix monotone. Elle porte
encore de l'épouvante sur son visage figé.
- A onze heures et demie, un fermier vint vers nous, son chapeau
à la main. On le croyait fou. Il nous dit que les Allemands
l'ont fait sortir de sa maison, qu'ils sont tout près de nous.
En effet, nous voyons des coups de fusil sortir par les
fenêtres. On s'inquiète, quand, tout à coup, nous voyons
incendier une ferme tout près de notre maison... Ce fut comme un
coup de foudre. Les balles passaient au-dessus de nous, sifflant
au-dessus de nos têtes, on ne voyait que la pointe rouge.
Ce fut une course folle. Tout le monde avait les yeux agrandis
par la terreur.
Mais le village où ils se réfugièrent fut envahi presque
aussitôt.
Une autre a vu, dans un bois, une femme accoucher d'un enfant
mort, tandis que les autres enfants demeuraient autour d'elle.
- Il était six heures du soir. Un commandant nous dit de partir.
Et la pauvre femme, je ne sais ce qu'elle est devenue. Nous
étions des mille personnes pour fuir...
Une autre dit: - Ma voisine a accouché dans un champ entre les
deux armées...
- J'ai vu mon mari tué à l'entrée d'un jardin, dit une jeune
Lorraine qui porte un misérable deuil; je me suis sauvée dans
une cave avec ma petite fille blessée. Je ne savais plus où
étaient mes deux garçonnets. Et puis, au lever du jour, je les
ai cherchés : ils avaient passé la nuit sur le corps de leur
père...
Ces choses effroyables sont racontées comme des choses toutes
naturelles avec une simplicité qui nous donne le frisson.
J'observe une femme encore jeune, assise à côté de sa fille de
dix-huit ans, et qui demeure en silence, les yeux grands
ouverts.
Elle a un visage maigri et comme durci, et cette expression
figée que nous connaissons bien : à cette expression, dans les
villages de Savoie où ils sont hébergés, nous distinguons tout
de suite les émigrés qui ont vu la guerre.
A son tour elle parle. Elle parle d'une voix monotone et rapide
comme si elle craignait de n'avoir pas le temps de tout dire :
sans cesse de nouvelles scènes reviennent à son esprit, se
pressent sur ses lèvres. Puis elle se tait. Sa fille continue le
récit. Et la mère l'interrompt pour rappeler un détail oublié.
Étrange et terrible dialogue. Elles sourient parfois. Elles
n'élèvent point la voix pour ne pas réveiller le wagon endormi.
Mais, en dépit du sourire et des intonations tranquilles, comme
on sent que l'horreur habite en elles et ne les quittera jamais
plus ! Elles étaient de Combres, un village de la Meuse, non loin
de Saint-Mihiel. Le 7 septembre il fut envahi une première fois
par les Allemands qui demeurèrent six jours puis durent se
retirer. Le 27 septembre, le bombardement commença. Les
habitants s'étaient réfugiés dans leurs caves. Puis on entendit
à toutes les portes de formidables coups de crosse. Les
Allemands étaient là. Les habitants terrorisés assistèrent au
pillage des maisons.
- Chez nous, ils ont trouvé un sac plein de cartouches qu'un
soldat français avait oublié.
Alors ils se mirent en colère. Un Allemand a jeté le sac par
terre et frappa dessus à coups de crosse. Une cartouche fit
explosion et la balle perça le plafond... Moi, je m'étais
réfugiée dans une chambre tout en haut avec mon fils... Quand
j'ai entendu le coup de feu, j'ai cru qu'ils avaient fusillé mon
mari et ma fille... le garçon a pris mal, nous n'osions pas
ouvrir la porte, nous avions peur de voir... Enfin, mon garçon
est allé sur l'escalier, il a crié : « Maman ! notre Madeleine
est là... et papa aussi, ils sont vivants ! » Quelles minutes...
- Le lendemain, on a fait sortir tous les habitants des maisons,
on les a réunis dans la rue. La mitraille passait au-dessus de
nos têtes. Cette fois, c'étaient les Français qui bombardaient
le village. Nous n'osions pas parler, car les sentinelles
avaient reçu l'ordre de nous imposer silence.
Au bout d'une heure d'attente, un officier s'avança vers cette
foule dont on se représente l'affolement silencieux, toutes ces
femmes, ces enfants, ces regards...
Et l'officier leur a dit, en désignant le sommet où se trouvait
l'emplacement des batteries allemandes: - Suivez-moi ! C'est la
jeune fille qui raconte maintenant et sa voix tremble un peu: -
Il n'y avait pas de doute, nous allions partir à la bataille.
Tout le monde se met à gémir. Et voilà qu'un obus éclate et
blesse une femme et un jeune homme. Tous nous nous enfuyons pour
nous abriter auprès des maisons. Mais l'officier se fâche et
répète l'ordre de marcher. Nous nous embrassons, nous pleurons,
nous sommes résignés à mourir, puisqu'il le faut. Des
sentinelles nous suivent; nous marchons en rang ; nous arrivons
au sommet de la côte des Hauts-de-Meuse et là, on nous fait
asseoir au grand soleil. La mitraille a cessé un instant. Bien
tôt, ça recommence de plus belle. Les canons allemands
répondent. Et nous sommes placés si près qu'il nous semble être
à côté d'eux. On se couche tout près les uns des autres...
- Oui, interrompt la mère. Mais moi je ne voulais pas que nos
quatre têtes se touchent, pour ne pas être tués tous à la fois.
Les enfants me disaient: « Si tu meurs, nous voulons mourir
aussi. . » Elle s'arrête et retrouve un détail.
- Quand nous étions au pied delà colline, j'ai vu, derrière
nous, M. le curé entouré de trois sentinelles. Les bombes
arrivaient. Je tournai lentement la tête et je vis M. le curé
qui, au passage d'une bombe, fit rapidement le signe de la
croix. Il donnait l'absolution à tous ses paroissiens...
Imagine-t-on ces paysans sans défense, ces femmes et leurs
petits offerts à un tel supplice ? Ces familles prosternées
contre le sol, les cris des enfants cramponnés à leur mère, les
pères assistant à cela...
A quelque distance, des soldats allemands creusaient des trous
pour s'abriter, sans doute. Alors toutes sortes d'idées
traversèrent les esprits affolés.
- Ils préparent nos fosses... Ils vont nous faire sauter...
La jeune fille continue: - A six heures du soir, on nous ordonne
de nous lever, de nous ranger, de suivre de nouveau les
sentinelles. Nous arrivons à l'église. Les femmes sont renvoyées
dans les maisons pour rapporter de la nourriture aux hommes qui
doivent rester à l'intérieur de l'église. Ma mère et moi
pénétrons d'abord dans la cuisine : tout était renversé, sens
dessus dessous... Nous marchons dans un fouillis d'objets, de
papiers, d'ustensiles... tout était pillé... Nous avons retrouvé
deux pots de confiture cachés dans la cheminée.
Dans l'église, on s'organisait au milieu d'un profond silence.
Il était défendu de parler... On partagea le pain. On s'installa
sur des bancs avec des couvertures que les femmes avaient pu
retrouver. De temps en temps, un officier et des soldats
faisaient le tour du parvis. Personne n'osa fermer l'oeil.
- A quatre heures du matin, on nous fit sortir. Et nous sommes
retournés à la bataille... à la même place...
Et cette femme disait cela comme si elle avait dit: - Nous
sommes retournés au marché...
La journée passa, lente. Il faisait chaud.
Deux civils furent autorisés à chercher de l'eau, escortés
parles sentinelles. Et toujours les obus qui s'entrecroisaient.
A cinq heures du soir, un officier déclara: « Vous allez tous
être fusillés ! » - Il prononçait : « fusilés », dit la jeune
Française qui, même à ce moment tragique, ne perdit pas sa
finesse d'observation.
Ce fut alors qu'au milieu des lamentations du troupeau affolé,
une jeune fille de vingt-quatre ans, Jeanne Beyer, s'interposa.
Elle alla droit à l'officier, et, sans trembler, lui adressa la
parole avec politesse et netteté.
- Pourquoi voudriez-vous nous fusiller ? N'avons-nous pas
toujours fait ce que vous nous demandiez ? Vous n'avez donc ni
parents, ni frères et soeurs, ni femmes que vous nous faites
souffrir ainsi ? Alors il redevint calme, et un moment après, il
se retira.
Et ces quelques mots évoquent toute la scène : l'officier
surpris, regardant cette villageoise qui se tenait là, devant
lui, et osait le questionner. Autour d'elle, la cohue des
paysans qui se taisaient, saisis par cette audace, repris
d'espoir en entendant cette jeune voix courageuse qui prenait
leur défense. Et l'officier, vaincu, s'en allant.
A la tombée de la nuit, ils descendirent des Hauts-de-Meuse et
retournèrent dans l'église, où, après une distribution de pommes
de terre bouillies, ils se couchèrent sur les dalles pour
dormir.
Le lendemain, ils pensaient retourner « à la bataille». Il n'en
fut rien. Six jours passèrent.
Les femmes faisaient la cuisine sur les pierres tombales, au
cimetière. On changeait de linge (on en possédait peu) dans le
confessionnal.
Un matin, on leur annonce que Combres va être bombardé. Et on
les emmène à Herbeuville, distant de deux kilomètres. Les
habitants d'Herbeuville sont enfermés dans l'église. Les gens de
Combres demeurent debout au milieu de la route. Des bombes
éclatent. Alors ils se laissent tomber à terre, s'asseoient sur
les fumiers. Un ordre passe: tous les hommes de Combres et d'Herbeuville
doivent se ranger, car ils vont partir.
Les femmes poussent des cris, se cramponnent à leurs hommes.
Minute atroce.
Jeanne Beyer s'avance et demande à l'officier: - Monsieur,
voulez-vous nous permettre, à ma soeur et à moi, d'accompagner
notre vieux père, âgé de soixante-dix ans ?
- Mademoiselle, répondit-il, nous allons trop loin, nous partons
pour Metz.
Pour Metz ! Si loin... en Allemagne. Quand les reverra-t-on ?
Quand reviendront-ils ? Dernières étreintes, embrassements
désespérés.
Rien ne fut épargné à ces gens de Combres et d'Herbeuville.
On vit partir le long cortège des hommes qui se retournaient,
regardaient sans cesse en arrière.
Et les femmes durent s'en aller du côté opposé... deux cortèges
de gens qui s'aiment, arrachés les uns aux autres.
Les femmes et les enfants retournèrent à Combres et passèrent
encore quatre semaines enfermés dans l'église. Le 18 octobre, on
les fit partir. Et le 23, ils couchaient dans les casemates de
Rastadt.
Sans paroles, j'écoutais ce récit, et parfois, je détournais les
yeux des deux mornes visages, et je regardais la campagne
ténébreuse sous le ciel voilé. Et il me semblait que toutes ces
souffrances, celles qu'on énumérait ainsi, et celles qu'on
n'avait pas dites et qu'on devinait, nous poursuivaient à
travers la nuit.
L'histoire continue, semée de ces détails qui rendent un son
d'authenticité, - sans une injure : ces femmes au ton posé
disent le bien comme le mal.
C'est la jeune fille qui parle.
- En Allemagne, dans le train, nous n'avions pas de pain. On en
a donné aux soldats. Et les soldats ont partagé avec nous.
La mère reprend: - On avait mis les malades sur des
charrettes... et il y en avait des malades ! On avait emporté
une vieille femme enveloppée dans son édredon. Elle est morte en
route. Alors, au premier village, on s'est arrêté devant le
cimetière. On l'a enterrée toute chaude...
- Oui, dit un vieil homme assis en face de nous, et qui écoute
en silence, ce qu'elles racontent-là, c'est l'histoire de tous
nos villages...
Il se tait. Et il regarde à travers la vitre les arbres noirs
défiler sur le ciel brouillé.
Une paysanne âgée qui n'a point encore parlé, immobile, les deux
mains jointes sur son tablier, prononce tout à coup: - Ah ! la
guerre est un grand malheur...
Mes yeux font le tour du wagon, contemplent ces femmes immobiles
et muettes au milieu des petits sommeillant. Et j'imagine le
train qui a passé hier, celui qui viendra demain : les mêmes
groupes, des expressions semblables, des drames parallèles, un
concert de douleurs éclatant tout à coup. Et je vois la France
envahie, et la Belgique, et la Pologne, et la Serbie... toute
cette chair à souffrance...
Mon Dieu !
LE CORTÈGE DES VICTIMES
ZURICH
Ce fut surtout à partir du
mois de mars 1915, l'arrêt des convois d'évacués étant plus
prolongé, et le train du matin, dirigé directement sur Zurich,
que Zurich organisa sa part de travail.
Au petit comité qui avait fonctionné jusqu'alors et qui avait
d'ailleurs peu à faire, puisqu'il s'agissait d'apporter
simplement des boissons chaudes dans le train, un groupement
plus vaste s'adjoignit.
Les convois arrivaient désormais à sept heures du matin, pour ne
repartir qu'à dix heures et demie.
Deux cents personnes environ ont travaillé à la gare sous les
auspices du comité. Il y avait beaucoup de besogne chaque jour,
pour préparer la réception du lendemain. Et, chaque matin, il
s'agissait de faire déjeuner, se laver et de pourvoir de
vêtements cinq cents personnes, de baigner, d'habiller de neuf
les enfants, de soigner les malades.
Jamais on n'eut de peine à recruter les infirmiers et les
infirmières bénévoles. Tous d'ailleurs se sentaient soutenus par
le mouvement magnifique de la population. On peut dire que la
ville de Zurich, comme celle de Schaffhouse, se consacra à cette
oeuvre. Riches et pauvres, et les plus pauvres parmi les pauvres,
collaborèrent. Ceux qui n'avaient pas d'argent donnaient leur
temps. Une crieuse de journaux a cousu cinquante-deux chemises
d'enfants. On recevait chaque jour des paquets anonymes,
lainages, tricots, vêtements. Sur un de ces paquets, il y avait
cette inscription : « Parce que je sais ce qu'est la misère, je
donne ce vêtement. » Une paysanne vint un jour trouver le
président du comité. Elle avait au bras son panier de marché et
elle portait le petit bonnet des femmes de la campagne
zurichoise. Alors, s'étant assise, elle sortit un gros
porte-monnaie rustique et dit en patois zurichois: - Monsieur le
pasteur, chaque fois que je viens au marché vendre mes oeufs, je
mets quelques sous de côté, et au bout de l'année, je les donne
aux plus pauvres. On m'a dit ce matin que ces gens qui passent à
la gare sont les plus pauvres de tous. Est-ce vrai ? M. Cuendet
l'affirma. N'avaient-ils pas tout perdu ? Alors elle vida dans
son tablier le contenu du porte-monnaie. On compta ces pièces de
vingt et de cinquante centimes. Il y avait plus de trente
francs.
Elle s'en allait. Mais, reprise de défiance, sur le pas de la
porte, elle se retourna et demanda encore, pour être bien sûre:
- Ils sont bien les plus pauvres, Monsieur le pasteur ? Il
répondit: - Arrangez-vous donc pour les voir passer, quand nous
les menons au Musée. Et si vous trouvez qu'ils ne sont pas les
plus pauvres de tous, je vous rends votre argent.
A quelques jours de là, comme il conduisait dans la rue le lent
troupeau si misérable, il s'entendit tout à coup interpeller à
voix très haute, et il reconnut, parmi la foule qui regardait,
massée sur le trottoir, la femme de l'autre jour.
- Monsieur le pasteur ! Oui, c'est vrai ! Certainement, ils sont
les plus pauvres de tous... Tenez encore...
Et elle vidait son porte-monnaie qui contenait douze francs
cinquante, la recette de la matinée.
Un autre jour, Mme Cuendet reçut une visiteuse d'aspect très
modeste, aux allures timides, qui refusa la chaise qu'on lui
offrait, se tint debout près de la porte, et tout à coup, sans
rien dire, tendit un billet de mille francs, et puis s'en alla,
refusant de se nommer, « parce que, pour ces choses-là, il ne
faut pas dire son nom... » Quelque temps plus tard, le président
vit entrer dans son cabinet une femme toute simple, qui fit le
même geste, ne voulut pas s'asseoir, et déposa sur la table un
billet de mille francs. Stupéfait, il la regardait: avec son air
de travailleuse pauvre, si décente et timide, elle lui rappelait
la description que sa femme lui fit de la première visiteuse.
- Ne voulez-vous pas me laisser inscrire votre nom ?
demanda-t-il.
Elle secoua la tête avec la même parole: c'était « bien inutile
» et d'ailleurs « on est tous frères »...
Et elle partit.
Il n'était pas remis de son émotion lorsque Mme Cuendet rentra.
Et elle lui dit: - C'est étrange... je viens de rencontrer dans
l'escalier la donatrice de l'autre jour.
Il répondit: - Elle a encore apporté mille francs pour les
rapatriés français...
Ce ne sont pas seulement les choses données qui émouvaient tous
ces malheureux, c'était plus encore l'affection que leur
témoignaient les Suisses alémans, la tendre compassion de leurs
gestes, tous ces menus services qu'ils s'efforçaient de leur
rendre, « alors qu'il y avait si longtemps que personne ne
s'était occupé de nous »...
Si nous relevons ces faits, ces chiffres et ces touchants
témoignages, c'est qu'il nous paraît nécessaire de fixer ces
choses qui prouvent la sympathie que nos compatriotes de la
Suisse orientale ont éprouvée pour les Français exilés, cet élan
de tout un peuple

qui tenait à affirmer sa solidarité envers les victimes de la
seule manière qui lui appartînt, en donnant son coeur, en
apportant ses offrandes.
Nos hôtes l'ont bien senti: ils disaient avec cette intuition
affinée par le malheur: - Ce n'est pas la même langue... mais
les coeurs sont pareils...
Il y avait plus qu'une sympathie affirmée, il y avait une
protestation, toute la révolte des consciences en face d'une
semblable guerre, dont on savait bien que ceux-ci n'étaient pas
responsables.
Les villes où les trains d'évacués ne s'arrêtent que quelques
minutes, ont tenu à prendre leur part de l'oeuvre commune. Une
amie, membre du comité de Berne, m'a raconté ce fait: Dans le
courant de l'hiver précédent, ayant besoin de vêtements pour les
rapatriés français, elle adressa à tous les journaux bernois un
court appel, rédigé en allemand qui, dès le lendemain, fut
publié. Les journaux de l'après-midi paraissent vers quatre
heures. Elle était sortie de chez elle. Elle rentra un peu après
six heures. Elle fut stupéfaite : des paquets étaient déjà venus
en grand nombre. Alors elle se mit à pleurer.
Les jours suivants, les dons continuèrent à affluer, remplissant
les chambres, montant, me dit-elle, jusqu'au plafond. Il fallut
deux emballeurs travaillant pendant quatre jours avec six
personnes pour expédier ces dons.
Un grand nombre de localités, et notamment Saint-Gall et
Winterthour, envoyèrent des vêtements à Zurich, à Schaffhouse, -
à Buchs pour les rapatriés italiens.
Dans le canton de Fribourg, chaque village apportait à son tour
ses offrandes.
A ces évacués français, est-ce nous qui avons donné ? Et
n'est-ce pas à eux que nous sommes redevables des heures les
moins amères de ces derniers mois, celles où nous avons senti
l'unanimité des coeurs suisses, les volontés unies dans le grand
effort mené en commun. Ah ! comme nos malheureux hôtes nous ont
rapprochés ! Ils ont été le trait d'union entre nos frontières
extrêmes, Schaffhouse, Genève. Et si nous avons bien souvent
admiré leur résignation, la sérénité qu'ils avaient su garder,
si nous avons aimé la vivacité de leur coeur que le malheur a
amolli, attendri, rendu sensible aux moindres nuances de
l'affection - nous les avons aimés encore pour ceci : ils nous
rendaient à nous-mêmes.
Le comité de Zurich a reçu des rapatriés d'admirables lettres de
remerciements.
« J'avais le coeur gros de voir ce pays si plein de tendresse »,
écrivait un vieil évacué.
« Croyez, je vous prie, à notre sympathie éternelle pour votre
pays... » écrivait un autre. Ils disaient de la Suisse: « La
nation à jamais notre soeur... » Il y avait aussi des lettres
collectives, comme celle des cinq cents évacués français, du
département de la Marne, réunis à Dijon avant de se séparer: «
Ils ne sauraient dire combien, après les longs mois de
souffrance sous l'occupation ennemie, l'accueil chaleureux,
fraternel qui leur a été fait à Zurich et à Genève, a été pour
eux réconfortant.
« Ils savaient la Suisse hospitalière et compatissante pour ceux
qui souffrent; mais les soins, la bonté dont ils ont été
l'objet, les ont pourtant surpris et confondus. Et pénétrant en
Suisse, il leur a semblé rentrer dans leur propre patrie.
« Plus encore que cette attention pourtant précieuse, la
sympathie universelle et vibrante partout témoignée pour la
France, leur a été au coeur.
« Pas plus que les soins si intelligents et si dévoués qu'ils
ont reçus, ils n'oublieront jamais les cris de « Vive la France
» poussés constamment sur leur passage, « Et c'est pourquoi en
décidant que cette lettre serait envoyée aux Comités de Zurich
et de Genève, pour les remercier de leur réception, ils ont
poussé une fois encore avant de se séparer ce cri de
reconnaissance: « Vive la Suisse ! » Voici encore une lettre qui
fut adressée d'une petite ville de Seine-et-Oise au comité de
Zurich et qui est signée de cent trente-trois noms.
« Profondément touchées par le récit que vient de leur faire une
évacuée de Meurthe-et-Moselle, au sujet de l'accueil fraternel
et si bienveillant reçu en Suisse, les Dames de la Ligue
patriotique des Françaises de notre ville, se font un pieux
devoir de témoigner tout particulièrement leur profonde
reconnaissance pour les témoignages si touchants de sympathie,
les attentions si délicates...
... Cet accueil a été un premier réconfort et comme un baume
cicatrisant sur la cruelle et nouvelle plaie faite à leur coeur,
en les arrachant à leurs foyers, après déjà tant de souffrances
endurées pendant plus de huit mois de captivité, sous le joug
allemand si pénible et humiliant.
Soyez assurées, chères amies de Suisse, que nos coeurs de
Françaises sauront vibrer toujours pour vous, et ne vous
oublieront jamais. » Il y eut enfin la lettre des petites
écolières de l'école de Trévoux, si touchante et si belle, et
qu'on voudrait citer tout entière (nous ne citons ces témoignages, parmi beaucoup d'autres, qu'à
titre purement documentaire. Ils nous paraissent de nature à
dissiper un douloureux malentendu en éclairant les sentiments
véritables du peuple suisse alémanique à l'égard des Français.
D'ailleurs ces témoignages spontanés sont tout à l'honneur de
ceux qui les ont signés.): « O chers amis suisses, nous
avons pleuré d'émotion et de reconnaissance...
... On nous a lu en classe les articles de journaux qui
racontaient comment étaient reçus à Schaffhouse, à Zurich, à
Lausanne et à Genève, nos compatriotes internés en Allemagne.
Nous en avons vu arriver à Trévoux, la ville où se trouve notre
école.
C'était un dimanche de février. Nous entendons encore leurs voix
qui chantaient la « Marseillaise » à leur entrée en gare. Et dès
le lendemain, nous avons su par eux quel accueil ils avaient
reçu de vous. Ils étaient sales et vous les avez nettoyés,
accomplissant sans répulsion cette besogne si peu attrayante;
ils avaient faim et vous les avez nourris; ils avaient froid et
vous les avez réchauffés. Ils n'avaient que des vêtements en
guenilles et vous leur avez donné de chauds vêtements; nous
avons vu les bons polos si chauds et encore immaculés, les
cache-nez, les vestes, etc., que la veille ils avaient reçus de
vos mains. Nos malheureux frères étaient tristes, désemparés
après tant de souffrances et tant de misères, et vous avez eu
pour eux des paroles d'affection, de tendre pitié. A ceux qui
pendant six mois et plus avaient subi une dure servitude chez
l'ennemi vous avez compris que rien ne pouvait être plus doux
que d'entendre l'air si réconfortant et les paroles vengeresses
de notre chère « Marseillaise » et, délicate attention qui nous
a touchées plus encore que le reste, vos jeunes filles la leur
ont chantée. Durant nos vacances de Pâques, nous en avons vu
d'autres de ces malheureux prisonniers et ils nous ont dit les
mêmes choses avec la même reconnaissance qui faisait trembler
leur voix.
Alors, nous aurions voulu voir un Suisse pour lui dire, nous
aussi, quelle gratitude, quelle admiration gonfle notre coeur
pour votre noble nation. Mais puisque nous ne pouvons pas le
dire, nous avons décidé de vous l'écrire. Il faut que vous le
sachiez.
Déjà en étudiant notre histoire, nous avons appris à connaître
votre bonté. Nous savons qu'en 1871 vous avez reçu avec le même
coeur les malheureux soldats de Bourbaki. L'autre jour nous
écrivions en dictée un passage de nos grands écrivains qui
racontait l'entrée de nos soldats en Suisse. Une phrase nous est
restée dans l'esprit comme un tableau que nous n'oublierons
jamais. « A ce spectacle, les habitants assemblés par centaines,
les mains chargées d'offrandes, pleuraient. Ils étaient accourus
des villes, ils apportaient des vêtements, du pain, de l'argent,
de la viande, des boissons; les plus pauvres donnaient. » Chers
Suisses, aujourd'hui comme en 1871, vous nous montrez que la
pitié, la bonté, la charité existent toujours, bien que depuis
des mois et maintenant même à cette heure où nous vous écrivons,
le canon tonne, des hommes se massacrent.
Pour tout cela, du fond du coeur, chers Suisses, merci. Merci
pour toutes ces pauvres mères, tous ces enfants, tous ces
vieillards que vous avez nourris, vêtus et réconfortés.
Merci en notre nom à nous, petites pensionnaires françaises qui
sommes vos voisines, puisque notre département touche à votre
pays. Et merci aussi, nous pouvons le dire, nous en sommes bien
sûres, au nom de toute la jeunesse de France qui souffre, admire
et espère en ce moment terrible et grandiose.
Nous, cette jeunesse qu'on appelle la France de demain, nous
n'oublierons pas.
La troisième année de l'École primaire supérieure de Trévoux,
Département de l'Ain.
Suivent les noms de trente-deux élèves.
Par cette froide matinée de décembre 1915, il fait encore nuit
noire, lorsqu'à sept heures et demie le train est annoncé :
quatre cent quatre-vingt-dix-huit personnes, dont cent
trente-neuf enfants au-dessous de douze ans, venant de Lille.
Il arrive très lentement. Aux portières se pressent de pâles
petits visages autour des figures fatiguées des mères. On fait
descendre les voyageurs, wagon après wagon. On les conduit par
escouades numérotées dans les deux vastes salles du buffet, et
au fur et à mesure, on les distribue le long des tables.
Aussitôt la première escouade assise, les portes se rouvrent
pour laisser passer les occupants du deuxième wagon, puis du
troisième. Ainsi, rapidement, sans bruit, avec un ordre
surprenant, conduits par les jeunes Zurichoises en blouses
blanches, les cinq cents convives sont installés. Figures
mornes, lasses, ahuries... Jeunes femmes tristes, au milieu de
leurs petits, quelques vieillards, quelques très jeunes garçons,
point d'hommes... Allure de citadins pauvres; ici et là un
groupe de paysans. Ce sont des habitants des villages
environnants. Ils furent évacués sur Lille.
Pour la seconde fois, pour la troisième, ils ont dû se remettre
en route, abandonner le logis de hasard.
Beaucoup ont des mines effarées et inquiètes. Ou leur avait dit
là-bas qu'ils seraient mal reçus en Suisse... Des vieux
refusaient de partir...
Déjà quelques rapatriés se mettent à sourire.
Tout en servant leurs enfants, les femmes laissent échapper des
paroles. Elles disent la vie si chère, le manque d'argent, les
tracasseries, l'angoisse, les bombes tout récemment tombées...
L'une d'elles ajoute: - Ah ! c'est quand on a des enfants... Si
l'on n'avait pas d'enfants, on n'aurait que son corps à
penser...
Au bout d'une table se trouvait un -vieux prêtre. Nous en avons
vu passer de ces vieux prêtres ! Leurs paroissiennes se
pressaient autour d'eux : c'était encore un peu de leur église
que les vieilles paysannes emmenaient avec elles; sa seule
présence les rassurait, évoquait le souvenir du clocher de leur
village au milieu de leur groupe éploré.
Cependant le prêtre s'est levé. Il a prononcé quelques
chaleureuses paroles.
Le président du comité s'approchant le remercia.
Et, lui tendant la main, il ajouta: - Monsieur le curé, nous
sommes confrères... je suis le pasteur protestant...
Le prêtre s'était levé. Il y eut une seconde de silence, puis il
s'écria: - Alors, Monsieur le pasteur, embrassons-nous ! Et ils
se sont embrassés.
Ce prêtre me demanda si nos soldats sont toujours aux
frontières. Et comme je lui répondais affirmativement, en
ajoutant que la garde est parfois dure à monter, sur les cols,
dans la haute montagne, par la neige, une femme d'aspect très
pauvre, à côté de lui, me tendit deux coupons de un franc en
disant: - Pour vos soldats...
Pendant ce temps, une section de territoriaux, qui déjeunaient
dans la salle contiguë, organisaient entre eux une collecte pour
offrir aux évacués de petits drapeaux suisses.
La première escouade a fini son repas. Le conducteur et la
conductrice la mènent au vestiaire. Les autres attendent leur
tour dans les salles chaudes du buffet.
On s'en va à travers la rue où le crépuscule s'éveille, où des
passants s'attroupent, émus et fraternels. On franchit la cour
magistrale du Musée, on descend dans un des sous-sols.
Les chaussures d'abord. Rapidement, les dames s'enquièrent des
besoins, examinent les pointures, trouvent pour chacun ce qu'il
faut. Puis ce sont les vêtements, le linge. Ici la table des
enfants. Là, les habits pour hommes. On se hâte sans confusion.
La première escouade est servie; on la fait écouler par une
autre porte au moment où le deuxième groupe arrive.
Sur le quai de la gare, en face de leurs wagons respectifs, les
rapatriés font une toilette sommaire autour des camions chargés
de cuvettes et de brocs d'eau chaude. Les mères démêlent les
cheveux des fillettes.
Comme ils sont blonds, ces petits enfants de Lille ! Le président
leur distribue des jouets.
On voudrait s'attarder dans le wagon-pouponnière : concert de
voix frêles, corps menus qui s'ébrouent, visages en miniature
qui pleurent et qui rient, et les jeunes filles, infirmières
bénévoles, penchées sur les baignoires, lavant, frictionnant,
puis habillant de neuf, transformant en beaux bébés soignés les
petits paquets malpropres arrivés tout à l'heure... Quel
triomphe ensuite lorsqu'on les rapporte à leurs mères et que
celles-ci hésitent une seconde avant de les reconnaître ! C'est
l'instant où les wagons s'ébranlent, où toutes les figures
penchées jettent encore un adieu. Le train est loin déjà, on
n'en aperçoit plus que la perspective rapetissée, et toujours
des mouchoirs s'agitent, encore, encore, jusqu'au dernier
instant où le dernier wagon disparaît dans l'éloignement.
Ainsi nous arrive l'écho des souffrances de Lille. Par
bribes, peu à peu, nous reconstituons l'histoire des derniers
mois.
Ce matin, au buffet, trois tables entières sont occupées par les
enfants de l'Assistance publique lilloise, garçons et filles.
Les filles ont jusqu'à seize ans, tandis qu'on n'a laissé partir
que les garçonnets. Pauvres petites figures si pâlottes et
chétives, si mornes, si tristes et si sages. Ils sont là, devant
leur pain et leur fromage, attendant la permission de manger. Le
médecin qui les accompagne espère pouvoir rentrer à Lille.
A plusieurs reprises, les Allemands ont apporté à l'Assistance
des petits enfants ramassés à côté de leurs parents morts dans

une ferme bombardée. Mais il est difficile de sauver les plus
chétifs : le lait manque. Heureusement, les Américains ont
envoyé du nestlé. Par moment, on n'a plus de charbon.
Et il faut allumer de l'alcool sur une assiette tout près des
bébés qu'on déshabille, afin de les préserver du grand froid.
Des évacués racontent que la fièvre typhoïde commence à sévir.
Mais le plus dur martyre de Lille, c'est l'affreux silence qui
l'entoure : n'avoir aucune nouvelle des êtres chers dont on sait
la vie exposée à chaque minute, martyre des femmes et des mères,
angoisse qui pèse sur chaque instant de leurs journées.
En descendant de wagon, il en est qui pleurent, qui pleurent...
- Il n'a pas pu venir nous voir avant la guerre... Et
maintenant, il est parti, bien sûr... il est de la classe 17...
- Non, non, Madame ! La classe 17 n'est pas partie encore, vous
allez le revoir !
Oh ! cet éclair de joie sur ce visage inondé de larmes. D'abord,
la mère ne peut pas croire. Puis l'inquiétude revient. Et dans
un sanglot, elle murmure: - Mais il partira... Et je n'ai que
celui-ci...
- Au moment où la guerre a été déclarée, j'ai pu me sauver
avec ma femme et mes deux petites et ma soeur enceinte, et ses
cinq enfants. On a marché quatre-vingts kilomètres en six
jours.... jusqu'à trente kilomètres par jour... Nous portions
les plus petits tour à tour, quand ils ne pouvaient plus aller.
Le gamin de quatre ans a fait douze kilomètres en deux heures.
Les routes étaient si encombrées qu'on devait faire de grands
détours.
Une femme a perdu son bébé... On n'avait rien pu emporter... On
mangeait comme on pouvait. Des gens qui emmenaient leurs vaches
nous donnaient du lait pour les enfants. A Soissons, comme on
venait de passer un pont, le pont a sauté derrière nous...
Enfin, on a pu prendre le train... Mais, jamais, jamais, depuis
ce temps, on n'a pu avoir des nouvelles de nos vieux qui sont
restés là-bas.
Dans le wagon, où des familles de Roubaix sont entassées, je me
rappelle ce récit qu'un soldat blessé m'avait fait à l'hôpital,
et cette parole obsède ma mémoire: - Jamais, jamais on n'a pu
avoir de nouvelles...
Tant d'autres ont eu ce même cri de désespoir, des maris, des
pères, des fils... Je revois la tristesse de leurs yeux. Us
pleuraient la nuit sous leur couverture. Les fêtes de Noël
éveillaient en eux une souffrance intolérable. Chaque jour, à
l'heure où les camarades recevaient leurs lettres, ils passaient
un moment cruel. Je revois les yeux désespérés d'un jeune soldat
qui ne savait plus rien de sa femme et de ses quatre enfants...
- Savoir... seulement savoir s'ils sont encore vivants...
Maintenant, nous avons la contre-partie.
Nous entendons l'autre cri d'angoisse qui s'élevait des cités
envahies, le cri qui pendant un an et demi s'est perdu dans le
silence.
Ces voix pourront-elles se rejoindre enfin ? Pour combien
sera-t-il trop tard ? Combien n'auront plus de réponse ? Nous
venons de quitter Zurich. Une dernière fois nous avions regardé
les infirmières zurichoises et les membres du comité rangés sur
le quai. Au moment où le train s'ébranla, toutes les évacuées se
mirent à pleurer, émotion de l'accueil reçu, sentiment qu'elles
allaient à des certitudes qui seraient peut-être des certitudes
terribles. Quelques-unes essayaient d'exprimer leur
reconnaissance.
- On ne croyait pas le bonheur si près de nous...
- En Suisse... dit une autre, nous avons retrouvé la France...
- On ne pourra jamais oublier...
Puis elles ont repris leur place. On remonta les glaces. Et
chacune retomba dans ses pensées. L'angoisse coutumière, un
instant écartée, revenait s'installer en face d'elles.
Une jeune femme qui posait sur sa petite fille de longs regards,
laissait couler ses larmes. Par moment, elle égrenait un
chapelet. Ses grands yeux fixes semblaient regarder au delà des
choses.
Son mari se bat. Elle est sans nouvelles depuis le mois de
février. Et nous sommes en décembre.
- Ah ! dit-elle, j'ai tant demandé au bon Dieu de le
retrouver... Et la petite le prie tous les jours... Mais il y en
a tant d'autres qui ont demandé aussi et qui...
Elle se tait. Elle ne veut pas formuler sa pensée. Les mots trop
précis ne semblent-ils pas rapprocher le malheur ?
Ses compagnes de route aussi s'enferment dans de longs silences.
Dans tous leurs gestes, dans tous leurs regards, on sent l'idée
obsédante qui s'interpose entre elles et les choses...
Je ne puis détacher mes yeux de tous ces blonds petits, ces
beaux petits aux joues roses, qui jouent et babillent à côté des
mères, ces petits qui sont peut-être des orphelins.
Une toute jeune femme se tient dans un coin avec une fillette
sur ses genoux.
- C'est votre enfant ? - Non...
Elle a adopté ce poupon abandonné. Elle est ouvrière. Elle coud
des habits de soldats.
Elle s'en va à Paris auprès de sa mère.
- Oh ! j'espère bien que je vais trouver les miens en bonne
santé, et de l'ouvrage tout de suite, dit-elle en regardant
l'enfant.
Elle a perdu tout ce qu'elle avait et jusqu'à son carnet de
caisse d'épargne. On lui a tout pris. Elle redit avec une belle
énergie:
- Les choses matérielles, ça ne fait rien, pourvu qu'on se
revoie ! Elle me confie qu'elle tâchera de louer une chambre sur
le même palier que sa mère.
- Que dira votre mère, quand elle verra votre petite adoptée ?
Elle répond avec un joli sourire: - Ma mère accepte tous mes
rêves...
Et elle ajoute en confidence: - Voyez-vous, quand on se marie,
on n'est pas toujours heureux, n'est-ce pas ? Moi, j'aurai du
moins mon petit bâton de vieillesse.
Cependant les femmes se mettent à parler.
Elles échangent leurs inquiétudes et leurs souvenirs. Ah I la
vie à Roubaix... 10 francs le kilo de beurre. Beaucoup ne
mangeaient plus de viande... Si l'on n'avait pas eu le
ravitaillement américain, les farines, le riz, le lait
condensé... Les enfants n'ont point trop pâti. Les mères se
privaient pour eux.
- C'est surtout les souffrances morales qui étaient dures à
supporter, dit une jeune femme d'aspect modeste et fin. Le
reste, ça allait encore...
Une femme brune, énergique, de nationalité suisse par son
mariage, raconte qu'elle a essayé de se sauver. Elle a réussi à
sortir de la ville, avec sa fillette. Elles ont marché toute la
journée, se cachant, suivant les chemins écartés. Elle portait
la petite. Le soir, juste avant d'arriver à un village où elles
devaient dormir, un soldat allemand les a mises enjoué. Elle a
pris l'enfant dans ses bras et s'est arrêtée. Elle fut ramenée à
Roubaix et mise en prison.
- Presque toutes les femmes ont été en prison, déclare l'une
d'elles. Quelquefois, c'était pour être allée acheter des pommes
de terre à la frontière, en contrebande.
Et celles qui ont reçu en cachette, des lettres de leur mari...
Lettres arrivées mystérieusement, quelqu'un les apportait sans
rien dire, puis disparaissait. Quelquefois ils faisaient des
perquisitions, une voisine ayant trahi les heureuses
destinatrices. Et si la lettre était trouvée, ils faisaient
choisir à la femme de payer une amende ou d'aller en prison.
Et l'on avait si peu d'argent que, le plus souvent, on préférait
la prison. Ou bien c'était un de ces courriers secrets qui
s'était laissé prendre. Il était fusillé. Et les lettres qu'il
portait révélaient tous les noms des coupables. La punition ne
tardait pas...
Beaucoup de femmes, lorsqu'elles recevaient ainsi une de ces
lettres mystérieuses, savaient bien qu'elles feraient mieux de
la détruire. Mais elles ne pouvaient s'y résoudre... Détruire
cette lettre... la dernière peut-être, le suprême souvenir de
celui que l'on aime. Alors elles les cachaient. Elles trouvaient
des cachettes invraisemblables.
Elles énumèrent les mille vexations, les punitions continuelles.
- Au moment où il faisait le plus chaud, on nous a défendu de
sortir de nos maisons après cinq heures du soir...
Il fallait des sauf-conduits pour aller d'un quartier à
l'autre...
Elles montrent les sous de carton qui remplacent désormais toute
la menue monnaie.
Elles sont là, autour de moi qui racontent et s'émeuvent, citent
des cas, rappellent l'histoire d'une amie. Et toutes ces
histoires parallèles corroborent avec une inexorable précision.
Quelques femmes, par un mot d'un prisonnier en Allemagne,
avaient été avisées qu'un des leurs était mort...
D'autres n'ont jamais eu de nouvelles.
Des tout jeunes gens surtout, on n'a plus rien su... de ceux qui
sont partis le 9 septembre... Alors elles se mettent à raconter
l'affreuse chose. L'une, cette blonde à l'air si calme, parle,
les autres acquiescent, interrompent, retrouvent des détails
oubliés. Et dans d'autres wagons, d'autres femmes ont recommencé
le même récit.
Le 9 septembre 1914, comme les Allemands approchaient, on donna
l'ordre de partir à tous les auxiliaires qui n'avaient pas été
mobilisés le premier jour, aux jeunes gens de dix-neuf ans et de
dix-huit ans. Les premiers groupes ont pu passer... Mais les
autres... Les Allemands les ont aperçus et, les prenant pour des
francs-tireurs, ont ouvert sur eux le feu des mitrailleuses et
les ont cernés. Affolés, ces garçons sans défense, sans armes,
sous les balles, se sauvaient, se jetaient dans les fossés.
Quelques-uns ont pu rebrousser chemin et regagner Roubaix où ils
ont été repris plus tard. Beaucoup furent faits prisonniers,
beaucoup furent blessés ou tués. D'un grand nombre, on n'eut
plus aucune nouvelle.
Ceux qui rentrèrent ont raconté... Ah ! l'attente de ces mères...
J'écoute ces paroles et je me souviens. Que de fois nos pensées
allèrent aux cités dont nous devinions le martyre ! Et
maintenant, il semble que le rideau se soit soudain déchiré.
Nous assistons à leurs souffrances. Et nous ne pouvons rien pour
les soulager...
La campagne toute blanche miroite au soleil. Des villages se
lèvent au milieu des prés couverts de neige. Les maisons
bernoises au grand toit de tuiles ont succédé aux maisons
zurichoises. Aux fenêtres, dans les jardins, des familles sont
groupées, des enfants agitent des drapeaux français et nous
emportons leur cri de bienvenue. Et partout, le long des
chemins, dans les villages, aux passages à niveau, et jusque sur
la voie, par ce beau dimanche, des gens attendent et saluent.
A tous les arrêts, une foule se presse dans la gare, des mains
se tendent, des yeux pleins de larmes cherchent les yeux des
rapatriés.
Et lorsque nous sommes repartis, je me penche à la portière et
regarde au loin les groupes s'en aller lentement, les épaules
pliées. Je devine leur silence. Ils emportent avec eux le
malheur de ces êtres entrevus un instant, la douleur et
l'angoisse qui s'exhalaient de ce long train sinistre.
Et tout en cheminant du côté de leur village, ces hommes et ces
femmes sentent frémir en eux tous les liens qui les enchaînent à
leur sol et à leur maison, et ils pensent avec la paysanne
zurichoise: - Ceux-ci sont les plus malheureux...
Aujourd'hui, à l'obsession de ces cortèges de victimes, se
mêlent continuellement dans mon souvenir deux images : les
figures de deux villages dans la zone de guerre : un village
détruit, un village envahi...
Un village en première position dans la région de Reims, et dont
pas une maison ne restait debout. Des deux côtés de la route,
c'était une longue perspective de ruines hachées menu et que de
nouveaux obus émiettent continuellement. Par les trous béants
des pans de murs on apercevait les jardins encombrés de
pierrailles et qui essayaient de fleurir, une branche de lilas
épargnée, des rameaux de cerisiers.
On sait bien. On a lu dans les journaux.
Les évacués nous ont dit cent fois: - C'est tout détruit chez
nous...
Et cependant, tandis que nous marchions entre ces cadavres de
fermes, il me semblait ne pouvoir croire ce que mes yeux me
montraient et je me sentais aussi bouleversée que par un
désastre imprévu.
Voilà donc l'image qu'ils gardent en eux, que contemplent sans
cesse leurs yeux tristes et fixes que nous essayons en vain de
distraire. Que de fois ils nous ont dit: - Celui qui n'a pas vu,
il ne peut pas se figurer ! Et malgré tout, ils ne peuvent se
résoudre à quitter ces ruines ! Ici les deux dernières habitantes
ne sont parties qu'il y a deux semaines, parce qu'on les y
forçait; ces demeures éventrées, pour elles, c'était encore «
chez nous »; le grondement du canon qui retentit par intervalle,
ce long sifflement des obus qui nous fait tressaillir, elles y
étaient si bien accoutumées qu'elles ne l'entendaient plus.
Lentement nous sommes allés jusqu'à l'étrange silhouette qui se
profilait sur le ciel : le reste de l'église. Un morceau de
campanile épargné, un morceau de voûte qui tient encore on ne
sait trop comment, un morceau de portail dressant encore son
tympan de mosaïques : un Christ au milieu de ses brebis, et les
mots : « Je suis le Pain de vie. » Une statue de martyr
renversée au pied des marches soulève la tête et proteste de
tout son geste et de tout son regard.
Plus douloureux encore que le village détruit nous est apparu le
village envahi. Du poste d'observation nous l'avons aperçu, non
loin de nous, au milieu des prairies, silencieux et qui semblait
désert sous ses jeunes feuillages. Il est encore habité,
cependant.
Mais aucune fumée ne montait de ses toits.
Aucun paysan ne se courbait sur les terres voisines. Autour de
lui s'étendait la plaine fraîche et ensoleillée absolument vide,
rayée d'un bout à l'autre par les lignes claires des tranchées,
immense réseau blond qui enveloppe toute l'étendue, tranchées
françaises, tranchées allemandes qui se continuent comme un même
ouvrage incompréhensible, gravissent les ondulations et s'en
vont à perte de vue jusqu'aux collines lointaines. Seuls
arrêtent le regard les taillis de fils de fer barbelés. Ah !
cette plaine vide et mortelle, cette plaine si habitée
cependant, et dont tous les habitants sont invisibles ! Aucun
être humain sous peine de mort ne peut s'y montrer un instant.
Comment se représenter que là, tout près, à trois cent cinquante
mètres de nous, les Allemands sont terrés ? Comment s'imaginer
que de ces lointains si bleus, si doux, de ces harmonieuses
collines la mort à chaque instant, peut descendre, chaque fois
que nous entendons le canon ? Des yeux ennemis sont là, partout
autour de nous; rien ne leur échappe : un geste imprudent, une
tête inopinément sortie de la cachette, et c'en est fait.
Et c'est là ce qui nous obsède et qui nous point : ce paysage
vide déroulé autour de ces fermes, ces lignes vaporeuses des
collines, et la mort circulant à traversées choses, sous ce
grand soleil printanier, la mort toute seule, maîtresse de tout,
possédant tout cet espace où les hommes l'ont érigée, l'unique
promeneuse dans ces champs merveilleux, l'unique visiteuse du
village envahi.
Toujours nos yeux retournent à lui, si proche et plus
inaccessible qu'un village de l'autre hémisphère. La longue-vue
du commandant me permet de le contempler de tout près. Ces
fermes, il me semble que je vais les toucher, heurter à leurs
portes, entrer, chercher leurs habitants mystérieux. Ils sont
là, sans doute courbés, obéissants, subissant les milles
contraintes, les mille vexations. Ils sont chez eux et ne sont
plus chez eux. Ils ne sont plus maîtres de leurs affaires, de
leur temps, de leur bétail, à peine le sont-ils encore de leur
vie, sous la condition de ne point enfreindre les ordres. Ils
vivent dans la terreur, dans la tristesse et dans l'angoisse.
Leurs nuits sont hantées de cauchemars. Leurs heures se
traînent. Ils attendent. Et lorsqu'ils voient refleurir les
lilas, leur seule pensée est celle-ci : « Déjà la seconde
fois... depuis que nous sommes envahis... » Ils ne savent rien.
Savent-ils, en ce printemps 1916, qu'un espoir leur est donné
désormais ? De brèves nouvelles pourront enfin traverser le
cercle de fer, ils apprendront bientôt si leurs fils sont
morts...
Tandis que je contemplais le village tassé au milieu des champs,
si contraint et si morne, les paroles des rapatriés revenaient
flotter autour de moi, devenaient d'une réalité terrible en la
présence de celui qui souffrait. Et il me semblait entendre sa
plainte s'échapper de lui, monter des fermes oppressées, venir à
nous à travers ces étendues qu'elle emplissait de son désespoir.
Lille, Roubaix, Valenciennes et tant d'autres ! Cités muettes,
villages autour desquels le silence s'est établi depuis tantôt
deux ans, et dont l'expression désolée habite en moi désormais,
vous nous avez parlé à travers la voix de ces rapatriés qu'on
exilait de vous.
Votre souffrance ils nous l'ont fait pressentir.
En leur donnant nos soins, en recueillant leurs paroles, nos
coeurs s'élançaient jusqu'à vous...
Et nous savons aussi que l'espérance vous soutient, et que vous
vivez, tournés vers l'avenir.
LE CORTÈGE DES VICTIMES A
GENÈVE
Pendant des semaines et des
semaines, dès la fin de l'automne 1914, presque chaque jour, la
gare de Genève vit arriver des trains remplis de ces malheureux
voyageurs.
Dans leurs wagons, qui demeuraient fermés, les internés civils
se pressaient, tendaient leur visage. Ils regardaient les
commissaires rangés sur le quai. Mais aucun d'eux n'avait ce
geste quasi réflexe de se pencher et d'ouvrir la portière : ils
étaient habitués à la discipline.
Enfin on les faisait descendre. Ils se hâtaient lentement. Ils
avaient les mains embarrassées de bagages disparates, cartons
mal ficelés, filets gonflés, paquets cousus dans des toiles,
paniers, valises fatiguées.
Des femmes portaient leur tout petit, traînaient les aînés.
En un instant, le quai était envahi d'une foule silencieuse, à
l'expression misérable et triste. Des femmes, toujours des
femmes, des enfants, de très jeunes gens, des vieillards.
Figures lasses. Vêtements fripés et salis.
Ils ressemblent à s'y méprendre au convoi qui a passé hier. Ils
sont pareils à ceux qui viendront demain. Tous ont la même
attitude obéissante, et résignée, de gens accoutumés aux longues
patiences.
Ils avancent vers la sortie. Ceux qui sont en retard se mettent
à courir. Ils remplissent l'escalier, le passage souterrain.
Puis on les range en cortège, entre les commissaires, la police
civile, les sauveteurs auxiliaires, les Samaritains. Les voilà
en route pour l'école accueillante des Pâquis ou de la rue de
Berne. Lamentable cortège...
Le grand jour accuse les teints brouillés, les traits gonflés,
le désordre des costumes. Les uns ont les pieds si malades dans
leurs chaussures abîmées qu'il faut les aider à marcher.
On soutient des vieux qui sont trop las. Des femmes pleurent
silencieusement. Leurs voisines les prennent par le bras. Tous
s'entr'aident. Ils donnent l'impression d'une solidarité qu'on
ne sent pas chez les foules heureuses.
Ceux-là mêmes, beaucoup mieux vêtus que les autres, dont les
bijoux attestent la condition aisée ont une allure pareille de
soumission. On dirait un grand troupeau humain qui va docilement
à sa destinée.
Les moins malheureux sont ceux qui furent pris au milieu d'un
voyage d'été et qui achevèrent leur villégiature dans quelque
couvent, quelque usine abandonnée de la province française, dans
un camp de concentration de l'Allemagne occidentale. Témoin
cette vieille Française alsacienne:
- On avait bien travaillé pendant vingt-cinq ans... Alors j'ai
voulu conduire mes filles dans mon village d'Alsace. Nous étions
parties le 24 juillet...
Toutes les femmes encore jeunes sont séparées de leur mari,
retenu en pays ennemi, - pour combien de temps ? D'un geste
pareil elles serrent leurs enfants dans leur jupe, et elles
versent de pauvres larmes aussitôt refoulées.
A les voir, on pénètre soudain dans les situations effroyables
créées par la guerre.
Alors se révèle le désarroi de ces existences qui, du jour au
lendemain, se sont vues mises en dehors du droit commun,
retranchées du monde et séparées des êtres chers.
Françaises ayant épousé des Allemands, Allemandes ayant épousé
des Français, reniées par leur famille et que leur pays expulse,
malheureuses dont les frères combattent dans une armée et le
mari, parfois le fils, dans l'autre... Coeurs deux fois
déchirés... Leur muet désespoir met comme un masque sur leur
visage.
- On ne pouvait pas divorcer, n'est-ce pas ? - Et puis on s'aime
davantage après qu'on a tant souffert ensemble...
Quelques-unes de ces femmes solitaires nous disent: - Je vais en
Allemagne où je ne connais personne... Je ne sais pas
l'allemand... Comment va-t-on nous recevoir là-bas ? Tout le
passé leur est arraché, et elles n'osent pas regarder l'avenir.
Un jour arriva un convoi de Hongroises et d'Italiennes de
Dalmatie. Toutes les jeunes avaient des enfants aux bras.
Beaucoup étaient très jolies avec leurs yeux ardents, leurs
dents brillantes et leur teint basané. Elles portaient sur leur
chevelure noire et nattée, des mouchoirs éclatants. Par ce jour
triste de fin d'automne, il semblait qu'un peu de splendeur
orientale fût entrée dans cette salle.
Malgré leur évidente misère, ces femmes ne semblaient point
abattues ni surprises. Sans doute les voyages ne les étonnent
guère. Et elles ignorent les complications de la vie civilisée.
Nous évoquions, en les contemplant, les tribus de Tziganes
errant dans les plaines dénudées de la Mer Noire.
Je revois l'une d'entre elles, une femme en cheveux, toute
ridée, à la peau dorée, aux membres fins, et qui parlait un
allemand incompréhensible. Une gitane, sans doute.
Elle avait des fils qui jouaient dans un orchestre et qu'on a
retenus « là-bas ».
- Elle a voyagé toute sa vie, dit un vieillard qui s'était
approché pour servir d'interprète.
La vieille nomade ne pouvait plus supporter ses souliers qui la
blessaient. Sans doute, était-elle habituée à accomplir pieds
nus tous ses voyages.
On lui donna des espadrilles en étoffe.
Radieuse, elle y introduisit ses pieds minces.
Et elle remercia en saluant, un salut si souple, si souriant, et
si digne à la fois, que l'une de nous, impressionnée, déclara: -
Elle a l'air d'une reine.
Une reine... possédant bien plus qu'un royaume circonscrit,
possédant tout l'espace, toute la beauté du monde, cette vieille
femme qui « a voyagé toute sa vie », préférant au bien-être la
liberté sans borne de celui qui ne possède rien.
Et je revois un autre nomade, ce berger aux cheveux gris, en
houppelande brune et en sabots, qui apportait avec lui comme une
évocation de l'existence patriarcale, une vision de la tente, du
feu de bivouac, des longues marches solitaires à travers la
campagne, derrière les moutons déambulant sans se hâter, pressés
les uns contre les autres.
Tout l'après-midi il se tint dans la cour avec son chien « pour
ne pas déranger le monde ».
Il retournait dans son pays, en Alsace.
- On a toujours du travail pour les bergers...
Il a une fille, mariée en Suisse. Mais il ne peut se rappeler
l'adresse, le nom de la ville...
Il l'a perdu. Alors, il n'a plus au monde que son chien. Et il
est si reconnaissant parce qu'on adonné de la nourriture à
l'animal ! Une dame du comité promit de le lui garder pendant
qu'il irait souper aux Cuisines populaires avec le convoi. Quand
il revint, il déclara: - C'était un repas de noce ! La dame lui
remit une écuelle pour qu'il pût faire boire son chien pendant
le voyage.
Il remercia, en ajoutant: - Ça fera pour nous deux...
Et en disant adieu, il promit à celle qui avait soigné son seul
ami: - Quand je serai là-bas, je vous écrirai une lettre...Mais
je voudrais vous demander de me répondre.
Elle dit: - Je vous le promets...
Les plus pitoyables sont ces défilés de vieux hommes qui
semblent encore plus dénués, plus abandonnés du sort que les
femmes.
Ce vieil ouvrier a travaillé en France toute sa vie. On lui dit:
- Pourquoi ne vous êtes-vous pas fait naturaliser ? Il répond: -
Je ne pouvais pas... Je n'ai jamais pu...
Je gagnais quatre francs cinquante par jour...
Ce chiffonnier, petit, tassé, qui parle le français sans accent,
voilà soixante ans qu'il vit en France... Et il en a
soixante-sept. On l'a opéré deux fois de la cataracte. Il n'y
voit plus bien.
- Le jour, ça va encore, dit-il. Mais quand il fait un peu
sombre, je ne sais pas où je suis.
Nous lui avons donné un pardessus. Il n'en a sans doute jamais
possédé. Il déclara qu'il était a comme un prince ».
Un autre, Un vieux berger, tout perclus de rhumatismes, se
traînait, appuyé sur sa canne.
Il parla de son troupeau, trois cent quatre-vingts moutons et
trois chiens. Quarante moutons étaient à lui. Ils représentaient
les économies de toute sa longue existence. Quand on est venu le
chercher, il a dû les laisser, n'ayant pas le temps de les
vendre : ainsi il a perdu tout son avoir... Il avait encore un
chien dont il dut se défaire. Il ne possède plus rien. Et dans
le hangar où il couchait sur de la paille, il avait attrapé ces
douleurs...
- Maintenant, dit-il, je ne pourrai plus garder les moutons...
Il faudra m'assister...
Les victimes de la guerre ! Ce ne sont pas seulement les beaux
soldats pleins de force qui donnent leur vie, ou qui reviennent
infirmes, avec une existence diminuée. Pour ceux-ci, il y a la
gloire, le sentiment d'avoir

rempli un devoir essentiel; il y a des décorations, des
pensions, et surtout l'estime, l'admiration de tous leurs
proches, de leur pays entier.
Mais qui consolera les victimes obscures ? Tous ceux qui, sans
savoir, souvent sans comprendre, se sont trouvés pris dans la
catastrophe, et paient, eux aussi, de leur santé, de la petite
aisance péniblement conquise, de tout leur bonheur, quelquefois
de leur vie. Ils ont, eux aussi, fait leur devoir pendant toute
leur existence... Et le malheur qui s'est abattu sur eux a ceci
d'aggravé qu'il leur semble inexplicable et qu'il ne sert de
rien à la Patrie.
Ces victimes-là, ce sont des populations entières sur qui
l'invasion a passé, qui ont vécu des semaines et des mois
d'épouvante, pour qui la vie ne redeviendra jamais plus « comme
avant ». Ah ! lorsqu'on essaie de faire la somme de tant de
souffrances, on se sent pris d'angoisse et d'épouvante. Il
semble que l'on n'ose pas regarder plus avant...
Les semaines coulèrent. Nous avons vu arriver les habitants des
localités proches de la frontière, qui avaient été refoulés en
Allemagne, ou emmenés prisonniers au moment de l'invasion :
Longwy, Audun-le-Roman, Blamont, Cirey, Badonviller, Dompierre-au-Bois,
et tant d'autres villages ; ces jolis noms de France prennent
aujourd'hui une résonnance douloureuse.
Lorsque ces femmes et ces hommes descendent de wagons, chargés
de leurs bagages hétéroclites, pauvres objets ramassés à la hâte
au milieu de l'affolement du départ soudain, entassés dans des
hottes, pliés dans des toiles, serrés dans de vieux havresacs
salis qui ont vu la guerre, sans doute, ficelés dans des sacs de
pommes de terre, ils donnent l'impression saisissante de
l'exode. L'exode de tout un peuple, terrifié par l'incendie, les
obus, fuyant sous la menace des ennemis, emportant ses petits,
oubliant dans l'effarement de la dernière minute, les choses
indispensables. Et lorsqu'ils sont rassemblés sur le quai de la
gare, comme une agglomération de malheureux, tous nous disent
ces mêmes paroles: - Nous n'avons plus rien... nous n'avons plus
que ça...
Avant de les emmener, il s'agit de leur faire déposer leur
bagage. Ce n'est pas toujours facile. Les vieilles femmes
retournent sans cesse à leurs paquets, ne voulant pas se laisser
persuader qu'on les leur rendra plus tard, à Annemasse.
Dans ce naufrage, ces pauvres choses sont tout ce qui reste de
leur bien. Elles tremblent de les perdre encore.
- Donnez-moi votre panier, on va vous conduire en automobile,
disait un commissaire à une vieille invalide qu'il aidait à
marcher.
- Non, non, je ne le donne pas, je veux le garder avec moi, on
me le prendrait ! Et d'un geste éperdu elle serrait contre elle
ce panier qui contenait une petite cafetière et un pot de
confiture, - son seul avoir désormais.
Sept heures du matin sonnent. Il fait encore nuit. Une aube
d'hiver, lente à venir. Le train vient d'arriver. Les évacués
français remplissent la grande salle des bagages : des
vieillards alignés sur les bancs, des femmes au milieu de
groupes d'enfants. Ils ont un aspect de misère, des attitudes
d'abattement, le teint plombé; une expression de tristesse
terrifiée est comme fixée sur leurs traits immobiles. Ce sont
des habitants des départements dévastés de la Meuse et de la
Marne, qui furent emmenés en Allemagne et que Ton rapatrie au
nombre de trois cents environ.
Dans le petit jour maussade, par une pluie battante, on les
conduisit au restaurant. Les rares passants s'arrêtaient au bord
du trottoir et les regardaient avec consternation.
Les gens de ce quartier, habitués cependant à voir défiler des
convois lamentables, n'avaient point encore assisté à une
pareille détresse...
Un ouvrier se dépouilla de son manteau, le jeta sur les épaules
d'un vieux et s'éloigna à la hâte.
Après qu'on eut servi le café au lait, le cortège se reforma et
reprit sa marche jusqu'à l'école de la rue de Berne.
Les commissaires aidaient à porter les enfants. La plupart des
petits toussaient.
Une fillette, que la bronchite et la fièvre rendaient toute
faible, était tombée dans la boue.
Des femmes avaient des pantoufles de lisière imprégnées d'eau.
Les pauvres vieilles allaient péniblement, toutes voûtées. Des
vieux se traînaient, appuyés sur des cannes. Beaucoup
s'emmitouflaient dans des châles et des écharpes toutes neuves,
contrastant avec leur dénuement, et qu'on leur avait donnés à
Schaffhouse
Il faisait jour à présent. Le convoi avançait très lentement sur
le pavé trempé.
Lorsqu'on se retournait et qu'on voyait ces faces tristes,
blêmes et si lasses, cette foule de malheureux qui déambulaient
sous la pluie, les larmes venaient aux yeux.
Ils semblent avoir pris une sorte d'habitude de leur infortune,
des longues pérégrinations, des interminables fatigues.
Ils furent refoulés d'un lieu à un autre lieu. Ils ne savent pas
où on les emmène. Ils disent : « Quand nous serons en France,
qu'est-ce qu'on va faire de nous ? » Ils n'ont plus un endroit
où ils voudraient aller, où ils soient attendus et chez eux.
Leurs villages, Saint-Rémy, Dommartin, Dompierre-au-Bois, Mouzay,
et d'autres encore, ont été bombardés et incendiés. Les maisons
qui restent encore debout sont entièrement pillées. Quelques-uns
disent: - Pourvu qu'on nous donne du travail !
C'est le seul voeu que nous leur ayons entendu formuler.
Cependant l'automobile des Samaritains avait déjà amené à
l'infirmerie les plus impotents : des vieillards paralysés, une
réfugiée devenue folle, et de pauvres vieilles que leurs jambes
se refusaient à soutenir. Tous les lits sont occupés. Et, dans
le couloir, cinq femmes décrépites, alignées sur un banc,
attendent leur déjeuner.
Leurs idées s'embrouillent. Elles ne savent où elles sont. De
leurs enfants dispersés, elles n'ont plus de nouvelles. Elles
confondent les pays qu'elles ont traversés. Ici... là...
ailleurs... qu'importe... Mais elles se rappellent, jusque dans
ses moindres détails, la chose terrible : leurs maisons qu'elles
ont vu dépouiller... leur bétail qu'on leur a pris.
- On avait bien travaillé pendant cinquante ans... pendant
soixante ans... puis voilà...
Se représente-t-on à quoi équivaut un tel désastre pour des
paysans dont toute la vie, tous les efforts ont gravité autour
de la ferme, du champ, du bétail ? Avec leur masque figé qui ne
s'étonne plus de rien, elles semblent effondrées sur les ruines
de leur existence.
Cependant, là-haut, dans la salle chaude, les sinistrés
paraissent un peu réconfortés.
Ils causent.
Lorsque, devançant l'invasion, en août 1914 les habitants de la
Meuse s'enfuirent vers le coeur de la France, ceux-ci avaient
refusé de partir, préférant rester dans leurs villages avec leur
bétail.
- Ah ! si l'on avait su, puisqu'on a tout perdu quand même...
Et ils se mettent à raconter la dévastation systématique de
leurs fermes : le pillage de la vaisselle, du linge, des
meubles...
- Nos beaux meubles... soupire une vieille femme.
Et elle énumère : les buffets, les armoires, les cuves, les
pressoirs détruits à coups de hache, les planchers enfoncés et
jusqu'aux portes démolies, leurs petites affaires abîmées,
déchirées, jetées au fumier. Une femme dit: - Cela me retournait
le coeur...
- Et le bétail...
- On nous l'a pris, on ne nous a pas donné de papier... Il ne
nous reste plus rien « chez nous », plus un lapin.
La plupart d'entre eux ont subi l'épreuve atroce du
bombardement. Les Allemands les faisaient se réfugier dans
l'église.
- Mais dans nos granges, nous aurions été plus à l'abri, dit une
femme, à cause du foin...
- Alors, dit une autre, quand on entendait les obus, on se
mettait comme ça...
Et elle saisit son enfant, et se baisse au-dessus de lui : -
afin que, si on était tué, le petit ne fût pas atteint.
Et rien n'est plus poignant que ce geste, dont on voit qu'elle a
l'accoutumance.
Ils furent parqués là, dans l'église, pendant des jours,
entassés, dormant comme ils pouvaient, sur les dalles, sur un
peu de paille, tâchant de retourner chez eux prendre une
couverture...
L'histoire de Dompierre-au-Bois est particulièrement tragique.
Le» Allemands l'occupèrent une première fois. Ceux-là, ils ne
détruisaient pas, ils payaient ce qu'ils prenaient... Puis les
dragons français les ont remplacés.
Un vieux paysan raconte: - Nous étions bien contents... On leur
avait offert des bouquets. Et puis les Allemands sont revenus.
Il en arrivait toujours, c'était comme des fourmis. Ils nous ont
mis dans l'église, en massif, et pendant ce temps, ils pillaient
toutes les maisons l'une après l'autre. Ils nous ont menacés de
nous fusiller, et pendant deux jours, chaque fois que la porte
s'ouvrait, nous croyions qu'on venait nous chercher. Des femmes
tombaient de frayeur...
Les Allemands avaient installé des batteries et tiraient sur le
fort de Troyon : le fort répondit et les obus français
arrivaient sur le malheureux village.
Ce récit évoque en nous l'impression de douleur d'un combattant
français (Maurice Gandolphe. La marche à la victoire): « Comment
libérer sans détruire, comment reconquérir plus que ces ruines
douloureuses et ces pitoyables survivants dont nous avons, dans
l'élan même de la poursuite, éprouvé l'angoissante amertume ?
C'est ici, à ces heures, qu'il faut ressentir l'intolérable
horreur d'une aliénation passagère de notre terre et de notre
vie. On ne réalise tout à fait « l'occupation d qu'au lieu et à
l'instant de la briser par-dessus ses victimes.
... Nous sommes là, penchés vers ce décor familier tout près.
Les autres, les occupeurs, restent tapis dans nos maisons, à
l'ombre de nos clochers entre lesquels ils fouillent leurs
terriers. Il faut bien tirer dessus - et on tire. » - N'est-ce
pas, dit une jeune paysanne, interrompant le vieillard, ce n'est
pas à cause de quelques civils que nos soldats pouvaient ne pas
tirer... Il fallait bien...
Un obus éclata dans l'église.
- Alors ce fut comme si on ne voyait plus clair. Tout le monde
s'est jeté dehors.
Et puis on est rentré quand on a vu que les autres ne suivaient
pas... Et on a vu les morts et les blessés... Vingt-deux morts
et dix-sept blessés.
Ce fut une scène atroce. Des familles étaient fauchées. Une
morte avait son poupon de six semaines entre les bras. Une autre
avait été tuée en allaitant son petit qu'on retrouva vivant dans
ses jupes. Une femme sur le point d'accoucher avait le pied
arraché; son mari, son père et sa mère étaient tués autour
d'elle.
On l'emporta dans la salle d'école. Et là, elle cria pendant
plusieurs jours, couchée sur la paille. On l'évacua ensuite à
Mars-la-Tour, et elle put enfin mourir, ayant mis au monde un
enfant mort.
Les plus gravement blessés furent laissés dans l'église, avec
les cadavres, jusqu'au lendemain. Sur l'autel intact, la statue
de la Vierge contemplait cette hécatombe de femmes, d'enfants et
de vieillards.
- Ma pauvre femme demandait tout le temps à boire, dit un vieux.
On ne m'a pas laissé lui apporter de l'eau. Elle n'est morte que
trente-six heures plus tard...
Un effrayant dialogue s'engage entre ces hommes et ces femmes
assis sur les bancs.
- Moi, j'ai eu ma fille de vingt ans tuée.
- Et moi, ma mère et mes trois soeurs...
- Et moi, mon mari...
- Cette petite fille que vous voyez là, toute pâlotte, c'est une
orpheline que sa cousine avait recueillie... Sa cousine fut
coupée en deux...
- Ah ! quand on est ensemble, on en parle, et c'est comme si on
était encore là...
Ils racontent leur départ précipité quelques jours plus tard,
les longs trajets sur les routes; ils portaient leurs enfants,
trop fatigués. Les blessés s'en allaient sur des chariots.
Plusieurs moururent avant d'arriver en Allemagne. A Metz, la
foule accourut pour les regarder passer. Et ils ont vu des dames
allemandes qui pleuraient. Ils allèrent dans un endroit, puis
dans un autre. A la caserne, où ils passèrent les dernières
semaines, ils furent bien traités. Les soldats étaient des
réservistes, qui avaient des femmes et des enfants.
On croit rêver en écoutant ces rescapés, à qui les pires
malheurs apparaissaient chose toute naturelle, désormais. Rien
ne saurait plus les surprendre ni les émouvoir. Et cette
expression prend une signification saisissante: - Nous avons
pleuré toutes nos larmes...
A dix heures, le premier convoi fut conduit au tramway qui
allait l'emmener à Annemasse.
Un public apitoyé regardait. Des femmes, spontanément, avaient
apporté à la rue de Berne des paquets de vêtements, et elles
pleuraient tout en les distribuant. D'autres, sur le trottoir,
attendaient le passage des Français et leur donnèrent des
objets. L'une d'elles, entendant une vieille paysanne regretter
son parapluie laissé « là-bas », s'écria: - Attendez, madame !
Bientôt elle nous rejoignait, tout essoufflée, et remit un
parapluie à la pauvre vieille ébahie, en s'excusant de ce qu' «
il n'était pas tout neuf ».
Une autre, à son tour, arriva en courant avec un manteau bien
chaud qu'elle lui posa sur les épaules.
Nous avons regardé s'éloigner les voitures.
Où vont-ils ? Qui va les recueillir et les aider, leur faire
retrouver - en dépit des souvenirs effroyables et du regret de
la ferme détruite, - un peu de bonheur ? Souvent le convoi
arrivait par le train de neuf heures du soir. A la hâte, on
formait le cortège. On faisait passer les hommes d'abord, les
vieillards, les impotents, les jeunes garçons. Puis venaient les
femmes. Beaucoup d'entre elles avaient des bébés dans les bras
et des petits qui s'accrochaient à leurs jupes.
Par les rues noires, dans la nuit, nous les conduisions au
restaurant. Nous passions entre deux haies de gens, avertis on
ne sait comment, qui attendaient les Français sinistrés, public
silencieux, respectueux, apitoyé.
Ceux d'entre nous qui portent des enfants sentent cette pitié
frémissante, ce mouvement des figures qui se penchent vers le
petit être endormi. Des mains se tendent, offrent du chocolat,
des friandises, des vêtements.
Une femme retire son écharpe de laine et enveloppe une fillette
au passage.

On installe les réfugiés au restaurant de tempérance, à
Montbrillant, dans deux salles.
On leur sert un repas chaud. Il y a des fleurs sur les tables.
Les dames s'emparent des petits, afin que les mères puissent
manger.
On distribue du lait aux bébés. On prépare des biberons pour la
nuit. Les commissaires secondent les servantes, emportent les
assiettes vides. Le propriétaire du restaurant voyant un enfant
presque nu sous sa robe, s'écrie: - Je vais voir là-haut, si ma
femme n'a pas quelque chose à lui donner...
Dans les allées et venues de ceux qui servent, les conversations
s'engagent, à demi voix d'abord, puis plus haut. Il fait bon.
Les visages fatigués se détendent. Quelques-uns prennent une
expression de bien-être.
D'autres demeurent tristes et anxieux. Beaucoup de femmes ont
leur mari, leur fils à la guerre et n'ont point encore reçu de
nouvelles. L'une d'elles, en grand deuil, raconte qu'elle a eu
son mari blessé d'un coup de feu et qu'on l'a éloignée de son
agonie.
Quelques-unes se demandent avec angoisse si on les laissera
retourner chez elles, dans des régions proches de la ligne de
feu.
Leur maison ne leur sera-t-elle pas interdite ? Tous se montrent
très touchés de la sympathie qu'ils sentent autour d'eux. Ils
l'ont sentie tout de suite, lorsqu'ils sont arrivés à la
frontière suisse. Ils s'attendaient à coucher dans les gares...
Tandis qu'on les a accueillis et soignés, à Schaffhouse, et sur
tout le parcours, à Zurich, à Berne, à Lausanne; on leur a donné
des vêtements, des fruits, des friandises. A Berne, ils ont vu
un de nos officiers, et ils ont crié : Vive la Suisse ! Nous les
écoutons, et nos yeux se remplissent de larmes : avec l'affreux
souvenir de leur catastrophe, ils emportent le nom de notre
pays, et ce nom leur est doux.
Dans le bâtiment d'école où des lits sont préparés, où des
tables sont fleuries, les commissaires procèdent aux formalités
administratives.
Nous emmenons les mères et les enfants dans la salle de douches.
Il y a de l'eau chaude, des tubs et des cuvettes alignées sur
les bancs. Et l'on commence la toilette des tout petits.
Des femmes nous disent: - Voilà trois mois que nous sommes en
voyage, tantôt dans un village, tantôt dans l'autre... Hier, à
Schaffhouse, nous avons dormi dans un lit, nous nous sommes
déshabillées pour la première fois.
Bientôt, la salle est transformée en pouponnière. Les bébés,
étendus sur les lits, agitent leurs membres, tandis qu'on les
frictionne. Quelques-uns pleurent. Il est tard. Ils ont sommeil.
D'autres continuent à sourire.
Tous ces bébés qui viennent de si loin, et qui ont traversé tant
de choses, placides, épanouis dans leur merveilleuse ignorance,
eux les tout petits, à qui rien ne manque, tant qu'ils sont
enveloppés des bras maternels...
Un garçonnet s'est déshabillé seul, tandis que sa mère s'occupe
de ses cadets, et il est là qui nous regarde, tout nu et
souriant.
Tandis que, penchées ensemble sur les lits, nous aidons les
mères à emmailloter les petits, elles nous confient leurs
difficultés et leur détresse.
Une jeune femme sanglote en langeant son nouveau-né. On vient de
l'avertir qu'elle ne pourra pas, sans doute, retourner dans sa
ville menacée. Elle dit: - Je ne sais plus où aller... je ne
connais personne...
Une fillette gazouille. Elle veut raconter, elle aussi. Elle
dit: - Les Allemands... ils m'ont pris ma poupée.
Son papa est parti à la guerre, mais il aurait bien dû rester
avec eux, puisqu'ils ont eu la guerre dans leur village.
J'avise un bel enfant, gras et rose, qui sourit à sa mère tandis
qu'elle lui fait sa toilette.
- Quel beau bébé, madame ? Quel âge a-t-il ? Elle se redresse, et
je vois qu'elle est toute jeune. Elle répond orgueilleusement: -
Quatre mois ! je le nourris... Ce que j'en ai mangé de tristes
choses pour me conserver mon lait ! Les autres, ça les
dégoûtait... Moi, je ne regardais pas ! Je pensais seulement à
mon petit, et je mangeais tout, n'importe quoi ! Aussi, voyez
comme il est lourd.
Elle le soupèse avec fierté.
Et elle répète: - Ce que j'en ai mangé, de tristes choses...
On amène une enfant qui vient d'être pansée à l'infirmerie. Six
ans. Elle a son bras en écharpe.
- Ce sont les Allemands qui t'ont blessé ta menotte ?
Elle lève un doux visage très tranquille et tout blanc. Sa voix
frêle répond: - Mais non, madame... nous étions dans l'église...
Alors les femmes, à demi voix, racontent l'histoire de cette
petite fille solitaire que l'une d'entre elles a emmenée par
charité.
Sa maman, qui habite Paris, l'envoya avec sa soeur de trois ans
passer l'été chez ses grands-parents, à Dompierre-aux-Bois.
Dompierre-aux-Bois, oui, nous connaissons ce nom désormais
tragique. Nous nous rappelons d'autres récits qu'on nous a faits
en pleurant. L'église éventrée par un obus. La mort tombant tout
à coup sur les réfugiés pêle-mêle...
Le grand-père, la grand'mère, l'oncle, la tante et la soeur de la
fillette furent tués. Et maintenant, on la ramène à Paris, et sa
maman ne sait rien encore.
Dans cette salle remplie du pépiement des tout petits, cette
évocation est intolérable: ce corps de trois ans qu'on
emportait, et la grande soeur, échappée par miracle, qui
"suivait sans comprendre.
- Et les blessés ne guériront pas... ajoute une vieille femme de
quatre-vingt-deux ans.
Sa main est bien longue à guérir... Elle suppure toujours.
Les bébés sont couchés, frais et calmés, ils vont s'endormir. Et
les mères entourent la jeune fille suisse-alémanique qui les
accompagna de Schaffhouse. Elle va les quitter.
Toutes veulent lui dire adieu, lui prennent les mains, la
remercient.
- Mademoiselle... je voudrais bien vous embrasser...
Et ces inconnues de la veille échangent des baisers...
Cependant la vieille femme continue à parler: - Le plus
terrible, ce n'étaient pas nos maisons brûlées, c'est que les
soldats allemands nous ont emmenés comme des malfaiteurs - des
soldats qui avaient leur baïonnette sortie ! Singulière
conception paysanne : ce départ forcé, cette escorte de soldats
lui paraissent une honte au bout de sa longue vie de travail
honnête. Cela elle ne peut le pardonner.
Ce qui nous surprend toujours au milieu des récits de
bombardement et d'incendie, c'est le calme de ces gens qui
racontent ces choses. Ils ne protestent pas. La perte de leurs
biens leur apparaît comme une conséquence inévitable: -
Qu'est-ce que vous voulez, c'est la guerre...
Tandis que les bourgeois, les propriétaires des fabriques
brûlées, s'indignent, invectivent et se révoltent, eux, les
pauvres gens, habitués aux fatalités, ils parlent de leur
désastre sans haine, d'un ton paisible. Ils ne savent pas où ils
iront. Bien sûr, on les enverra quelque part où ils pourront
être tranquilles. Ils acceptent tout d'avance. N'est-ce pas, on
ne pouvait empêcher ces choses...
Leur malheur les revêt d'une sorte de dignité. Ils en ont tant
vu ! D'autres sont plus malheureux encore. Ils disent : « Voyez
cette femme, son mari est mort... sa maison est brûlée... elle
est sans nouvelles de son fils... Et celle-ci, elle a perdu son
enfant... » Douceur des coeurs qui, tout déchirés, trouvent
encore de la compassion pour les autres...
Un jour, en vertu d'un hasard, qu'on avait tout fait pour
prévenir, une colonne de vieillards et de jeunes garçons
français rencontra, dans la rue, le convoi des internés
allemands, au grand émoi des commissaires. Le résultat fut
inattendu. Un vieil homme français a soulevé son chapeau, en
disant: - Ce sont de pauvres bougres comme nous...
Et ce fut tout.
Un soir, à l'infirmerie, on a amené une vieille paysanne
française. Ici encore c'était un fait tout à fait exceptionnel
imposé par des circonstances particulières: les autres lits
étaient occupés par des Allemandes.
Dans la chambre silencieuse et demi-obscure, la vieille femme,
assise sur son séant, se mit à parler. Elle était d'un village
près de Saint-Mihiel qui fut occupé par les Allemands et
bombardé ensuite, au centre même de la bataille. On les fit
passer en Allemagne. Ils allèrent dans un endroit, puis dans un
autre, à Sarrebourg, et enfin à Saverne où on les mit dans une
prison. On leur dit bien qu'ils n'étaient pas comme les autres
prisonniers. Mais il n'y avait point de place ailleurs. Les
soeurs étaient bien gentilles pour eux. Ce n'était pas leur faute
s'ils n'étaient pas bien nourris... elles donnaient ce qu'elles
avaient. Alors des dames de Saverne, - des Alsaciennes, dont les
sympathies sont françaises, - sont venues les voir.
Et elles ont apporté des vêtements, du linge aux plus dénués, et
de la nourriture, des saucisses...
Elle s'arrête et son masque blême et ridé sourit à ce souvenir.
Sans doute ne sait-elle pas lire : une de ces vieilles paysannes
telles qu'on en rencontre encore dans les campagnes reculées et
dont toute la vie s'écoule, resserrée, entre les murs de leur
ferme.
Tantôt elle parle avec vivacité, et tantôt elle s'arrête,
regarde fixement devant elle comme si elle contemplait en
elle-même des images, images toutes proches encore et toutes
fraîches. Elle dit: - A présent, on n'a plus une chaise à soi,
plus une fourchette, plus rien...
Je demande: - Votre village a-t-il été brûlé ? Elle acquiesce:
- Oui... beaucoup de maisons ont brûlé.
- Mais pas la vôtre ? Elle répond: - Pardon...
Et elle se tait un moment, la tête penchée.
Elle a deux fils à l'armée et deux filles qui se sont sauvées
avant elle et dont elle ne sait plus rien. Pendant douze jours,
le village fut bombardé continuellement ; tous les habitants se
cachaient dans les caves. Et quand une cave s'écroulait, ils
allaient dans une autre. Elle est restée jusqu'au dernier
moment, à cause du bétail; à la fin, elle a lâché toutes ses
bêtes parce que l'écurie brûlait. Celui qui n'a pas vu, il ne
peut pas se figurer...
Elle ajoute: - Qu'est-ce que voulez ? c'est la guerre...
Cependant à travers ces paroles toutes simples, coupées de
silence, les images terribles apparaissent, emplissent peu à peu
la salle où les Allemandes se taisent et écoutent
Une jeune fille, étendue sur le lit voisin, s'est soulevée. Elle
ne perd pas une parole.
La vieille femme reprend: - Les soldats allemands, je ne peux
pas me plaindre... Naturellement ils nous demandaient des
choses. Fallait bien qu'ils mangent, n'est-ce pas ? Mais ce
n'était pas leur faute s'ils étaient là. Il fallait bien qu'ils
aillent pour leur pays, comme nos garçons pour le nôtre. Et ils
auraient autant aimé rester chez eux, bien sûr. Quand il n'y a
plus rien eu à manger, ils nous donnaient de leur rata. Et je
lavais leurs affaires. Quand les obus venaient ils se fourraient
avec nous dans les caves. On était là tous ensemble.
Elle oublie de manger son potage qui refroidit sur ses genoux.
Elle continue: - Le jour qu'on a dû partir, je faisais la soupe
pour les porcs. Un officier allemand a écrit quelque chose sur
la porte. Alors les Allemands ont tiré du canon. Ils tiraient
au-dessus de nous, sur les Français qui étaient au bas de la
côte, au delà des vignes. Ah ! ils ne s'amusaient pas à chercher
du raisin...
Elle s'arrête un instant avec un sourire: elle sourit à sa
tragique plaisanterie.
- Et les Français, ils tiraient d'en bas sur le village. Et ce
sont leurs obus qui ont mis le feu à nos maisons. Quand je
voyais des Allemands blessés par terre, je pleurais aussi, comme
pour les nôtres... On nous a dit qu'il valait mieux partir.
Alors on a tout laissé, les denrées, le raisin, le bétail. On
est parti sans pouvoir rien emporter. Les maisons brûlaient. Ça
faisait un beau feu.
Elle ajoute: - Ah ! oui... c'est une terrible guerre.
J'écoutais comme dans un rêve déconcertant cette évocation
poignante de l'invasion et de la bataille au milieu de ces
femmes allemandes qui, peu à peu, cessaient d'être hostiles, se
laissaient gagner par une pitié que je lisais sur leur visage,
et cette pitié devenait de l'admiration pour cette vieille
ignorante, si fruste et si simple, qui ne se plaignait pas et
trouvait encore moyen de sourire.
La jeune fille allemande prit la parole à son tour. Elle n'avait
pas été internée. Elle était infirmière chez une dame
américaine, et, avec sa maîtresse, elle avait traversé la France
et vu des blessés. Et ces blessés Français étaient si gais ! Et
elle ajouta tout à coup, en se tournant vers la paysanne
lorraine: - Vous avez bien raison, vous avez bien raison de
sourire ! Il faut garder tout son courage ! Et j'eus l'impression
que la pauvre vieille dépouillée était une victorieuse, elle qui
avait su s'emparer de ces coeurs d'ennemies et les plier à
l'admiration.
Tandis que passent, pressés autour de leur mère, les enfants
rapatriés, les plus petits, indifférents et souriants, les aînés
gardant parfois leur mine pâlotte et leurs yeux tristes,
refusant de se laisser distraire, je repense toujours à cette
petite fille de Lorraine que j'ai connue dans un village de
Haute-Savoie où ses parents furent évacués. Une petite fille de
dix ans qui promenait autour d'elle des regards effrayés, et «
qu'on ne vit jamais rire ».
Sa mère disait: - Elle était pourtant bien robuste, avec de
bonnes joues. Mais elle a souffert. Les enfants, ils ont plus de
peine à supporter...
Cette femme avait les gestes mornes de ceux qui ont traversé une
catastrophe interminable.
Elle appelait sa fillette, assise dans un coin, les mains
pendantes.
- Va donc jouer avec les autres ! Les paysannes, devinant son
souci, disaient: - C'est si jeune ! Elle oubliera ! Regardez-
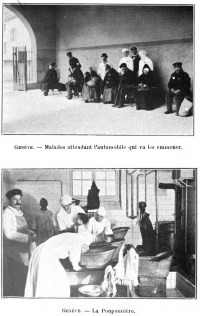
donc ceux-ci comme ils ont repris, déjà ! La mère secouait la
tête. Les enfants ne sont pas tous pareils, n'est-ce pas ? Une
petite fille blonde aux yeux gris qui regardaient toujours au
loin...
Naguère, lorsqu'elle s'éveillait, la journée ne lui paraissait
pas assez longue. Elle rougissait de joie quand la maîtresse
l'embrassait au sortir de la classe. Volontiers elle se figurait
que tout le monde est bon, lorsque la voisine lui rapportait du
marché de Lunéville des gâteaux qu'elle partageait avec ses
amies. Le soir, elle jouait sur la place du village, tandis que
les plus grandes se promenaient en se donnant le bras. Elle
disait sa prière avant de s'endormir et savait que le bon Dieu
l'aimait bien.
La chose effroyable arriva. Des coups de fusil qu'on tirait sur
les hommes.
La fuite dans les caves où l'on se tenait tapis les uns contre
les autres... Son père qui pleurait...
Et puis la faim... Elle n'osait pas dire combien elle avait
faim... Un vieil homme de leur ferme avait déclaré: - Cela ne
peut pas durer plus longtemps, il faut du pain pour les
enfants...
Alors la nuit, en se cachant, il apporta trois miches...
Cet homme, on ne le revit pas. Après elle ne savait plus. Les
scènes se confondaient.
Des figures terrorisées passaient devant elle.
On disait que M. le maire était devenu fou...
Puis les soldats français entrèrent. On put manger et dormir.
Mais un matin, sa mère la prit par la main: - Vite, il faut s'en
aller ! Tous ceux du village s'enfuyaient. Les uns avaient des
sacs et des brouettes, bientôt ils les abandonnèrent pour courir
plus vite. Ce qui la frappa d'horreur ce fut la vieille boiteuse
qu'on dut laisser au bord du chemin et qui les appela longtemps
d'une voix désespérée.
Au haut de la côte, ils se retournèrent. Et tout le village
brûlait. Elle cherchait à reconnaître leur ferme dans les
flammes. Mais sa mère l'entraîna.
Ils marchèrent sans repos, sans nourriture tout le jour. Ils
arrivèrent à un autre village. Le lendemain il y eut la bataille
tout autour d'eux. Réfugiés dans une cave, ils entendaient
l'éclatement des obus et des cris, des hurlements d'hommes. La
petite fille pensait que la fin du monde était venue.
Seulement le bon Dieu les avait oubliés...
Beaucoup de temps passa... elle ne savait plus. La journée était
pareille à la nuit. On entendait des blessés qui appelaient
doucement: - Camarades, pitié ! pitié I Camarades...
Et personne n'osait aller vers eux.
Il fallut se sauver encore. Des soldats français, tout
saignants, se traînaient dans la rue et demandaient à boire. Et
la petite fille stupéfaite vit sa mère se détourner en pressant
le pas.
Quand on fut sorti du village, on dut enjamber des corps et des
corps. Il y en avait... des Français, des Allemands couchés
pêle-mêle. Et les chevaux, le ventre ouvert. Et du sang... Sa
mère l'entraînait: - Ne regarde pas...
Et puis cette odeur dont le seul souvenir vous ôte le goût du
pain...
Ils marchèrent longtemps. Ses pieds lui faisaient si mal qu'elle
ne comprenait pas comment elle se tenait encore debout. On
voyait une ville là-bas, au bord de la plaine.
Il fallait l'atteindre. Son père et sa mère lui donnaient la
main... Mais comme cette ville se rapprochait lentement ! Enfin
on les avait entassés dans un wagon.
Et ils étaient partis sans savoir où.
Maintenant, ils étaient bien... ce village tranquille
ressemblait au sien; les gens lui parlaient doucement... Mais il
lui semblait qu'elle ne pourrait plus redevenir comme avant.
Sa mère gémissait: - Dire qu'on a tout perdu et qu'on est chez
des étrangers...
La petite fille souffrait d'un mal plus profond que le chagrin
de la ferme détruite. Elle ne savait pas l'expliquer avec des
paroles.
Seulement quand on s'asseyait avec les hôtes autour de la table
dans cette ferme qui était désormais sa demeure et qu'on lui
disait: - Mange... sa gorge se serrait et les bouchées ne
descendaient pas.
Des fillettes la prenaient par la main, l'emmenaient. Elles
étaient amicales et joyeuses.
Il y avait autour du village des arbres chargés de fruits. Les
raisins mûrissaient dans les vignes. Sur les seuils les poules
picoraient comme naguère. Il faisait beau. Elle retrouvait des
aspects familiers. Rien ne semblait changé.
D'autres enfants venus de loin, eux aussi jouaient, acclimatés
déjà. Elle ne pouvait pas... Bientôt on la retrouvait assise à
l'écart, le regard fixe, petite figure pâle qui ne riait plus.
Rien ne la réconciliait avec le monde qu'elle avait découvert
tout à coup si cruel.
Les vêtements, les jouets qu'on lui donna, les paroles de
tendresse, les soins maternels mêmes restaient impuissants à
exorciser ce pauvre coeur de fillette confiante et croyante.
Ce fut un peu plus de deux semaines après son arrivée qu'elle
mourut. Le médecin déclara que cette plaie légère qu'elle avait
au pied s'était envenimée, déterminant l'infection générale.
Mais le père pensait qu'elle avait eu « les sangs tournés ». La
petite fille avait vu trop de choses...
Les paysans groupés autour de la fosse étroite hochaient la
tête, apitoyés. Amener une enfant de si loin et puis la voir
mourir en trois jours...
Tandis que défilent dans nos rues les familles rapatriées, je
regarde ces têtes brunes ou blondes, ces visages de huit ans, de
dix ans, - l'âge où l'on souffre déjà, mais où l'on ne sait pas
encore expliquer sa souffrance. - Combien de petites filles trop
sensibles et de garçons précoces, la nuit s'éveillent en
sursaut, baignés de sueur, et subissent de nouveau les heures
d'épouvante ? Si l'on pouvait raconter ces choses... énumérer ces
paroles, ces cas extraordinaires ou navrants. Chaque jour
c'étaient d'autres détresses. On vivait en pleine tragédie,
toujours la même, et toujours différente, renouvelée à l'infini.
La douleur sans nom de la guerre pénétrait avec chaque convoi
dans ces salles, devenait l'air même que nous respirions, et il
semblait que nous n'aurions jamais assez de sympathie et de
tendresse pour alléger cette atmosphère chargée de catastrophes.
Une femme en deuil, la figure vieillie avant l'âge, à l'écart,
effondrée sur sa valise, ne parlait à personne, refusant du
geste le thé qu'on lui offrait, se détournant lorsqu'on voulait
lui parler. Une dame genevoise s'assit à côté d'elle et s'empara
de sa main, doucement.
- Qui avez-vous perdu ? Alors, elle dit d'une voix basse et
accablée: - Ma petite fille...
Et elle reprit, les yeux fixés dans le vide, comme si elle
contemplait la scène affreuse: - Elle avait sept ans... Une
balle l'a attrapée, là, sous mes yeux...
Il y eut un silence. Aucune parole n'était possible. La mère
ajouta: - Elle n'avait pourtant rien fait...
Les deux femmes se taisaient. Les mots blessent de telles
douleurs. Cette malheureuse, depuis des semaines toute seule
avec le déchirement de son coeur, sentit cette affection offerte.
Et soudain, elle se mit à pleurer. Elle pleura longtemps.
C'étaient les premières larmes qu'elle versait.
En la voyant sangloter ainsi, le visage dans ses deux mains, je
repensais à une parole d'enfant entendue naguère. Un instituteur
avait demandé à ses élèves: - Qu'est-ce que c'est que de
pleurer ? Les bambins hésitaient, ne sachant définir.
- Voyons, quand est-ce qu'on pleure ? L'un d'eux répondit: -
Quand on est un petit peu moins malheureux.
Cette femme solitaire, était peut-être un peu moins malheureuse,
puisqu'elle pleurait...
De tels deuils n'étaient pas rares. En avons-nous vu passer des
mères qui avaient perdu leur enfant ! maladies, fatigues,
changement d'existence... Il en est qui disparurent dans la
bousculade du départ. D'autres moururent en wagon.
Une jeune Lorraine raconta que sa soeur, qui avait deux petits
enfants, étant sortie pour leur chercher du lait, retrouva sa
maison en flammes. Les deux petits criaient aux fenêtres. Elle
voulait se précipiter. Les soldats, afin de la sauver, la
retinrent. Les enfants furent brûlés. Depuis lors on n'a plus
rien su d'elle. Peut-être est-elle devenue folle.
Beaucoup de vieilles paysannes qui n'avaient jamais quitté leur
village, qui l'avaient vu bombarder et incendier, considéraient
comme leur suprême malheur l'obligation d'en partir.
- Quand même c'était tout brûlé chez nous, on s'y plaisait bien,
dit l'une d'elles.
Au cours d'un de ces trajets, je donnais le bras à une femme
hâve, l'air misérable et qui se traînait, et je dis, apitoyée: -
Vous avez bien souffert...
Alors elle me lança un coup de coude presque brutal, et avec un
regard affolé, elle chuchota: - Taisez-vous donc I Vous n'avez
pas vu l'gendarme, là tout près ! J'crois qu'il vous a entendue.
Pauvre femme désorientée, à l'esprit malade. Elle n'avait pas
encore compris qu'elle était en Suisse.
Ces malheureux n'en revenaient pas d'être les objets d'attention
et de soin. Ils ne savaient comment exprimer leur
reconnaissance.
- Oh ! monsieur, dites-moi votre nom que je le mette dans mes
prières, disait une évacuée à l'un des commissaires.
Une méridionale, âgée, souffrant d'une inflammation de la gorge,
ne pouvait pas croire qu'on ne lui laissait pas payer les
oranges qu'on lui donnait: - Vous ne voulez pas me dire que vous
faites tout cela pour rien du tout, dites ! Et la joie que leur
causaient les distributions de bonbons et de pastilles !
- Oh ! madame, ce que c'est que d'avoir quelque chose de bon dans
la bouche ! Comme ça nous change...
Une vieille Alsacienne, parlant très mal le français, à qui un
commissaire avait donné un petit drapeau bleu blanc rouge,
demanda: - Moi, je peux garder, souvenir ? Il lui répondit
affirmativement.
Alors elle se mit à pleurer. Et dans son émoi, perdant un peu la
tête, elle essuyait ses larmes avec le drapeau.
Une femme, dans un coin, se tenait impassible, son petit aux
bras. Elle avait suivi machinalement le cortège. Et la fatigue
l'accablait à tel point qu'elle ne voyait même plus la saleté de
son enfant, ni les haillons humides dont il était emmailloté.
Un commissaire, doucement, le lui prit des bras, et après
l'avoir rassurée, il alla le confier aux dames de la
pouponnière.
Une Samaritaine rapporta le bébé, un beau bébé frais et rose,
ayant des langes neufs, une robe de flanelle immaculée, une
brassière de laine souple, des bas, des souliers blancs. Avec sa
mine souriante et reposée, le soin délicat de sa mise, il
semblait un de ces enfants choyés que l'on présente au dessert à
sa famille ravie. La jeune fille le promenait de groupe en
groupe, demandant: - A qui le bébé ? Mais elle n'obtenait point
de réponse. Alors un sauveteur auxiliaire s'empara de l'enfant,
et, debout sur une table, il le montrait à la foule des évacués
en criant d'une voix qui dominait le tumulte des conversations:
- A qui le bébé ? Une voix basse et tremblante répondit enfin: -
A moi, Monsieur...
La mère l'avait reconnu. Elle avait hésité un moment : depuis
bien des semaines, elle n'avait pas vu à son petit cette belle
mine.
Alors elle le prit et le serra contre elle. Et elle ne put rien
dire, tant elle pleurait en l'embrassant.
Une de mes amies apportait chaque matin du fil et des aiguilles
afin de recoudre les boutons des pauvres vêtements. Un jour,
elle remit des boutons à la veste d'un homme âgé, à la figure
respectable et très digne. La couture de son manteau avait
craqué. Des épingles le maintenaient tant bien que mal.
Elle se mit en devoir de le recoudre. Lui la regardait faire,
tout ahuri. Sans doute, ce geste de femme lui rappelait-il son
abandon actuel, évoquait peut-être d'autres visages féminins
penchés sur ses nippes, autrefois.
Une émotion l'étreignit qu'il ne savait pas dire. Alors, tandis
qu'elle rapprochait de lui sa figure, pour lui parler, - il
était un peu sourd, - tout d'un coup, il lui appliqua sur la
joue un bon gros baiser. Et il la considérait avec un sourire,
comme s'il venait de faire la chose la plus naturelle du monde
aussi naturelle que de laisser rajuster son manteau...
Elle, sentant toute la détresse exprimée par ce baiser,
refoulait ses larmes, et il lui semblait, en regardant la foule
misérable qui se pressait dans l'atmosphère épaissie de la
salle, que toute la tristesse et toute la gratitude de ces êtres
s'épanchaient sans parole, et venaient à elle dans ce baiser.
Un vieillard entrait en Suisse pour la seconde fois comme
prisonnier de guerre ; il fut interné en 1870, avec l'armée de
Bourbaki. Alors il demanda à revoir le lieu de son internement.
On le conduisit à l'église de la Fusterie. En passant sur le
pont du Mont-Blanc, notre hôte d'autrefois a reconnu l'île
Bousseau, il s'est souvenu qu'on l'y avait conduit en promenade.
Il considéra longtemps l'église, en fit le tour, et sans cesse
il la comparait avec la lointaine image qu'il avait gardée. Il
se souvint qu'il y avait « des séparations ». Il dit que « ça
l'avait beaucoup intéressé de revoir ça ». Puis il demeura un
moment en silence. Peut-être songeait-il aux années qui avaient
coulé entre ces deux voyages... Et sans s'étonner de voir les
mêmes événements se reproduire à de longs intervalles, comme un
rythme inexorable, il s'émerveillait que le sort l'eût ramené
dans cette ville. Soudain, il recouvra la parole. Et il ne
trouvait pas assez de remerciements...
Je revois un ménage d'octogénaires, un petit vieux et une petite
vieille courbés et ratatinés. Ils cheminaient péniblement, les
derniers du cortège en se tenant par le bras. Les regards ahuris
qu'ils promenaient autour d'eux, leur air d'être plus dépaysés
encore que les autres, disaient bien qu'ils en étaient à leur
premier voyage... et quel voyage ! Leurs vêtements étaient des
haillons. Lorsque le cortège fut entré, et que, l'appel terminé,
on voulut les conduire aux vestiaires respectifs des hommes et
des femmes, ils protestèrent d'une seule voix: - Nous ne voulons
pas nous séparer ! Elle, surtout, n'y pouvait consentir. Et elle
suppliait le commissaire: - Mon bon Monsieur, il ne faut pas
nous séparer, nous sommes si vieux ! Et puis, vous savez, avec
cette méchante guerre, il ne nous reste pas beaucoup à vivre,
qui sait ? Et puis, vous savez c'est aujourd'hui cinquante ans
qu'on s'étions mariés ! A ce mot, ils se regardèrent, souriants
au milieu de leur détresse.
Leurs noces d'or... Un demi-siècle d'amour, un demi-siècle de
vie commune, et de souffrances partagées, jusqu'à cette
souffrance ultime de la perte du foyer et de l'exil... Et
c'était aujourd'hui leur anniversaire.
Cependant, le vieillard, qui comprenait mieux les choses,
rassurait sa femme et la persuadait à demi. Elle se laissa
emmener au vestiaire. Mais à voir sa répugnance, nous sentions
bien que son inquiétude persistait.
Pendant ces longues et terribles semaines, leur principal souci
ne fut-il pas de demeurer ensemble ? Ce fut lui qui reparut le
premier dans la grande salle. Il était méconnaissable, serré
dans une redingote noire, une fleur à la boutonnière ; il avait
peigné ses mèches grises et lavé ses mains. Il avait pris un air
de respectabilité et l'attitude d'un homme qui célèbre son
cinquantième anniversaire de mariage. Il se tenait près de la
porte, attendant sa femme. Mais lorsqu'il la vit venir, il ne la
reconnut point, non plus qu'elle ne le reconnut lui-même. Des
vêtements presque neufs la transformaient : une jupe, une
jaquette.
Elle avait un visage net de vieille femme bien propre. Elle
approchait, timide, un peu gauche, les yeux inquiets et pleins
de larmes; elle voyait son mari et continuait à le chercher.
Ils sont face à face. Leurs regards se rencontrent. Ils se
retrouvent. Et tout à coup, ils tombent dans les bras l'un de
l'autre. Et ils pleurent ensemble.
Mais, cette fois, il y a, dans ces larmes, de la joie.
Une heure de détente, c'était celle où l'on conduisait les
rapatriés à leur repas. Souvent, quand l'heure des convois s'y
prêtait, c'était aux Cuisines populaires. Autour des longues
tables garnies de fleurs, on les faisait asseoir.
Et ils retrouvaient un sourire à la vue de ces bouquets préparés
pour eux et qu'on distribuait aux femmes à l'instant du départ.
Jamais nous n'avons manqué de fleurs... Les propriétaires de
serres en envoyaient, tous ceux qui possédaient une plate-bande
la dépouillaient, et les fleuristes et les pauvres femmes du
marché apportaient leur bouquet
Les commissaires et les dames aidaient au service. On faisait la
chaîne, on passait les assiettes. Et parmi ces serviteurs
bénévoles il y avait des gendarmes et des professeurs éminents.
On voyait de braves agents s'appliquant à faire manger des
enfants ahuris ou fatigués qui oubliaient leur nourriture.
Chez tous les témoins de ces misères il y avait un tel désir
d'aider, une émotion si poignante, que les différences de
culture et de milieu étaient, par miracle, effacées.
Autour des victimes, il n'y avait plus qu'une communion de
pensée, un élan semblable; ce n'est pas un des moindres
bienfaits que nous devions à ces malheureux.
Le repas fini, on les reconduisait à l'école.
Les agents, les commissaires et les dames se chargeaient des
enfants. S'il pleuvait, on les portait pour ne pas que tous ces
petits pieds fussent mouillés. Et l'on ouvrait tous les
parapluies, une collection de parapluies qui furent envoyés
anonymement à la gare pour abriter les internés.
Je me rappelle un soir, en particulier. A l'extrémité d'une
table, un groupe d'hommes graves et tristes remerciaient avec
une politesse extrême chaque fois qu'on leur passait une
assiette. Tous avaient des habits pareillement pauvres et salis.
Mais deux ou trois d'entre eux, aux figures plus affinées,
semblaient des hommes cultivés. Après le dessert, on servit le
café. Puis le signal du départ fut donné. Les mères
rassemblaient les enfants, serraient dans leur sac les biberons
de lait chaud. On retrouvait les joujoux des petits, les cannes
des vieillards. Au milieu de ce brouhaha, tout à coup, personne
ne sut comment, un silence se fit. Et l'on vit se lever un des
hommes qui occupaient le bout de la table. Un instant il se tint
là, tout droit, immobile, muet et les yeux fermés. Je me
souviens qu'il avait une longue barbe grise et que son visage,
en pleine lumière avait une sorte de beauté solennelle que je
n'avais point remarquée tout à l'heure. Et soudain il se mit à
parler. Il parla, les yeux clos, d'une voix un peu hésitante, un
peu brisée, et qui s'affermissait. Et il s'adressait à tous ces
hommes et ces femmes qui se taisaient autour de lui.
- Mes amis, ne quittons pas la Suisse sans l'avoir bénie et
remerciée. Je me rappellerai, ma vie entière, ce repas de ce
soir, servi par des mains amies. Voilà des mois que personne ne
nous a servis ainsi. Là-bas, on nous apportait bien notre
manger, mais comment ! Et ici on nous a servis ! servis avec
amour. Nous ne l'oublierons jamais.
Merci I Et les autres, après lui, de répéter: Merci ! Tous les
rapatriés nous entouraient. Et ce furent d'éloquentes poignées
de main, de ces étreintes vigoureuses où ceux qui ne savent
parler mettent le trop-plein de leurs sentiments. Et nous
pensions que c'était notre pays qu'ils remerciaient ainsi...
Le matin nous les escortions au tramway.
Une foule était toujours là, massée le long du trottoir pour les
regarder partir. Lorsque tous étaient assis, qu'on avait rendu
les petits enfants aux mères, installé tant bien que mal, sur
les banquettes, les plus vieux et les plus souffrants, le
tramway à quatre voitures s'ébranlait, et tous, aux portières,
nous envoyaient un dernier adieu. Alors, en répondant à leurs
signes amicaux, nous sentions en nous comme un bizarre
déchirement.
Jamais plus nous ne reverrons leurs visages...
Us vont se disperser. Ils s'en iront aux quatre coins de la
France. Ce convoi, qui était comme un être vivant aux multiples
douleurs, ne sera plus. Pendant un jour, il nous fut donné de
participer à la vie de ces hommes et de ces femmes, de pénétrer
dans leur chagrin ou leurs difficultés... Il ne s'agit point là
de rencontres banales. A de telles heures, tout ce qui est
extérieur et de convention est balayé : les coeurs se rencontrent
et se trouvent et se laissent déchiffrer; ils s'épanchent sans
paroles, et se joignent par ce qu'il y a en eux de plus profond,
de plus douloureux et de plus vivant... On s'attache à ces amis
d'une heure qui se sont montrés à vous si vrais. Leurs visages
reviendront nous visiter. Et nous nous demanderons : Où sont-ils
? Ont-ils enfin un peu d'oubli ? L'apaisement est-il venu ?
Il y eut des convois plus lamentables encore. Il y eut des
asiles d'incurables dont on évacuait à la fois tous les malades.
Les plus valides se traînaient appuyés sur des cannes. On
portait les autres dans les automobiles. Et les infirmes
arrivaient sur des brancards. Oh ! cette file de brancards qui
se suivaient le long de la rue...
Il y eut de pauvres folles qui répétaient continuellement de
vaines paroles et des gestes d'insensées, qui agitaient sans
relâche les mêmes inquiétudes. Pour la plupart d'entre elles, ce
désordre de leur esprit fut causé par leur épouvante.
Il y eut des convois entiers d'hommes, tout jeunes garçons et
vieillards, qui revenaient des camps de concentration. On les
avait pris dès les premiers jours de la guerre, séparés de leur
famille. Et dans le désarroi de cet adieu brusqué, ils avaient
dû partir, pleins d'ahurissement et de douleur, ne comprenant
plus. Parmi eux, des maires, des prêtres, emmenés comme otages.
Leurs figures hâves en disaient long... Ils étaient couverts de
vermine.
- Ne m'approchez pas, madame, s'exclamait un jeune garçon,
obligeamment. Je suis plein de poux...
Ces minables adolescents se réveillaient lorsqu'on leur
distribuait des cigarettes. Ils nous entouraient à l'envi. Et
chacun voulait raconter son histoire... Ils tiraient de leurs
poches les couteaux ingénieusement fabriqués avec un cercle de
tonneau découpé et aiguisé, les cuillères qu'ils avaient
façonnées dans du bois. Et tandis que nous considérions leurs
maigres visages, nous n'avions pas besoin de leurs récits pour
connaître leurs souffrances.
Ces garçons de quatorze, de quinze ans, depuis des mois étaient
sans nouvelles de leurs parents. Les vieux furent arrachés à
leur femme, demeurée là-bas. Des hommes réformés se mettaient à
pleurer tout à coup en parlant de leurs petits. Et quelle
consolation donner ? Le pays dévasté, le bien anéanti, tout cela,
ils s'y résigneraient encore. Mais ne rien savoir...
- J'ai sept enfants... et ma femme devait accoucher du
huitième... et je ne sais rien...
- J'ai cinq enfants... le plus petit a deux ans...
Les voix se brisent. Les pâles visages barbus se crispent et se
détournent. Les larmes silencieuses de ces hommes sont plus
émouvantes que tous les sanglots des femmes.
- Ah ! pour ceux-là qui sont tous ensemble, ce n'est encore
rien...
Les parents du soldat qui ignorent son sort, connaissent les
alternatives d'angoisse et d'espérance. Peut-être, demain,
recevront-ils des nouvelles du fils offert à la patrie. Et s'il
est sacrifié, ce sacrifice affreux sera rendu moins dur par le
sentiment qu'il est mort en faisant son devoir. Mais trembler
pour la femme et les petits demeurés dans le pays dévasté, être
certain que toute démarche est, d'avance, condamnée 5 On sait
que depuis peu de semaines il est devenu possible de transmettre
de brèves nouvelles dans la France envahie)...
Je me rappelle l'attitude accablée, les larmes lentes d'un
vieillard dont la femme était restée là-bas.
- On ne s'était jamais quitté, dit-il. Et à présent...
Sa voix se brisait. Il se taisait. Et cette pauvre douleur
contenue de ce vieil homme au rude visage s'échappait malgré
lui.
Un bossu, maigre et jaune, me dit qu'il est perdu, qu'il va à
Évian pour y mourir.
Le régime du camp a aggravé sa maladie de foie. Et la phtisie
l'a pris. Sa femme et sa fille sont restées dans la Meuse. Il me
montre une lettre que sa femme a pu lui faire parvenir en
Allemagne, une lettre bien écrite, très tendre, lui recommandant
de se soigner: « Tu es ce que nous avons de plus cher... ».
Il considère la feuille de papier avec un sourire navré et les
larmes aux yeux.
- Je ne les reverrai pas. Je sais que je suis perdu. Je connais
un peu de médecine.
Il se tait. Puis il reprend: - Avant la guerre, j'étais aussi
heureux, plus heureux que Monsieur Poincaré... Ma femme, elle a
trente-cinq ans... Nous avons une belle enfant qui pousse comme
un chêne...
Et il redit: - Nous étions heureux. J'ai toujours été pour la
vie de famille...
Alors, comme s'il ne pouvait échapper à l'obsession de son
drame, il raconte: - Et nous aurions pu nous sauver. Nous étions
même déjà partis avec le bétail. Puis, nous avons pensé : « Les
Allemands ne viendront pas », et nous sommes retournés à la
maison. A quoi tiennent les choses ? La plupart de ces hommes
sont dans le plus absolu dénuement. Ils ne possèdent plus un
sou, à la lettre. Ils ont des papiers allemands qu'on leur a
donnés en échange des économies de toute leur existence.
Il me souvient d'un homme, encore jeune, d'allure digne, une
figure qui attirait le respect; il était maire de son village.
Il était dans l'aisance, avant. Mon amie lui raccommodait ses
nippes. Il lui dit tout à coup, en hésitant, avec un accent de
honte: - Madame... puisque vous êtes si bonne...
voudriez-vous me donner quatre sous... pour acheter du tabac.
Quelquefois, les femmes d'un village sont emmenées dans une
autre direction que les hommes. Et ces deux convois s'en vont,
l'un à droite, l'autre à gauche, dans l'inconnu.
Une évacuée, ainsi séparée de son mari et de son fils, nous a
fait en quelques brèves paroles le tableau de ces départs.
- Un jour, on a dit qu'on allait partir. On a réuni les hommes
et les garçons sur la place et toutes les femmes en dehors du
village. Tout ce monde criait et pleurait. Et les hommes sont
allés par les champs... et nous, par la route... Et on ne s'est
plus jamais revu. On n'a plus eu de nouvelles...
Et puis les enfants qu'il fallait traîner... les quelques objets
indispensables qu'il fallait porter... les interminables marches
le long des routes, jusqu'à la station de chemin de fer, à
travers tout ce désespoir...
Quelques-uns, parmi les évacués, n'ont pas terminé leur voyage.
Tandis que leurs frères de misère s'apprêtaient à partir,
l'automobile de l'hôpital venait les chercher. Les Samaritains
les transportaient de l'infirmerie, où ils furent soignés dès
leur arrivée, dans la voiture. Et ce fut leur suprême trajet.
A l'hôpital, on les entoura de sollicitude et d'affection. Le
docteur et les infirmières qui les avaient reçus, rue de Berne,
leur faisaient jusqu'à la fin des visites d'amis. Et lorsque est
venue pour eux la dernière heure, ils ne se sont pas sentis
seuls.
S'ils n'ont pu retrouver la terre de leur patrie, ils ont du
moins leur sépulture dans une terre amie... Ils ont bien gagné
leur repos.
A partir du mois de mars 1915, l'entreprise du rapatriement des
évacués fut militarisée.
Des soldats de la territoriale remplacèrent les gendarmes et la
police civile. Ce furent eux qui donnèrent le bras aux
vieillards, qui se chargèrent des paquets, qui portèrent les
enfants. Et rien n'était joli comme de voir ces blonds petits
des Ardennes et du Nord endormis sur l'épaule d'un brave
fantassin grisonnant. Ces pères de famille retrouvaient, pour
arrêter les pleurs des bébés fatigués et dépaysés, les petits
noms qu'ils adressaient à leurs mioches, autrefois. Et les
enfants, rassurés, leur souriaient, frottaient leurs joues aux
moustaches des soldats paternels qui savaient si bien les
porter.
Désormais, les convois de cinq cents évacués arrivaient deux
fois par jour, régulièrement, à heure fixe. Après l'appel, rue
de Berne, après qu'on les eut ravitaillés, qu'on eut secouru les
plus pauvres et soigné les plus malades, ils repartaient presque
immédiatement, les tramways les conduisaient à Annemasse. Et
beaucoup d'entre nous se désolaient, en les voyant si nombreux,
de ce qu'il devenait impossible de donner à chacun de ces
malheureux assez de réconfort. Ils étaient tant ! et l'heure
était si courte ! Il fallait aller au plus pressé, et se
contenter de dispenser aux malades et aux enfants les soins
d'urgence.
Alors ce fut la foule qui se chargea de compléter cet accueil
que les circonstances voulaient trop sommaire au gré de nos
coeurs apitoyés. Ce fut elle qui donna à nos hôtes, dès l'instant
où ils foulaient le sol de Genève, cette atmosphère de sympathie
et de tendresse qui leur était si douce, qui les faisait se
redresser et sourire et pleurer, verser de ces larmes qui
allègent le malheur.
On connaissait le moment de l'arrivée. Il n'y avait plus de
flottement. Et chaque jour, le matin et l'après-midi, la foule
se massait aux environs de la gare, silencieuse, recueillie, les
mains pleines de présents. Il y avait là toute la population de
Genève, des magistrats, des ouvriers, des professeurs, des
pasteurs, des employés. Il y avait là tous les habitants de ces
quartiers modestes où passaient chaque jour les lugubres
cortèges et qui ne sont jamais lassés de donner. Il y avait
beaucoup de femmes. Et toutes amenaient leurs enfants. Les
petits tenaient des rouleaux de chocolat, des fleurs et des
jouets.
Les parents apportaient des vêtements, des sacs, des valises, de
la menue monnaie. De pauvres femmes avaient des filets tout
remplis de provisions.
On attendait, docilement. Les soldats passaient, refoulant les
groupes afin de maintenir le passage libre. On obéissait. Les
automobiles, prêtées aux Samaritains par leurs possesseurs,
défilaient, se rangeaient devant le quai.
Le train était arrivé. Les automobiles repartaient presque
aussitôt, emportant les malades. Sur le perron de la gare,
encadrés par les soldats, on voyait paraître les premiers rangs
des rapatriés. Ils descendaient lentement. Ils défilaient.
D'autres suivaient.
Et toute la foule alors, massée à droite et à gauche, d'un même
mouvement, se rapprochait, les mains tendues. Et rien n'était
beau comme cette irrésistible avancée au passage des victimes.
Il semblait qu'on eût voulu les envelopper et les garder. Elles
ne voyaient plus rien de la ville étrangère, plus rien que deux
murailles vivantes, des visages tendus vers elles, des mains qui
leur donnaient.
C'était comme une affirmation spontanée de bienvenue, une
protestation, sans paroles, contre les maux dont elles
souffraient. C'était comme une offrande unanime des coeurs. Les
évacués en passant recevaient cet amour. Et des larmes de
délivrance répondaient aux larmes de pitié.
La foule encadrait le cortège et l'escortait jusqu'à l'école.
Parfois des conversations se nouaient au vol. Les pauvres gens
s'arrêtaient un instant afin de remercier. Une expression de
surprise joyeuse transfigurait soudain les visages si las.
Les soldats, obéissant à leur consigne, pressaient la marche.
Mais, bénévoles, ils laissaient se poursuivre cet émouvant
échange et ils aidaient les voyageurs aux mains embarrassées. On
sentait qu'en eux-mêmes ils approuvaient la foule.
Sur le trottoir, devant la porte, les passants regardaient se
refermer les grilles. Et, lorsque deux heures plus tard, on
faisait sortir les évacués pour les conduire au tramway, ils
retrouvaient la foule accourue comme à un cher rendez-vous.
Et tous les jours c'était ainsi.
Au mois de janvier 1916 passèrent les derniers convois réguliers
venant directement de la France envahie - les derniers jusqu'à
ce jour (quelques convois égrenés ont passé pendant le
printemps). Ils étaient composés de familles indigentes et
nombreuses, évacuées d'office.
Ce furent encore d'inénarrables misères.
Jour après jour, à la fin de l'après-midi, on voyait les évacués
descendre le grand escalier qui aboutit à la rue de Lausanne :
toutes ces figures échelonnées, si défaites et si tristes, qui
ondulaient vers nous... toutes ces femmes en cheveux, ces
grappes d'enfants, accrochés à leurs jupes, ces nouveau-nés
empaquetés, ces vieilles de la campagne, en bonnets ruchés, un
châle mince croisé sur la poitrine, ces couples âgés qui se
tenaient par le bras... ces paysans vêtus de blouses ou de
vestes en futaine, ces bons visages rudes, hérissés de poils
blancs, cette allure lente et roide, ces vieux corps qu'on
devine tout perclus, écrasés d'une fatigue immense... Beaucoup
de femmes pleurent. Et la foule qui les attend, s'efforce de les
consoler au passage.
- Ne pleurez plus... courage ! Bon courage !...
Et ce piétinement de troupeau, ces sabots qui traînent sur le
pavé, cette docilité... cette attitude humble de gens
terrorisés... Un vieux qui descendait du trottoir remonte
précipitamment. Un autre, si courbé qu'il semblait chercher
quelque chose par terre, tâche de presser le pas.
Des lambeaux de conversations s'engagent entre eux et la foule.
- Oui... tout est détruit chez nous...
- Près de Craonne... Oh ! le canon... On se mettait dans nos
caves...
- Chez nous, quatre-vingts civils tués par les obus...
- Moi, j'allais dans les champs travailler sous les balles...
avec ma petite... une balle s'est éclaboussée contre mon
sabot... On n'y faisait plus attention...
- Un obus a éclaté dans notre maison...
L'institutrice était là, elle a eu le pied emporté... on n'a
jamais pu retrouver ce pied dans la chambre...
Trois enfants voyagent seuls. Leur mère a été fusillée.
Une femme a sept petits autour d'elle, deux qu'elle a adoptés.
- Qu'est-ce que vous voulez ? On ne pouvait pas les laisser,
n'est-ce pas ? Ah ! les jours de pluie ce cortège lent piétinant
dans l'eau, ces femmes harassées, ces petits tombant dans la
boue et qu'on relève tout emplâtrés, ces toux, ces voix
d'enfants, ces vieux impassibles et muets, ces passants qui
pleurent...
Des Français réfugiés à Genève, des rapatriés distribués en
Savoie, venaient, dans l'espoir d'obtenir des nouvelles des
leurs restés là-bas, confiants dans un hasard miraculeux...
Quelquefois on voyait une femme se détacher tout à coup de la
foule et tomber dans les bras d'une évacuée : des amis, des
parents qui se retrouvaient.
Pendant tout le dernier printemps une mère est venue ainsi à
chaque convoi attendre ses deux enfants. Un soir d'été, ils
passèrent.
Ce sont eux qui l'ont reconnue, au moment où le tramway allait
partir pour Annemasse.
Ils se sont précipités hors de la voiture, ils se sont jetés sur
elle... « Maman ! » Devant l'école de la rue de Berne', une femme
de ménage, en tablier bleu, demande la permission d'entrer: - «
Mon filleul » est dans ce convoi... Je veux le voir... Il a
cinquante-quatre ans « mon filleul ». A présent, il faudra que
j'en prenne un autre à qui je puisse envoyer mes colis...
On sort de l'automobile des vieux inertes, des femmes qu'il faut
porter.
On voit les groupes s'enfoncer dans la pénombre, les infirmiers
soutenant des malheureux dont on n'aperçoit que les dos voûtés
et une mèche de cheveux gris. L'un d'eux a dit: - Comme il
aurait mieux valu mourir avant...
Ruines humaines qui ne possèdent plus rien sur la terre qu'un
corps infirme... toutes les douleurs aggravées, rendues
irrémédiables...
Les autres malades attendent leur tour, dans la voiture,
immobiles, tels qu'on les a placés, sans étonnement et sans
paroles.
Je revois un de ces vieux indifférents qui, au moment où l'auto
démarra, eut tout à coup comme un éclair de conscience. Il se
découvrit, il eut une sorte de sourire. Le vent dressait des
mèches grises autour de son visage blême. Et jusqu'à l'instant
où l'auto disparut, tout au bout de la rue, nous avons vu cette
figure penchée vers nous et comme éclairée par cette pensée
qu'il n'avait pas exprimée.
Et je revois cette grand'mère qui portait un petit-fils de deux
ans et faisait marcher les quatre autres devant elle, petits
gars de quatre à huit ans, qu'on n'aurait pas pris pour des
frères car ils étaient presque de la même taille et vêtus de
hardes disparates.
Elle avait un mince visage durci et rouge, encadré par un bonnet
de vieux crêpe dont les brides serraient ses joues ridées. Elle
disait en redressant l'enfant appuyé à son épaule: - Ils sont
lourds...
Elle allait droit devant elle, ployée sous son fardeau, sans
regarder à droite ni à gauche. Parfois elle proférait quelques
mots à demi voix et il fallait se pencher sur elle pour
comprendre: - J'en ai élevé onze...
- Ma fille... ils l'ont gardée là-bas...
Elle s'en allait dans l'inconnu, avec sa figure immobile, comme
sourde aux paroles, les yeux fixés au loin, dans le passé
peut-être, toute seule, chargée des cinq petits-fils,
recommençant dans sa vieillesse le travail de sa longue vie, et
n'ayant que cette parole résignée: - Ils sont lourds.
Images de la détresse humaine qui nous poursuivront désormais.
Obsession des malheurs créés par cette guerre... Notre
génération, qui fut témoin de telles choses, n'aura pas trop de
toutes ses forces pour essayer de réparer... de reconstruire.
Rien n'est plus affreux que la détresse de ces octogénaires
qu'on déracine et qui souvent font tout seuls le voyage,
arrachés aux leurs, arrachés à la demeure où leur vie s'écoula,
comme cette femme de quatre-vingt-huit ans que nous avons vue
dans un cortège et qui avait avec elle, pour tout bagage et pour
unique compagne, une petite chienne qu'elle emportait enveloppée
dans des linges.
Elle nous la montra, disant: - J'ai eu bien du mal à la
sauver... Je l'ai cachée pendant trois mois...
Elle ajouta: - J'habitais une petite maison... On m'a pris ma
maison...
Et une femme à côté d'elle appuya: - Elle est de notre
village... On lui a tout pris... Mais ne vous inquiétez pas, je
prends soin d'elle.
Alors nous avons demandé à la vieille: - Qu'est-ce que vous avez
comme argent ? On va vous le changer: Elle répondit: - Rien... je
n'ai rien...
Et, montrant la petite chienne, elle redit: - C'est tout ce qui
me reste.
On lui donna un panier pour installer sa chienne. On mit au cou
de la bête un collier.
La joie enfantine, la reconnaissance que témoigna la vieille
dépouillée nous faisait mal.
Dans un autre convoi se trouvait encore une vieille femme qui
voyageait solitaire.
Elle avait quatre-vingt-cinq ans. C'était une paysanne de mise
décente : une jupe noire, un bonnet noir, une figure mince et
épuisée, un visage fin qui semblait en cire jaunie.
Une paysanne qui ne savait pas lire et qui, sans doute, n'avait
jamais quitté son village.
Elle aussi disait: - On m'a tout pris... je n'ai plus rien...
Elle ne savait plus où était sa fille. Elle l'avait perdue. On
la fit aller d'un côté et sa fille de l'autre. Se
retrouveront-elles ? De son petit-fils qui se bat, depuis le
commencement de la guerre, elle n'a aucune nouvelle...
Elle dit: - J'ai tout vu et j'ai tout souffert...
On lui offrit des vêtements. Du linge lui ferait-il plaisir ? Un
manteau, des souliers ? Mais elle remuait doucement la tête. Et
elle a dit à celle qui l'interrogeait ainsi: - Pourquoi est-ce
que tu fais ça pour mon pauvre corps ? Il est fini...
Ce tutoiement biblique avait quelque chose de poignant. Mon
amie, saisie, et les larmes aux yeux, insista doucement: -
Dites-moi, je vous en prie, qu'est-ce que je puis faire pour
vous ? La vieille femme répondit: - Rien... j'ai tout perdu...
Embrasse-moi ! Mon amie se souviendra toujours de ce baiser, de
l'étreinte fervente de cette paysanne mystique qui lui dit tout
à coup: - On se verra là-haut ! Alors malgré les protestations de
la vieille femme on l'habilla de neuf. A chaque chose qu'on lui
donnait, elle redisait, doucement obstinée: - Ça ne vaut pas la
peine... Mon pauvre corps... c'est fini, vois-tu...
Lorsque vint le moment de rejoindre le convoi en marche, et
qu'on vint la chercher pour l'installer dans l'automobile, la
vieille voyageuse redit en se séparant de celles qui l'avaient
accueillie: - Mais on se reverra là-haut ! Son expression de
certitude heureuse transfigurait le visage ruiné. Celle qui
avait « tout vu et tout souffert » et pour qui les choses du
monde étaient désormais comme si elles n'étaient point, laissait
derrière elle une impression d'admiration. Elle n'était pas
seulement résignée : la certitude que sa douleur lui avait
donnée la rendait riche d'une richesse qu'aucune contingence
humaine ne pouvait atteindre désormais.
Ainsi jour après jour, semaine après semaine, mois après mois,
passait le cortège des victimes. Ceux qui l'ont vu passer
garderont intacte cette vision de désespoir. Jamais on ne
contempla tant de détresses réunies, un pareil gaspillage de
bonheurs, de santés et de vies. Les convois d'épaves nous
présentaient continuellement la face la plus cruelle de la
guerre, celle que n'illumine point l'héroïsme de ceux qui se
donnent, et vont à la mort en chantant, les clairons sonnant la
charge, les drapeaux, les parades militaires, tout ce qui
dissimule un peu en le couvrant de gloire, l'effroyable carnage.
L'héroïsme de ces troupeaux humains s'appelle de la résignation.
Ils sont courbés par les contraintes, accoutumés aux vexations,
dociles aux ordres, muets et tristes. Ils sont conscients que
leur malheur est inutile à leur patrie. La grandeur qui s'élève
du sacrifice volontaire n'est point leur partage... Ils ne
peuvent relever la tête et sourire à leur mal glorieux.
Et cependant de ces souffrances en apparence vaines s'élève une
autre grandeur. On aime encore davantage le sol dont on fut
chassé, le pays en l'honneur duquel on a tout perdu. Il ne reste
à ces Français que leur qualité de Français, et cette qualité
leur tiendra lieu de tout désormais.
Pareils à cette vieille femme qui retrouvait des larmes en
baisant les trois couleurs, ils avaient, en présence de leur
drapeau dont ils ont été privés si longtemps, un frisson que ne
connaîtront pas les autres Français.
Ils ont subi l'invasion, la terreur, le bombardement,
l'incendie. Ils ont vu brûler leur maison et tuer leurs frères.
Ils se souviendront. Ils seront les premiers à proclamer à
chaque instant de leur vie: « Restons ensemble ! Serrons-nous les
uns contre les autres, soyons forts pour que jamais la guerre ne
revienne... » Et ces paroles qu'ils ne nous ont point dites,
nous les avons néanmoins entendues.
Et nous les faisons nôtres. Elles demeurent après qu'ils ont
passé.
FIN
NOTICE HISTORIQUE
LES DÉMARCHES PRÉLIMINAIRES
Lorsque la guerre éclata, les États belligérants, en général,
signifièrent aux ressortissants des nations ennemies d'avoir à
quitter immédiatement leurs territoires. Ce fut pour tous
ceux-ci une perturbation profonde. Un grand nombre de ces
expulsés, pour des raisons diverses (encombrement des trains,
difficultés de se procurer leurs papiers de légitimation, etc.),
ne purent franchir les frontières. Ils furent alors internés.
Telle fut la première catégorie des civils que la Suisse
rapatria. Les convois de civils français furent en nombre peu
considérable. Bientôt une seconde catégorie d'internés leur
succéda: des prisonniers habitant les provinces envahies envoyés
et gardés en Allemagne et, après un séjour plus ou moins long
dans les camps de concentration et les forteresses, rendus à la
France.
Puis ce fut la troisième catégorie : les évacués qui, saisis
dans leurs villages, étaient renvoyés en France, en passant par
la Suisse.
Il est surtout question, dans les pages qu'on vient de lire, des
deux dernières catégories de rapatriés.
Dès le début de la guerre, la Confédération suisse offrit, en
vue du rapatriement des internés civils (1) (il ne s'agissait
pas encore des évacués), ses bons offices à la France, à
l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Et le 22 septembre 1914, le
Conseil fédéral décidait la création d'un Bureau de rapatriement
des internés civils (2) qui siégerait à Berne. Le même jour, il
édictait un Règlement dont voici l'article premier: Article
premier. - Il est créé sous la surveillance directe du
Département politique un Bureau de rapatriement des internés
civils. Ce bureau, dont le siège est à Berne, est chargé de
transporter dans leur pays d'origine les femmes, enfants,
infirmes, vieillards et autres personnes civiles non aptes à
porter les armes et qui ont été retenus par ordre d'une autorité
administrative ou militaire d'un des États impliqués dans la
guerre actuelle (3).
Les négociations avec les Etats belligérants furent laborieuses.
Il y avait, parmi les internés civils, des hommes mobilisables
et il fallait faire un triage. L'entente s'établit d'abord sur
cette base : on rendrait à leurs pays respectifs les femmes et
les enfants, puis les hommes âgés de moins de dix-huit ans et de
plus de cinquante ans (4).
Les frais de transport, dit le message, « seront supportés par
les Etats d'origine des personnes à rapatrier... Il
appartiendra, en revanche, à la bienfaisance publique de
supporter les frais d'entretien et de logement des internés
durant leur transit par la Suisse ». Cet appel de l'Etat aux
individus est bien dans la tradition suisse, et l'on peut
affirmer que, pas plus à Schaffhouse, qu'à Zurich ou à Genève,
ou encore à Rorschach, et d'ailleurs dans aucune ville suisse,
la « bienfaisance publique » ne faillit à son devoir.
L'ŒUVRE EN MARCHE
C'est le 22 octobre 1914 que les premiers internés français
entrèrent en Suisse et le 2 novembre que passèrent les premiers
Austro-Allemands. L'oeuvre était en marche.
Le 21 décembre 1914, le Département politique fédéral, sur le vu
de communications venues des pays intéressés, annonçait que le
rapatriement des internés civils, sous forme de convois
collectifs, devait être considéré comme terminé. Les Commissions
d'étapes devaient arrêter leurs fonctions le 24 décembre.
En dépit de cette communication, les transports ne cessèrent
pas. Le 5 janvier 1915, de nouveaux convois traversaient la
Suisse.
C'étaient alors, presque exclusivement des évacués français
provenant des départements occupés par les armées allemandes. Du
4 au 14 février 1915 seulement, Schaffhouse en reçut plus de
4.000. On se hâtait. Il était entendu, internationalement, que
cette prolongation de transport devait prendre fin le 28
février. Chaque jour un convoi de 450 rapatriés environ quittait
Schaffhouse pour Genève. Au 1er mars, 20,475 personnes retenues
en pays ennemi, traversant la Suisse en 186 convois (le plus
fort comptait 739 voyageurs), avaient rejoint leurs patries
respectives.
Cependant, au début de mars 1915, le Bureau de Berne et les
Commissions d'étapes furent officiellement dissous. La
Confédération militarisait le transport des évacués. La
direction des convois passait au Service territorial fédéral et,
dès le 6 mars, sous la protection sympathique et la surveillance
amicale des soldats du landsturm (5) et de Comités nommés à cet
effet, les malheureux rapatriés continuaient à défiler.
Aujourd'hui encore, les convois ne sont pas arrêtés.
Organisation générale. - Il est évident qu'un pareil transport
nécessitait une organisation assez compliquée et quelquefois
délicate, et d'autant plus compliquée et délicate que les
voyageurs composant les convois avaient souvent subi des misères
sans nom - misères morales et physiques. Il y avait à prévoir
non seulement le voyage en chemin de fer, mais encore le
ravitaillement le long de la route et le logement. En outre, les
convois transportaient beaucoup de malades, même un certain
nombre de mourants... Il fallut parer à toutes les aventures.
Mais il est évident qu'on ne pouvait penser à tout et qu'au fur
et à mesure que les besoins se préciseraient, il y aurait lieu
de pourvoir à leur satisfaction. C'est ainsi que chaque
Commission d'étapes vit se créer autour d'elle des organismes
secondaires qui rendirent aux évacués des services aussi variés
que nombreux (6).
A Genève, où beaucoup de convois arrivèrent le soir, le Conseil
administratif de la Ville offrit de vastes locaux, dans
plusieurs des écoles primaires, pour héberger les évacués. Un
grand nombre de commissaires de bonne volonté, - dames et
messieurs - des délégués de groupements constitués :
Samaritains, Sauveteurs auxiliaires, les gendarmes, les employés
des chemins de fer fédéraux, ceux des établissements publics où
logèrent les évacués et les internés, le personnel des
restaurants - spécialement celui des Cuisines populaires -
furent chaque jour sur la brèche et l'on peut donner à tous ce
témoignage qu'ils ont fait leur devoir.
Que les convois arrivassent aux premières heures du matin ou
tard dans la soirée, toujours le personnel nécessaire était
présent. Et quelquefois il y eut de rudes journées...
Dans les autres villes, avec quelques variantes dans la
composition des « commissions » chargées du travail, ce fut la
même bonne volonté unanime et, dans les grandes lignes, la même
organisation.
Commissions d'étapes. - Le Département politique nomma, pour
chaque ville, à l'extrémité des lignes à parcourir par les
convois, des commissaires fédéraux, chargés de diriger la
réception, le ravitaillement et la continuation du voyage des
évacués et internés civils (7).
Dès la militarisation des convois, les commissions d'étapes
furent supprimées. Et les comités fonctionnèrent désormais avec
l'agrément de l'autorité militaire. Zurich qui, jusque-là,
n'avait joué qu'un rôle secondaire, devint une étape principale.
Son Comité agrandit considérablement ses fonctions, et son
président (8) eut à mettre en oeuvre une organisation très
complète (9).
Les commissaires d'étapes et les présidents de Comités furent
secondés par des dévouements sans nombre. Nous nous interdisons
de citer des noms - il faudrait tous les citer - car l'anonymat,
dans une oeuvre comme celle-ci, est la règle.
Trajet. - Les internés civils et les évacués français entraient
en Suisse à Schaffhouse. Ils quittaient notre pays à Genève, où
des tramways les conduisaient à Annemasse, la ville la plus
rapprochée de la frontière.
Les internés civils allemands et austro-hongrois arrivaient à
Genève. De là ils étaient dirigés : les premiers à Singen
(grand-duché de Bade) par Winterthour; les seconds à Bregenz
(Vorarlberg) par Rorschach.
Le nombre de convois ayant traversé la Suisse dans les deux sens
est, au moment où j'écris ces lignes, de 523.
Ravitaillement. - Le ravitaillement de ces très nombreux
passagers (il y en eut jusqu'à 1.350 en une seule journée) fut
évidemment la tâche la plus lourde que l'oeuvre eut à accomplir.
Il fallait nourrir tous ces voyageurs, mais il fallait aussi les
soigner médicalement, les nettoyer, les laver et, presque
toujours les habiller. Un grand nombre d'entre eux avaient été
saisis dans la rue et emmenés sans avoir eu la possibilité de
rentrer dans leur maison prendre quelques habits ou quelque peu
de linge.
En hiver, nous avons vu arriver des femmes qui, capturées dans
la belle saison, n'avaient sur elles que des vêtements d'été. Il
fallut pourvoir à tout. A chaque étape, d'immenses vestiaires
furent établis. Et c'est là peut-être que la « bienfaisance
publique », comme disait le message du Conseil fédéral, fut la
plus active. Dans tous les locaux, des quantités de vêtements,
de souliers, de chapeaux, pour femmes, pour hommes et pour
enfants, s'entassèrent. A Schaffhouse, ville de la Suisse
alémanique, à l'extrême frontière, l'accueil fait aux évacués
français était si cordial que le moins qu'on en peut dire, est
de constater qu'il était simplement fraternel. En une seule
journée, on apporta 600 (je dis : six cents) colis (10). Ce
chiffre donne une idée de l'effort accompli dans chacune des
villes d'étapes. Et il faut noter qu'il s'agit seulement ici des
colis remis aux commissaires. Dans la rue, au passage, les
évacués reçurent aussi beaucoup de présents. Plus tard, après la
militarisation du service, la France expédia à l'adresse des
villes d'étapes de nombreux vêtements (11).
Quant au ravitaillement alimentaire, il eut lieu selon les
possibilités de chaque ville d'étape. A Genève, ce fut
principalement à l'établissement modèle des Cuisines populaires
et dans un restaurant de tempérance, à Montbrillant (12).
A Schaffhouse, où la vaste installation des Cuisines populaires
n'existe pas, les évacués étaient répartis, par escouades, dans
divers restaurants de la Ville et dans quelques hôtels. A
Zurich, ils prenaient leurs repas dans la gare même. A Genève,
le coucher avait lieu sur des paillasses militaires prêtées par
l'Etat, installées dans les locaux scolaires - un des locaux,
plus favorisé, eut des lits -; à Schaffhouse, les commissaires
fédéraux avaient pris des arrangements avec divers hôtels et les
évacués eurent le réconfort, en arrivant d'Allemagne, de trouver
un bon bain et un bon lit.
Cette hospitalisation et ce ravitaillement furent quelquefois
très difficiles. Souvent les trains étaient annoncés
tardivement; souvent les convois comprenaient un nombre
considérable de voyageurs, beaucoup plus que la quantité prévue,
et il fallait trouver moyen de ne léser personne. Quelquefois
même les trains se succédaient, annoncés au tout dernier moment,
et c'est ainsi que pour parer à tout, il fallut avoir des
commissaires de bonne volonté en permanence depuis les premières
heures du matin jusque très avant dans la nuit.
Voici un seul exemple des difficultés rencontrées dans le
travail, emprunté aux procès-verbaux du Comité schaffhousois:
Le 23 janvier 1915, deux trains, l'un de 578, l'autre de 739
internés, entrèrent en gare de Schaffhouse presque
simultanément. On avait été avisé, la veille, à 9 heures du
soir. Il avait fallu, toute la nuit, chauffer les locaux
destinés aux arrivants. Il fallut se procurer la nourriture en
quantité suffisante et le lait pour les enfants.
Il fallut faire face à la réexpédition - sans confusion - des
nombreux bagages (13). A 10 h. 55, le premier train partait pour
Genève. Le second convoi fut retenu toute la journée. Il était
particulièrement misérable et la population schaffhousoise se
porta, par milliers, sur son passage et dans les hôtels, pour
secourir ces malheureux. Le rapport journalier conclut
sobrement: « Ce fut une des journées les plus fatigantes de
notre travail et nous pouvons dire, avec satisfaction, que
chacun fit son devoir avec conscience et dévouement. » Dans la
rue, les commissaires - des deux sexes - avaient pour mission de
porter les enfants et les paquets - dont quelquefois, à aucun
prix, les évacués ne voulaient se débarrasser à la gare (14) - et
souvent la population les aidait; dans les restaurants, ils
secondaient le personnel, naturellement débordé, et l'on vit des
« chaînes » de servants composées de représentants de toute la
population : ouvriers, professeurs, gendarmes, magistrats,
rapprochés dans une activité bienfaisante, réunis mieux que par
tous les discours patriotiques, se passant l'un l'autre les bols
de soupe et les assiettes de viande, les desserts ou les tasses
de café.
Tout le long du trajet, à chaque arrêt du train et dans la rue,
les rapatriés recevaient des vêtements, friandises, jouets pour
les enfants, etc.
Change. - Aux têtes de ligne, à Schaffhouse et à Genève, les
rapatriés qui le désiraient, pouvaient effectuer, dans les
meilleures conditions possibles, le change des monnaies
étrangères dont ils étaient porteurs.
Poste. - Les commissaires distribuaient des cartes postales,
généralement affranchies (à Schaffhouse, au début de l'oeuvre,
elles l'étaient toutes). A Genève, dans les locaux affectés à la
réception des évacués, on installa une sorte de bureau de poste
où des quantités considérables de lettres et de télégrammes
furent consignés.
Correspondances. - Les Bureaux de rapatriement des commissaires
d'étapes recevaient des missives à l'adresse des évacués. A
Genève, les noms des destinataires inscrits sur des tableaux
attiraient l'attention des arrivants. Et les lettres classées
par ordre alphabétique pouvaient ainsi leur être délivrées au
passage.
Le Bureau de rapatriement de Berne, à lui seul, a reçu et
expédié, grâce aux soins d'auxiliaires volontaires et seulement
jusqu'au début de mars 1915, moment où les convois furent
militarisés - 52.878 envois postaux.
Recherche des disparus. - Durant le trajet à travers la Suisse,
on signale aux rapatriés l'Agence des prisonniers de Genève
(Croix-Rouge internationale) pour la recherche des disparus.
En outre, le Bureau de Genève publie les listes de tous les
rapatriés qui ont traversé la Suisse (noms, prénoms, âge, lieu
de domicile en France (15).
Ces listes, dressées jusqu'au 29 février 1916, ont été envoyées
par le Bureau de Genève à tous les camps de prisonniers en
Allemagne. Les Français internés dans ces camps peuvent, en les
consultant, savoir quelles sont les personnes de leur localité
qui ont été rapatriées.
Soins médicaux. - A toutes les étapes, il y avait en permanence
des personnes chargées de donner les soins médicaux aux évacués
: délégués des Croix-Rouges, des Samaritains, infirmières et
infirmiers, etc. Des médecins dirigeaient les services. Des
brancardiers volontaires, des automobiles obligeamment prêtées
par leurs propriétaires, étaient à la disposition des services
médicaux et transportaient les plus malades.
A Schaffhouse, une première infirmerie disposant de quatre
pièces, avec des lits, avait été établie dans la gare; à Zurich,
la visite médicale se faisait dans les wagons mêmes; à Genève,
une infirmerie avec service complet était dirigée par un
médecin. Installée dans le bâtiment scolaire de la rue de Berne,
elle rendit des services considérables.
Les convois renfermaient chaque fois de nombreux malades.
Lorsque les cas étaient graves, les patients étaient dirigés sur
les hôpitaux.
Dans un seul convoi, à Schaffhouse, 45 malades furent envoyés
soit à l'infirmerie soit à l'hôpital.
Mais c'est à Genève que le service médical fut le plus
achalandé. Il était assuré par la Société des Samaritains. Du 24
octobre 1914 au 31 janvier 1916, le médecin attaché à
l'infirmerie eut à traiter 8.951 cas, ce qui, sur 108.564
rapatriés des divers pays belligérants, représente le 8,23 pour
cent (16). 59 malades furent transportés dans les hôpitaux de
Genève.
Décès. - Il y eut malheureusement à déplorer quelques décès :
voyageurs tombés subitement malades en cours de route, malades
insuffisamment soignés durant leur captivité et leur transport,
vieillards surmenés, etc. A Schaffhouse moururent deux
rapatriés; à Zurich, une jeune fille de vingt-deux ans. Chaque
fois les corps étaient accompagnés au cimetière par les
commissaires et les habitants. Des pierres commémoratives furent
élevées sur les tombes des malheureuses victimes. A Genève, on
eut à enregistrer 16 décès (17).
Statistique. - Les diverses installations aux étapes
nécessitèrent évidemment des frais considérables. Ils ont été
couverts par des dons.
Il est impossible d'établir une statistique exacte des dépenses
faites jusqu'au moment de la militarisation des services, non
plus que des sommes déboursées. Beaucoup de celles-ci le furent
individuellement par les membres des Comités et ne figurèrent
jamais dans la caisse commune.
Un chiffre cependant peut être précisé : à Zurich, le Comité
avait encaissé, à fin décembre 1915, la somme de 75.000 francs.
Il est également impossible de connaître avec précision la
valeur des dons en nature (18). Si nous nous basons sur les
indications des Comités de Zurich (n'oublions pas qu'il a
commencé à fonctionner seulement dès mars 1915) et de Genève, on
peut affirmer, sans crainte d'exagération, que les vêtements
distribués aux diverses étapes, représentent, à eux seuls, une
valeur marchande d'environ huit cent mille francs à un million.
Du 24 octobre 1914 au 31 mars 1916, il a passé en Suisse 523
convois, sur lesquels 148 étaient des convois austro-allemands.
Les 375 convois français ont transporté 97.753 voyageurs, sur
lesquels 19.940 hommes, 45.834 femmes, 10.584 enfants de moins
de quatre ans, 21.895 enfants de quatre à treize ans.
Les 148 convois austro-allemands ont transporté 1.678 hommes,
9.557 femmes, 906 enfants de moins de quatre ans et 1.545
enfants de quatre à treize ans, soit un total de 13.686
personnes.
En additionnant tous les rapatriés, sans distinction de
nationalité, nous constatons que la Suisse a rendu à leurs pays
respectifs 111.439 personnes.
Cette statistique s'arrête au 31 mars. Depuis ce jour, un
certain nombre de convois ont passé et à la date où j'écris,
d'autres sont annoncés.
Eugène Pittard.
(1) L'idée d'échanger les internés civils est
née, en Suisse, dès le début de la guerre, simultanément dans
beaucoup d'esprits, mais l'initiative de cet échange revient à
M. Edouard Audéoud, de Genève, qui, d'ailleurs, fut nommé dans
cette ville commissaire fédéral pour cet échange.
(2) Feuille fédérale, 1914, IV, p. 127.
M. le Dr professeur Ernest Rôthlisberger en fut nommé directeur.
(3) Ernest Rôthlisberger. Die schweizerische Hilfsaktion fur die
Opfer des Krieges und das Heimschaffungswerk, Separatabdruck aus
dem Politischen Jahrbuch der schweizerischen Eidgenossenschaft,
Bern, 1915.
(4) En réalité les arrangements postérieurs permirent de
rapatrier, en plus des femmes et des enfants, les hommes
au-dessous de dix-sept ans et au-dessus de soixante ans, ainsi
que ceux âgés de quarante-cinq à soixante ans manifestement
inaptes au service militaire. Consulter les diverses «
Communications » adressées par le Département politique fédéral
et rassemblées par M. Rôthlisberger.
(5) Les soldats du landsturm sont, à peu près, l'équivalent des
territoriaux français.
(6) Indications pour rechercher les personnes disparues, mise en
rapport avec des parents ou des amis dans les villes suisses,
distribution de cartes postales et de fleurs, prêts de
parapluies, etc. Beaucoup parmi les commissaires bénévoles
servirent de scribes à de pauvres gens illettrés; les tables des
restaurants furent ornées en permanence de vases de fleurs et de
bouquets, etc. Ces petits soins et ces petites attentions
furent, nous le savons, très doux à ceux qui en ont bénéficié.
(7) Ce furent : à Schaffhouse, M. Henri Moser, puis M. Spahn ; à
Korschach, M. le Dr Heberlein ; à Genève, M. Edouard Audéoud et
M. Georges Werner.
(8) M. le pasteur Cuendet.
(9) Documents sur la guerre européenne. Le passage des rapatriés
à Zurich, Bâle, 1915; un album de 56 pages.
(10) La ville de Schaffhouse ne compte que 15.000 habitants
environ, sur lesquels il y a plus de 4.000 étrangers, Allemands
pour la plupart.
A Genève les colis furent apportés en nombre considérable,
venant de toutes les parties du canton. L'estimation en est
impossible, car leur contenu s'écoulait chaque jour, comme un
fleuve.
(11) Œuvre : « Le vêtement du prisonnier de guerre » à Paris.
(12) Consulter pour ce qui concerne le ravitaillement à Genève :
Lucie Achard, Le passage des internés civils d Genève. Extrait
du 49e rapport du Comité central du Bureau de bienfaisance.
Genève (1915).
(13) 7.500 kilos de gros bagages seulement, pour un seul train.
Les frais de cette journée s'élevèrent pour le ravitaillement et
les frais de bagages à 3.789 fr. 05.
(14) Les bagages étaient parfois de qualités invraisemblables et
telles qu'on peut seulement les supposer dans le trouble d'une
pareille aventure.
(15) Liste des internés [ou des évacués] civils français
dressées par les soins de M. Audéoud. Paris, Lyon, Genève. Il y
en a déjà huit et un supplément.
(16) Dr Jean Késer, L'infirmerie des internés civils et des
évacués à la rue de Berne, Genève. Brochure, Genève, 1916.
Voici quelques détails des cas traités : Appareil digestif et
annexes, 1.935 : appareil circulatoire et maladies du sang,
1.203; appareil respiratoire, 1.198: contusions, plaies, abcès,
ulcères, 1.113; dermatoses, 948; système nerveux, 857 ; maladie
des yeux, 416 ; etc.
Cette statistique a été continuée.
(17) Au 31 janvier 1916.
(18) Nous entendons simplement les dons en vêtements. Il est
impossible d'évaluer les autres.
Dans toutes les villes que traversaient les convois, des
groupements de bonne volonté recueillirent des dons nombreux en
faveur des rapatriés. Il en fut ainsi, d'ailleurs, dans d'autres
villes où les convois ne passaient pas. Rappelons que lorsque le
rapatriement fut confié au Service territorial (c'est-à-dire dès
mars 1915), le Gouvernement français participa, dans une large
mesure, au rééquipement des évacués. |













