|
|
La Saint-Antoine à Buriville - Conte lorrain
|
|
|
ALMANACH DU
PELERIN DE 1948
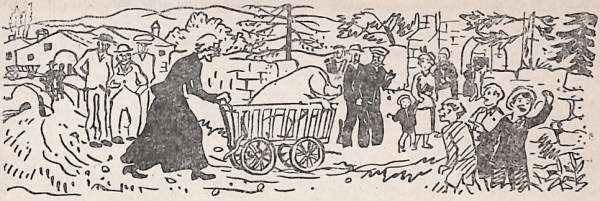
La Saint-Antoine à Buriville
CONTE LORRAIN
Après une vie laborieuse et bien
remplie, le Fanfan et sa femme étaient devenus vieux, me contait un
bon grand-père de là-bas.
Le Fanfan comptait presque trois quarts de siècle et la Mélie 6 ans
de moins.
Après avoir économisé toute leur vie durant, et même tiré le diable
par la queue dans leur jeune temps, ils avaient réussi à amasser une
petite réserve. Laquelle réserve subissait une évaporation
continuelle, due aux difficultés multiples des temps présents.
lis avaient marié honorablement leurs trois babettes (1) dans les
villages voisins. Des « ruine-maison », disait la Méfie de ses
filles au temps de leur établissement.
Maintenant les deux vieux avaient partagé leur matériel de culture
et loué leurs champs. Ils en avaient cependant conservé un qu'ils
cultivaient avec amour, et qui leur donnait des légumes pour «
passer l'année » et des pommes de terre pour engraisser un cochon.
Ah ! ce cochon, il était pour eux. maintenant toute leur espérance
d'ici-bas, toute leur ambition. Ils l'achetaient petit au printemps
et le tuaient devenu gros durant l'hiver suivant. Alors, c'était la
fête, la « grillade » comme on dit en Lorraine. Filles, gendres,
petits-enfants, tout le monde arrivait de bonne heure. On mettait
les quatre allonges à la grande table, et c'était un enterrement qui
se terminait toujours gaiement. Puis, les jours suivants, on
découpait, on fabriquait le boudin, les saucisses, les andouilles,
on salait et fumait le lard et les jambons. Bref ! tout un trésor
pour les temps que nous venons de vivre, et où le Fanfan et la Mélie
puisaient durant toute l'année pour maintenir à flot leur santé
déclinante.
Mais tout allait encore trop bien. Vint la mauvaise année entre
toutes. Le cochon, pourtant acheté bien cher, et, comme il se doit,
d'un tempérament rustique et glouton, après avoir grandi assez vite
au début, cessa subitement de se développer. Il mangeait peu,
faisait la grasse matinée et une sieste interminable après ses
repas. Lorsqu'on le sortait, au lieu de courir comme ses
prédécesseurs et de tout bousculer, il s'asseyait sur son train de
derrière comme un toutou, et reniflait l'air du temps avec une
évidente satisfaction. Lorsque la Mélie le sermonnait pour
l'encourager à produire du saindoux, il répondait par des petits
grognements discrets et secouait la tête pour amener ses oreilles,
qu'il avait fort longues, à recouvrir ses petits yeux malicieux.
Sait-on jamais ce qu'ils pensent, ces cochons ? ... Au point où en
étaient les événements des Indes, la Mélie n'était pas loin de
penser qu'il faisait la grève de la faim pour s'assurer une plus
longue existence et saboter les bases même du ravitaillement.
Puis le Fanfan arrivait, les mains dans les poches. li insultait le
goret en lui donnant tous les plus vilains noms qu'un cochon peut
entendre, et que celui-ci écoutait d'ailleurs avec patience et
dignité. Alors le Fanfan bourrait le bout de son sabot dans le gras
des reins du cochon qui, cette fois, élevait le timbre et se
contentait de changer de place.
Et cela se passait tous les jours, et dura de longs mois.
Un vétérinaire, mandé, vous eut dit qu'il s'agissait là de
rachitisme, maladie commune chez les porcs, et qui se manifeste
surtout quand ceux-ci manquent d'exercice. Pour le Fanfan et la
Mélie c'était du « mal de pattes » tout simplement. En temps normal,
chez nous, un porc atteint de cette affection est mis en saucisse
sans aucun délai... Un cochon, ça ne se soigne pas autrement. Nul,
sur la terre, n'a plus mauvais caractère. Prenez un cochon dans vos
bras, pour le soigner, ou même pour l'embrasser, si cela vous dit,
eh bien, il criera exactement aussi fort que si vous voulez le tuer.
De guerre lasse, le Fanfan consulta le grand Jules, un de ses vieux
amis, qui avait terminé autrefois son service militaire comme «
infirmier premier jus » et qui passait pour y « tâter » dans la
médecine vétérinaire. Il s'était créé une réputation dans le
village, beaucoup plus vite qu'un éminent docteur dans une grande
ville.
A la vue du cochon, le grand Jules hocha la tête avec gravité. li
connaissait deux remèdes. Le Fanfan et la Mélie respirèrent. Premier
remède : lavage de la partie malade avec une décoction de fleurs de
cerisier. Deuxième remède : lavage à l'eau de neige. Le grand Jules
termina son diagnostic en comparant la croissance de ce cochon-là à
celle du trèfle, qui végète la première année et ne fructifie qu'à
la seconde.
Malheureusement, on était à la mi-septembre, et tout chacun sait que
les cerisiers ne fleurissent qu'en avril. Les moïs s'écoulèrent donc
et, durant l'hiver qui suivit, la neige ne fit son apparition qu'à
la Chandeleur. On ne sut jamais si l'un ou l'autre des d'eux remèdes
valait quelque chose, car peu avant de temps des chandelles, vers la
mi-janvier, Ia Mélie eut une inspiration. Pour essayer de tirer son
cochon de là, puisqu'arrivait le jour de la Saint-Antoine, elle
irait en pèlerinage à Buriville.
Vous connaissez Buriville ?... Ça m'étonnerait. C'est un charmant
petit village situé à une heure de marche de chez nous. Blotti au
creux d'un vallon, on ne le voit de nulle part. Il faut vraiment y
aller pour le découvrir. Quand il vous apparaît, au détour du
chemin, vous pensez voir un couvent. Son petit clocher à, étages,
sans art et sans pointe, fait bien dans le paysage. Il précède la
petite église, souriante et proprette. Tout près, un petit pont
enjambe un ruisseau. L'ensemble rappelle un peu la cité de Paris,
mais de très loin, certes. L'église étant Notre-Dame, le petit pont
serait le Pont-Neuf; le ruisseau, la Seine ; quant aux bateaux, ils
sont remplacés ici par des canards.
Au clocher, il n'y a point de cadran pour indiquer l'heure. Ici, il
n'y a. ni train ni autobus à « rater ». Comme il n'y a pas d'heure,
les gens de Buriville ne sont jamais en retard.
Lorsqu'on pénètre dans la minuscule église, on remarque tout de
suite à droite, suspendue entre deux fenêtres, une grande toile
représentant en grandeur naturelle deux saints. Au bas de la toile
on lit : saint Antoine et saint Basle, patrons de ce lieu. Deux
embusqués, me direz-vous, qui ne doivent pas avoir grand'peine à
intercéder pour les gens de ce village qui ne comptait pas 80 âmes
au dernier recensement. Mais voilà, avoir deux patrons, cela
correspond à avoir deux fêtes patronales, ce qui n'est pas fait pour
déplaire aux cousins, parents et amis des gens de Buriville, qui
viennent se régaler deux fois par an.
La première de ces deux fêtes a lieu le 17 janvier, jour de la
Saint-Antoine.
Le prêtre desservant Buriville, qui est deuxième annexe d'Ogéviller,
vient célébrer une Grand' Messe, durant laquelle on expose à la
vénération des fidèles une statuette du saint ermite, qu'accompagne
un joli petit cochon. Il y a offrande, mais ne sont admis à défiler
devant le Saint que les messieurs. Pourquoi ? ... c'est la
tradition. Les mauvaises langues disent naturellement que c'est
parce que saint Antoine est surtout le patron des cochons... Mais
passons...
L'assistance est toujours solidement renforcée par les gens des
villages. avoisinants, venus prier saint Antoine pour qu'il veuille
bien s'intéresser à la prospérité de leurs porcs et à la
multiplication
de leur race. C'est une coutume qui paraît bien un peu bizarre, mais
rien n'est plus authentique.
C'est donc à cette cérémonie que la Mélie avait décidé d'assister.
Mais pour attirer plus sûrement sur elle et sur son cochon les
faveurs du Saint, elle avait décidé d'emmener le goret avec elle. On
emmène bien les gens malades à Vichy ou à Vittel, ça ne serait pas
plus drôle de conduire son cochon à Buriville. Si ça ne s'était
jamais fait, ça se ferait, il faut un commencement à tout.
Elle se prépara, mit un peu de paille dans le fond d'une petite
charrette à quatre roues, bordée de lattes. Elle amena cette
ambulance d'un nouveau genre tout près du goret qui, toujours assis
sur son train de derrière, regardait faire. La Mélie le saisit par
les pattes de devant et le Fanfan par le « pont arrière » et ruie
!... ruie !... ruie !... se mit à hurler l'animal, qui se laissa
embarquer avec une mauvaise volonté évidente...
Et la Mélie partit, poussant devant elle la charrette et le cochon,
qui avait l'air à présent de s'intéresser au déroulement du paysage.
Les voyages forment la jeunesse.
L'arrivée de la Mélie à Buriville, en pareil équipage fit sensation.
D'ordinaire, à la vue d'un malade grave, on est saisi d'un sentiment
de confusion qui porte à la tristesse. Mais ici, c'était tout le
contraire, les gens riaient aux éclats, ce qui semblait à la Mélie
peu conforme à l'esprit du pèlerinage. Au fond, elle eut souhaité
que son cochon se mit à « rigoler », lui aussi. Ne dit-on pas qu'un
malade qui rit est à moitié guéri ?
Elle gara son véhicule dans le petit clos qui précède l'entrée de
l'église et, sans plus s'occuper de l'animal à demi paralysé, elle
pénétra dans Le sanctuaire, trouva une petite place, sortit son
paroissien et suivit l'office avec recueillement.
A la sortie, la foule s'intéressa beaucoup à ce pèlerin grognon et
malodorant que les gamins taquinaient au passage. La Mélie sortit la
derrière, juste avant le prêtre qu'elle arrêta.
- M'sieur le curé, dit-elle, vous n'allez tout de même pas me dire
comme mon homme que j'suis me foutue bête d'avoir amené mon cochon
en pèlerinage, qué mal qui a, dites oir? C'est-y pas aussi une
créature du bon Dieu, comme vous et moi ?...
Et elle se mit à raconter au prêtre, tout au long, la triste
histoire de son goret, ses efforts
à le soigner, ses déceptions continuelles, son ravitaillement
compromis, cette « grillade » en famille qu'on ne pourrait pas
célébrer cette année, et tout ... et tout...
A ces mots de grillade, le bon prêtre, fils de paysans, sentit comme
monter à ses narines une forte odeur d'oignons frits qui lui rappela
soudain qu'il n'avait pas encore déjeuné et qu'il serait temps d'y
songer. Mais pouvait-il quitter cette vieille femme sans essayer de
la consoler un peu ? Il tourna donc alentour du cochon en ayant
l'air de l'examiner avec soin et en posant à la Mélie des questions
précises et qu'on sentait compétentes. Puis soudain il s'arrêta et,
de son doigt étendu, il montra la queue du goret qui pendait entre
les lattes de ta charrette, raide comme une baguette de tambour...
- Tenez, dit-il, tout le mal vient de là : un cochon qui se porte
bien doit avoir la queue en
tire-bouchon....
La Méfie rougit de plaisir.
- Ah ! ben, fit-elle, vous, au moins, vous avez un remède qu'est
meilleur que ceux du grand Jules, et plus facile à se procurer.
C'est mon homme qui va le soigner maintenant le cochon, lui qui le
regarde toujours avec les mains dans les poches. Ah ! comme je vas
te le faire se dégrouiller, le bougre...
Puis, en se confondant en remerciements, elle prit gaiment le chemin
du retour, laissant, là le prêtre qui, malgré une solide
instruction, ne s'expliqua jamais les raisons d'une telle joie.
Le retour fut une allégresse. Durant le repas qui suivit, la Mélie
fit la théorie au Fanfan, qui hocha la tète avec scepticisme, mais
promis d'essayer le jour même. C'était pas bien dur, puisqu'il
s'agissait simplement de tordre la queue de l'animal pour le
guérir...
Le cochon était resté en liberté dans la cour. Toujours assis, il
avait l'air de regretter amèrement sa belle ballade en voiture. Le
Fanfan s'approcha de lui par derrière, lui saisit la queue à deux
mains en lui imprimant un violent mouvement de rotation et de
torsion à la fois, exactement comme s'il s'agissait de lier un fagot
avec un hart. Le goret jeta un cri de douleur et fit un bond en
avant. Le Fanfan revint une heure après et recommença. Cette fois,
le cochon fit deux bonds. A raison de 12 applications du remède par
jour, le surlendemain il faisait 10 mètres d'une seule traite et
reprenait de l'appétit. Quinze jours après il ne s'asseyait plus et
il suffisait que le Fanfan paraisse pour que l'animal fit vingt fois
de suite le tour de la cour à une vitesse foudroyante. Puis un beau
jour, pour bien prouver à son maître qu'il n'avait plus besoin de
ses services, et sans doute pour varier ses exercices, il réussit à
passer entre les jambes du Fanfan, qui se retrouva dans la boue les
quatre fers en l'air.
Le cochon, redevenu gai et gourmand, ne fit jamais un monstre,
puisqu'il fallut le tuer déjà en mai, avant l'apparition des
chaleurs. Mais il atteignit une taille acceptable et fit, comme dans
toute histoire qui se termine bien, le bonheur des uns et des
autres.
En ce temps-là, la servante du curé desservant Buriville reçut des
mains d'une vieille femme qu'elle ne connaissait pas, et en
l'absence de son maître, un pesant paquet. Elle l'ouvrit. Il
contenait une épaule de cochon et... la queue de l'animal ! A son
retour, le prêtre pensa à une moquerie, mais le souvenir du goret de
Buriville lui revint. Il donna à ce présent l'accueil que l'on pense
et, tout en le dégustant, il se demanda comment le cochon avait pu
grandir si vite, puisque la queue de la pauvre bête, raidie par la
mort, n'était plus en tire-bouchon du tout.
JULIEN MALO.
(1) Filles. |
|













