Comme indiqué dans un précédent article,
la chapelle du Château d'Herbéviller-Lannoy aurait été
démontée avant 1927 pierre par pierre, et transportée au « Detroit
Institute of Arts ». Mais son aspect actuel n'est pas celui
d'origine, ne serait-ce que par les vitraux allemands enchâssés
en 1947.
Etat actuel à Détroit
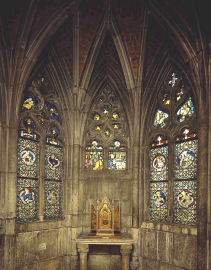 |
Carte postale ancienne
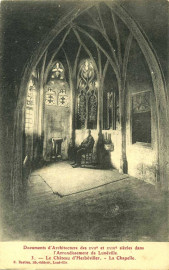 |
Quel était l'état de la chapelle au moment
de son transfert ?
L'article, reproduit et traduit ci-dessous, du Bulletin de
l'institut des arts de Detroit nous donne deux photographies de
1927, et l'indique
« originale dans toutes ses parties » :
 |
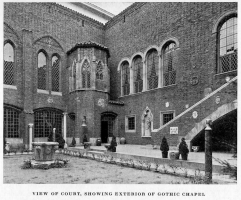 |
|
Carte postale 1929 : |
 |
|
On constate cependant
des différences importantes entre la carte postale
ancienne (d'avant la première guerre mondiale) et la
photographie de Détroit : les fenêtres à croisillons
carrés sont devenus losanges, les croix de Lorraine
surplombant l'autel ont été remplacées par des vitraux
plus complexes, l'autel lui même s'est grandement
élargi...
Nous disposons de quelques cartes postales donnant
l'aspect extérieur du château avant la guerre :
Mais surtout, de son aspect en 1918 :
Et la chapelle n'a pas disparu
intégralement sous les obus !
|

|
Elle avait été préalablement démontée
pierre par pierre, par l'antiquaire parisien
Demotte (ce que confirme aussi Jacques
Sadoul dans
Le Pays
Lorrain).
Les deux documents ci-contre, non
datés, font apparaître la toiture rénovée et la
chapelle absente (mais ils sont
sans doute d'après guerre, à en croire la
croissance de l'arbre à gauche).
L'antiquaire Demotte * a transporté la chapelle avant
guerre (1912 ? 1913 ?) à Paris, dans sa
galerie 27 rue de Berri, où il va l'exposer
en 1913, avant de la négocier
dès 1922 avec le directeur du musée de Détroit,
pour une acquisition définitive en 1923.
Mais qu'ont réellement acheté les Américains
? La chapelle originale, comme ils l'affirment
en 1927, ou une version modifiée par Demotte ?
(l'article du
Journal Gil Blas de 1913 parle aussi
étrangement de verrières et non de
vitraux) |
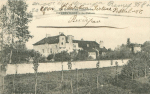
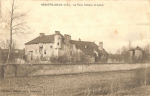 |
|
|
Ce qui semble confirmer cette hypothèse, est la
photographie ci-contre de la chapelle, issue d'une
publicité de Demotte en 1931 pour sa succursale de New-York ; la
chapelle est indiquée à Detroit mais mentionnée comme
autrefois dans la collection new-yorkaise de Demotte.
S'il est difficile d'y discerner l'état des fenêtres
(les deux traverses visibles laissant cependant penser
qu'il s'agit déjà des fenêtres à losange),
les modifications des croix de Lorraine ont déjà été
opérées, tout comme celle de l'autel qui supporte une
étrange statue (vierge à l'enfant ?) qu'on ne retrouve
sur aucun autre cliché. S'il s'agit, comme on peut le
soupçonner, d'un cliché pris dans la galerie Demotte de
New-York avant 1923, on pourrait en déduire que :
- la chapelle aurait bien été transférée de la galerie
parisienne à la galerie new-yorkaise avant sa cession à
l'Institut de Detroit ;
- c'est bien Demotte qui l'aurait rendue plus "esthétique"
pour en favoriser la vente, de sorte que les Américains,
qui n'ont sans doute jamais eu sous les yeux la carte
postale ancienne en début de cet article, auraient acquis une
version remaniée qu'ils croyaient originale.
|
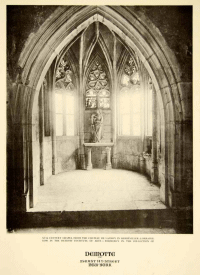
|
|
On notera par ailleurs que la même
chapelle, dans son état modifié, servira de couverture
au bulletin de l'Institut de Detroit en 1951 :
|
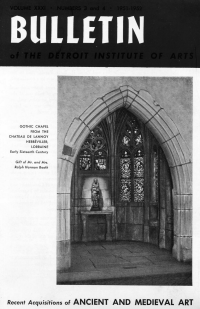 |
Bulletin of The Detroit Institute of Arts Of the City of Detroit
Vol. IX - OCTOBER, 1927 - No. 1
FRENCH GOTHIC CHAPEL C. 1500 GIFT OF MR. RALPH H. BOOTH
FRENCH GOTHIC CHAPEL
In the short time that our new building has been open to the
public, the French Gothic chapel, the dedication gift of Mr.
Ralph H. Booth, has become one of the most popular spots in the
Museum. Little wonder, indeed! This tiny structure, complete and
original in all its parts, with its weathered but well-preserved
old stone walls, pillars, and ribbed vaulting, its stained glass
windows, its altar and holy water font, brings to the people of
this young country something of the real atmosphere of past ages:
an atmosphere which the most perfect reproduction of antique
architecture somehow fails to give. In this little room one may
dream of the noble and courtly people, long passed away, who
prayed here; the very stones are alive and tell of the many
hands which touched them, of the skirts which brushed them, and
of the countless feet which trod them. |

(cliquer sur l'image pour
accéder au PDF) |
The chapel, originally a part of the Chateau de Lannoy in
Herbeviller in Lorraine (eastern France), was dismantled, and
stone for stone shipped to Detroit, where it was rebuilt into
the Museum in connection with the Gothic Hall. The exact date of
the castle, the records of which go back to the thirteenth
century, has not come down to us. We only know that it acquired
its present form while belonging to the Créhange family, who had
bought or inherited the estate from Marguerite de Chambley, Dame
de Parroy, late in the fifteenth century. Stylistic reasons lead
us to suppose that our chapel was built in the first years of
the sixteenth century. About the year 1525 the castle came into
the possession of the Bannerot family, who held It until the
eighteenth century, when René de Bouchard, husband of Anne de
Lannoy, became the owner. In 1758 their daughter married Jean
Pierre, Comte de Lignéville, in whose family the estate remained
until the Revolution. Lignéville is the last noble name
connected with the castle. Abandoned and maltreated during the
Revolution, in the nineteenth century it became the home of
several bourgeois families and is today a farm house.
In style the chapel represents the very last phase of French
Gothic art. Its general plan, ending in five sides of an octagon,
still follows the scheme established for choirs and chapels in
the first examples of Gothic architecture of the twelfth century.
The vault, however, which in the High Gothic period was
supported by single ribs ascending in a straight line from the
pillars to the keystone, has here become an intricate starlike
network of delicately moulded ribs. The capitals of the early
period and the wreaths of scanty foliage which superseded them,
marking the intersection of the engaged shafts and the vault,
are here entirely eliminated. In the traceried windows we have
the bows and "fishbladders" of the typical flamboyant manner,
and finally, above the niche on the right wall, we observe a not
conspicuous but significant detail: the relief decoration of
dolphins and acanthus leaves, the first glimpse of the coming
new style of the Italian Renaissance, a fact which definitely
proves that our chapel stands on the boundary of two periods, or
one might even say between two worlds.
W. H. |
Traduction du Bulletin du « Detroit Institute of Arts » de la ville de
Detroit
Vol. IX - OCTOBRE 1927 - N ° 1
CHAPELLE GOTHIQUE FRANÇAISE Vers 1500 - DON DE M. RALPH H. BOOTH
CHAPELLE GOTHIQUE FRANÇAISE
Durant le peu de temps où notre nouveau bâtiment a été ouvert au
public, la chapelle gothique française, don dévoué de M. Ralph H.
Booth, est devenu l'un des endroits les plus populaires du
Musée. Rien d'étonnant, en effet ! Cette petite structure,
complète et originale dans toutes ses parties, avec ses vieux
murs de pierre résistants mais bien conservés, ses piliers, ses
voûtes nervurés, ses vitraux, son autel et son bénitier, apporte
au peuple de ce jeune pays quelque chose de l'atmosphère réelle
des siècles passés: une atmosphère que la plus parfaite
reproduction de l'architecture antique échoue en quelque sorte à
donner. Dans cette petite pièce, on peut rêver des gens nobles
et courtois, disparus depuis longtemps, qui ont prié ici : les
pierres sont vivantes et témoignent des nombreuses mains qui les
ont touchées, des jupes qui les ont frôlées et des pieds
innombrables qui les ont foulées.
La chapelle, à l'origine une partie du château de Lannoy à
Herbeviller en Lorraine (est de la France), a été démantelée, et
expédiée pierre par pierre à Detroit, où elle a été
reconstruite au sein du musée dans le cadre de la salle
gothique. La date exacte du château, dont les traces remontent
au XIIIe siècle, n'est nous est pas parvenue. Nous savons
seulement qu'il a acquis sa forme actuelle alors qu'il
appartenait à la famille Créhange, qui avait acheté ou hérité de
la succession de Marguerite de Chambley, Dame de Parroy, à la
fin du XVe siècle. Des raisons stylistiques nous amènent à
supposer que notre chapelle a été construite dans les premières
années du XVIe siècle. Au environ de l'an 1525 le château est
entré en possession de la famille Bannerot, qui l'a détenu jusqu'au
XVIIIe siècle, où René de Bouchard, époux d'Anne de Lannoy,
en est devenu propriétaire. En 1758, leur fille a épousé Jean
Pierre, comte de Lignéville, dans la famille duquel la
succession est restée jusqu'à la Révolution. Lignéville est le
dernier nom de famille noble en relation avec le château.
Abandonné et maltraité pendant la Révolution, il est devenu au
dix-neuvième siècle le foyer de plusieurs
familles bourgeoises et est aujourd'hui une maison de ferme.
En terme de style, la chapelle représente la toute dernière
phase de l'art gothique français. Son plan général, se réduisant
aux cinq côtés d'un octogone, suit rigoureusement le schéma
établi pour les choeurs et chapelles des premiers exemples de
l'architecture gothique du XIIe siècle. La voûte, cependant, qui
dans la période du gothique était soutenue par de simples
nervures ascendantes, en ligne droite des piliers à la clef de
voûte, est devenu ici un réseau étoilé complexe, d'ogives
délicatement moulées. Les éléments essentiels de la première
période, et les couronnes de feuillage maigre qui les
remplacent, marquant l'intersection des axes engagés et de la
voûte, sont ici totalement absents. Dans les fenêtres en ogive,
nous trouvons les arcs et "vessies de poissons" typiques du style
flamboyant, et enfin, au-dessus de la niche sur le mur de
droite, on observe un détail bien peu visible mais
d'importance: la décoration en relief de dauphins et de feuilles
d'acanthe, premier aperçu du prochain nouveau style de la
Renaissance italienne, ce qui prouve définitivement que notre
chapelle se situe à la frontière de deux périodes, ou,
pourrait-on même dire, entre deux mondes.
W. H.
Magazine of the
Women's City Club of Detroit - Septembre 1927
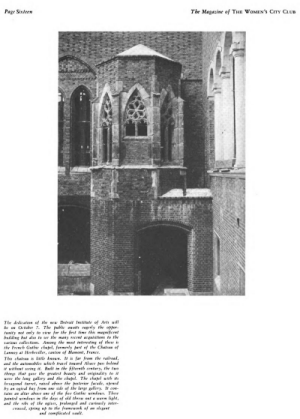
Les Arts
Exposition d'art gothique
Voilà, je pense, une nouveauté, - en 1913. Une exposition d'art
gothique, peinture, verrières, et statuaire. Des merveilles,
comparables aux plus hauts chefs-d'oeuvre de Chartre.s, Reims,
Amiens, Sens, Bourges, ou de Notre-Dame de Paris. Cela va nous
changer des sempiternelles et commerciales exhibitions de
marines bretonnes, frondaisons versaillaises et « couchers de
soleil sur le grand canal ». Est-il possible d'imaginer pour les
artistes, les archéologues, Les grands amateurs, les érudits,
une rétrospective plus émouvante et d'un enseignement plus
profond ?
Ce spectacle d'une rareté précieuse, c'est à M. Demotte (et qui,
sinon M. Demotte, pourrait à l'heure actuelle, l'offrir ?) que
nous en serons, sous deux mois, redevables.
A cette exposition, qui attirera l'élite à l'hôtel de la rue de
Berri, l'on verra d'abord la représentation de la Vierge par des
exemplaires français de premier ordre, du douzième siècle au
seizième, c'est-à-dire jusqu'à cette école de Troyes, qui est
encore tout imprégnée du sentiment et de la technique médiévaux,
et n'est pas encore italianisée. Vierges debout, assises,
portant un bouquet, présentant un fruit, une grappe de raisins à
l'Enfant. Une Vierge adorable, oeuvre d'un intérêt exceptionnel,
tenant de la main droite un encrier à l'Enfant Jésus, qui tient
de la main gauche un phylactère sur lequel il écrit de l'autre
main. Cette statue est du nord de la France, XVe siècle.
La série compte d'autres ouvrages dignes de là plus. fervente
admiration.
Nous ne pouvons aujourd'hui que les indiquer, nous réservant de
les décrire longuement au moment voulu.
Vous verrez à la galerie Demotte-, le portrait entier de la
Chartreuse de la Réole (début du XVe). Il sera présenté, en
place pour ainsi dire, dans une crypte construite chez M.
Demotte. Et l'on ne saurait, sans les avoir vues, soupçonner
la beauté unique des fêtes du Christ, de la Vierge et de saint
Jean qui couronnent ce portail roman.
Dans la même crypte seront exposés une statue du Christ entrant
à Jérusalem le dimanche des Rameaux, pierre d'une éloquence
familière et d'un réalisme exquis. A droite et à gauche., deux
figures de prophètes. Ces trois pièces, d'une qualité égale à ce
qu'on voit de plus beau à Chartres, proviennent de l'église de
Notre-Dame de la Couldre, à Parthenay, dans les Deux-Sèvres,
église romaine dont il ne reste plus, que le portail à quadruple
voussure.
On nous montrera ensuite des fragments de chapiteaux de la
cathédrale de Saint-Denis ; et des fragments de Reims. De Reims
encore, une délicieuse petite figure d'apôtre appuyé à un
pilastre et venant d'une église rémoise aujourd'hui, détruite.
De la cathédrale de Conques, des « corbeaux » de l'expression
la plus saisissante.
Le treizième siècle sera représenté par une statue de Roi assis
sur un trône, en marbre blanc ; par une statuette d'apôtre, en
bois sculpté polychrome, style d'Amiens ; un extraordinaire
buste de bourreau, au visage menaçant.
Ce sont ensuite deux têtes d'apôtres (début du XIVe siècle)
pures comme, des antiques, provenant d'un portail détruit de
l'église parisienne de Saint-Jacques. Du XIVe une Vierge trouvée
il y a quelque soixante années, à Saint-Germain-des-Prés, type
parfait de l'art de l'Ile-de-France ; un Groupe de Donateurs,
neuf figures de pierre, bloc sublime, exhumé de l'abbaye de
Jumièges.
Du XVe, le buste étonnant, d'un Diacre, revêtu de sa chape aux
broderies de pierre ajourée, et dont le chaperon porte comme
ornements les images de la Vierge et de l'ange Gabriel.
Et pour clore le lot du XVe, un bas-relief montrant un Donateur
et sa femme, présentés par saint Jacques à la Vierge assise. Au
second plan, se lit dans la pierre l'histoire des épisodes de la
vie aventureuse et guerrière de ce donateur.
Du XVIe, deux Saintes Femmes provenant d'une Mise au tombeau, et
une statuette de bois colorié figurant la Vierge assise sur un
trône et jouant avec l'Enfant.
Joignez a cet ensemble prodigieux quelques tapisseries
gothiques, verdures animées, verdures à oiseaux ou à scènes
religieuses ; des primitifs français et flamands, dont un
triptyque, la Vierge et l'Enfant auprès de saint Joseph, sainte
Catherine et sainte Barbe; avec, soir les volets, deux anges
musiciens. Cette peinture, du tout début du quinzième, cet d'art
anversois ; la fraicheur prodigieuse de son coloris, la fermeté
du dessin, la suavité expressive du sentiment, tout y concourt à
notre ravissement.
Quant aux vitraux (notamment les quatre panneaux où l'on voit
-deux saint Paul et deux saint Pierre), ils s'étageront du
douzième au quinzième siècle.
Et vous aurez encore la surprise d'admirer chez M. Demotte la
chapelle démontée, transportée, reconstituée pierre à pierre, du
château de Lannoy, à Herbeviller (Meurthe-et-Moselle), chapelle
avec ses verrières, son autel, et bas-relief dédié à saint
Hubert.
Nous reviendrons à loisir sur cette manifestation considérable.
Pour la commenter, il -faudrait un volume. Et ce volume,
Courajod, André Michel, Emile Malle, M,He Louise Pillion l'ont
écrit. La statuaire française du treizième s'adresse à ce que le
jugement, la sensibilité, le coeur ont de plus secret et de plus
noble. L'art des imagiers gothiques vaut par une harmonieuse et
sereine unité ; sa sculpture, liée à l'architecture dans le
rapport exact d'une plante avec le sol qui la porte et la
nourrit, est la floraison symbolique de l'art chrétien. Ce
symbolisme, d'ailleurs, n'empêche pas le réalisme le plus probe,
le plus savoureux, de se donner libre carrière. Mais l'esprit
dompte la matière. Tout l'art chrétien du moyen âge est dominé
par la préoccupation qu'exprima Suger de conduire les âmes « par
le moyen des choses matérielles aux Immatériel : de materialibus,
ad immaterialia ».
D'ores et déjà nous devons un grand merci à M. Demotte qui va
bientôt nous donner la plus salutaire leçon et la meilleure des
joies.
Louis Vauxcelles.
* Georges Joseph Demotte
(1877-1923) est un marchand d'art, né en Belgique qui
possédait un magasin à Paris (27 rue de Berri) et à New
York (8 east 57th Street). Spécialisé dans l'art
médiéval français, il achetait des structures et
sculptures gothiques qu'il revendait ensuite.
Henri Matisse fit son portrait en
1918.
Les méthodes de Demotte restent fortement critiquables : on sait
ainsi qu'ayant acquis le très rare manuscrit mongol du Livre des
rois (Shahnameh), il le démembra irrémédiablement pour vendre
chaque illustration à divers collectionneurs, sans même
hésiter à détacher des recto/verso pour maximiser son
profit. |
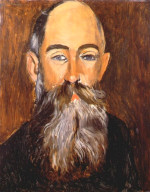 |
Il engagea
en 1923 un procès en diffamation contre l'américain Joseph Duveen, qui affirmait qu'une statuette médiévale vendue par
Demotte était un faux. Mais il mourut accidentellement le 4
septembre 1923, abattu au retour d'une chasse au sanglier par
son collègue marchand d'art Otto Wegener. Le Gaulois du 5
septembre 1923 conclut l'information par ces lignes : « on
sait que M. Demotte avait été partie dans un procès au
correctionnel portant sur des commissions pour ventes d'objets
d'art en Amérique. A l'occasion de ce procès, certains
chefs-d'oeuvres, figurant dans les collections nationales,
furent passionnément discutés par les experts et les
archéologues. M. Demotte emporte avec lui dans la tombe le
secret des Lansquenets du Louvre et de maintes sculptures du
moyen âge et de la Renaissance exportées dans le Nouveau Monde
».
Car, outre le procès américain, Demotte était opposé
à l'antiquaire Jean Vigouroux, son ancien directeur de la succursale de New
York, pour des affaires d'encaissements de commissions et de
détournement de fonds. Mais Vigouroux durant ce procès ne
cessera d'accabler Demotte d'accusations de faux.
On peut ainsi noter, entre autres déclarations suspectes au
cours de ce procès qui servit quasiment de feuilleton au journal
le Gaulois :
« M. Vigouroux estime que les deux
lansquenets provenant d'un château du Barrois sont faux. Fausses
également les deux statues de rois provenant de
Notre-Dame-de-la-Coulche, à Parthenay, et l'Annonciation aux
mages. [...] M. Vigouroux à l'appui de ses dires, à montré des
photographie des originaux. D'après ces documents il y aurait eu
restauration. [...] M. Vigouroux a affirmé à M. Ameline que les
deux statues de la Vierge dont l'une se trouve actuellement au
Musée Métropolitain de New-York et l'autre au Musée Gardner de
Boston étaient fausses. Il a enfin déclaré au magistrat que M.
Demotte possédait, rue Dutot, un atelier où l'on fabriquait de
fausses statues. Mais cet atelier aurait été fermé, paraît-il,
dès l'ouverture de l'enquête ». (Le Gaulois, 20 juin 1923)
« M. de Stecklin, ami du sculpteur Boutron, maître des ateliers Demotte,
raconte ce qu'il a vu : - J'ai pu voir, dit-il, une vieille
cheminée de ferme, frustre et simple, devenir une magnifique
cheminée renaissance avec frises et cartouches. J'ai vu un saint
porteur d'une sacoche changer de sexe et devenir une vierge
portant l'Enfant Jésus. ». (Le Gaulois, 15 novembre 1924)
Il faudrait aussi, pour compléter, se pencher sur la mort suspecte
en 1920 du sculpteur Boutron, chef de l'atelier de pierre de
Georges Demotte...mais cela nous conduirait fort loin de notre
sujet originel.
|
Rédaction :
Thierry Meurant |
|













