|
|
|
|
|
|
|
Antoine-Alexandre Jandel
(1783-1862), architecte de l'hôtel de ville
|
Dans son Histoire du Blâmontois dans
les temps modernes, l'abbé Dedenon livre cette très
courte information : « A Blâmont, les locaux de l'hospice
devenaient insuffisants : ils furent agrandis, en 1827. Ceux de
l'hôtel de ville surtout criaient misère : ils furent remplacés
par l'édifice actuel, dont le dessin est dû à l'architecte
Jeandel.»
| Jean Nicolas Antoine Alexandre
Jandel naît à Pompey le 6 octobre 1783. Il est le fils
de Jean Nicolas Jandel, avocat au parlement, seigneur de
Braux, de Nayves-en-Blois et de Méligny (et ancien
Directeur et caissier de la verrerie de baccarat), qui
habite Nancy mais dispose d'une maison de campagne à
Pompey. |
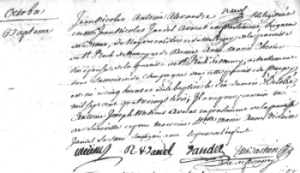 |
L'acte de mariage d'Antoine Alexandre Jandel
et Marie Elisabeth Josephine Chabert à Gerbeviller le 13 août 1809, porte la
mention « élève ingénieur des Ponts-et-Chaussée, domicilié à
Champey ». Le terme « élève » n'est pourtant plus de mise, car
si Jandel est parfois cité comme « architecte », il apparait le plus
souvent sous sa véritable désignation « ingénieur des ponts et
chaussées », ayant intégré l'école polytechnique à compter du
1er frimaire an XII (23 novembre 1803) et été admis le 30
octobre 1806 dans le service public des Ponts-et-Chaussées.
De nombreux éléments biographiques sur Jean Nicolas, Antoine
Alexandre et son épouse, figurent dans la
« Vie du
révérendissime père Alexandre-Vincent Jandel soixante-treizième
maitre général des frères-prêcheurs » (par Hyacinthe-Marie
Cormier, Ed. Paris 1896), biographie consacrée au fils aîné du
couple.
Un premier projet de construction d'un hôtel de ville à Blâmont,
avec halle, école et tribunal est présenté par Jandel en 1828 pour un
montant de 85.000 francs sans honoraires et 5.000 francs de
vieux matériaux. Ce projet, avec halle au rez-de-chaussée, hôtel
de ville et salle de justice de paix au premier niveau et écoles
au second niveau, est rejeté par un rapport du 22 février 1828
qui soulève divers problèmes :
-
il manque le plans des caves ;
-
les escaliers donnant sur halles pourraient avoir deux
révolutions au lieu d'une ;
-
la distribution des pièces
de l'hôtel de ville est fortement critiquée : il faut
créer pièce de dégagement donnant accès au secrétariat, aux
archives, au cabinet du maire ;
-
pour la justice de paix, il n'y a pas de cabinet
prévu pour le juge et une pièce de dégagement est à créer ;
-
la présence des écoles au-dessus de la salle du Conseil
municipal est jugée incorrecte à cause du bruit ;
-
les plans ne présentent pas de latrines, et il convient d'en
faire à chaque étage ;
-
les piles des élévations aux angles du rez-de-chaussée sont
trop faibles ;
-
il convient de faire une arcade d'entrée aux vestibules devant
les escaliers, et au premier niveau, de faire reposer les
croisées sur un bandeau et de prévoir un encadrement aux
croisées côté place ;
-
la hauteur de 4,15 mètres sous poutres est jugée insuffisante
;
-
dans le salle du conseil une cheminée est jugée préférable au
poêle ;
-
deux grands escaliers sont
considérés comme inutiles, tout comme les greniers.
Jandel refera son projet en tenant compte de ces observations,
et le projet sera définitivement adopté le 23 juin 1829, pour un
total de 93.000 francs (hors honoraires) : le bâtiment comprend
la halle au blé avec corps de garde et pompe à incendie au
rez-de-chaussée, et hôtel de ville et justice de paix au premier
étage. Les matériaux sont la pierre de taille, la maçonnerie de
moellons pour le surplus des murs, et la charpente est en chêne
et sapin.

Hôtel de Ville - 1829
Rez-de-chaussée |

Hôtel de Ville - 1829
Entresol |
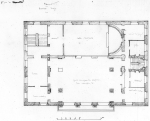
Hôtel de Ville - 1829
Premier étage |

Hôtel de Ville - 1829
Coupe |
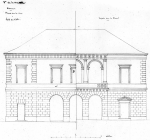
Hôtel de Ville - 1829
Façade sur la place |
|
Parmi les projets et réalisations de Antoine
Alexandre Jandel on peut citer :
-
en 1815, des travaux pour les gendarmeries de Nancy,
Lunéville, Toul, Bayon, Baccarat, Vézelise, et Blâmont (coût de
3.945 francs pour cette dernière) ;
-
en 1820, un projet de réparation de la couverture de l'église
de Saint-Nicolas de Port ;
-
en 1820, la construction, à la demande du Préfet, du
presbytère de Laloeuf, et de l'école de Vroncourt ;
-
en 1820, des travaux à la gendarmerie de Vézelise ;
-
en 1822, des travaux destinés à changer le cours de la Meurthe
au haras de Rosières-aux-Salines ;
-
en 1822, la construction d'un hangar pour le haras de
Rosières-aux-Salines ;
-
en 1823, un projet ajournée de restauration de l'asile
d'aliéné de Laxou ;
-
en 1823, des travaux des reconstruction du manège du haras de
Rosières-aux-Salines ;
-
en 1827, un projet de réparation au séminaire de Nancy, pour
reconstruire la couverture, le plâtre et les enduits des murs et
plafonds, établir un maître-autel et deux autels secondaires, le
menuiserie, etc. Le projet sera refusé avec ce commentaire peu
flatteur : « Jandel est sorti de ses attributions naturelles et
il serait sage de ne point envahir les fonctions d'architecte
pour lesquelles il ne paraît pas posséder l'acquis nécessaire »
;
-
en 1828, des travaux au séminaire de Nancy pour la réparation
de la chapelle ;
-
...
Antoine Alexandre Jandel décède à Nancy le 18
décembre 1862 (son épouse y est décédée le 29 septembre 1854).
Vie du révérendissime père Alexandre-Vincent
Jandel
soixante-treizième maitre général des frères-prêcheurs
Hyacinthe-Marie Cormier (Ed. Paris 1896).
[Page 1]
Le Père Alexandre-Vincent Jandel naquit à Gerbéviller, en
Lorraine, l'an 1810. Rien de remarquable, sous le rapport de la
noblesse ou de la fortune, ne signale ses ancêtres. Son aïeul
paternel était fils d'un simple paysan chargé du transport des
matériaux dans une usine de verrerie, à Saint-Quirin. L'enfant
aimait sans doute à monter sur la voiture de son père pour y
prendre ses ébats ; l'abbé de Saint-Ignon, propriétaire de
l'usine, le remarqua, s'intéressa à lui et lui fit faire ses
études. Il était, en effet, supérieurement doué, devint avocat
brillant au parlement de Nancy, et se fit une fortune.
Malheureusement, il était joueur; tout son avoir dut être vendu
peu à peu, pour payer ses dettes.
Marié en 1769, il eut en 1783 un fils qu'il appela
Antoine-Alexandre. Celui-ci, négligé par son père, passa une
partie de son enfance à Champel, près de Lunéville, maison de
campagne qui avait échappé aux dilapidations du jeu.
Il ne lui resta plus tard, comme souvenir de ses premières
années, que la douce et triste image de sa mère enlevée à son
affection, quand il n'avait que sept ans, après avoir beaucoup
souffert. En dehors de là, il ne se rappelait que le passage de
nombreux régiments pendant la révolution, et les longues
chevauchées faites à travers les bois, avec un brave Hongrois,
prisonnier des campagnes d'Italie, devenu son fidèle serviteur,
presque son ami. Il tenait d'ailleurs de sa race une haute
stature, un tempérament robuste, une force de corps peu commune,
que cette vie au grand air avait contribué à développer.
Malgré les lacunes de son instruction primaire, il fut admis, en
1804, à l'Ecole polytechnique où il eut pour répétiteur Arago,
le futur membre de l'Institut et du Gouvernement provisoire de
1848. Il sortit un des premiers de cette école, et y remplit
lui-même les fonctions de répétiteur pendant un an, après ses
cours d'application des ponts et chaussées.
De retour à Champel et jugeant le moment venu de s'établir dans
le monde, il jeta les yeux sur une jeune personne de
Gerbéviller, appelée Mlle Joséphine Chabert-Marquis, soeur d'un
de ses camarades de l'Ecole polytechnique (*).
Mlle Chabert n'était pas moins remarquable par sa foi vive que
par son jugement droit, son énergie, son esprit d'initiative et
l'aménité de ses manières. Au plus fort delà terreur, le curé de
Gerbéviller, M. Bessat, avait dû s'exiler, et le vicaire, M.
Hunal, se tenait caché près du pays, errant dans les bois ou de
maison en maison ; Joséphine, âgée à peine de 14 ans, secondait
vaillamment le ministère de ce jeune prêtre. Ses parents, il
faut le dire, étaient de connivence; moins actifs qu'elle, ils
donnaient leur fortune ; et l'argenterie, à son tour, y passa.
L'abbé Hunal, qu'elle tenait au courant de tout, venait
fréquemment la nuit, à l'aide de déguisements successifs qu'elle
inventait et lui enseignait à bien porter, pour administrer les
secours de la religion aux fidèles. Que de fois ne vit-on pas
Mlle Chabert, à la faveur des ténèbres, sans craindre ni la
police ni les autres dangers, porter de petits enfants entre ses
bras pour leur procurer le bienfait du baptême ? Et combien de
ces pauvres créatures nées de parents forcenés révolutionnaires
entre tous, ne lui durent-elles pas leur admission dans le sein
de l'Eglise ?
Un enfant, en particulier, fruit de l'inconduite, excita sa
compassion; elle s'en constitua la marraine, et le secourut
constamment dans sa pauvreté. Joseph, elle l'avait ainsi appelé,
en souvenir de son propre nom de Joséphine, répondit mal à ce
dévouement ; par un coup de tête il s'engagea dans l'infanterie
de marine et passa au Sénégal. Quand il en revint malade et sans
ressources, elle le soigna, lui acheta les outils de sa
profession et le maria, sans le ramener pour cela à des
habitudes régulières. Usé par la boisson, il mourut à l'hôpital
de Nancy; mais chrétiennement; c'était la récompense de plus de
trente ans de charité et de prières.
Gerbéviller ne fut pas, du reste, l'unique théâtre du courage de
Joséphine, elle alla même jusqu'à pénétrer dans la prison de
Nancy pour y consoler sa parente Mme de Foucault, qui fut
inopinément sauvée de la mort, par la chute de Robespierre, le 9
thermidor.
Avec toutes ces qualités, la jeune fille montrait des aptitudes
littéraires très avancées pour son âge. Elle ne se lassait pas,
ont raconté ses intimes, de lire les auteurs du dix-septième
siècle ; elle avait surtout la fibre cornélienne. Enthousiaste
et énergique comme Charlotte Corday, pieuse et raisonnable comme
Mme de Lescure, elle se tenait, par ses aspirations, à mi-chemin
de ces deux femmes célèbres, mais était de leur taille par
l'intelligence et le coeur. En vain, son confesseur lui
reprochait-il sa passion pour Racine et autres tragiques ; il la
trouvait impénitente. Elle excellait aussi à interpréter les
romances sentimentales de l'époque, et un jour elle ne put
maîtriser à l'église un accès de fou rire, en entendant chanter
un cantique sur l'air d'une romance peu faite pour le saint
lieu.
Quoique ses préférences fussent pour les charmes de l'esprit,
elle ne dédaignait pas les ornements extérieurs et les portait
fort bien. Un jour qu'elle assistait au sermon de la
Congrégation de la sainte Vierge, dont malgré tout, ses qualités
sérieuses et son' ascendant sur les jeunes filles l'avaient fait
nommer présidente, le prédicateur tonna contre le luxe et les
ajustements des femmes, et il crut donner le coup décisif par
cette apostrophe : « Du reste, en êtes-vous pour cela plus
belles ? » - « Oui », répondit tout bas la présidente ; et elle
accentua son dire par un geste de la tête. Le prédicateur, sans
entendre le mot, remarqua le geste et lui en demanda raison à la
sacristie, après la séance ; mais elle maintint son sentiment.
Elle n'entendait pas contester les dangers d'une parure abusive,
au point de vue de la piété; mais prétendre qu'au point de vue
de la grâce extérieure, il n'en ressort aucun embellissement,
lui semblait une fausseté. Elle mettait du reste, dans cette
application à la toilette, la plus grande innocence; et tout en
elle, soin de la parure, gracieuseté dans les manières, passion
littéraire, faisait place à une dignité fière devant l'ombre du
mal.
Ce fut à cette époque qu'elle connut M. Jandel, jeune ingénieur;
elle gagna promptement ses sympathies et n'hésita pas à les lui
rendre. Son extérieur distingué, la convenance de ses manières,
ses talents précoces, la bonté répandue sur son visage, tout lui
plaisait. Le projet d'alliance fut donc bientôt arrêté. La
malheureuse question de fortune faillit tout faire échouer ;
Joséphine n'avait pour toute dot que ses qualités personnelles ;
et le père du jeune homme, ruiné par le jeu, voulait une
belle-fille qui apportât de la fortune. Avec sa volonté de fer,
il s'opposa plusieurs années au mariage, mais se heurta contre
une énergie persévérante, d'autant plus forte qu'elle était
revêtue de formes plus respectueuses. Enfin, en 1809, à demi
vaincu par la fermeté de son fils, à demi subjugué par les
qualités de la jeune fille, il donna son consentement, sans
toutefois fournir aucun secours pécuniaire. C'était assez pour
les deux fiancés. Ils s'unirent devant l'Eglise, et Dieu ne
tarda pas à leur donner de meilleures richesses que l'or et les
pierreries.
Trois enfants furent le fruit de leur mariage, un fils et deux
filles. L'ainé, celui-là même dont nous retraçons la vie, naquit
le 18 juillet 1810, la veille de la fête de saint Vincent de
Paul, à Gerbéviller, pendant un séjour qu'y faisait
accidentellement sa mère, car le jeune ménage, à cause de la
profession du mari, habitait Nancy. On le baptisa sous le nom de
Jean-Joseph-Alexandre, dans la chapelle du château, ancienne
église des Carmes. Depuis cette époque, sa mère se sentit une
plus spéciale dévotion pour cette chapelle, lieu de son propre
baptême; elle y entrait souvent pour prier, tandis qu'elle
laissait son enfant jouer sur l'herbe, près de la porte, afin de
ne pas le perdre de vue. Lui aussi se rappelait avec délices,
surtout à la fin de sa vie, ce sanctuaire, et ses jeux enfantins
sur la pelouse, et la piété de sa mère. Aussi, quand on restaura
la chapelle, il tint à honneur, en reconnaissance de ces grâces
premières, de lui offrir une partie du corps de saint Tharcise,
protomartyr de l'Eucharistie, qu'il avait pu obtenir à Naples.
Dans sa première enfance la santé du petit Alex (c'est ainsi
qu'on l'avait surnommé), donna de vives et continuelles
inquiétudes à ses parents, tant il était chétif et malingre; sa
mère, d'autre part, ne put continuer à le nourrir, malgré le
désir ardent qu'elle en avait. Mais, craignant qu'une nourrice
ne transmît à l'enfant quelque chose de ses infirmités physiques
ou morales, elle se résolut de l'élever au biberon. Ce qu'il lui
fallut de sollicitudes, d'industrie et de patience ne peut
s'exprimer; néanmoins elle réussit. Pendant ses quatorze
premiers mois, le petit enfant avait été souffreteux, ses
plaintes étaient si continuelles qu'une nuit, ne l'entendant
pas, ses parents accoururent à son berceau, tremblant de le
trouver mort ; mais il dormait paisiblement, et ce sommeil
favorable continua depuis lors.
La naissance d'une autre enfant, Gabrielle, vint compléter la
joie des parents (**). Le foyer se peuplait, s'emplissant d'une
pieuse allégresse. Avant tout, Dieu y régnait et y versait ses
grâces. M. Jandel, indifférent pendant sa jeunesse en matière
religieuse, comme presque toute sa génération, avait cherché la
vérité d'un coeur droit; les conférences de M. de Frayssinous
assidûment suivies à Paris pendant ses loisirs d'étudiant,
l'avaient éclairé. L'ascendant de sa chère Joséphine acheva en
lui l'oeuvre de la persuasion. Une fois convaincu, il alla
jusqu'au bout et ne dévia plus ; c'était avec une noble et
généreuse simplicité qu'il accomplissait tous ses devoirs
religieux, sans ostentation, comme sans respect humain.
M. Jandel avait pour qualité principale un coeur aimant et
dévoué ; en lui le sentiment prévenait la réflexion et lui
nuisait souvent. Sa femme, tout aussi généreuse, mais douée
d'une raison plus pénétrante et plus maîtresse d'elle-même,
tempérait par son influence l'excès des qualités de son mari;
aussi ne parlait-il d'elle qu'avec une sorte d'admiration.
Parfois pourtant il passait outre à ses avis ou négligeait de la
consulter, ce dont il avait presque toujours à se repentir.. Mme
Jandel ne se prévalut jamais de ces déconvenues pour faire
montre de la solidité de son jugement. Si elle avait de
l'esprit, il était sans ostentation et surtout sans malignité.
Grâce à ce tact délicat, la paix régnait dans la maison ; et M.
Jandel s'y plaisait. Jouir de cette vie d'intérieur sous le
regard de Dieu, dans son pays natal, avec des devoirs
professionnels qui l'intéressaient, quelques amitiés qu'il
savait choisir, et des travaux agricoles bien plus propres, il
faut l'avouer, à le distraire qu'à l'enrichir, c'était assez
pour son ambition, car c'était assez pour son coeur. On ne tarda
pas cependant à lui offrir un poste d'ingénieur en chef, mais le
déplacement était une condition, il remercia modestement. Une
seule fois il fut détaché de Nancy pour faire à Luxembourg le
service de capitaine du génie. La place n'était pas assiégée,
mais simplement observée ; il prit part cependant, aux
avant-postes, à quelques engagements où il fit bravement son
devoir et eut son cheval tué sous lui ; Dieu protégea ses jours,
pour lui, sans doute, mais aussi pour sa jeune famille, sur qui
reposaient tant d'espérances.
Elevés par d'aussi dignes parents, les deux enfants ne pouvaient
manquer de grandir dans la vertu. En Gabrielle, se manifestaient
plutôt les qualités du père; Alexandre était le portrait de sa
mère. Elle s'occupa spécialement de son éducation et y suivit,
sans la connaître, la maxime qu'un cardinal dominicain, le B.
Jean-Dominique, donnait pour règle à une mère de famille : «
Elevez votre fils pour Dieu, puis pour ses parents, en
particulier pour vous qui êtes sa mère, mais aussi pour le bien
public, et formez-le à supporter l'adversité. » L'enfant
conserva toute la vie pour sa mère un amour de prédilection.
Même après avoir grandi, il quêtait volontiers ses caresses,
qu'il lui restituait avec usure, de la manière la plus naïve et
la plus gracieuse. En même temps, il montrait pour son autorité
un respect profond; car on l'avait habitué à agir pour Dieu dont
les parents sont les représentants visibles. Mme Jandel avait su
lui inspirer de tels sentiments de piété, que la pénitence la
plus sensible dont elle pût le menacer était de ne pas le mener
à la messe ; cette crainte le ramenait de suite au devoir. Une
seule fois la punition lui fut imposée, et elle lui fit verser
tant de larmes, que la mère n'eut plus le courage d'y revenir.
Le trait suivant témoigne quelle était, dans l'enfant, à l'âge
de cinq ou six ans, la droiture de coeur. Un jour on le cherche
partout, mais en vain. Qu'est-il devenu ? Se serait-il permis,
contre sa coutume, d'aller jouer dans le voisinage ? Aurait-il
été victime de quelque accident ? L'anxiété est indescriptible
dans toute la maison. Enfin on le trouve dans une grande chambre
noire, à genoux : « Que fais-tu là, malheureux enfant ? - Je me
punis tout seul ! - Eh! qu'as-tu donc fait ? - J'ai désobéi »; -
et il rapporte le grief enfantin dont il s'est rendu coupable. -
« Mais, lui observe-t-on, ta mère ne l'a pas vu. - C'est égal,
le bon Dieu l'a vu ; je me punis tout seul. »
Il parait qu'il en avait agi souvent de la sorte, sans que
personne l'eût soupçonné, tant il s'appliquait à cacher ces
pénitences volontaires.
Sous l'influence de ces vues de foi si simples et si hautes, les
autres sentiments auxquels on fait appel pour agir sur le coeur
de l'enfance, comme la crainte de contrister les parents, le
désir de leur plaire, l'ambition de mériter leurs éloges, se
développaient à l'aise dans le jeune Alexandre, sans péril de
trahir les espérances ou de dégénérer en défauts. Aussi
faisait-il la consolation de toute la famille, et la confiance
de sa mère allait-elle jusqu'à le consulter sur les affaires
embarrassantes de la maison.
Pour donner une base solide à son éducation littéraire à
laquelle elle tenait tant, Mme Jandel plaça son fils pendant
quelque temps à l'école des Frères, qui venaient de s'établir à
Nancy. Là, encore, il se fit remarquer par sa sagesse précoce ;
la croix d'honneur brillait si habituellement sur sa poitrine
qu'il y semblait abonné, et il la portait avec autant d'aisance
que de modestie. Dans les processions il tenait volontiers
l'oriflamme ; à l'autel il se faisait un bonheur de servir comme
enfant de choeur; et il se permettait parfois d'amicales
remontrances aux autres petits clercs dissipés, leur citant avec
véhémence certains passages d'un sermon qu'il avait entendu sur
les peines de l'autre vie.
Il est certain cependant, que les premiers éléments du latin et
du grec lui furent donnés à la maison paternelle, par un employé
du bureau de son père nommé Jacquinet, ancien chef d'étude au
collège, jeune homme instruit et consciencieux ; car il ne
ménageait pas davantage le fils de son ingénieur que s'il eût
été l'enfant d'un subalterne. Heureusement que l'élève était
capable de tenir à ce régime ; et même d'y gagner, pour la
trempe du caractère. Telles étaient son application et ses
aptitudes, que, peu de temps après, le maître vint exposer son
embarras à M. Jandel ; « Votre fils en sait maintenant autant
que moi, si ce n'est plus; je ne puis rien lui apprendre, ni
même répondre à ses questions. »
L'élève et le maître, séparés dès lors, conservèrent l'un de
l'autre le plus affectueux souvenir. Bien des années plus tard,
ayant appris que le P. Jandel faisait à Mirecourt une mission,
M. Jacquinet s'y rendit, et, après une prédication dans laquelle
le Missionnaire avait ravi son auditoire par l'onction de sa
parole, l'ancien professeur le saisit au sortir même de
l'église, dans une chaleureuse accolade, et s'écria tout ému : «
Voici mon élève ! » Le P. Jandel, revenu de son étonnement,
répondait avec affection : « Voilà mon bon maître ! » Cette
rencontre laissa de délicieux souvenirs à M. Jacquinet qui se
plaisait à la raconter à ses enfants.
L'éducation de Gabrielle fut aussi l'objet de grands soins de la
part de ses parents ; ils la lui firent commencer dans l'un des
pensionnats les plus estimés de Nancy. Son frère, chargé de la
conduire régulièrement en classe chaque jour, s'acquittait de
son mandat avec un sérieux et une dignité que l'on remarquait
partout sur son passage. Les petites élèves, frappées de son air
modeste et bon, ne le regardaient qu'avec vénération : c'était,
à leurs yeux, l'image d'un ange qui passait.
[...]
[Page 268]
Le P. Jandel venait à peine de terminer ses laborieuses visites,
qu'un coup douloureux le frappait au coeur : la nouvelle de la
mort de sa mère, décédée à Nancy, le 29 septembre 1854, âgée de
soixante-onze ans. Les deux dernières années de sa vie avaient
été attristées par une maladie terrible, un ramollissement du
cerveau, qui éteignit progressivement sa brillante intelligence.
Parfois elle sentait elle-même l'envahissement de quelque chose
comme de la folie ; elle pleurait alors et disait : « Ah, mes
enfants! Dieu me frappe à l'endroit sensible; il m'humilie dans
ce qui me rendait fière ! » Son affection pour les siens,
surtout pour son Alex, surnagea dans ce naufrage; mais elle se
démentait parfois vis-à-vis de son digne mari, qui, avec sa
fille, l'entourait des soins les plus dévoués. Peu avant sa
mort, elle recouvra en entier sa lucidité d'esprit et reçut les
derniers sacrements avec une grande piété.
Le P. Jandel suivait avec angoisse les phases de la maladie de
sa mère et s'associait aux épreuves de ceux qui la soignaient,
particulièrement de sa soeur à qui il écrivait : « Ma mère
affaiblie de tête est devenue égoïste ! ce qui était le plus
antipathique à son caractère !! Il m'en coûte tant de ne plus
avoir depuis bien des mois une seule ligne de sa main ! et
pourtant je me garde bien de le dire, car je sens que ce serait
pour elle une nouvelle source d'affliction. Je comprends, pauvre
soeur, tout ce que ta vie a de pénible, et je prends une part
bien vive à tes souffrances ; mais quelle belle couronne tu peux
te préparer pour le Ciel, si tu sais les supporter en chrétienne
! Je ne cesse de le demander pour toi à Notre-Seigneur, afin
qu'il ne permette pas que tu perdes le fruit de tant d'amertumes
et de douleurs physiques et morales. Quant à venir la voir, je
ne le puis à cause d'affaires qui réclament ici ma présence. Du
reste, ma visite ne serait pas opportune, dans l'état
d'affaiblissement et de tristesse où elle se trouve. Mon
apparition ne pourrait guère manquer de lui produire une
secousse funeste qui achèverait de l'anéantir moralement et qui,
peut-être, compromettrait son existence. Elle est si faible, et
les séparations lui ont toujours fait tant de mal, qu'il y
aurait plus que de l'imprudence à lui ménager cette occasion.
Elle n'en sentirait vivement que la souffrance, sans en avoir la
joie ; aussi ai-je dit au Saint-Père, les larmes aux yeux, en
lui demandant sa bénédiction pour elle, que je n'espérais plus
la revoir, et il m'a répondu avec son onction plus que
paternelle : Si Dieu l'appelle, elle ira vous attendre au Ciel.
C'est bien en effet dans cette pensée de foi que se trouve toute
consolation !
« La grâce que le bon Dieu lui a faite, en lui rendant pour
quelques heures toute sa raison, afin de la préparer à recevoir
les derniers sacrements, est et sera pour nous tous une grande
consolation, et un immense adoucissement à l'épreuve qui nous
est ménagée. Je suis heureux aussi de penser qu'elle m'a béni,
et je te remercie avec effusion, d'avoir profité d'un de ses
instants plus lucides pour le lui demander. A présent, quelle
que soit l'heure où il plaise au Seigneur de l'appeler à lui,
nous aurons la consolante pensée qu'elle n'a paru devant lui,
que munie de tous les secours que prodigue la religion aux
fidèles enfants de l'Eglise. Depuis plusieurs mois, je me
prépare à cette perte, et je ne reçois jamais une de vos lettres
sans regarder, avant de l'ouvrir, si elle n'est point cachetée
de noir. » [...]
[Page 392]
A peine de retour de ce voyage, Dieu l'éprouva par la mort de
son père : ce fut le 18 décembre 1862 que s'éteignit ce bon
vieillard, âgé de quatre-vingts ans, miné peu à peu par une
consomption lente et aussi par le désir de se trouver réuni à sa
chère Joséphine. Jusqu'au dernier jour, il garda toute son
intelligence et la tendresse de son coeur, ne songeant qu'à
s'oublier pour les autres, et se montrant affable, doux,
reconnaissant envers tous, plus particulièrement envers sa
fille, son gendre et la famille de ce dernier.
Il eut la consolation de revoir encore une fois son fils, à
Nancy, au mois d'août 1862. Celui-ci, en prenant alors congé de
son père qu'il n'espérait plus revoir en ce monde, lui dit : «
Mon Père, avant que je vous quitte, bénissez-moi », et il reçut
à genoux la bénédiction paternelle. M. Jandel reprit : «
Alexandre, tu m'as demandé de te bénir et je l'ai fait de toute
mon âme; mais c'est à mon tour à demander ta bénédiction. » Et
se soulevant avec effort, du canapé sur lequel il était assis,
il s'agenouilla devant son fils, qui étendit les mains sur sa
tête avec une prière muette. Tous deux se séparèrent trop émus
pour prononcer une parole, laissant la même émotion à Gabrielle
et à son mari, qui avaient été témoins de cette grande scène. Le
P. Jandel avoua plus tard, que la séparation lui causa en ce
moment une douleur si sensible, qu'elle dépassa celle qu'il
éprouva ensuite en apprenant la mort. Dès qu'il en reçut la
nouvelle, par sa soeur, il répondit :
« Dieu vient donc de rappeler à lui notre Père ! Adorons sa
sainte volonté et remercions-le de nous l'avoir conservé si
longtemps et de l'avoir si bien préparé à la mort. Quand on a le
bonheur de voir mourir si chrétiennement ceux qu'on aime, on se
reproche comme de l'égoïsme, de trop les regretter, et de
s'affliger, alors qu'on les sait arrivés les premiers au terme
du voyage, pour nous attendre dans la patrie. [...]
(*) Elle était née en 1781, dans une famille aux idées
progressistes, mais ennemie des excès de la révolution; elle
avait pour parent le conventionnel Marquis, connu pour avoir
voté contre la mort de Louis XVI.
(**) Une fille nommée Victoire leur était née auparavant, mais
avait peu vécu. |
|
|
|













