|
Nous avons publié l'article paru en 1853 dans
le Journal de Société d'archéologie lorraine et du Musée
historique lorrain sur
Jean-Baptiste Charles Claudot. Dans
son exposé ci-dessous Gaston Save reproche
"nombre d'erreurs et d'omissions" à
cet article.
Selon les sources, Charles Claudot
serait décédé le 8 janvier 1806 ou le 27 décembre 1805.
La table décennale du registre d"état civil de Nancy
indique « 27 décembre 1805 - 7 nivôse an 14 », mais le
registre d"état civil (ci-contre) porte uniquement la date du « 7
nivôse an 14 ».
Il y a donc erreur de conversion entre les calendriers
républicain et grégorien, et Charles Claudot est ainsi décédé le
28 décembre 1805, et donc ni
le 27 décembre, ni le 8 janvier comme l'indique l'article
ci-dessous de Gaston Save. |
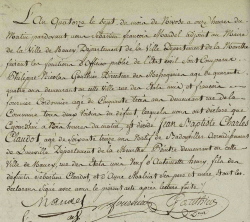
Acte de décès de Charles
Claudot - Nancy |
De surcroît, puisque la table décennale de l'état civil de
Badonviller confirme que Jean-Baptiste Charles Claudot est né le
19 septembre 1733, il n'avait donc pas 73 ans lors de son décès,
mais 72, de sorte que l'acte de décès (et l'article de Gaston
Save) comporte une mention erronée.
La Lorraine
Artiste
19 février 1888
CHARLES CLAUDOT
DÉCORATEUR
Il est peu de collectionneurs
lorrains qui ne possèdent une toile de Claudot, ce fécond
décorateur qui, jusqu'à l'âge de 73 ans, produisit sans fatigue
tant d'oeuvres diverses.
Il a peint d'immenses décors de théâtre et des miniatures pour
tabatières ; il décora des salles de fêtes et des églises ; il
composa des pompes funèbres et des sujets grivois ; il a laissé
des tableaux très achevés et des tableautins lestement troussés,
des paysages et de l'architecture, des fleurs et des portraits,
des scènes de genre et d'histoire, bref un peu de tout et pour
tous les goûts.
La plupart des maisons bourgeoises de Nancy, bâties ou
restaurées de 1760 à 1800, ont eu leurs dessus de porte ou de
glace décorés de peintures de ce fa presto, et ce sont souvent
ces trumeaux qui, nettoyés et encadrés, occupent aujourd'hui des
places honorables dans mainte galerie de tableaux.
Il y a vingt-cinq ans environ, quand on commença à rechercher
ces dessus de porte, que l'on découvrait souvent en arrachant
les papiers de tenture, il en passa tellement à l'atelier de
restauration de M. Alnot, au Musée, que Sellier demandait
gravement en entrant :
« Combien de Claudot, ce matin, père Louis ? » Cette abondance
faisait penser moins à l'oeuvre d'un peintre qu'au produit d'une
manufacture bien outillée.
C'est peut-être cette fécondité abusive qui a relégué le
laborieux artiste au dernier plan, dans les études de nos
critiques d'art lorrain. Ils l'ont sans doute cru trop pressé de
produire pour avoir pu laisser une oeuvre bien achevée et l'ont
voué à l'obscurité, singulier contraste, pour avoir prodigué
trop de preuves de son alerte talent.
Seul, à notre connaissance, M. A. Gény a donné une courte
biographie de Claudot dans le Journal de la Société
d'Archéologie lorraine (2e année, p. 19); mais avec nombre
d'erreurs et d'omissions déjà relevées par M. Charles Courbe
dans ses Promenades historiques à travers les rues de Nancy (p.
307). Une telle étude mérite donc d'être reprise et complétée à
l'aide des documents des archives municipales, afin de rendre à
ce peintre la place honorable à laquelle il a droit dans la
mémoire de ses concitoyens.
Jean-Baptiste-Charles Claudot naquit à Badonviller en 1733, et
non en 1730, comme l'écrit Jean Cayon. Il a été remarqué, à ce
sujet, que la Notice des tableaux du Musée de Nancy (1875)
plaçait Badonviller dans le département des Vosges, ce qui força
le pointilleux Courbe à « essuyer trois fois ses lunettes pour
se convaincre qu'elles n'étaient pas troubles. »
Ce prodigieux lapsus calami a été heureusement réparé dans la
dernière édition (1883).
Charles Claudot était né trois mois après la mort de son père,
Sébastien Claudot, originaire des Vosges, et qui occupait une
place dans la magistrature de cette partie de la principauté de
Salm, réunie alors au duché de Lorraine. Sa mère, Anne Malriat,
restée veuve avec quatre enfants, et sans fortune, confia son
plus jeune fils au curé de l'endroit qui était en même temps
instituteur.
Ses dispositions pour le dessin furent cultivées par son
précepteur qui l'envoya à Blâmont où il fit ses premières
décorations dans l'église des Capucins, puis à Lunéville où il
travailla aux peintures de l'église des Carmes.
A vingt ans, Claudot fut nommé professeur de dessin et de
peinture au pensionnat des Jésuites de Pont-à-Mousson. Lionnois
dit qu'il y resta jusqu'à la dissolution de cette société, en
1768 ; mais nous le retrouvons à Nancy en 1759, où il se marie,
le 14 septembre, à l'église Saint-Roch, avec Marie-Louise Hatt,
fille mineure de George Hatt, maître tailleur pour femmes, et
d'Elisabeth Labaute. Il avait alors vingt-six ans et demeurait
chez son beau-père, au n° 5 actuel de la rue Stanislas. Ce n'est
que trois ans après, en 1762, qu'il paie son droit de
bourgeoisie comme nouvel entrant.
La Lorraine a quatre Claude : Claude Gellée, Claude Charles,
Claudot et Claudion (que l'on écrit à tort Clodion).
Claudot dut chercher sa voie en étudiant l'oeuvre des deux
premiers. Gellée commença par peindre des fonds d'architecture,
en 1625, pour, son maître Deruet, à l'église des Carmélites de
Nancy. Claudot fit de même : il fut chargé de peindre toute la
partie décorative des compositions de Girardet et exécuta de
nombreux décors d'architecture d'après les maquettes d'André
Joly, peintre et architecte du roi.
Les habitués de notre théâtre ont pu admirer un décor de palais,
qui ne paraît que rarement, peint par Claudot, en 1766, d'après
les dessins de Joly, et dont le Journal de la Meurthe du 15
brumaire, an XI, parle ainsi : « un superbe palais à fond percé,
un des plus beaux morceaux d'architecture qui existe en Europe,
donné à la commune de Nancy par le feu roi de Pologne. »
C'est en effet une composition grandiose, occupant six plans,
dont les trois premiers figurent de grandes arcades aux
entrecolonnements garnis de statues de dieux plus grandes que
nature et dont le riche entablement atteint les frises.
Les derniers plans figurent une coupole largement ouverte,
décorée à profusion de sculptures, de marbres et de dorures. La
perspective se terminait à l'infini, sur la toile de fond, par
de hauts portiques conduisant à un arc triomphal entouré de
jardins. Cette dernière partie est presque détruite, et il est
difficile de bien juger de la beauté du reste, l'écartement
actuel des portants de notre théâtre ne permettant plus de
donner à ce décor sa plantation primitive. La peinture a du
reste souffert, par l'humidité et par plusieurs restaurations
peu habiles. Claudot avait déjà du la repeindre à neuf en 1803.
Mais, tel qu'il est, c'est encore le plus beau décor de notre
théâtre, et si l'on n'y trouve point les effets puissants de
couleur et de lumière des décorations modernes, le spectateur se
sent impressionné par la grandeur des lignes, la richesse de la
composition et la parfaite ordonnance de la perspective. C'est
sans doute aussi le plus ancien décor conservé en France.
Gaston SAVE.
(A suivre)
La Lorraine
Artiste
26 février 1888
CHARLES CLAUDOT
Décorateur
A la mort de Stanislas, la
même année 1766, la Ville et les corps de l'Etat, firent de
grandes dépenses de décoration pour la pompe funèbre et les
services célébrés dans les principales églises de Nancy. Claudot
dessina, d'après les plans de Girardet, le mausolée du roi de
Pologne élevé par les, ordres de la municipalité dans l'église
Saint-Roch, pour la pompe funèbre du 26 mai. Il décora lui-même
de peintures les consoles et les gradins ;du catafalque, les
emblèmes du fond du choeur et ceux placés à la porte de
l'église. Ce catafalque a été gravé par Collin, et l'on en voit
une belle peinture au Musée lorrain (n°486) que nous attribuons
à Claudot et qui provient d'un trumeau de cheminée du Tribunal
de commerce. C'est la seule vue intérieure qu'on possède de l'
ancienne paroisse Saint-Roch, détruite à la Révolution.
Claudot avait encore, pendant cette première période de sa vie,
aidé dans divers travaux le décorateur André Joly dont il était
sans doute l'élève en même temps que celui de Girardet. Il
participa aux grands travaux de peinture commandés par Stanislas
pour la Malgrange et pour la salle de la Comédie. Il fournit
aussi, en 1766, un portrait du roi le Pologne, destiné au salon
carré de l'hôtel de-ville ; mais son oeuvre principale fut la
décoration des trois salles du Palais du gouvernement, qu'il
exécuta en 1764 et 1765. Ces travaux ne figurent pas dans le
compte général de dépenses de Stanislas, puisqu'il date de 1761
; mais ils se retrouvent dans les archives municipales.
Dans la grande salle du milieu de la façade, Claudot peignit
cinq tableaux, surmontant les cinq grandes portes et
représentant, dit le compte des archives, différents paysages
ornés de figures. Dans un salon voisin, appelé le Cabinet de
jour, deux autres dessus de porte, du même artiste, figuraient
des paniers de fleurs posés sur une balustrade, dans un fond de
paysage et se rapprochaient sans doute comme composition des nos
288 et 289 du Musée de Nancy (H. 1, 25. - L. 1, 10) qui
proviennent du château de Maxéville.
Disons en passant que sur treize tableaux et dessins de Claudot,
possédés par notre musée, un seul est visible (N° 289), à la
hauteur du plafond, et qu'il ne peut donner qu'une idée bien
imparfaite du talent si varié de cet artiste. Les autres sont
exposés dans les greniers, aux chaleurs et froidures les plus
extrêmes, en compagnie d'environ trois cents toiles qui y
laisseront leur dernière croûte, en attendant qu'on ajoute une
salle au musée.
L'année suivante, 1765, Claudot peignit encore au Palais du
Gouvernement, deux toiles de six pieds de haut, dimension
extraordinaire pour des dessus de porte, représentant des
paysages ornés de figures. De toutes ces peintures, il ne reste
rien, aujourd'hui dans ce palais qui, abandonné entièrement sous
l'Empire et la Restauration, subit depuis plusieurs
transformations pendant lesquelles ces peintures disparurent,
soit enlevées, soit recouvertes de plâtre ou de papier.
La même année, on trouve encore, dans les comptes de la Ville,
mention de la bannière de la paroisse Saint-Pierre, peinte par
Claudot et représentant d'un côté saint Stanislas et de l'autre
saint Pierre. Il peignit donc aussi des figures de grande
dimension. Le musée de Nancy possède du reste de lui deux
tableaux d'histoire formant pendants : L'Echelle de Jacob (N°
293) et l'Ange annonçant aux bergers la naissance du Christ, (N°
294, H. 0,60. L. 0,47), dons de M. Gaudchaux.
Le dessin et la couleur de ces toiles, sans être très
remarquables, rappellent assez la facture de Girardet, avec plus
de recherche dans les fonds et les accessoires, mais aussi moins
de grandeur de ligne et d'exactitude de dessin, dans les figures
principales.
Dans la belle collection de tableaux anciens de M. Maguin,
ancien directeur du télégraphe, vendue à Nancy en 1854, se
trouvaient aussi deux sujets d'histoire, peints par Claudot.
L'un représentait Tancrède, revêtu de son armure, gravant sur le
rocher, à l'entrée d'une grotte, les initiales du nom de son
amante. Près de lui, son cheval est attaché à un arbre. (H.
0.50, L. 0.65.) Comme pendant, Armide trace sur l'écorce d'un
chêne le nom de Tancrède. Au second plan, un troupeau traverse
la campagne. Les fonds de paysage de ces deux tableaux étaient
aussi finement terminés que les figures. On ignore par qui ils
furent achetés.
Comme peintures d'artistes lorrains, la même collection Maguin
possédait encore : le Concert Céleste par Claude Charles, Jésus
dans le désert, par Duperron de Metz, l'Attaque d'un convoi par
Deruet et gravé par Callot (?), trois Claude Gellée, très
douteux, une Vénus de Girardet, un portrait par Jacquart, et la
curieuse toile du Musée Lorrain (N° 282) par Jacquard et Martin
des Batailles, représentant François III et sa cour, près de
Frouard, au confluent de la Meurthe et de la Moselle.
Le Musée Lorrain possède aussi deux tableaux d'histoire par
Claudot. Les bergers d'Arcadie (N° 443 H. 0.55. L. 0.73)
appartiennent bien à sa première manière où domine le style de
Girardet. L'autre peinture, N° 444, est, selon le catalogue, «
l'esquisse du tableau représentant Saint-Sébastien chez Irène,
lequel placé à la cathédrale de Nancy, est attribué à Claudot. »
Nous avons vainement cherché cette peinture à la Cathédrale qui
ne contient que trois toiles pouvant être attribuées à Claudot :
deux dans la chapelle des fonts baptismaux : l'Adoration des
Mages et le Baptême du Christ, l'autre dans la chapelle
Saint-Fiacre, Jésus chez Marthe et Marie.
Cette dernière est attribuée à Claude Charles, par M. Auguin,
dans sa Monographie de la Cathédrale, attribution qu'il base sur
la tradition et sur deux C majuscules tracés sur un des vases de
grès placés sur la table derrière Madeleine. Or ce monogramme
peut tout aussi bien être la signature de Charles Claudot, et si
l'on n'y a point pensé, c'est que plusieurs biographes lui
donnent à tort, pour prénom principal, celui de Jean-Baptiste ;
tandis que son acte de baptême, du 19 septembre 1733, indique
bien que Charles est son véritable prénom. De plus cette
peinture porte bien tous les caractères des compositions du
milieu du XVIIIe siècle et Claude Charles était mort en 1747,
âgé de 86 ans. Enfin, en comparant cette toile à celles qui sont
attribuées à Claude Charles, la Sainte Famille du Musée de la
ville, la Résurrection, la Tête de vierge, la Sainte Famille et
l'Enée portant son père Anchise, du musée Lorrain, on ne
reconnaît, dans le tableau de la cathédrale, aucun des procédés
qui caractérisent l'oeuvre du maître de Girardet.
Quant aux qualités et défauts de cette toile de Claudot, nous
nous en référons entièrement aux très justes mais un peu sévères
appréciations de M. Auguin : « La facture de cette oeuvre est
large, l'entente de la composition heureuse, le geste du Christ
est noble. L'ensemble pèche néanmoins par un défaut d'éclat dans
la couleur. On cherche sans la rencontrer, dans cette oeuvre,
une application heureuse du clair-obscur. Les tons procèdent par
opposition lourdes. La négligence des demi-teintes est sensible
dans la valeur des draperies ; la figure de Marthe est colorée
par un reflet rougeâtre très recherché de toute l'école
lorraine, et que cette école a longtemps emprunté aux peintres
de la décadence italienne. Le modelé de l'artiste s'adoucit, il
est vrai, dans les carnations de ses personnages. » Ajoutons que
la figure de Marie, qui est au second plan, semble beaucoup trop
petite pour sa distance aux autres personnages.
L'attribution de cette toile à Claudot paraît du reste confirmée
par une note de 1806 constatant que la Cathédrale reçut à cette
date trois grands tableaux attribués à la jeunesse de Claudot,
venant du Musée installé alors dans la chapelle du Lycée et qui
furent placés dans la chapelle de Saint Gauzelin.
Les deux autres tableaux de Claudot sont évidemment ceux que
l'on voit aujourd'hui dans la première chapelle du bas côté de
droite et qui sont appréciés comme suit, par M. Auguin. «
Considérées en elles-mêmes, ces deux oeuvres se recommandent
plutôt par la composition que par le coloris. Le ton général est
absolument conventionnel, froid et timide ; mais si nous
examinons plus à fond la manière même dont les relations de
valeur sont respectées, nous verrons une prédominance de la note
du ciel et certaines touches dans les troncs d'arbres, qui sont
comme une signature de l'artiste. La composition elle même est
plutôt méthodique que noble. On chercherait en vain dans ces
deux oeuvres, de la passion, du mouvement, de la grâce, de la
souplesse. Il n'y a tout au plus que de la sagesse, de la
pondération et une certaine tendance vers le style élevé. C'est
évidemment l'oeuvre d'un novice imbu des maîtres du XVIIe siècle
et risquant de timides essais de couleur, sans être pour cela ni
plus vrai, ni plus puissant que ses maîtres. » (Monographie de
la Cathédrale de Nancy, p. 190.)
Il manquait encore à Claudot un maître. Girardet était un
artiste de talent, mais sans grande qualité saillante, et il
approchait de la soixantaine. C'était, pour Claudot, alors âgé
de trente-trois ans, la seule relation artistique profitable
qu'il pût trouver à Nancy. A la mort de Stanislas, cette foule
d'artistes venus de toutes parts pour collaborer aux immenses
travaux du roi de la bâtisse, s'était dispersée. Nancy, déchue
de son rang de capitale, ne promettait plus de grandes
ressources à ceux qui restaient. Claudot prit un parti décisif
et se transporta, avec ménage et atelier, à Paris. C'est là
qu'il devait trouver son vrai maître, celui qui convenait à ce
tempérament vif et alerte, Joseph Vernet.
Gaston SAVE.
(A suivre)
La Lorraine
Artiste
3 mars 1888
CHARLES CLAUDOT
DÉCORATEUR
(Suite.)
Claudot et Joseph Vernet
étaient faits pour se comprendre, quoique le maître eût vingt
années de plus que son nouvel élève. Dès l'âge de quinze ans,
Vernet peignait avec son père des dessus de porte, des écrans,
des panneaux de voiture et de chaise a porteurs, des tableaux de
fleurs et de fruits. A dix-huit ans, il part en Italie, où il va
puiser, dans les leçons des grands décorateurs Soliména et
Pannini, une habileté vraiment surprenante à créer sans redite
des aspects toujours nouveaux de la nature.
La beauté pittoresque, grandiose et souvent « terrible » des
ruines de Rome, des rochers de Tivoli, d'Albano, de Lariccia et
du golfe de Naples veut pour interprètes, non pas un Claude
Gellée, amoureux calme des beaux soirs dans la campagne romaine,
mais de puissants décorateurs à la Salvator Rosa, comme les
maîtres de Vernet. Devant cette rude nature où la terre, le ciel
et la mer sont en lutte perpétuelle, Vernet, quoique méridional,
ne se laissa pas entraîner par la fougue italienne ; mais il
apprit le secret des grands effets décoratifs, de la plantation
du décor, en un mot, où chaque plan, avec sa silhouette
pittoresque et sa valeur de ton décroissante, se découpe sur le
suivant, jusqu'à l'horizon, tandis que du ciel tourmenté, un jet
de lumière vient frapper en plein le motif à mettre en évidence.
Et, avec une facilité prodigieuse, pendant ses vingt deux ans de
séjour en Italie, il composa sur ce thème les milliers de
variations que l'on retrouve à profusion dans tous les musées
d'Europe.
Quand Claudot vint à lui, en 1766, Vernet venait d'abattre les
vingt-deux grandes toiles des Ports de France, payées 6,000
livres chacune, peu pour ce qu'elles valent, mais beaucoup pour
l'époque. Ce qui ne l'empêchait point de livrer aux marchands,
bon an, mal an, plus de cinquante tableaux. Au salon de 1765, il
en exposa vingt-cinq ! Et quels tableaux ! s'écrie Diderot : «
C'est comme le Créateur pour la célérité, c'est comme la Nature
pour la vérité. »
Peut-on bien reprocher à Claudot, maintenant, cette fécondité
qui fut non seulement un don de la nature, mais encore une leçon
du maître? A cette école, le peintre n'était point un
photographe pour la précision du détail, mais il devait l'être
pour la rapidité de « l'opération.» Devant la nature, d'un
rapide crayon il traçait les contours ; avec quelques chiffres
il notait les valeurs et les couleurs. Vernet avait toujours sur
lui un carnet où tous les tons étaient numérotés, comme dans le
répertoire des couleurs de Chevreul, à Sèvres. G6 B4 V, tracé
sur un arbre au lointain, signifiait qu'il était gris bleuâtre,
avec une pointe de vert. Puis, de retour à l'atelier, ce
paysage, encore vivant dans la mémoire et précité par les notes,
était jeté sur la toile et devait être achevé dans la fraîcheur
de la première pâte. On ne trouvera, sur les tableaux de Claudot,
ni glacis, ni frottis, ni repeints ; de là leur conservation et
leur solidité. Ils n'ont perdu, depuis un siècle, ni en vigueur,
ni en éclat. Solidement peints du premier jet, bien empâtés,
mais d'une pâte amollie et rendue élastique par l'huile, ils ont
gardé toutes les finesses de ton que perdent en peu d'années les
tableaux laborieusement « tripotés » et surchargés de «
revenez-y.» Aussi c'est un plaisir pour les restaurateurs
d'avoir à les nettoyer : ils peuvent laver, brosser, dévernir à
l'alcool tout à leur aise ; jamais la couleur n'est attaquée. «
Voilà de la bonne peinture ! mossieu Sellier... » disait
finement le père Louis.
Sans avoir gravi lés monts du Padouan, ni longé les côtes
escarpées de Sicile, Claudot s'assimila rapidement la manière et
le genre du maître. Il peignit l'Italie comme s'il l'avait vue,
et peut-être mieux. Comme Vernet, il ennoblit son décor en y
plantant des fabriques italiennes, des tours en ruines, des
arcades verdoyantes de lierre, d'élégantes colonnades, des pans
d'arcs de triomphe dégradés pur le temps et rajeunis par les
fleurs. Dans d'autres toiles, on reconnaît les compositions du
Guaspre, ses collines déchirées, ses grands plans, ses
mouvements de terrain divisés par des cours d'eau. Mais ce qui
l'attire surtout, c'est la mer, qu'il n'a jamais vue que dans
les marines de son maître. Tandis que celui-ci se plaît à la
peindre déchaînée, furieuse, telle qu'il l'a contemplée un jour,
attaché au mât pour ne rien perdre de l'horreur d'une tempête,
Claudot soulève à peine les vagues de l'Océan et ne souffre
point que d'épaisses nuées ternissent de leurs teintes sinistres
le miroir de ses eaux paisibles. S'il y a des rochers sauvages,
un pêcheur y attachera sa barque et toujours un gai rayon de
soleil, prenant la voile en écharpe, se jouera dans les
cordages, les poulies et les mâts, se réfractant sur les eaux
profondes, brillant sur la rame et dans les perles d'eau qu'elle
soulève.
Tels sont les Claudot que l'on rencontre le plus souvent, et il
y en a des centaines, infinies variantes du paysage italien,
avec une pointe de style héroïque mélangé d'idylle pastorale.
Que d'art n'a-t-il pas fallu pour prêter un intérêt soutenu à
tant d'oeuvres légères, faites d'un souffle et sans cesse
renouvelées, pour se transporter en esprit au milieu de ces
contrées inconnues de lui, dans une Italie inventée et qui ne
lui a été révélée que par l'imparfait témoignage des oeuvres
d'autrui ? Prestige de clair-obscur, opposition des couleurs,
esprit, grâce, touche facile, étonnante fécondité d'invention,
que de richesses dépensées pour mener à bien ce naïf poème qui
n'était qu'un trumeau !
A tant de qualités, il faut bien joindre quelques défauts, ceux
de tous les décorateurs. Moins maître que son maître, Claudot
fut aussi moins consciencieux, moins fidèle dans le dessin,
moins attentif aux beautés du détail et à la grâce intime de la
nature. Facilement il tombe, quand il n'y prend garde, dans la
manière lâchée des peintres de décor. Mais à cette époque, ce
n'était pas là précisément un défaut Le tour classique, les
velléités de noblesse et cet italianisme un peu factice ne
déplaisaient pas aux amateurs lorrains auxquels il envoyait ses
toiles. Ils n'avaient qu'un reproche à lui adresser, c'était de
ne pas dessiner suffisamment ses figures. Il est vrai que la
toile étant mise en place, comme dessus de porte, il n'y
paraissait guère.
Le nombre des commandes lui venant de Lorraine engagèrent
Claudot, après trois ans de séjour à Paris, à regagner Nancy.
Son maître, qui était devenu son ami, ne le laissa point partir
sans regret. Il avait été parrain de son premier fils
Hubert-François, né en 1767, et espérait que son élève se
fixerait pour toujours auprès de lui. Mais l'amour du pays natal
l'emporta sur cette amitié dont Claudot parla toute sa vie avec
attendrissement et il refusa également les demandes de plusieurs
souverains d'Europe qui, appréciant son talent, l'avaient appelé
auprès d'eux. Il revint en 1769 à Nancy, où naquit, la même
année, son second fils, Dominique-Charles, qui fut baptisé à
Saint-Roch, le 29 septembre, et coûta la vie à sa mère. Claudot
se remaria l'année suivante, à Saint-Sébastien, avec Antoinette
Henry, et, le 2 juin 1771, naquit son troisième fils
Jean-Baptiste Sébastien. Il en eut un quatrième, Charles
-François, le 11 juin 1776, et deux filles : Marie-Jeanne, née
en 1775, et Marie-Anne, en 1777. M. Gény lui attribue sept fils
et une fille; nous n'avons retrouvé dans les Archives que les
six enfants précédents.
Il avait deux soeurs à Nancy : Barbe-Monique, née en 1731, et
Marie-Anne, qui fut marraine, le 26 octobre 1776, du fils du
célèbre sculpteur Sontgen, dont Claudot fut le parrain. Il
habita, jusqu'à, sa mort, au n° 50 actuel de la rue, de la
Hache, qui forme le coin de la rue Saint-Dizier.
(A suivre). Gaston SAVE.
La Lorraine
Artiste
25 mars 1888
CHARLES CLAUDOT
DÉCORATEUR
(Suite.)
Depuis son retour à Nancy,
c'est encore à Claudot que la municipalité confia l'exécution
des grands décors nécessités par les cérémonies publiques. En
1774, il dessina la décoration du mausolée élevé- dans l'église
des Dominicains, lors des deux services célébrés pour le repos
de l'âme de Louis XV, le 26 mai, et qui fut gravé par Collin. Le
même graveur nous a conservé également le dessin du mausolée
composé par Claudot et élevé, le 18 juin 1774, par les ordres de
la municipalité, dans l'église Saint-Roch.
En 1777, il peignit, pour l'église Sainte-Elisabetb ou des
Soeurs-Grises, le tableau du maître-autel représentant une
Assomption dans un véritable décor d'architecture.
Lionnois attribue les principales figures de cette toile à
Claude Charles qui, à cette époque, était mort depuis trente
ans. Quoique ce tableau n'existe plus, il faut donc,
croyons-nous, en laisser tout le mérite à Claudot qui, nous
l'avons vu, avait exécuté bien d'autres toiles contenant des
figures de grande dimension. « Cette peinture, dit Lionnois,
fait un très bon effet et semble agrandir l'espace. »
En 1778, Claudot peignit deux grands tableaux de paysage pour le
salon de l'hôtel de l'Intendance, place Royale, et fit, en 1779,
les décorations de la salle du Nouveau Concert, créée en 1774.
En 1790, il répara les peintures du salon carré de l'Hôtel-de-
Ville que le tassement des murs avait lézardées de fentes et de
crevasses. On remarque encore aujourd'hui ces retouches à l'oeuvre
de Girardet, principalement sur le premier panneau à gauche,
Apollon donnant, sa lyre au poète, que M. Larcher est en ce
moment occupé à repeindre complètement, la présence d'une
cheminée dans ce mur ayant écaillé presque entièrement la
peinture.
Enfin, en 1803, nous trouvons encore Claudot, malgré ses
soixante-dix ans, brossant un grand décor de palais pour la
première représentation du Jugement de Salomon, mélodrame eu
trois actes, pièce à grand spectacle, danses, marches militaires
et décors nouveaux. « Au second acte, dit le Journal de la
Meurthe du 15 brumaire, an XI, le théâtre représente un
vestibule à colonnades et à fond percé, dessiné par le citoyen
Gerardet et peint par le citoyen Claudon père, artiste de cette
commune. » Quoique Girardet fut mort en 1778, c'est-à-dire
vingt-cinq ans avant cette représentation, nous pensons
néanmoins qu'il fut bien l'auteur de ce décor que nous avons
retrouvé et restauré, en 1881, au théâtre de Lunéville, où il
fut transporté il y a environ cinquante ans, pour servir à une
cérémonie quelconque. C'est bien, en effet, le style de Girardet
et le procédé de facture de Claudot, et sans doute ce dernier
exécuta-t-il ce décor en 1803 d'après une maquette de son
premier maître qu'il avait conservée dans ses cartons. Presque
aussi riche de composition que le décor de Nancy, celui de
Lunéville a cependant, dans les détails d'ornement, le caractère
de sécheresse et de raideur de son époque. C'est déjà le style
premier Empire, appliqué sur un palais Louis XVI. En parlant de
ces deux décors, M. Charles Courbe demande, page 310 de ses
Promenades historiques : « Que sont devenues ces dernières
oeuvres de nos artistes nancéiens ? S'adresser maison Raulecourt,
Tardieu et Cie . » On voit que ces oeuvres existent toujours et
qu'elles pourront être conservées, - si on le veut bien.
Les dernières années de Claudot avaient été attristées par des
chagrins de famille. Ses fils aînés François et Charles avaient
refusé, en 1792, de servir leur pays et étaient émigrés à
l'étranger. C'en fut assez pour faire noter leur père comme
suspect et lui amener mille désagréments. Ne pouvant excuser ni
condamner ses fils, le vieil artiste s'efforça de réparer leur
faute, et, en 1793, en cette année terrible où la France
semblait condamnée, mais où le sang des vieillards mêmes
s'échauffait au feu du patriotisme, Claudot n'hésita pas,
quoique peu fortuné, à porter ses bijoux à la Monnaie pour
secourir la Patrie en danger. C'est à peine s'il avait alors
quelques commandes et encore payées en assignats. Cependant il
accomplit gaiement ce noble sacrifice. Mais ce désintéressement,
si honorable pour le citoyen, coûta cher à l'artiste. Les
amateurs nancéiens d'alors ne se piquaient pas d'être très
républicains (quantum mutait !!!) et lui retirèrent leurs
commandes. Claudot se vit obligé, pour vivre, d'avoir recours
aux entrepreneurs et de se mettre à leur merci pour la
fourniture des dessus de porte et des trumeaux qu'il était
d'usage, alors, d'enchâsser dans les boiseries de toute chambre
bourgeoise. Ses peintures en souffrirent : sa touche, de
spirituelle qu'elle était, devint épaisse, son talent si naïf et
si frais dégénéra en un lourd métier ; il fabriqua à la douzaine
des tableaux de pacotille.
M. Morey, dans les Artistes lorrains à l'étranger (1883),
rapporte qu'il employait à gages et à l'année un broyeur de
couleurs et un encadreur qui ne pouvaient suffire â l'activité
dévorante du maître. Le prix le plus élevé de ses tableaux ne
dépassait pas plus de six écus de six livres ; les moindres
étaient d'un écu de six francs, plus le prix de la couleur de
l'outremer, si toutefois on désirait qu'elle entrât dans les
ciels.
Cette nécessité de composer toujours et sans cesse affaiblit
même son esprit. Devenu producteur infatigable, de peintre
charmant qu'il était, il fut amené à se copier lui-même.
Beaucoup de ses dernières toiles se retrouvent en triple, en
quadruple répétition. Sa fertilité le fit paraître monotone, lui
si varié pourtant dans ses aptitudes. On l'accusa bientôt de se
répéter incessamment et d'être semblable à ces diseurs de bons
contes, trop enclins à redire les mêmes histoires. Malheur à
l'artiste qui descend au rang d'entrepreneur ! Quand il mourut,
le 8 janvier 1806, c'est à peine si l'on pensa qu'il avait eu
quelque mérite. Sa laborieuse carrière avait été trop longue, on
ne le jugea que par les faibles esquisses de ses derniers ans.
Et sa tombe se referma sans qu'un ami ait pensé à résumer son
oeuvre. La Renommée est bien femme : c'est pour les jeunes,
fauchés dans la vigueur de leur talent naissant, qu'elle sonne
ses éclatantes fanfares ; elle oublie les glorieux débuts de
l'artiste vieilli. Il faut, pour lui rendre justice, que cent
ans aient passé sur sa tombe. On oublia même la date de la mort
de Claudot et tous les catalogues de notre musée, jusqu'en 1883,
la mettaient, avec une erreur de-huit ans, en 1814.
Heureusement il reste assez de ses oeuvres pour rendre à ce
laborieux artiste la place à laquelle il a droit dans l'école
lorraine. Le Musée lorrain n'en contient pas moins de dix-huit ;
il y en a treize au Musée de la Ville ; on en trouve dans
beaucoup de galeries particulières, d'églises et de musées des
environs. M. Legay, à Nancy, en possède actuellement quatre qui
lui viennent de Mlle Claudot : les Pèlerins d'Emmaüs (H. 0,90.
L. 0,70), fort belle toile, avec le paysage très fin et les
lointains bien vaporeux, les figures mieux dessinées que
d'habitude et un ciel fort étudié. L'Adoration des Mages est
d'une époque plus moderne ; la fraîcheur de ce tableau est telle
qu'il semble sortir du chevalet. Des ruines antiques
merveilleusement traitées en décorent le paysage. Les Laveuses à
la fontaine (H. 0,80. L. 1,00) sont groupées dans un site
pittoresque dont les lignes sont grandes et simples, tandis que
la lumière n'est pas épargnée dans le ciel et les lointains. La
halte du troupeau fait pendant à ce dernier.
Les paysages du Musée lorrain sont d'un autre style, plus
descriptif et moins large, ayant été peints d'après nature. Les
nos 487 et 488 (H. 0,64. L. 1,05) sont des vues panoramiques de
Nancy prises, la première, de Malzéville, près du Petit-Jéricho
; la seconde, des hauteurs qui avoisinent la Commanderie.
(A suivre.)
Gaston SAVE.
La Lorraine
Artiste
1er avril
1888
CHARLES CLAUDOT
DÉCORATEUR
(Suite et fin.)
Les nos 489 et 490 sont des
répétitions de ces mêmes vues ; mais leur format plus petit (H.
0,52. L. 0,97) a nécessité la suppression de plusieurs détails
de premier plan et des grands arbres qui forment un repoussoir
décoratif et comme la coulisse d'avant- scène de toutes les
toiles de Claudot.
M. Morey dit à ce sujet : « Sa signature consiste en un arbre
mort, placé sur le premier plan de ses tableaux, ou en sept
oiseaux qui volent dans le ciel, représentant les sept lettres
de son nom. » Mais il est fort douteux qu'on ait jamais
rencontré cette signature bizarre.
M. Lucien Wiener possède aussi une variante de la vue prise de
la Commanderie, plus petite, mais où les détails sont traités
avec une finesse que l'on rencontre rarement dans les Claudot.
C'est sans doute la première étude d'après laquelle il peignit
les répétitions précédentes.
Les nos 491 et 492 furent peints, en 1801, depuis les fenêtres
de l'appartement de M. Mennessier-Lallement qui habitait à cette
époque la maison à l'angle de la rue des Michottes et de la
place de l'Académie, actuellement maison Collenot. La première
est une vue de la place de Grève et du cours de la Liberté,
actuellement cours Léopold, animée d'une centaine de petits
personnages et animaux spirituellement peints et où l'on
remarque un groupe joyeux se pressant autour de l'estrade d'un
charlatan. L'habitude du peintre d'orner ses paysages de ruines
romaines l'a mal servi cette fois, car il élève, dans un coin de
cette place, une immense colonne antique qui donnerait bien de
la tablature à nos archéologues modernes, si l'on ne voyait
qu'il s'agit simplement d'un porte-lanterne très grossi pour
meubler ce coin du tableau.
Le pendant est une vue du fossé séparant la Ville-Vieille de la
Ville-Neuve, entre les rues de la Pépinière et Stanislas, où
circulent les incroyables de Nancy, les uns à pied, d'autres
dans d'élégantes voitures. (H. 0,85. L, 1,05.) Ces six tableaux
ont été donnés au Musée par MM. Mennessier, de Metz.
Deux autres toiles, plus grandes (H. 1,40. L. 1,60), ont été
peintes par Claudot en 1801, comme l'indique la date tracée sur
une borne du n° 500. Elles lui furent commandées par M. Jaquinet,
avocat au Parlement de Nancy, propriétaire de vignes et d'un
vendangeoir à Bayon, pour décorer la maison qu'il habitait, rue
Saint-Jean, n° 6, à Nancy. Elles représentent le village de
Bayon, pris de deux points de vue opposés. Sur le n° 501, on
aperçoit, au second plan, le château de M. de la Galaizière, à
Neuviller-sur-Moselle. Quoique de la même année que les toiles
précédentes, celles-ci leur sont inférieures comme exécution ;
il est vrai qu'elles n'étaient point faites, par leur dimension,
pour être vues de très près.
Les Bergers d'Arcadie (n° 443. H. 0,55. L. 0,73) sont d'une
facture médiocre et assez pauvre comme composition. C'est un
exemple des peintures rapides et négligées des dernières années
du peintre. Les deux lavis à l'encre de Chine (nos 445 et 446.
Ovale. H. 0,40. L. 0,31), nous paraissent de la même époque et,
malgré de belles ruines d'architecture, ne présentent guère plus
d'intérêt. Quant au n° 444, saint Sébastien chez Irène, cette
petite esquisse (H. 0,27. L. 0,22) nous paraît devoir être
attribuée à Jacquart ou à un de ses élèves, car elle présente
la même facture que les nos 436 et 437.
Nous ne pouvons accepter comme étant de Claudot les nos 419, 420
et 421, représentant, dit-on, la femme, la mère et la soeur du
peintre, qui ne ressemblent en rien à ses autres peintures.
Mais la plus belle toile de Claudot, au Musée lorrain, est sans
contredit son portrait (n° 417. H 0,80. L. 0,75), dent le n° 418
est une répétition plus pâle de couleur et moins bien conservée.
D'après le costume, ce portrait aurait été peint entre 1780 et
1790, et sa figure porte bien environ cinquante ans. La
physionomie est agréable et ne manque point de distinction,
sérieuse mais sans prétention. Les traits réguliers seraient
presque sévères, si l'oeil spirituel ne cachait une certaine
malice. Pas de traces de bonhomie, d'enjouement, d'ingénuité, ni
de gaîté naturelle ; c'est un homme froid, correct, mais
certainement fin et spirituel ; peut-être philosophe et, sinon
amoureux de son art, du moins très occupé à produire.
Si un tel caractère a aimé la nature, la vraie, c'est sans doute
un peu en citadin. Je ne crois pas que la campagne l'ait jamais
trop ému : pour lui, elle devait manquer d'architecture romaine.
Mais sans doute elle l'amusait, avec beaucoup dépassants et de
maisonnettes, et il y prenait plaisir franchement, comme font
les Parisiens en vacances.
Durival nous apprend qu'il fit beaucoup de paysages dans les
Vosges « et jusqu'au sommet du Donon . » Nous n'avons jamais
rencontré de vues semblables, dont l'aspect sauvage et solitaire
s'écarterait tant de ses autres productions. Il y a bien une vue
d'un petit hameau des environs de Framont qui fut gravée,
d'après son tableau, par Fachot le jeune ; mais là encore, le
paysage sombre et sévère est égayé par une masse de détails
amusants qui en font presque un petit décor de fantaisie.
C'est que l'idéal de Claudot était avant tout de flatter les
yeux et- d'amuser le spectateur par une plantation habile de
coulisses pittoresques. C'est comme décorateur qu'il est
admirable, et on ne l'a pas dit assez, ou même on ne l'a point
dit.
On a donc bien raison de rechercher ses oeuvres, que sa fièvre
de travail a heureusement faites nombreuses, gracieux documents
d'une époque où la nature même se façonnait à l'image d'une
société vive, légère, brillante et spirituelle.
Gaston SAVE |













