|
Nancy illustré : mondain,
thermal, littéraire, artistique, sportif
Août 1913
LES SAPEURS-POMPIERS DE NANCY
(à propos de leur présence à la Revue du 14 Juillet)
C'est un livre qu'il faudrait écrire sur ce
corps d'élite pour rappeler ses origines déjà anciennes, les services nombreux
qu'il a rendus, le dévouement dont il a donné tant de preuves, pour exposer les
transformations heureuses que son organisation a subies et décrire son matériel
se perfectionnant sans cesse jusqu'à devenir le plus beau de France.
Mais, hélas! la place dont nous disposons est bien réduite ; c'est donc une
simple monographie que nous allons faire, heureux d'apporter, nous aussi, notre
modeste part de chaude sympathie et de véritable admiration, à ces braves gens,
jadis souvent et à tort raillés et qui, aujourd'hui, se sont imposés à l'estime
et à la reconnaissance de leurs concitoyens.
I. - Historique de la constitution
C'est en 1524 que notre duc Antoine prend les
premières mesures pour combattre les incendies.
Soixante-quatre ans plus tard, Charles III, dans un règlement, fixe les
attributions du Gouverneur « en cas de feu advenant ». Il ne s'agit, dans ce
document, que d'un pouvoir de police pour requérir le public de travailler à
l'extinction du feu, ce qui constitue un rudiment d'organisation en cas
d'incendie.
Le 10 janvier 1704, le Conseil de Ville promulgue une ordonnance de police pour
prévenir les incendies. Cette ordonnance prévoit deux mesures, l'une préventive,
l'autre pour combattre le feu. En ce qui concerne cette dernière, elle décide
que « les officiers de police doivent se rendre au feu ainsi que les ouvriers de
la ville ; que de leur côté les bourgeois doivent éclairer les rues par des
lumières placées à leurs fenêtres ; que les voisins du sinistre sont tenus à
faire couler l'eau de leurs puits dans les rues et d'y établir des retenues ».
Un autre règlement de police du 29 mars 1755 contient des prescriptions
générales nouvelles. Six bourgeois sont désignés pour conduire chaque pompe; ils
reçoivent chacun 20 livres, mais « s'ils ne sont pas prompts et exacts ils sont
frappés d'une amende de 25 livres ». Douze charpentiers et couvreurs sont
désignés pour aller aux échelles. Enfin le règlement indique qu'il sera donné
aux personnes désignées pour combattre le feu « une médaille de métal pour
servir à cette occasion seulement ».
Le 17 octobre 1782, le feu détruit l'hôtel du marquis d'Alsace, un des édifices
dus à Stanislas et faisant partie de ses ensembles d'architecture. L'attention
est portée sur les imperfections du service. La question se pose si sérieusement
que comme solution on décide la création d'un Corps de Sapeurs-pompiers, origine
véritable et directe de la Compagnie des Sapeurs-pompiers municipaux. Claude
Mique, architecte du roi de Pologne, devient le premier commandant des Pompiers
de Nancy.
Peu d'événements importants sont à signaler jusqu'en 1884, époque à laquelle
s'accomplit une véritable révolution dans le Corps des Sapeurs nancéiens.
Le 25 mai, ces derniers étaient réunis, place Stanislas, pour être passés en
revue et y reconnaître un sous-lieutenant. Le choix de l'officier n'étant pas
celui des hommes, au moment où le maire, M. Voland, après avoir donné lecture du
décret de nomination, ordonne de fermer le ban, personne n'obéit.
Cet acte
d'insubordination a pour conséquence la dissolution de la Compagnie.
Le 10 août suivant, sur de pressantes instances de la Municipalité, M.
Albert
Barbier accepte la lourde tâche de reformer la Compagnie. C'est un homme
d'initiative et d'organisation. Sous son habile et sage commandement,
d'heureuses transformations vont s'opérer.
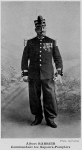
Albert BARBIER
Commandant les Sapeurs-Pompiers
Il constitue d'abord un corps de 120 hommes, avec un premier poste permanent à
l'Hôtel de Ville, composé de 3 hommes. En 1896, ce poste comprend deux équipes
de 4 hommes chacune. En 1901, son effectif est porté à 16 hommes. C'est à ce
moment que l'idée vient, pour la première fois, de construire une caserne pour
les Sapeurs-pompiers, mais des considérations budgétaires empêchent la
réalisation de ce projet.
Enfin, en 1905, l'Hôtel de France, rue Gambetta, devient vacant. Sur les
conseils de M. Barbier, la ville en fait l'acquisition.
Alors le commandant, aidé de ses officiers et de son personnel, se met à l'oeuvre
; tous les travaux de réfection sont effectués par les Sapeurs, la cour est
pavée, les canaux refaits, les salles à manger deviennent des remises, des
greniers, des dortoirs, les petites dépendances des lavabos, salles de bains, de
douches et, les chambres d'hôtel, des logements. Il n'y eut comme dépenses que
l'achat des matériaux.
Nous avons visité en détail cette installation merveilleuse et parfaitement
comprise. Elle fait honneur à ceux qui en ont eu l'initiative et surtout à ceux
qui ont su la réaliser dans les meilleures conditions de commodité et d'hygiène.
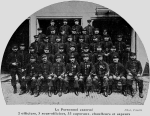
Le Personnel caserné
2 officiers, 3 sous-officiers, 33 caporaux, chauffeurs et sapeurs
II. - Le Matériel de jadis et celui d'aujourd'hui
Le matériel du début était plus que rudimentaire. Il consistait en seaux et en
seringues. On pratiquait de petits réservoirs, sous les combles des grands
monuments, destinés à recueillir les eaux de pluie et à chacun de ces réservoirs
était attachée une seringue.
En 1524, le duc Antoine ordonne l'achat de « seilles » ou seaux de cuir bouilli.
En 1593, on se préoccupe d'installer un matériel d'incendie dans la
Ville-Vieille avec des guetteurs dans les tours de l'église Saint-Epvre et
l'année suivante un second matériel est établi place Mengin.
En 1627, on achète 4 seringues en cuivre analogues à celle de Troyes.
Un inventaire du 17 novembre 1692 indique que la ville possède, à la Ville
Vieille, 111 seaux en cuir bouilli, 2 grands crochets, 8 grandes échelles, 1
falot de fer a mettre du goudron ; l'inventaire du 5 juillet 1695 établit ainsi
le matériel de la Ville Neuve : « 122 seaux tant bons que méchants, 10 hors de
service qu'il faut raccommoder et plusieurs à mettre en forme, plusieurs
échelles et une grande à la halle ».
Un autre inventaire du 6 juin 1701 contient, après l'énumération des seaux,
échelles et crochets, cette curieuse mention-. « une petite pompe qu'on a fait
venir autrefois de Strasbourg, mais je scay, par expérience, qu'il n'y a rien si
utile que de bons seaux, échelles et crochets, toutes ces pompes et ces engins
étant propres aux lieux où il y a des caneaux dans les rues et de l'eau nette ».
Le 30 juin 1708, nouvel inventaire qui porte, après les seaux, « 2 pagniers
cirés qu'on a fait venir de Champagne et que l'on disait être bons et qui ne
vaillent rien ; l'on n'a pu s'en servir. Une pompe que l'on fit venir de
Strasbourg, pas plus utile que les 2 pagniers ».
En 1718, on est d'un avis contraire et la Ville fait venir de Strasbourg 2
pompes a 80 tuyaux chacune qui sont remises l'une à la Ville-Vieille et l'autre
a la Ville-Neuve.
Une délibération du 1er juillet 1719 décide que l'on fera venir de Strasbourg 2
grandes pompes comme les deux premières et 2 plus petites de moitié avec doubles
tuyaux. L'année suivante ces pompes sont montées sur des chariots.
Vers cette époque on fait l'essai d'un procédé imaginé par un Allemand pour
l'extinction des incendies, consistant dans l'emploi d'un petit baril de poudre,
placé dans un plus grand rempli d'eau et déterminant par son explosion dans ce
milieu, une projection d'eau et un développement de fumée capables d'éteindre et
d'étouffer le feu. L'expérience, est tentée le 17 février 1723 devant le duc
Léopold, le prince de Portugal et toute la Cour; « ils ne furent pas trop
contents du secret de M. l'Allemand», écrit Nicolas.
L'Almanach de 1762 indique l'existence de 5 grandes pompes ; 2 sont au vieux
magasin derrière Saint-Epvre, dans la Ville-Vieille, 2 dans la Ville-Neuve,
derrière Saint-Sébastien, une au théâtre. Il fait en outre connaître le nombre
de coups de la cloche du beffroi qui indiquera la Paroisse où est le danger : 1
coup Notre-Dame, 2 coups Saint-Epvre, 3 coups Saint-Roch, 4 coups
Saint-Sébastien, 5 coups St-Nicolas, 6 coups Saint-Fiacre et 7 coups
Saint-Pierre.
Une nouvelle division du matériel est faite en 1780. Paroisses Notre-Dame et
Saint-Epvre, au Pavillon, 2 pompes avec leurs ajoutoires, 150 seaux et 7 boyaux.
Paroisse Saint-Epvre, à la Comédie, 2 pompes avec leurs ajoutoires, 150 seaux et
6 boyaux. Paroisse Saint-Sébastien, chez les Augustins, 1 pompe avec son
ajoutoire, 100 seaux et 6 boyaux. Au Palais épiscopal, place de la Cathédrale, 1
pompe avec son ajoutoire, 100 seaux et 6 boyaux. A l'Hôtel de la Police, la
pompe pour les feux de cheminée et 22 seaux.
Un mémoire de Despoid, du 17 décembre 1768, relate qu'il a fourni à la Ville une
nouvelle pompe de sa construction ; devenu le fournisseur de Nancy, Despoid
fournit dans les années suivantes un certain nombre d'autres pompes en «
remplacement de celles usées » ; ces pompes comprennent un chariot à 4 roues,
leurs caisses sont en menuiserie de bois de chêne et leurs balançoires en bois.
Elles valent de 400 à 1.500 francs.
Un arrêt du Parlement du 24 décembre 1782 ordonne «qu'il y aura toujours au
moins 8 grandes pompes et 4 petites pompes de cheminée, avec les corps de cuir
et leurs autres agrès en état de servir, la quantité de 500 seaux de cuir en bon
état, des échelles, des perches, crochets également en bon état et en nombre
suffisant, - qu'en outre les personnes chargées d'aller au feu, auront « un
bonnet de cuir, tant pour les garantir que pour les faire distinguer ». Avec la
création d'un corps de Sapeurs-pompiers, sous le commandement de Mique, a lieu
une reconstitution du matériel.
Différentes transformations s'opèrent encore dans la suite au cours du XIXe
siècle, mais en ne réalisant que des améliorations du régime de 1782. Les plus
importantes ne s'effectuent réellement que sous la direction de M. Barbier.
En prenant le commandement de la Compagnie, celui-ci s'aperçoit vite que le
matériel ne répond plus aux besoins d'une ville comme Nancy et son premier soin
est de remplacer les pompes d'un modèle ancien, très lourdes, par conséquent peu
maniables, par un matériel neuf, modelé sur celui de Paris, ce qui, à cette
époque, constituait ce qu'il y avait de mieux, tant comme légèreté, solidité et
bon rendement.

Matériel automobile des Sapeurs-Pompiers
Tout d'abord, le poste permanent de l'Hôtel de Ville est muni d'une petite
pompe, avec dévidoir accroché après, pour faciliter les premiers secours.
Les échelles constituent un train complet, depuis celles de 6 mètres, jusqu'à
celles de 14 mètres ; ce matériel, lourd, est d'un maniement difficile. C'est
alors qu'un officier de la Compagnie, le lieutenant Gugumus, invente l'échelle
aérienne. Et le 1er février 1881, la Compagnie est dotée de 2 échelles
aériennes, l'une de 20 mètres et l'autre de 15 mètres et tout le train des
échelles anciennes disparaît.
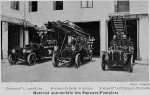
Matériel automobile des Sapeurs-Pompiers
En 1900, le commandant Barbier se rend à Paris et assiste aux essais d'une pompe
automobile. Il en saisit tous les avantages. Aussi, à peine de retour, il
propose au maire de faire l'acquisition d'un matériel de ce genre. Et le 1er
février 1901, cette pompe nouvelle, la première employée en France, est mise en
service.
En même temps que la création de la caserne, le commandant Barbier propose à la
Ville - ce qui est immédiatement accepté - d'acquérir une voiture automobile
Dietrich de 24 HP pour permettre le départ rapide, en cas d'incendie, du
personnel et des tuyaux, échelles, etc.
Depuis 1882 la Compagnie possède une pompe à vapeur dont la chaudière tubulaire
est détériorée par l'usage. Il va falloir l'expédier à Paris pour y faire les
réparations nécessaires, quand, après avoir, étudié la question, le commandant
imagine de supprimer la chaudière, de monter le corps de pompe directement sur
un châssis automobile qui devra servir de tracteur et, au moyen d'un embrayage,
procurer le fonctionnement de la pompe par un système de son invention. Un
troisième départ est ensuite constitué par la transformation, sur les mêmes
principes, de pompe automobile primitive.
A cette époque le matériel se complète d'une petite voiture à bras, système
Legagney, destinée au service des brancardiers, et d'un fourgon automobile pour
les feux de cheminée.
A cette époque l'Union des Femmes de France, désireuse de se ménager, en temps
de guerre, un moyen rapide pour le transport des blessés, fait l'acquisition
d'une voiture automobile aménagée en ambulance et la confie aux
Sapeurs-Pompiers, avec autorisation de s'en servir pour les besoins de la Ville
et au profit des victimes d'accidents.
En 1912, sur la proposition du Commandant, la Compagnie achète une nouvelle
pompe automobile, dernier modèle du genre, pouvant alimenter 6 lances avec un
débit de 1.400 litres à la minute.
Enfin, s'étant rendu compte que l'échelle Gugumus, remorquée par une pompe
pouvait occasionner des accidents par suite de son déplacement latéral, pour
obvier à cet inconvénient, l'administration municipale octroie tout dernièrement
un chariot automobile qui, avec un dispositif nouveau et spécial, porte
l'échelle ; de cette façon les dangers d'accident sont réduits et le service de
l'échelle aérienne grandement et définitivement perfectionné.
Actuellement le matériel comprend ainsi, une voiture de départ, trois pompes
automobiles, une voiture automobile porteur d'échelles, une voiture automobile
pour feux de cheminée, une voiture d'ambulance.
Et ces jours derniers, en contemplant ce matériel, toujours en état de partir
par un simple tour de manivelle, cette caserne si bien agencée, ces hommes de
dévouement qui attendent, toujours prêts, que le devoir les appelle; nous
songions à la somme de travail, à l'esprit de suite, à la ténacité qu'il fallut
au commandant Barbier et à ses collaborateurs, pour arriver, avec le concours
des municipalités qui se sont succédé depuis la refonte complète de la
Compagnie, à doter notre ville d'un matériel et d'une organisation que l'on peut
presque considérer comme unique en France, et qui ont, en tous cas, été le
premier type d'un service automobile, et le modèle imité par plusieurs
grandes villes.
Nous ne clôturerons pas cet aperçu sans dire un mot des ateliers de menuiserie,
et de ferronnerie dans lesquels les hommes de la Compagnie opèrent eux-mêmes les
réparations et même les améliorations du matériel actuel. Cet entretien,
constant et soigneux, qui s'étend aux bâtiments et aux locaux de la Caserne, se
fait ainsi dans les meilleures conditions au point de vue de l'état et de la
conservation des choses sur lesquelles il porte, et avec les avantages d'une
précieuse économie pour le budget municipal.
Il convient enfin d'ajouter que le corps des Sapeurs-Pompiers de Nancy effectue
une moyenne annuelle de 70 à 80 sorties pour incendies, et des sorties
quotidiennes, quand ce n'est pas plusieurs par jour, pour le service de la
voiture d'ambulance, celui des feux de cheminée et pour accidents divers. Il est
fait face à ces exigences et aux nombreux services de vigilance et de
prévention, théâtres, établissements publics, avec un personnel de 36 hommes,
outre les officiers.
III. - A la Revue du 14 juillet 1913
Jadis les Sapeurs-Pompiers défilaient armés à la droite de la troupe lors de la
Revue du 14 Juillet. Mais le commandant Barbier, ayant supprimé l'armement pour
absorber ses hommes dans le service d'incendie, il n'en était plus ainsi depuis
longtemps.
Pourtant la population, fière de ses Sapeurs-pompiers, déplorait cette
abstention, et dans les premiers jours du mois dernier, on proposa à M. Barbier
de reprendre la tradition. Une question surgit alors : comment la Compagnie se
présentera-t-elle ?
Le Commandant tranche la difficulté en décidant que ses hommes se montreront à
la Revue comme au feu, c'est-à-dire qu'ils défileront avec leur matériel
automobile au complet. Il sollicite ensuite de M. le Général commandant le 20e
Corps d'armée et de M. le Général commandant la 11e Division, l'autorisation
nécessaire qui lui est accordée, après examen, avec un aimable et bienveillant
empressement.
Et le 14 juillet, nos Pompiers sur leurs machines, tenue de feu, dans un
impeccable défilé, à la suite de la cavalerie, place Carnot, sont, comme nos
soldats, longuement et chaudement acclamés.
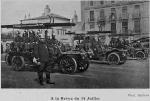
A la Revue du 14 juillet
C'est, pour nos Sapeurs la récompense de plusieurs années de travail silencieux,
de transformations incessantes, d'améliorations continuelles.
C'est toute une révélation pour le plus grand nombre de nos concitoyens qui
ignoraient le long effort auquel se livre notre Compagnie depuis l'époque de sa
transformation, c'est-à-dire depuis bientôt trente années.

Le défilé à la Revue
IV. - Le Musée
Après avoir parcouru la caserne de la rue Gambetta, admiré son agencement
merveilleux, son admirable matériel, une surprise nous est encore réservée par
la visite de son Musée.
Non seulement nos Sapeurs sont fiers de leur organisation actuelle, des moyens
dont ils disposent pour accomplir leur tâche, leur devoir le cas échéant, mais
ils ont le culte du souvenir.
Dans une des plus belles salles de la caserne, grâce à l'heureuse initiative de
leur Commandant et avec le concours de quelques-uns de ses amis, s'est constitué
un Musée, unique en son genre en France. Là se trouvent réunis : portraits,
gravures, vieux parchemins, anciennes pompes, seaux primitifs, tenues de ville
et de service et une complète collection de casques de Compagnies régionales,
des principales villes de France et de l'Etranger.
Nous y contemplons le portrait du premier commandant des Sapeurs-Pompiers de
Nancy, Claude Mique, de vieilles gravures représentant les incendies les plus
célèbres depuis les temps les plus lointains.
Nous parcourons d'anciens documents, Ordonnances, décrets des Ducs de Lorraine,
arrêts du Parlement, règlements des Administrations de la Cité. Nous lisons,
entr'autres, avec émotion, cette page de service, arrachée au livre journalier
et écrite au moment où entraient dans notre ville, en 1870, les premiers soldats
allemands.
En songeant aux pompes puissantes que nous venons de contempler, nous regardons,
avec pitié, une reproduction de ces petites seringues qui servaient à nos pères
il y a quelque 400 ans pour lutter contre le feu, les pompes a bras, si
rudimentaires et si lourdes, les seaux modestes qui devaient causer tant de
rudes fatigues â ceux qui s'en servaient.
Puis ce sont les bonnets d'incendie et les casques, depuis le XVIIIe siècle, les
tenues de ville et de service qui retiennent nos regards. Ici il faut l'avouer,
c'est du regret que nous éprouvons ; en effet, l'habit dans le passé était plus
riche que celui qu'endossent aujourd'hui nos Sapeurs-Pompiers ; mais en y
réfléchissant nous reconnaissons volontiers que sous leur modeste livrée nos
Sapeurs de l'époque, grâce à leur matériel actuel, peuvent accomplir meilleure
et plus utile besogne. Les tenues étrangères nous retiennent également.
L'âme des ancêtres, la tradition de courage et de dévouement des aïeux,
noblement gardée et pieusement suivie, flottent parmi ces riches et inestimables
collections.
Nous nous arrêtons enfin devant une vitrine dans laquelle, sous une palme d'or
et un ancien drapeau, sont renfermées les coiffures des officiers et sapeurs
morts au feu ; auprès sont leurs portraits, et à côté de l'un deux, un morceau
de la poutre noircie qui a, dans sa chute, donné
la mort.
V. - Morts au feu
C'est avec émotion que nous saluons la mémoire de tous ces braves, victimes de
leur dévouement.
La liste en est déjà longue, nous la parcourons :
7 juillet 1627. - Incendie du Palais ducal
BOURA Démange, manouvrier.
N..., (Nom et profession inconnus).
18 décembre 1652. - Incendie de maison à la Ville-Vieille
POIROT Vauthier, de Ludres.
1681. - Incendie des Hôtels de Salm et des Grandes-Ecuries
DUPRÉ Claude, concierge du petit Hôtel de Salm.
14 novembre 1858. - Incendie Dermier
ROUX Louis-Auguste, sapeur.
22 novembre 1859. - Incendie Ponel
DROUIN Nicolas, sapeur.
GEORGES Nicolas, sapeur.
REDONNET Joseph, sapeur.
13 septembre 1894
COLLIGNON Alphonse, sous-lieutenant.
1er janvier 1896. - Incendie de la Préfecture
THIÉBAUT Joseph, sapeur.
Après cette émouvante lecture, nous nous retirons étonné, enchanté de tout ce
que nous avons vu et appris. C'est l'histoire tout entière du Corps des
Sapeurs-Pompiers de Nancy que nous venons de parcourir. Nous avons assisté à ses
débuts si modestes, nous l'avons suivi dans ses multiples et heureuses
transformations, nous avons pu apprécier ce que notre population doit surtout à
l'homme remarquable qui, en ce moment, a l'honneur de la diriger.
Déjà le Gouvernement a récompensé le dévouement de celui qui a su placer nos
Sapeurs au premier rang des Pompiers de France en le nommant chevalier de la
Légion d'honneur.
Puisse ce modeste travail lui assurer la reconnaissance de ceux de ses
concitoyens qui, en nous lisant, apprendront à connaître tout ce qu'il a fait
pour notre Cité ; nous en sommes certain, ce sera pour lui une récompense d'un
autre genre, mais à laquelle il ne sera pas moins sensible qu'à la première.
Et enfin, avant de clore cette étude, qu'il nous soit permis d'émettre un voeu :
que bientôt, pour les récompenser, eux aussi, de tout leur dévouement, la Ville
veuille bien remettre à ces bons citoyens l'étendart qui fut repris en 1884 à
leurs prédécesseurs, il sera en de bonnes et fidèles mains.
Nous n'en doutons point, ce jour-là ce sera grande fête chez nos Sapeurs; ils
ont été si longtemps à la peine, qu'ils peuvent bien, un jour au moins, être à
l'honneur et à la joie.

Le Musée du Feu |
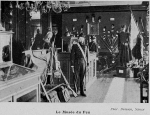
Le Musée du Feu |
Ed. DOMBRAY |













