|
MÉNAUT ET GRATIEN D'AGUERRE
Versailles - Imp. Aubert 1867
Ménaut et Gratien d'Aguerre
ne se seraient illustrés que par la défense de Nancy contre
Charles le Téméraire, que ce titre suffirait à leur gloire. Mais
ils se sont distingués par bien d'autres exploits, ces hardis
soldats, toujours pleins d'une indomptable énergie, toujours
avides de fatigues et de dangers. Leur nom nous a donc semblé
mériter un souvenir ; leur histoire fait d'ailleurs passer en
revue, sous une forme plus restreinte et pourtant non moins
animée, tous les principaux faits contemporains auxquels ils ont
pris une part si considérable, et dont plusieurs ont une
incontestable
grandeur.
Mais, à côté de leur nom et de leur famille, il est un autre nom
et une autre famille, celle des Bidos de Saint-Vincent, dont
l'histoire n'en peut être détachée. Une union constante et
peut-être sans exemple a comme identifié ces deux familles
pendant près de deux siècles; plusieurs alliances ont rendu leur
descendance commune, et font que, depuis l'extinction de la
branche masculine des d'Aguerre, ceux-ci n'ont plus d'autres
descendants que les Bidos de Saint-Vincent, à l'exception de
ceux qui, par les Lorraine-Elbeuf, et après plusieurs
changements de noms, les représentent avec beaucoup d'éclat à
l'étranger. Aussi, partout où nous rencontrerons les d'Aguerre,
au Béarn. en Espagne, en Lorraine, en Provence, à Rumigny et à
Reims, partout nous retrouverons avec eux les fils de Bidos
partageant leurs fatigues et leurs périls. Et c'est même une
singularité assez rare et curieuse à observer que ces Béarnais,
transplantés dans des pays étrangers et lointains, y conservant
cette union particulière, souvenir des moeurs simples et
patriarcales de leurs montagnes, et cela en tous temps, en tous
lieux, et malgré la succession des générations et des individus.
Maintenant, nous avons à dire les causes qui amenèrent ces
soldats béarnais à s'attacher à la Lorraine pour s'y faire une
nouvelle patrie si éloignée de leur propre pays.
En 1467, Jean, duc de Lorraine, entreprit une expédition en
Espagne pour faire valoir ses droits de succession au trône
d'Aragon. De son côté, le Béarn avait de nombreux griefs contre
le roi Jean II, alors en possession de l'Aragon, car Jean II
avait fait mourir le prince de Viane, son propre fils du premier
lit, et frère de la comtesse de Béarn; il avait, de plus, enlevé
à tous deux la Navarre qui leur appartenait du chef de leur mère
; aussi des troupes béarnaises se joignirent avec empressement à
l'armée lorraine pour attaquer le roi Jean.
Les principaux chefs de ces Béarnais étaient les deux frères
Ménaut et Gratien d'Aguerre; ils étaient du pays de Soule et des
environs de Mauléon (Basses-Pyrénées).
A eux se joignit Joannot, des seigneurs d'Agnos et de Bidos; il
portait le nom de Bidos du lieu de sa naissance, de même que son
fils Joannot de Saint-Vincent prit ce nom du lieu de sa
naissance et de leur seigneurie.
Bidos est situé à l'entrée de la charmante vallée d'Aspe, à une
demi-lieue d'Oloron et à six de Mauléon (Basses-Pyrénées).
Joannot avait les armes d'Oloron qui n'ont point cessé d'être
portées dans sa descendance, et qui sont « d'or à une vache de
gueules, accollée et clarinée de sable, au canton senestre
d'azur chargé d'une croix potencée d'or, écartelé d'or, à une
cloche de gueules.» Armes significatives, car la vache de
gueules désigne la ville du Béarn, comme la cloche et la croix
la ville épiscopale.
Mais les seigneurs d'Agnos n'avaient aucune prétention sur
Oloron, et ces armes viennent sans doute de ce que Joannot
conduisait sa bande sous la bannière de cette ville (1).
Revenons maintenant à l'expédition des Lorrains en Espagne, pour
laquelle nous consulterons Ferreras et Mariana (2) qui donnent
des détails beaucoup plus précis et circonstanciés que les
récits très incomplets de la Chronique de Lorraine et de Dom
Calmet. Ce dernier historien s'appuie d'ailleurs beaucoup trop
sur la chronique scandaleuse dont l'auteur, aussi étranger à la
Lorraine qu'à l'Espagne commet souvent d'incroyables erreurs.
(1) Une branche puînée des Saint-Vincent a, pendant longtemps,
substitué à ces armes celles des Vaillant, par suite d'une
alliance avec l'héritière du nom et des biens de cette famille.
(2) Ferreras. - Mariana. - Coutumes de Soule. Archives des
Basses-Pyrénées, B. 82lt, 876, 877. Recherches sur la noblesse
de Champagne en 1668.
CHAPITRE I.
Guerre d'Espagne.
1467 à 1472.
L'armée lorraine, entrée en
Espagne en 1467 pour marcher à la conquête de l'Aragon, y fit de
rapides progrès et s'empara de la Catalogne et de Barcelone, sa
capitale. Dès le 12 janvier 1468, le duc Jean délivrait à
Barcelone des lettres portant donation à Jean d'Anjou, de
Conflans-en-Jarnisy, ville par la défense de laquelle Gratien d'Aguerre
allait bientôt s'illustrer.
Les Lorrains conquirent ensuite la plus grande partie de
l'Aragon, et ils touchaient au but de leurs efforts lorsque le
cours de ces triomphes fut interrompu par la mort soudaine du
duc Jean, arrivée le 13 décembre 1470, à Barcelone. Ce fut Jean
de Calabre, frère naturel du duc, qui commanda à sa place, mais
il eut peu de crédit sur l'armée lorraine, dont la plus grande
partie revint en France en 1471. Les d'Aguerre furent de ceux
qui restèrent fidèles à Jean de Calabre qui, abandonné par la
plus grande partie des siens, se vit enlever toutes ses places,
à l'exception de la ville de Barcelone, dans laquelle il fut
bientôt assiégé. Le 5 novembre 1471, Galeotto, l'un de ses
capitaines, ayant fait une sortie, fut mis en déroute, fait
prisonnier, et avec lui fut pris l'étendard de la ville de
Barcelone; malgré ce revers, Jean de Calabre se défendit encore
avec une rare constance pendant une année, et ne se rendit que
le 17 octobre 1472. Ainsi l'armée lorraine avait su se maintenir
à Barcelone pendant l'espace de cinq années.
Le courage et les services des d'Aguerre dans cette longue et
difficile expédition sont attestés par les lettres patentes du
duc René II, en date du 10 avril 1477 : « Ayant regart aux grans,
notables et laborieux services que notre trèscher et féal
chevaillier messire Gratien de Aguerre a fait à nostre. grant
père le roy de Jhérusalem et de Siciles, et à feu nostre oncle
le duc Jehan, duc de Calabre et de Lorraine, en leurs guerres et
emprinses de Cathelongne;. ..» Les lettres du 23 décembre 1489
citent aussi : « Les grans, continuelz, laborieulx, très
aggréables et recommandables services que ledit messire Gratien
et les siens nous ont faitz par cy-devant, tant en nostre pays
de Cathelongne, avecques et en la compagnie de nostre... oncle
le duc Jehan de Calabre, et à nostre... grant père le roy de
Sicille. » D'autres lettres des 14 août 1477 et 18 mai 1485 font
aussi connaître que Ménaut avait, dans le cours de cette même
campagne, avancé au duc Jean et à son frère Jean de Calabre une
somme de sept mille écus d'or, qu'il ne parvint à se faire
rembourser que bien des années après.
Ferreras. imariana. - Dom Calmet, Histoire de Lorraine, tome V,
page 169. Idem, Notice de la Lorraine, tome II, page 276.
Archives de Lorraine.
CHAPITRE II.
Guerre contre Charles le Téméraire.- Siège de Conflans. -
Premier siège de Nancy.
1475.
Après cette issue
désastreuse de l'expédition d'Espagne, Ménaut vint en Lorraine
en 1473 avec les siens. Il ne s'y attacha point au service du
duc Nicolas qui régnait alors, mais à celui de la tante du duc,
Yolande, comtesse de Vaudémont, qui résidait à Joinville avec
son fils René II. « Lui et ses gens sont venus au service de
notre très redoubtée dame et mère et au notre. » (Lettres
patentes du 1er mars 1480.) Du reste, Ménaut n'arrivait pas à
Joinville entièrement en étranger, car, indépendamment des
services qu'il venait de rendre au duc Jean, frère de la
comtesse Yolande, celle-ci avait tout récemment perdu son mari,
qui avait fait avec Ménaut la campagne d'Espagne, et l'un des
principaux hôtes de Joinville, Jean de Brou, plus connu sous le
nom de Petit-Jean de Vaudémont, revenait aussi de cette
expédition. Mais Ménaut ne séjourna que peu de mois à Joinville,
et il en fut bientôt tiré par un événement qui donna un bien
plus vaste essor aux services de lui et des siens.
Le 27 juillet 1473, le duc de Lorraine, Nicolas, était enlevé
après trois jours de maladie, sans avoir été marié. Le jeune
comte de Vaudémont, René II, lui succéda et alla s'établir à
Nancy où se fixèrent également, comme attachés à son service,
Ménaut et Gratien d'Aguerre, ainsi que ceux qui les
accompagnaient. Les premiers temps du règne de René furent
tranquilles; aussi ne fut-il guère question ni des braves
compagnons béarnais, ni de leurs services et bien moins encore
du remboursement de l'argent qui leur était si légitimement du.
Mais, plus tard, de graves difficultés étant survenues avec le
duc de Bourgogne, pour lequel nombre de seigneurs lorrains
avaient pris parti, les d'Aguerre, trop oubliés jusqu'alors,
revinrent enfin en mémoire. Le 8 avril 1475, Ménaut fut nommé
conseiller et chambellan du duc, et, le 1er mai suivant, Gracian
était fait écuyer d'écurie. Le temps ne devait pas tarder ou les
d'Aguerre justifieraient amplement ces modestes faveurs. En
effet, René ayant commencé, le mois suivant, les hostilités
contre les Bourguignons, Gracian d'Aguerre, que nous appellerons
désormais Gratien pour nous conformer à l'orthographe lorraine,
fut chargé de la défense de Conflans, que vinrent bientôt
assiéger le comte de Campobasso et le maréchal de Luxembourg
avec une armée de six mille hommes munis d'artillerie.
Par un singulier hasard, la fortune mettait ainsi en présence
deux hommes qui s'étaient déjà vus et qui devaient se revoir
encore plus d'une fois sur le champ de bataille, mais dont le
caractère et la fortune étaient également dissemblables. Ces
deux hommes étaient Gratien d'Aguerre et Nicolas de Montfort,
connu sous le nom de Campobasso, qui tous deux avaient combattu
en Espagne sous le même drapeau, dans l'armée lorraine.
Campobasso, que René venait de récompenser richement par le don
de Commercy, avait, un instant après, trahi la Lorraine dont il
s'était fait un des plus dangereux ennemis; pendant ce temps,
Gratien, le simple écuyer d'écurie, était resté fidèle, comme il
ne cessa jamais de l'être, et l'un des meilleurs soutiens de la
cause des Lorrains.
Malgré la grande supériorité du nombre des assiégeants,
Campobasso ne put s'emparer de Conflans, et, craignant d'être
lui-même attaqué, il leva le siège.
« Gracian Daguerre, lequel estait dedans, quand il se veit
assiéger, moult bien se sceut déffendre. De nuict et de jour
faisaient leurs efforts pour la cuyder prendre. » (Chronique de
Lorraine, n° 125.) Gratien, devenu ainsi libre par la retraite
des assiégeants, alla à Pont-à-Mousson joindre l'armée du duc
René ; il s'y retrouva avec son frère Ménaut et avec son
compatriote Joannot, que nous appellerons, comme l'Histoire de
Lorraine, Jeannot de Bidos. La Chronique de Lorraine défigure
ainsi leurs noms à cet endroit : Menat de Guerre et Gracien son
frère, Jennoy de BidoL
Peu après, René fut averti que le duc de Bourgogne accourait
avec de grandes forces contre lesquelles il ne pourrait tenir;
il résolut alors d'aller chercher du secours en France et en
Allemagne. En se retirant, il confia aux chefs de son armée la
défense de ses places les plus importantes. Gratien d'Aguerre
fut placé au château de Prény, et Jean de Calabre reçut le
commandement de Nancy. Ce dernier, ayant pu mieux que personne
apprécier en Espagne la bravoure et la fidélité de Ménaut d'Aguerre,
le prit avec lui dans Nancy, et, par une singulière fortune, les
d'Aguerre devaient ainsi figurer avec honneur aux trois sièges
successifs de cette ville dans le cours d'une année.
Le duc de Bourgogne arriva de Luxembourg en Lorraine au
commencement du mois de septembre, et s'empara rapidement de
toutes les places sur son passage. Seul Gratien d'Aguerre sut se
maintenir à Prény comme il venait de le faire à Conflans. «
Tentost après, dit Jehan Aubrion, ceulx de Ciercque
s'accordèrent à luy et toutes les altres chastel et bonnes
villes de Lorraine, réservé Prény, que ung appelé Gracia de
Guerre tenait et ne la volt point rendre. »
Cependant il s'agissait pour le duc de Bourgogne d'une
entreprise beaucoup plus importante, de s'emparer de la capitale
de la Lorraine.
Le siège de la place commença le 20 octobre 1475; ce fut ce
jour-là que Campobasso, auquel le sort réservait de se trouver
toujours personnellement en lutte avec les d'Aguerre, ses
anciens compagnons d'armes, enleva les troupeaux de la ville de
Nancy, qu'on avait eu l'imprudence de laisser paître sans
défense dans la prairie de Tomblaine ; c'était là un très grand
revers pour la garnison qui voyait ainsi disparaître les moyens
de subsistance indispensables pour pouvoir prolonger la
résistance. Néanmoins elle se défendit vaillamment; mais René,
sachant qu'elle manquait trop de vivres pour pouvoir tenir
longtemps, écrivit aux assiégés de capituler, et, conformément à
ses lettres qui arrivèrent le 25 novembre, la place se rendit
après cinq semaines de siège, obtenant toute sûreté pour les
habitants, et pour la garnison l'autorisation de se retirer
libre avec les honneurs de la guerre. Le 27 novembre, Ménaut
sortit donc de Nancy, ainsi que toute la garnison, et trois
jours après Campobasso y entrait solennellement à la suite du
duc de Bourgogne. Mais une année ne devait pas s'écouler avant
que Ménaut, commandant cette fois en personne, ne prît par une
nouvelle et plus heureuse défense de Nancy contre Charles le
Téméraire et contre Campobasso une éclatante revanche. Du reste,
les services de Ménaut durant ce siège sont honorablement
reconnus par les lettres patentes du duc René, du 16 février
1476, dans lesquelles, en rappelant que Ménaut a été deux fois
au nombre des assiégés dans la ville de Nancy, ce prince
constate qu'il s'y est chaque fois « si vaillamment et
courageusement porté que possible était à supporter à corps
humain. »
Archives de Lorraine. Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. V, p.
158, 178, 319. Chronique de Lorraine, n° 125 à 137. - Journal de
Jehan Aubrion, bourgeois de Metz, p. 80.
CHAPITRE III.
La Lorraine reconquise sur les Bourguignons.
1476.
Après la prise de Nancy,
Ménaut se rendit auprès du duc René, alors absent de la
Lorraine, et nous ne le voyons reparaître qu'avec ce prince
lorsqu'il revint un an après à la tête d'une armée ; il en fut
de même de Bidos qui était retenu par un service dans la maison
du duc. Nous devons, du reste, remarquer que Ménaut d'Aguerre et
Bidos restaient tous deux généralement attachés à la personne et
à la maison du prince, tandis que Gratien d'Aguerre, plus
impétueux, aimait à se séparer pour commander des troupes et à
entreprendre des expéditions seul et pour son propre compte.
Toutefois, comme la Lorraine se trouvait alors au pouvoir des
Bourguignons, et qu'on était réduit à une inaction forcée,
Gratien se retira dans l'asile qui avait été le premier séjour
des d'Aguerre à leur arrivée dans nos contrées. Il se rendit
auprès de la comtesse Yolande, au château de Joinville, où se
trouvaient réunis quelques-uns des plus braves Lorrains qui sont
cités par la Chronique de Lorraine. « Ains premier parlerons du
bastard de Valdemont, de Gracian de Guerre, de Henry et Ferry,
enfants de Tantonville, de l'escuyer Gérard, de Jehan d'Aigremont,
assy de Petit Jehan de Valdemont. » Gérard est mis ici par
abréviation de Gérard d'Avillers; les enfants de Tantonville, ce
sont les deux Ligniville, et Petit Jehan de Valdemont n'est
autre que Jean de Bron, appelé aussi M. de Pierrefort. Notons
avec soin les noms de ces sept braves guerriers, noms qui se
retrouveront si souvent et presque toujours ensemble dans
l'histoire de cette guerre. Ces hommes, déterminés et
entreprenants, attendaient avec impatience dans leur retraite de
Joinville une occasion qui ne tarda pas à se présenter.
Le 3 mars 1476, Charles le Téméraire perdit la bataille de
Morat. Dès lors, les capitaines retirés à Joinville pensèrent
que le moment était arrivé de reprendre l'offensive à eux seuls
et malgré l'absence du duc René. En effet, dans la nuit du 13 au
14 avril, ils s'emparèrent du château de Vaudémont par escalade,
au moyen d'une intelligence avec le châtelain, et mirent bientôt
la main sur plusieurs autres places. Gratien d'Aguerre devint
capitaine de Foug; de là, il se joignit à la garnison de
Fontenoy, et harcela tellement Gondreville, que les
Bourguignons, qui l'occupaient, furent forcés de l'abandonner.
Ces premiers succès, suivis de plusieurs autres, firent
comprendre aux chefs lorrains la nécessité d'agir de concert
pour frapper un plus grand coup. En conséquence, Gratien se
réunit aux deux Vaudémont, ainsi qu'aux autres capitaines, et
tous ensemble vinrent, le 12 août, assiéger Bayon, qu'ils
prirent par escalade. Le surlendemain, ils allèrent mettre le
siège devant Lunéville, dont ils parvinrent à s'emparer au bout
de quelques jours, malgré un assaut resté infructueux. Dès lors,
ils crurent que rien ne pourrait leur résister et s'en vinrent,
à la fin du mois d'août, mettre le siège devant la ville de
Nancy. La Chronique de Lorraine relate ainsi les dispositions
prises par les assiégeants : « Dès Virlay jusque à Sainct-Jehan
ont faict un grand biez, dedans se sont lousgiés. Valthier de
Panne à Virlay son losgis estait; Monsr de Pierrefort on moulin
estait (Petit-Jean de Vaudémont). Monsr le bastard de Vaudemont,
Gracien [d'Aguerre], l'escuyer Gérard, les enfants de
Tantonville et ceulx d'Aigremont estaient tous entour de Sainct-Jehan.
»
On voit que les sept de Joinville se retrouvaient encore là au
complet comme dans les sièges précédents.
Depuis peu de jours cette entreprise était commencée, lorsque
Jean de Vaudémont reçut des lettres de René qui le forçaient de
s'éloigner; le duc l'informait de son projet d'aller lui-même
s'emparer d'Épinal, et il lui donnait l'ordre de prendre cent ou
cent vingt de ses hommes les mieux montés et de se rendre en
toute hâte avec eux, pour le 8 septembre, en vue d'Épinal, afin
d'y opérer sa jonction avec lui. Vaudémont s'empressa d'exécuter
ces ordres; il alla à la rencontre de René qui, de son côté,
arrivait au rendez-vous avec une armée de trois à quatre mille
hommes. Ces forces étant trop supérieures pour que la garnison
d'Épinal tentât de résister, la place se rendit sans coup férir,
et René y fit son entrée.
« Il mit son féable serviteur Ménault Daguerre por bien ouadier
ledit chastel, avecque luy y avoit xxx Gascons, tous gens de
guerre et de bonne façon. » (Chronique de Lorraine, n° 163.)
Peu de jours après la prise d'Épinal, le duc René arriva devant
Nancy avec Jean de Vaudémont, et poussa si vigoureusement le
siège que la ville fut forcée de se rendre le 5 octobre. Ce fut
un grand bonheur pour les Lorrains que Nancy n'eût pas tenu
quelques jours de plus ; car, deux jours après le départ de la
garnison, le duc de Bourgogne, qui arrivait en toute hâte avec
une armée de secours, se présentait devant Toul. En apprenant la
prise de Nancy, qui avait si malheureusement déjoué ses calculs,
ce prince ne put retenir sa colère, « jura sainct Georges que
devant que il fust les Roys, de toute la duchiéseigneur en
serait, luy et ses gens li duc René hors chasserait, ou tous
mors ils demoureraient. » (Chronique de Lorraine, n° 170.)
Serment de funeste présage, et dont la dernière partie seulement
devait se trouver, jour pour jour,. si funestement réalisée par
le propre trépas du duc de Bourgogne.
Chronique de Lorraine, n°s 143 à 170. - Histoire de Lorraine, t.
V, p. 347 à 353.
CHAPITRE IV
Le grand siège de Nancy.
1476
Après la prise de Nancy par
les Lorrains, les deux armées passèrent quinze jours à se
surveiller mutuellement sans en venir aux mains. Mais, le 21
octobre, les Allemands qui composaient une très grande partie de
l'armée lorraine s'étant mutinés, René fut forcé de battre en
retraite ; il quitta donc Pont-à-Mousson à l'heure même où le
duc de Bourgogne y entrait de son côté, et il alla coucher à
Saint-Nicolas. En même temps, René commit Ménaut et Gratien d'Aguerre
à la défense de Nancy; cette mission de veiller à la défense de
la capitale de la Lorraine contre un ennemi aussi formidable
était sans doute d'une extrême importance, mais elle était en
même temps entourée de difficultés presque insurmontables, car
la place manquait de vivres et de munitions de guerre.
Le duc de Bourgogne commença aussitôt le siège de Nancy, qui fut
investi le 25 octobre. Dès les premiers temps, on éprouva une
disette que l'armée et les habitants supportèrent avec courage;
toutefois, la place ne pouvait absolument tenir si elle n'était
promptement secourue par le duc de Lorraine, ainsi qu'il en
avait donné la promesse formelle en s'éloignant pour aller
solliciter l'appui de ses alliés.
En effet, quelques semaines après l'ouverture du siège, René,
qui était allé à Zurich, reçut des Suisses l'assurance qu'on lui
donnerait une dizaine de mille hommes qui seraient entièrement
prêts pour la fin de décembre. Aussitôt, Syffred de Baschi,
maître d'hôtel du duc, que l'Histoire de Lorraine appelle
simplement Chiffron, s'offrit pour aller porter aux assiégés
cette bonne nouvelle. Arrivé à Vaudémont, il s'y aboucha avec
les d'Aigremont (Choiseul), les Tantonville (Ligniville) et
Gérard d'Aviller; tous conçurent alors le projet assez hardi de
ne point se borner à faire tenir des nouvelles aux assiégés,
mais de profiter de l'occasion pour ravitailler la place en
hommes et en provisions ; ils résolurent donc de se jeter dans
Nancy, et de charger leur bande de poudre et de viandes salées.
Arrivés à Clairlieu, ils y attendirent la nuit; à l'heure de
minuit, ils se glissèrent par derrière Laxou, parvinrent au
sommet de la côte de Toul, et y firent une halte pour observer
les lieux. N'ayant aperçu personne de garde, ils recommandèrent
leur âme à Dieu, et, l'épée à la main, marchèrent sur les murs
de la place. Arrivés aux fossés, ils s'y élancent en criant :
Lorraine ! Ce bruit donne l'alarme des deux côtés : ceux de
Nancy allument des torches, et les Bourguignons se jettent dans
les fossés pour arrêter le convoi. Cette tentative ne réussit
qu'en partie, car le gros de la bande fut forcé de battre en
retraite et de retourner en toute hâte à Vaudémont; les chefs
seuls qui étaient en avant purent pénétrer, à l'exception
toutefois de Baschi. Ceux de Nancy accueillirent ces nouveaux
arrivés avec une grande joie et se félicitèrent de l'assurance
d'être bientôt secourus.
Cependant, Syffred de Baschi, n'ayant pu franchir une tranchée,
avait été fait prisonnier. « Le bon maistre d'hostel Chiffron à
duc de Bourgoigne fut mené, tous les seigneurs après de lui
estaient. Quand il le veit, jura sainct Georges que incontinent
pendu serait. » (Chronique de Lorraine, n° 183.) Toute la
noblesse insistait pour obtenir la grâce de Syffred, « le comte
de Nassol, le comte de Simay (Chimay), M. de Bièvre (Jean de
Rubempré), le grand Bastard (le propre frère du duc), tous
prièrent pour lui. » Mais le duc. résistait à tous avec colère,
et cette scène nocturne avait sa sauvage et farouche grandeur.
Cependant le comte de Campobasso, qui avait servi dans l'armée
lorraine avec Baschi, insistait plus que tout autre, remontrant
au duc les représailles, que ces actes de violence pourraient
attirer sur ses propres serviteurs. « Le duc, quand il veit que
le comte assy fièrement parlait, le duc airmé estait, en ses
mains ses gantelets avait, haussy la main, à comte donna un
revers ; le comte plus ne dit mot, ne tous les altres assy. Li
duc le délivra à dict prévost. Va faire ton debvoir. »
(Chronique, n° 183.) Incontinent Syffred fut conduit au
supplice, au lieu où est maintenant l'église Saint-Nicolas. «
Ledit prévost sus l'abre le feit monter; en disant son In manus
tuas, etc..., en bas fut rué, le paure homme morut : Dieu luy
veuille pardonner. » (Chronique, n° 183.) La nuit n'était donc
point encore passée que déjà Syffred avait cessé de vivre. Au
point du jour, Gérard d'Aviller et les Tantonville s'abouchèrent
avec les Bourguignons pour recommander que le prisonnier fût
traité avec humanité. Ayant appris, en réponse, sa mort funeste,
ils demandèrent son corps qui leur fut délivré. Le grand bâtard
le fit mettre dans un drap de soie et porter à ceux de Nancy par
quatre gentilshommes. Toute l'armée et toute la population
suivirent son corps, et on l'enterra avec la plus grande pompe à
Saint-Georges, auprès du grand autel.
Tel fut ce célèbre acte de violence de Charles le Téméraire,
acte dont les conséquences furent fatales; car, outre les
représailles beaucoup trop sanglantes que René en fit tirer
sur-le-champ, le silence de Campobasso, après l'outrage qu'il
avait reçu du duc, pouvait laisser à penser de la part de cet
Italien qui savait attendre et choisir son moment. En effet, la
fortune allait bientôt solder tous ces comptes de sang.
Campobasso sut se procurer une insigne vengeance à la bataille
de Nancy, et deux mois ne devaient pas se passer avant que
Charles le Téméraire allât, lui aussi, reposer sous les dalles
de Saint-Georges, auprès du bon maistre d'hostel Chiffron. Et,
par un singulier hasard, Ménaut d'Aguerre, qui venait d'ordonner
la pompe solennelle de Syffred, devait être celui que, par une
commission spéciale, « René choisit pour présider aux
funérailles de Charles le Téméraire. » (Lepage, Commentaires sur
la Chronique de Lorraine, p. 90.) Il lui fut ainsi donné de
réunir ces deux ennemis au pied du même autel et dans la paix du
même tombeau.
Au milieu du deuil de la mort de Chiffron, Gratien d'Aguerre et
Petit-Jean de Vaudémont, qui était aussi renfermé dans Nancy,
avaient pourtant à se réjouir d'avoir vu pénétrer dans la place
les Ligniville, les d'Aigremont et Gérard d'Aviller, car ainsi
se trouvaient, sauf un seul, réunis dans ce moment critique les
sept seigneurs qui, partis de Joinville trois mois auparavant,
avaient commencé à reconquérir la Lorraine. Quant à Jean de
Vaudémont, qui manquait à cette réunion de chefs éprouvés et si
habitués à se retrouver ensemble à la peine, il n'était point
resté indifférent aux embarras des assiégés, et avait su leur
donner de ses nouvelles. Il commandait-à Gondreville, et, le
jour de la Toussaint, il était parvenu à se glisser secrètement,
à la tête de trois cents soldats, par la forêt de Haie, auprès
de Laxou; avec cette poignée d'homme, il se jeta la nuit sur les
assiégeants qui occupaient Laxou, et cette surprise eut tout le
succès qu'on pouvait en espérer avec le peu de soldats dont
Vaudémont disposait.
Cependant les privations extrêmes des assiégés augmentaient
chaque jour, et le secours impatiemment attendu n'arrivait pas.
Pied-de-Fer, qui était sorti de Nancy pour aller chercher et
rapporter des nouvelles de René, n'osa pas à son retour rentrer
dans la place, et s'arrêta à Rosières. Il fallait donc trouver
un homme de coeur qui voulût bien se hasarder à entreprendre avec
plus de succès cette périlleuse mission. « Les capitaines Ména
et Gratien et tous les altres cherchaient por en treuver ung. Un
nommé Thierry, drapier que de Mirecourt estait, lequel dict :
Messeigneurs, à l'ayde de Dieu, se vous voliez, je iray et
dedans huit jours, à plus tard, je vous jure que céans
retorneray. » (Chronique, n° 188.) Thierry remplit sa mission
avec autant de courage que d'habileté, et il rentra à Nancy,
annonçant qu'il avait vu plus de dix mille Suisses rassemblés
auprès de René qui, dans huit jours, viendrait les secourir.
Toutefois, la disette, qui était extrême, n'était pourtant pas
le seul mal dont les assiégés eurent à souffrir, car le manque
de poudre était tel que l'artillerie ne pouvait plus faire aucun
service. On éprouva pourtant une légère amélioration à cet
égard. « Messire Michel Glory, que gouverneur de l'artyllerie
estait, dict à tous les capitaines Ména et Gratien que encore
deux tonnes de pouldre avait, lesquelles coichiez les avait du
temp des Bourguignons ; nuls ne les scavaient, fors que lui. »
(Chronique, n° 189.) Pierre le Bombardier fit mener une pièce à
la porte La Craffe et tira avec un grand succès sur l'ennemi.
Peu de jours après, le duc de Bourgogne reçut à son camp la
visite d'un souverain. Son cousin germain, Alphonse, roi de
Portugal, se trouvant en France, voulut faire une tentative pour
amener la paix entre la France et les Bourguignons. Il se rendit
d'abord à Toul, et Charles le Téméraire alla au-devant de lui
jusqu'auprès de cette ville. Le roi de Portugal arriva devant
Nancy le 29 décembre, et alla loger à trois lieues de cette
ville, au château d'Amance. Mais, ses efforts en faveur de la
paix ayant été inutiles, il repartit deux jours après.
A Nancy, la famine augmentait chaque jour, on était arrivé à la
dernière extrémité. Le terme de Noël, annoncé plusieurs fois
comme celui de la venue de l'armée de secours, était passé
depuis dix jours; l'anxiété était des plus grande, et la
situation désespérée. Malgré cet état de désolation et
d'épuisement, les assiégés firent le dimanche 5 janvier,
longtemps avant le jour, une sortie qui ne fut pas sans quelque
utilité, suivant le témoignage du duc René lui-même; en parlant
du duc de Bourgogne, il dit : « Mais là, Dieu merci, il eut deux
empêchements, l'un que ceux de la ville, qui ne pensaient point
que je fusse si près d'eux, saillirent par une poterne, et, du
côté là, ils brûlèrent toutes les tentes et tuèrent ce qu'ils
trouvèrent, puis se retirèrent dans la ville. » Leur retour eut
lieu à sept heures du matin. « Les assiégés étaient à peine
rentrés dans la ville, lors qu'un soldat bourguignon se jeta
dans le fossé, près du palais, en criant : Vive Lorraine ! jour
Dieu, sauvez-moi la vie, car des nouvelles vous apporte. On le
conduisit devant les capitaines Ménaut et Gratien d'Aguerre,
auxquels il raconta en détail tout ce qui venait de se passer.
On annonça aux habitants l'arrivée des secours. » (Digot, p.
339.)
Le sort des assiégés allait ainsi être bientôt décidé par la
bataille. Or, voici comment se passa ce grand et mémorable
événement.
Chronique de Lorraine, p. 239 à 290. - Dom Calmet, p. 351, 379.
Digot, Histoire de lorraine, t. III.
CHAPITRE V.
La bataille de Nancy.
5 janvier 1477.
René étant enfin arrivé à
Saint-Nicolas, les deux armées se préparèrent pour la bataille
dès le matin du 5 janvier 1477. Pendant ce mouvement, Campobasso
avait déserté avec les siens pour passer à l'ennemi, et il se
retrouvait pour la seconde fois au service de la Lorraine.
L'armée du duc de Bourgogne était ainsi disposée : elle avait
devant elle son artillerie, en arrière le ruisseau de Jarville,
à sa gauche elle s'appuyait sur la Meurthe, et à sa droite sur
le bois de Saulrupt. Charles le Téméraire était placé au centre,
le bailli de Flandre à l'aile droite, et Galéotto à la gauche,
le même Galéotto qui avait combattu pour les Lorrains à
Barcelonne. L'arrière-garde était commandée par le grand bâtard
Antoine de Bourgogne.
L'armée de René commença l'attaque en tournant, à la faveur d'un
bois, la droite de l'ennemi dont elle dépassa le corps d'armée,
rendant l'artillerie des Bourguignons sans effet, puis elle
tomba à l'improviste sur l'arrière-garde; celle-ci ayant été
surprise et culbutée, sa déroute amena celle de toute l'armée de
Charles le Téméraire.
La garnison de Nancy ne crut pas devoir rester inactive. « Ména
Daguerre et Gratien son frère et tous les altres en airmes
estaient, saillirent dehors tous embastonnés, frappaient et
chargeoient sus ceulx que demeuré avaient. » (Chronique, n°
203.) Le duc de Bourgogne se trouva enveloppé de tous côtés; son
artillerie, qui avait été tournée, ne put tirer qu'un seul coup
qui tua deux hommes. Cependant, et bien que dès le début la
situation semblât désespérée, les Bourguignons se défendirent
longtemps et vaillamment; la bataille paraît en effet avoir duré
six heures, puisque le duc René, qui poursuivit aussitôt les
fuyards, ne franchit le pont de Bouxières qu'à cinq heures du
soir.
Charles le Téméraire battit en retraite accompagné de son frère
Antoine, et arriva près de l'étang Saint-Jean, entouré par
l'élite de la noblesse ; là, plus de cinq cents des siens se
firent tuer auprès de lui pour le défendre ; mais à la fin son
cheval s'étant embourbé dans la vase, il fut frappé de plusieurs
coups de lance et tué par Claude de Beaumont à l'endroit où se
voit encore la croix érigée en mémoire de ce funèbre événement.
« Quand la note blesse veirent que leur seigneur mort estait,
tous le habandonnirent : les uns s'enfuyaient de çà et de là, le
grand bastard Anthoine print la fuycte vers Laixou. »
Après la mort du duc. le grand bâtard Antoine de Bourgogne se
trouvait l'homme le plus considérable de toute l'armée, et
c'était à lui à en rallier les débris, s'il était encore
possible. Jeannot de Bidos, qui combattait avec distinction dans
l'armée lorraine, s'élança à la poursuite de ce personnage
important et le fit prisonnier. « Quand il vient à la chenevière
de Jeannot le Gascon, il fut prins. » (Chronique de Lorraine, n°
203.) Jeannot s'empara aussi d'un des principaux seigneurs
bourguignons, Philippe de Neufchastel. Henri de Neufchastel,
seigneur de Chastel, fut fait également prisonnier. Ils étaient
l'un fils, l'autre neveu du maréchal de Bourgogne; la Chronique
de Lorraine appelle le premier M. de Fontenoy, et le second M.
d'Arricourt, seigneur de Chastel. Tous deux furent conduits au
château de Foug, et le grand bâtard Antoine de Bourgogne fut
mené à Pulligny. La prise si importante que Bidos venait de
faire semblait être pour lui un événement des plus heureux, et
pourtant nous verrons bientôt combien d'ennuis et de traverses
il en résulta non-seulement pour lui, mais encore pour le duc de
Lorraine.
Par suite de cette victoire signalée, René reprit enfin
possession de sa capitale, mais il la trouva bien dévastée. «
Les murailles étaient battues et comme arrasées par force de
l'artillerie. » (Lettres patentes du 14 février 1476.) Il ne put
se loger dans son palais, car on en avait été réduit à brûler
une partie des matériaux pour empêcher la garnison de mourir de
froid. Pourtant il fit son entrée sous le plus bel
arc-de-triomphe où prince eût jamais passé : sous un arceau
composé des os de tous les animaux immondes dont avaient mieux
aimé se nourrir les habitants de Nancy, que de ne pas pousser
jusqu'au bout leur sublime défense. » (Dumast, Nancy. Histoire,
etc., p. 9.)
Les d'Aguerre avaient ainsi rendu un service signalé à la
Lorraine en sauvegardant Nancy. Ils surent, malgré la famine et
l'entier épuisement des munitions de guerre, prolonger, assez
pour que René pût arriver à temps, cette résistance héroïque,
juste sujet d'une gloire impérissable pour leur nom.
Chronique de Lorraine, nos 196 à 209. - Dom Calmet, Histoire de
Lorraine, t. V, p. 388.
CHAPITRE VI.
Pompe funèbre de Charles le Téméraire.
1477
Le corps du duc de
Bourgogne ne put être retrouvé et reconnu parmi tous les morts
que le lendemain de la bataille. Nous avons dit qu'au
commencement du siège de Nancy Charles le Téméraire « jura saint
Georges que devant que il fust les Roys de toute la duchié
seigneur en serait ou tous morts ils demoureraient. »
(Chronique, n° 170.) Et le lundi, jour des Rois, lendemain de la
bataille de Nancy, la porte de Saint-Nicolas, qui conduisait à
la collégiale de Saint-Georges, s'ouvrait de nouveau comme elle
s'était ouverte six semaines auparavant pour le corps du bon
maître d'hôtel Chiffron, et donnait passage à un aussi
lamentable convoi.
Quatre gentilshommes se présentaient encore portant dans de
riches draperies un corps inanimé ; mais, cette fois, c'était
celui du dernier duc de Bourgogne, et dans ce drap funèbre
gisaient avec lui le nom, la fortune et les destinées d'une
vaste et puissante souveraineté. Cette journée était doublement
douloureuse pour Ménaut d'Aguerre au milieu de son triomphe. Il
était chargé par le prince de présider aux funérailles du brave
soldat, du souverain malheureux contre lequel il avait souvent
combattu avec des fortunes diverses; et, au même moment, il
revoyait dans l'armée lorraine le comte de Campobasso par lequel
il avait été assiégé deux fois dans Nancy, Campobasso qui avait
comme lui combattu en Espagne sous le drapeau lorrain, et qui,
après avoir trahi la Lorraine pour la Bourgogne, et ensuite la
Bourgogne pour la Lorraine, venait d'être ce jour même rétabli
par René dans sa seigneurie de Commercy.
Cependant, bien que le corps du duc de Bourgogne eut été reconnu
par un de ses pages, on jugea prudent de ne pas procéder à son
inhumation avant que cette reconnaissance n'eût été confirmée
par ceux des prisonniers que leur rang rendait les plus
familiers avec le prince. René manda donc aussitôt les deux
Neufchatels, et par suite Bidos alla chercher et amena Philippe
de Neufchastel, son prisonnier. Le duc René « en la chambre
entra le premier. La teste desfula (découvrit). Quand lesdits
seigneurs le veirent, à genouils se mirent. Hélas! vecy nostre
bon maistre et seigneur. » (Chronique de Lorraine, n° 210.) Le
grand bâtard, aussi amené, reconnut pareillement son frère; tous
les doutes étant ainsi dispersés, on s'occupa de procéder à la
pompe funèbre.
Le dimanche 12 janvier, le corps de cet infortuné prince entrait
dans l'église Saint-Georges, porté par quatre comtes et six
autres seigneurs. Le cortège était triste et solennel entre
tous, car, lorsque tous les honneurs eurent été déposés sur le
corps dans la tombe, on ne vit pas cette fois les grands
officiers venir faire leur debvoir selon l'usage, descendre dans
la fosse, en rapporter l'épée et la grande enseigne, et en
l'agitant crier par trois fois : Vive le duc. En effet, avec ce
prince avaient péri, son nom, sa race et sa souveraineté ; avec
lui la Bourgogne était ensevelie dans cette tombe, et la pierre
funèbre se refermait pour toujours sur tous deux.
Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. V, p. 384 et 386. -
Chronique de Lorraine, n° 209, 210. - Bulletin de la Société
d'archéologie, Nancy, 1851, p. 182, 183.
CHAPITRE VII.
Guerre du Luxembourg.
1477 à 1478.
René s'occupa, le même jour
16 février 1477, de régler le sort de ses deux fidèles
serviteurs Bidos et Ménaut d'Aguerre, qui, comme de coutume,
étaient restés près du prince, tandis que Gratien était allé au
loin recommencer la guerre. Le prince accorda à Bidos qui avait
consenti à lui remettre ses deux prisonniers, Antoine de
Bourgogne et Philippe de Neufchastel, non pas dix mille écus
pour l'un d'eux seulement comme le dit Dom Calmet, mais cinq
cents livres de rente sur les salines pour la remise de tous les
deux ; « à laquelle a esté prins, disent les lettres patentes de
René du 16 février 1476 (1477), messire Anthoine, bastart de
Bourgongne, par nostre tréschier et bien amé pennetier, Jannot
l'aubellestrier, lequel depuis, à nostre requeste, à iceluy
messire Anthoine quiété de sa foy et le rendu et délivré en nos
mains. et aussi que semblablement il nous a mis entre mains
messire Phellipe du Nuefchastel. » Bientôt après, Louis XI
pressa avec insistance le duc René de lui remettre Antoine de
Bourgogne qu'il redoutait beaucoup, et le duc de Lorraine, après
de grandes hésitations, n'osa refuser ; il conduisit lui-même
Antoine à Arras, après avoir stipulé les assurances les plus
formelles pour la sécurité du prisonnier qui, du reste, fut
traité avec beaucoup de faveur à la cour de France. Nous verrons
bientôt la suite de cette affaire et nous raconterons les
persécutions dont elle fut l'origine pour Bidos.
L'année suivante, René fit encore don à Jeannot de Bidos des
maison, place, terre et seigneurie de Rémicourt, près de Nancy.
Les lettres patentes délivrées à cette occasion, le 8 avril
1478, font une mention encore plus formelle des services de
Bidos, « en considération des grans, fructueux et aggréables
services que nostre très cher et féal Jehannot de Bidou, nostre
pannetier, nous a par cy devant faiz, résident continuellement
en nostre service, mesmes au recouvrement de nostre duché, où il
s'est vaillamment employé et exposé sa personne en plusieurs
grans périlz et dangiers, sans nous habandonner. »
Peu après, Bidos obtint une charge qui témoigne de la confiance
que le prince avait en lui; il fut nommé capitaine des
cranequiniers ou arbalétriers à cheval de la garde. Nous avons
vu qu'il était pannetier de Lorraine, charge qu'il conserva
pendant plus de trente ans, car son épitaphe lui donne encore le
titre de pannetier du roi de Sicile.
Ainsi que nous l'avons dit, le même jour 16 février, René fit
une autre disposition en faveur de Ménaut d'Aguerre, et lui
concéda des biens qui avaient fait retour au domaine. Ménaut
était à cette époque conseiller, chambellan du duc et capitaine
d'Épinal; il commandait, en outre, une compagnie d'hommes
d'armes au service du duc de Lorraine.
Quant à Gratien d'Aguerre, incapable de rester inactif, il
s'était, aussitôt après la bataille de Nancy, offert pour aller
au pays de Luxembourg tenter des conquêtes sur les Bourguignons.
René convoqua les États, à Épinal, pour délibérer sur la
continuation de la guerre ; les États s'y opposèrent
formellement et le prince parut se ranger à leur avis. Mais
Gratien insista vivement, et, ayant fini par l'emporter, il
partit sur-le-champ pour le Luxembourg avec le titre de
lieutenant général du prince et de capitaine général. Il parvint
rapidement à s'emparer de Louppy, de Chauvency, ainsi que des
villes de Virton et de Damvillers. René engagea à Gratien Louppy
et Virton et toute sa prévôté, pour l'indemniser des dépenses
faites tant pour la prise de ces places que pour l'entretien des
fortifications. Il lui donna, en outre, la seigneurie de
Chauvency et celle de la ville de Damvillers. Dans les lettres
patentes de cette concession, en date du 10 avril 1477, le duc
rappelle de la manière la plus honorable pour Gratien les
services qu'il avait rendus en Espagne et en Lorraine : « Ayant
regart aux grans, notables et laborieux services que nostre très
cher et féal chevaillier messire Gracien de Aguerre a fait à
nostre grant père le roi de Jhérusalem et de Siciles, et à feu
nostre oncle le duc Jehan, duc de Calabre et de Lorraine, en
leurs guerres et emprinses de Cathelongne; lequel depuis en
habandonnant et délaissant les propres pays et lieux de sa
nativité, s'en est venu par deçà pour continuer envers nous sa
bonne loyaulté, incontinent après nostre réception à cestui
nostre duché, où il s'a emploié songneusement, honorablement et
vaillamment, tant à la conduicte de ci noz gens d'armes en noz
guerres et affaires qu'avons eu à l'encontre de feu nostre
oncle, Charles, duc de Bourgogne, comme à la déffence de nostre
ville de Nancy, en laquelle il, avecques autres de nos bons
serviteurs, a esté assiégé par nostredit oncle et tenu ledit
siège en grande extrémité, tant en déffault de vivres comme de
baterie des murailles de nostredite ville, jusques à ce que, à
l'ayde de Dieu, de Nostre Dame et de monsieur sainct Nicolas,
nous avons, à puissance d'armes, levé ledit siège, » Après la
prise de ces différentes places, Gratien allait s'occuper du
siège de Montmédy et il rassemblait des provisions pour cet
objet, lorsqu'une trêve avec les Impériaux, suivie bientôt d'un
traité de paix, assura à la Lorraine les conquêtes qu'il venait
de faire, et mit fin aux hostilités. Il se trouvait ainsi jouir
d'un repos de quelques mois., chose assez rare dans son
existence, et il le mit à profit pour songer à un établissement.
II épousa Madelaine de Castres, fille de Nicolas de Castres et
de Madelaine, dame de Vienne-le-Chatel. René lui témoigna en
cette circonstance « toute son affection en faisant célébrer au
palais ducal même ses noces avec Madelaine de Castres, et en
donnant à cette occasion des joûtes et des tournois. »
Madelaine de Castres avait pour aïeul maternel Henry de Vienne,
fils de Bertrand et petit-fils de Hugues de Vienne, qui vivait
vers 1350. Hugues de Vienne eut pour second fils Jean de Vienne,
seigneur de Pont-Saint-Vincent, près Nancy, dont le fils Nicolas
et le petit-fils Jean Il furent aussi seigneurs de
Pont-Saint-Vincent; ce dernier, bien qu'il possédât cette
seigneurie lorraine, fut tué dans l'armée du duc de Bourgogne,
et Pont-Saint-Vincent, dont nous aurons à reparler, fit retour
au domaine ducal. Ce mariage donnait ainsi à Gratien des
prétentions sur les terres considérables de Vienne-le-Chatel et
de Pont-Saint-Vincent, prétentions dont nous verrons plus tard
les résultats.
Archives de Lorraine. Dom Calmet, Histoire de Lorraine., t. V,
p. 142, 390. - Journal de la Société d'archéologie, Nancy, 1863,
p. 233. - Digot, Histoire de Lorraine, t. III, p. 364, 369. -
Lepage, Commentaires sur la Chronique de Lorraine, p. 85.-
Manuscrits de la Bibliothèque impériale. Recherches sur la
noblesse de Champagne en 1668, au mot Vienne.
CHAPITRE VIII.
Guerre de Gratien d'Aguerre contre la ville de Metz. - Voyage de
Ménaut en Provence et en Italie.
1478 à 1180
Gratien avait fixé sa
résidence et celle de ses troupes dans la ville de Damvillers,
où il se trouvait à même de surveiller ses seigneuries de
Damvillers et de Chauvency, ainsi que ses domaines de Virton et
de Louppy. Ce séjour lui donnait avec la ville de Metz, dont le
commerce s'étendait beaucoup dans le Luxembourg, des rapports
souvent délicats, par suite des plaintes dont l'occasion se
présentait fréquemment entre voisins dans ces temps de désordre.
Dans une affaire de cette nature, Gratien - adressa, le 20
octobre 1478, aux magistrats de la ville de Metz, une lettre qui
a quelque intérêt, parce qu'elle est la seule qu'on possède de
Gratien. Elle commence par ces mots : « Très honorés seigneurs
et bons amis, je me recommande à vous tout ce que je puis ; »
elle finit ainsi : « Et au surplus s'il est chose que pour vous
puisse volontiers et en mon petit pooir le ferai; c'en scet Dieu
notre Seigneur qui vous ait en sa sainte garde. Ecrit au chastel
de Damvillers le 20e jour d'octobre 1478. Gracian Daguerre,
seigneur de Damvillers et lieutenant et capitaine général pour
mon très redouté seigneur Monseigneur le duc de Lorraine es
marches par dessa. Tout votre... » Contresigné Guillaume Drouare,
avec paraphe.
Peu après, il survint un plus grave sujet de querelle. Des
soldats de Gratien s'étaient emparés du château de Pontoy. Ils
étaient douze compagnons de guerre, selon la chronique en vers
des Messins; neuf, selon les lettres d'instruction données par
la cité à ses ambassadeurs près de Louis XI. Les Messins
envoyèrent contre ces soldats une troupe nombreuse qui, après un
premier assaut resté infructueux, fut plus heureuse au second,
tua deux des assiégés, et fit prisonniers les autres qui furent
amenés à Metz et mis à mort.
La cité leur manda brièvement
Qu'ils vuydassent paisiblement ;
Ils répondirent au sergent :
Vous n'êtes pas assez de gens.
Les seigneurs prindrent une bande
De gentils galants belle et grande,
Très tous jeunes galans de prix,
Furent au deuxième assaut prins.
Deux furent tués en la place,
Et les aultres amenés à Metz ;
Si mal s'avaient deffendus,
Que tous dix en furent pendus.
(Chronique de la noble cité de Metz.)
Une patience beaucoup plus grande que celle de Gratien eût été
cette fois mise à l'épreuve ; aussi il n'hésita point à déclarer
la guerre à la ville de Metz, dont la puissance était cependant
formidable. Il lui envoya ses lettres de défi le 24 mars 1479,
et commença aussitôt les hostilités en allant, à la tête de sept
à huit cents hommes, attaquer le val de Metz. Pour se venger de
ces entreprises, les Messins dirigèrent contre lui deux
expéditions dans lesquelles ils n'eurent aucun succès. Leur
récit n'en peut paraître suspect d'exagération en faveur de
Gratien, car elles ne nous sont connues que par les écrivains de
l'opulente cité, Gratien et ses hommes d'armes, qui étaient très
peu clercs, n'ayant pas eu d'historien.
Voici comment le journal de Jehan Aubrion, bourgeois de Metz,
raconte la première de ces entreprises conduite par Philippe de
Raigecourt et Michiel le Gornais, à la tête de deux mille
piétons et deux cent quarante chevaux : « Item, le premier jour
de may, vint le massaigier (de) Gratial de Guerre en la cité,
aporteit lectres aux srs; et demandait responce, et on le fit
hosteller en l'ostel d'un appelez Jehan Husson, en la rue de la
Haie. Et, le lendemain, Jehan Dex, qui estait clerc des septz de
la guerre, par l'ordonnance de ses maistres, comme il disait,
s'en allit vers le dit messagier en l'ostel du dit Jehan Husson
et paiait tout ce que le dit messaigiés avait despendus avec
iiij compaignons qui estoient avec lui de sa conguissance, et
donnait audit messaigiés un florin au chat. Et luy dit qu'il
s'en retournait vers son maistre, et qu'il n'averoit point de
responce par escript, mais qu'il ly dit de bouche qu'il faisint
bonne guerre à la cité, ét qu'il y vienit bien tost veoir, ou
senon, ons l'yrait bien tost veoir luy mesmes. Et tantost le
mercredy après, on mist gens emssamble bien environ ijer et XL
chevalx bien au point, tant des sodiours comme des varlets d'ostel,
et bien ij milles à piedz, tant de la cité comme du Vault, en là
conduite du sr Michel le Gornais et du sr Philippe de Raigecourt,
ambeduit tous deux chevaliers, et qui estoient septz de la
guerre. Et s'en allont sur la nuit et emmenont avec eux xviij
clerz chargiés d'artillerie, d'exuelle, de planches, de pain, de
vin, et d'avoinne ; et s'en allont de bonne tire jusques à
Billay. Et illec séjournont, et envoient ung sr appellé le Hurt
du Lucembourg et les gens le conte de Biche, qui alors estoient
aux gaiges de la cité; et les envoiont jusques devant Damvillers
pour veoir par quelle manière cons y macterait le siège. Et
quand ilz vinrent tous -devant la porte de Damviller, ils
trouvont ung des serviteurs du dit Gracian qui s'en allait à
provision, à tout ung mullet, pour ledit Gracial, et le prinrent
et l'emmenont à Billey, de coste nos srs et nos gens l'interroguairent
du fait de Gratia; lequel leur dit que le dit Gratia estoit fort
sur sa garde et qu'il savait bien leurs venue. Et leurs dit tel
chose que nos srs trouvont en conseille avec leurs gens de
retorner pour cette fois; et s'en revindrent, grace à Dieu! sain
et saulfz, et ramenont y celuy compaignon et le mulet, et encore
ij aultres compaignons qu'ils prinrent au chemin. »
Cette première attaque ayant eu un succès assez médiocre,
puisqu'elle s'était bornée à la prise d'un mulet et de son
conducteur, que leur mauvaise fortune avait mis sur le chemin de
cette armée, les Messins saisirent une occasion plus opportune
peut-être que loyale de se venger de Gratien : « Un des
officiers de l'armée de ce commandant vint secrettement à Metz,
et promit aux gouverneurs de cette ville de lui livrer Gratien.
Ils assemblèrent promptement quatre mille hommes, et se mirent
en campagne : mais quand ils arrivèrent près de Damviller, comme
ils faisaient repaitre leurs troupes, ils furent subitement
attaqués et mis en déroute. » (Dom Calmet, t. V, p. 395.)
Voici comment les Messins racontent cet événement dans leur
Chronique de la noble cité de Metz (Dom Calmet, Preuves, t. III,
p. 317) :
Un nommé Gratian de Gueldre
Contre la cité feit la guerre,
En despitant sans nul mercy,
Vint brusler à Ars et Ancey.
...
De ce seigneur un serviteur
De son armée conducteur,
Vint noncer aux seigneurs de Metz,
Croyez-moi, je vous Je promets.
Que si mon maistre voulez avoir,
Je vous en ferai tel debvoir ;
Venez un jour, au lendemain
Le livrerai entre vos mains.
Une armée hors de la ville
Assemblarent de quatre mil,
Artillerie et charroy devant,
Estendars et bannières au vent.
Quand vinrent près de Dainviller,
Pour toute arrogance éviter,
En faisans un petit repas,
Fut rompu le tour du compas.
Cette guerre se prolongeait ainsi sans résultats décisifs,
lorsqu'il survint entre la Lorraine et la France une
complication qui changea beaucoup la situation de d'Aguerre.
Le duc René II se sentait à la veille de perdre son grand-père
René Ier, duc de Bar, comte de Provence et roi titulaire des
Deux-Siciles, royaume qu'il avait quelque temps occupé. Il
s'agissait pour le duc de s'assurer la succession de son
grand-père et de la défendre contre la cupidité de Louis XI, qui
obsédait de ses intrigues la faiblesse naturelle du vieux roi
René. Pour atteindre ce but, il résolut de partir avec son
fidèle Ménaut d'Aguerre pour la Provence, où il s'aboucherait
avec son aïeul; et, pour donner le change à Louis XI, il lui fit
connaître que son intention était d'aller faire valoir les
prétentions du roi René sur Naples et de reconquérir ce royaume.
Louis XI ne pouvait que gagner à une expédition aussi
aventureuse, et, comme si elle lui eût déjà semblé couronnée de
succès, il a soin, dans sa correspondance, quand il parle de
René, de l'appeler mon cousin le duc de Calabre. Pour lui
montrer sa bonne volonté, il se charge de solder et d'entretenir
une compagnie d'archers de sa garde; il veut qu'on se hâte de
payer une année de solde à l'avance, « et gardez bien qu'il n'y
eût faute, car j'aimerais mieux qu'il demeurât de mes autres
affaires. » Mais, au même instant, et comme il était beaucoup
moins dupe du duc de Lorraine qu'il ne lui convenait de le
paraître, connaissant par expérience les moyens d'influence les
plus efficaces sur le vieux roi toujours besogneux, il
recommanda de lui verser une somme de vingt mille écus.
La bienveillance de Louis XI s'étendit non-seulement sur le duc
de Lorraine, mais encore sur les d'Aguerre, qu'il savait en
crédit à la cour de Lorraine ; aussi, le gouvernement de la
ville de Mouzon étant venu à vaquer en ce moment, par suite du
décès de Louis de Joyeuse, il le donna à Gratien d'Aguerre; et,
en même temps, il s'entremettait entre les Messins et Gratien
pour négocier une trêve qui fut en effet conclue le 20 juillet
1479.
Cependant le duc René était arrivé en Provence avec Ménaut; et,
comme il y prolongeait beaucoup son séjour, il excita
naturellement la défiance de Louis XI, qui parvint à découvrir
que le duc de Lorraine s'était fait remettre par son grand-père
des lettres pour la mise en possession du Barrois. Louis, qui
avait ses créatures à la cour de Provence où il distribuait
largement les pensions, contraignit le vieux roi à révoquer les
avantages qu'il avait faits à son petit-fils. Celui-ci, voyant
dès lors l'impossibilité de lutter contre un pareil adversaire,
résolut de quitter la Provence ; mais, comme il lui importait de
ne pas rentrer en Lorraine par la France et, de plus, d'aller en
Italie pour y nouer des relations qui pourraient être utiles à
ses prétentions sur le royaume de Naples, il s'embarqua à
Marseille, le 25 décembre, pour aller à Venise.
Pendant que Ménaut d'Aguerre était ainsi embarqué avec le duc
René, son frère Gratien se rendait près de Louis XI à Tours, où
se trouvaient également les seigneurs Warry Roncel, Raigecourt
et Dex, ambassadeurs de la ville de Metz, envoyés pour le traité
de paix que les deux parties désiraient conclure sous les
auspices du roi de France. On a encore les instructions données
à cette occasion aux députés de la cité. Le traité fut signé à
Tours, le 26 janvier 1480; en voici le préambule : « Nous les,
maistre échevin, treize jurés, et Conseil de la cité de Metz
d'une part, et je Gratian Daguerre, chevallier, seigneur de
Damvillers, gouverneur de Mouzon, faisons savoir à tous que
comme puis aucun temps en ça à l'occasion d'aucune poursuite ou
querelie que je Gratian Daguerre, dessus nommé, prétendais faire
à ladite cité pour certaines considérations ad ce me mouvant;
lors eusse meu guerre par mes lettres de déffiance entreprise
sur eux en leurs terres et pays, laquelle guerre fut continuée
par l'une partie contre l'autre en exploits en guerre
accoutumés... »
On convint dans le traité de se tenir quitte de part et d'autre
de tous dommages et répétitions. Ainsi se termina, sans aucun
désavantage pour Gratien, cette guerre qui témoigne autant de sa
hardiesse que de sa puissance.
Quant au voyage où son frère Ménaut se trouvait engagé à la
suite du duc René, il n'eut pas lieu sans de grands embarras. La
traversée fut des plus difficiles, et le prince, assailli par
des tempêtes successives, ne put arriver qu'au bout de trois
mois à Venise. Mais là, ses négociations réussirent
complètement. Le 16 avril, il fut déclaré lieutenant général de
la République vénitienne, et il conclut en même temps un traité
d'alliance, par lequel il s'engageait à venir au secours de la
République aussitôt qu'il en serait requis, traité qui amena par
la suite René en Italie. Après ces arrangements, le prince
reprit le chemin de la Lorraine avec Ménaut.
Histoire de Metz, t. VI, p. 206, 228, 401. - Journal de Jehan
Aubrion, p. 95. - Chronique de la noble cité de Metz, t. V,
texte, p. 393. - Dom Calmet, t. III, Preuves, p. 316. - Digot,
Histoire de Lorraine, t. III, p. 365. - Archives de Lorraine.
CHAPITRE IX.
Assemblée des Etats généraux. - Les d'Aguerre quittent la
Lorraine.
1481.
Le duc de Lorraine était
depuis peu de temps de retour de Venise lorsqu'il apprit la mort
de son grand-père le roi René, comte de Provence. Désireux de
faire valoir ses droits sur la succession de son aïeul, et de
tenter une expédition dans ce but, le duc songea naturellement à
Ménaut d'Aguerre et à Jeannot de Bidos, car les seigneurs
lorrains étaient peu soucieux d'une entreprise aussi lointaine,
et d'ailleurs, Ménaut, qui venait de séjourner en Provence,
avait déjà été en relation avec les partisans des Lorrains. D'Aguerre
et Bidos partirent donc pour cette difficile et périlleuse
mission, dans laquelle on devait être aidé par les partisans que
René croyait s'être conciliés en Provence.
Cependant le duc espérait obtenir de ses sujets, faute de
soldats, au moins quelques subsides pour l'aider dans une
entreprise aussi naturelle, car il eût été étrange d'abandonner
des droits si évidents ; il convoqua donc les Etats de Lorraine
pour le 8 août 1481. Mais il fut bientôt constant à l'avance
qu'un violent orage éclaterait contre Gratien, dont les
conquêtes dans le Luxembourg avaient excité la jalousie de la
noblesse. Piqué de voir ainsi reconnaître ses nombreux services,
Gratien abandonna Damvillers et la Lorraine pour aller fixer sa
résidence en France, et, le 6 août, avant-veille du jour de
l'ouverture des Etats, il remit au duc de Lorraine la seigneurie
de Damvillers, la prévôté de Virton ainsi que le château de
Louppy, dans lequel René devait plus tard passer ses dernières
années. En échange de ces terres, le duc de Lorraine concéda à
Gratien, à titre d'engagement, les baronnies, villes et
châtellenies de Rumigny, Aubenton, Watephall, etc., biens que ce
prince possédait en France.
On pouvait espérer que la retraite des d'Aguerre adoucirait les
dispositions des Etats, mais il fut loin d'en être ainsi. Leur
longue réponse fut insolente pour le prince, auquel ils disaient
entr'autres : « Car vous voiez que, parceque vostre revenu va la
pluspart au duire (plaisir), à boire et à manger, vous ne pouvez
trouver argent pour despescher ung ambassadeur pour vos
affaires. Aussy, tous vos conseillers, gentilshommes, officiers,
et bref tous ceulx de vostre maison braient et crient après
vous.... » D'ailleurs, Gratien était désigné aussi clairement
que possible, et la jalousie contre ces conquêtes perçait assez.
Les expéditions qui avaient suivi la bataille de Nancy avaient
été entreprises « par la simulation d'aulcuns qui plus
désiroient leur bien particulier, et qui, par les guerres, se
vouloient faire grands, ainsy qu'ils ont faict..., Vous mistes
gens d'armes en Bourgogne et en Luxembourg... et par la prinse
du Luxembourg, le duçhé de Bar, ou vos gens d'armes vivoient,
fut mis à pauvreté et destruict. » Du reste, on doit peu
s'étonner de l'inimitié que montrait contre un soldat étranger
une noblesse qui respectait aussi peu son propre souverain. En
effet, ce n'était pas seulement Campobasso que les d'Aguerre
retrouvaient à la cour de Nancy, après l'avoir combattu dans les
rangs de l'armée de Charles le Téméraire, c'étaient encore les
Desarmoises (notamment Simonin, grand-maître de l'artillerie de
Lorraine), les d'Haraucourt, Lenoncourt, Dommartin, Toullon, d'Haussonville,
Lucy, Vaudoncourt, Raville et tant d'autres. Leur sympathie pour
Gratien était naturellement assez médiocre, et force était bien
à lui et à son frère de s'exiler de la Lorraine. Certes, il ne
dut pas quitter sans quelque émotion, pour ne plus les revoir,
et le souverain qu'il servait depuis dix ans avec une fidélité
rare en ces temps, et le palais où ce prince lui avait donné
l'hospitalité, comme à l'un de ses proches, pour la célébration
de son mariage, et la ville de Nancy où lui et son frère
s'étaient tant signalés durant les trois sièges, cette ville où,
suivant l'expression du duc René, Gratien avait « supporté et
enduré innumérables misères et adversités pour l'amour de nous.
» (Lettres patentes du 23 décembre 1489.) Et peut-être le prince
lui-même ne se sépara-t-il pas sans quelque regret de cet utile
et fidèle serviteur, dans ce moment où ni l'un ni l'autre ne
pouvaient deviner que le fils de Gratien reviendrait près du
fils de René, lors d'une guerre formidable qui mettrait de
nouveau la Lorraine en péril, et qu'il séjournerait de longues
années dans cette même cour comme le principal ministre de son
souverain.
Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. V, p. 397.- Archives de
Lorraine. - Digot, Histoire de Lorraine, t. nf, p. 369.
CHAPITRE X.
Guerre de Provence.
1481.
On a vu que Ménaut avait
quitté la Lorraine, accompagné de Jeannot de Bidos, pour aller
faire la guerre en Provence; il s'agissait d'enlever ce pays à
Charles, comte du Maine, qui s'en était emparé à la mort du roi
René. Ménaut se rendit en Provence par le Rhône, il dépensa
trente livres tournois pour bateaux et batelliers qui le
menèrent de Chaalons en Bourgongne jusques en Avigon. A son
arrivée en Provence, il fit pour le duc de Lorraine une levée de
soldats à la tête desquels il plaça quatre connétables ; « il
presta en outre à Jannot de Bidos neuf ducas d'or pour l'ayder à
fournir à la soulde des gens qu'il avoit soulz luy, » et avança
pour cette guerre des sommes nombreuses dont il ne put obtenir
le remboursement que quatre ans plus tard. (Lettres patentes du
18 mai 1485.) Il combattit à la prise des villes de Forcalquier
et de Boyon, se signalant comme toujours ainsi que le constatent
ces lettres qui rappellent que Ménaut a fait la guerre de
Prouvence, « où il alla de nostre commandement et ordonnance
lorsque nostre dit sieur du Maine occupait nostredit conté de
Prouvence ; ouquel pays, ledit Ménault, pour la grande affection
et amour qu'il avoit à nous, s'est trouvé et mis plussieurs foiz
en grant péril et danger de sa personne. » L'entreprise
commençait à réussir, mais il survint un concurrent bien
autrement redoutable que Charles, comte du Maine. Ce dernier
était valétudinaire, sans enfant ; on attendait sa fin
prochaine, et Louis XI s'était fait instituer son héritier.
Aussi, après la prise de Forcalquier, Ménaut fut-il très
grandement contrarié de voir arriver Vermandoys, roy d'armes de
Monseigneur le Roy, accompagné de Prouvence, aussy roy d'armes,
intimant défense, au nom dudit seigneur roi, de plus amplement
persister sur cette entreprise au préjudice des droits du très
redouté seigneur et roi. Ménaut regretta peu les six écus d'or
qu'il remit par courtoisie et pour honorer la personne de leur
auguste souverain à chacun de ces deux dignitaires, lesquels
acceptèrent gracieusement et avec bénignité pour se conformer
aux usages et coutumes de leurs fonctions féciales ; mais il lui
était bien autrement pénible d'entrevoir, en présence d'une
intervention aussi formidable, la chute d'une entreprise dont on
avait espéré le succès. Toutefois, il fallut bien s'arrêter, et
ce ne fut pas le seul revers de Ménaut, car bientôt il essuya,
comme nous le voyons par les lettres de René, « la perdition de
ses biens, meubles, artillerie, tapisserie et autres utencilles
d'ostel que nostre feu sieur Charles, à son vivant conte du
Maine, luy print et fist prendre audit pays de Prouvence. »
La fortune était en ce moment bien contraire à Ménaut; il venait
d'éprouver tous ces désastres; d'un autre côté, après ce qui
venait de se passer aux Etats de Lorraine, et peut-être peu
satisfait du manque de fermeté du prince en faveur de ses plus
utiles serviteurs, il ne voulut jamais rentrer dans ce pays,
préférant y laisser en souffrance des intérêts considérables. Il
lui restait, en effet, à poursuivre le remboursement des avances
qu'il venait de faire pour l'expédition de Provence ; il avait
aussi à toucher l'arriéré d'une rente sur les salines de Dieuze,
et à obtenir le remboursement du capital de cette rente. Mais il
aima mieux attendre quatre années, jusqu'au moment où il trouva
l'occasion de joindre en Normandie le duc de Lorraine qui régla
les comptes des sommes dues à Ménaut, auquel il renouvela dans
ses lettres patentes toute la satisfaction de ses nombreux
services. Ménaut était encore à cette époque conseiller et
chambellan du prince; car, ainsi que son frère, même après avoir
abandonné la Lorraine, il conserva une dizaine d'années ce titre
honorifique, bien qu'ils se fussent tous deux défaits de toutes
leurs autres charges.
Louis XI étant mort un an après l'expédition de Provence, Ménaut
entra alors au service de la régente de France, et fut nommé
châtelain, viguier et commandant de Sommières auprès de Nîmes.
Il conserva ces fonctions pendant plus de douze ans, ainsi que
le témoignent ses quittances conservées à la Bibliothèque
impériale, et l'année 1496, date de la dernière de ces
quittances, fut probablement voisine de sa mort. A cette époque,
il était depuis plusieurs années conseiller et chambellan du
roi.
Ménaut d'Aguerre ne laissa qu'une fille, Louise d'Aguerre, qui
épousa Claude Strousse, plus connu sous le nom de Saint-Beaussant.
Archives de Lorraine. - Manuscrits de la Bibliothèque impériale.
CHAPITRE XI.
Duel de Jeannot de Bidos.
1482
Après l'expédition de
Provence, Bidos n'abandonna pas la Lorraine comme les d'Aguerre,
et il cessa de s'associer, ainsi qu'il l'avait toujours fait, à
ses deux anciens compagnons d'armes, qui, du reste, se
trouvaient également séparés l'un de l'autre. Mais s'il fut
impossible à Bidos de prendre pour lui-même le parti
d'accompagner les d'Aguerre, il le prit du moins pour son fils,
qu'il envoya à Rumigny et loin de la Lorraine suivre la fortune
de Gratien. Quant à lui, il se trouva, après le départ des d'Aguerre,
figurer dans un duel que l'histoire de Lorraine a rendu célèbre.
En 1482, Baptiste de Roquelaure, qui avait combattu à la
bataille de Nancy, et qui était passé ensuite au service de
Louis XI, arriva de France et porta plainte au duc de Lorraine,
« demandant par sa requête que Jeannon (Jeannot de Bidos) lui
rendît sa part. et portion de tout ce qu'il avait gagné en cette
bataille (de Nancy), en vertu d'une convention qu'ils avaient
faite entre eux, de se partager par moitié tout le gain qu'ils y
pourraient faire, offrant ledit Roquelaure de prouver ce qu'il
avançait par un combat en champ clos. » Cette demande était
assurément fort étrange, et il était facile de deviner quel en
était le but et quelle en serait l'issue. Roquelaure, après la
bataille de Nancy, avait quitté la Lorraine sans faire aucune
réclamation, et c'était seulement près de six ans après qu'il se
ravisait et venait tout d'un coup faire apparaître, avec un
éclat affecté, une prétention que le bon sens indiquait assez
n'avoir rien de sérieux et n'être qu'une simple et méprisable
avanie; car le duel ne devait pas avoir lieu incontinent et
avant que Roquelaure ne pût se dérober.
Cependant, la noblesse consultée accueillit la demande de
Roquelaure et l'autorisa à provoquer Bidos en duel. Le 10
septembre, en présence du duc, Roquelaure jeta son gant pour
gage de bataille. Alors Bidos se couvrit en face du prince d'un
sien bonnet, « disant audit Roquelaure que faussement et comme
lâche gentilhomme il faisait icelle demande. prenant Dieu,
Notre-Dame et monseigneur saint Georges, avecque son bon droit,
à son aide. » La journée du combat fut assignée à six semaines
plus tard, au 22 octobre. Le but de Roquelaure étant dès lors
atteint, il s'en retourna paisiblement en France.
Avant le jour du combat, le duc fit construire auprès de son
palais un champ à doubles lices avec une tourelle à chacun des
quatre coins pour les rois d'armes.
Le mardi 22 octobre, jour désigné pour le combat, le duc arriva
sur le champ de bataille avec une cour très nombreuse. Puis on
mit au dedans du champ « quatre notables chevaliers, Didier de
Landres, Joffroy de Bassompierre, Philippe de Ragecourt et Jean
de Baude, armez de toutes pièces et la tête couverte par
estoutez, qui firent les serments en tels cas accoutumés. »
Après quoi, Lorraine, héraut d'armes, fit les proclamations
ordonnées.
Vers midi, « Jeannon de Bidotz, monté sur un cheval bardé et
armé de toutes armes, tenant une lance en son poing et ayant
l'épée et la dague ceints et la masse à l'arçon de la selle,
s'en vint présenter à l'entrée des portes dudit champ de cousté
senestre, disant y avoir jour à l'encontre de Baptiste
deRoquelor. » A l'instant le duc René envoya vers lui Hardouin
de la Faille, chevalier, commis en la place du maréchal de
Lorraine, accompagné de deux chevaliers et de Lorraine, héraut
d'armes, ainsi que du secrétaire du duc. Hardouin demanda à
Jeannon « ce qu'il quérait. Bidos requit que la porte du champ
luy fut ouverte et qu'il fut reparty de sa portion dudit champ,
du vent et du souleil, » protestant que si ledit Roquelor, son
ennemi, ne paraissait point, il fut déclaré déchu et exclu de
ses demandes ; « que s'il avait des armes forgées par mauvais
arts, charmes ou invocations, qu'elles luy fussent ôtées. »
Il demandait de plus qu'il pût faire entrer dans le champ avec
lui ses conseillers, son pleige ou garant, et son grand avocat
ou avoué. Hardouin de la Faille alla prendre et rapporter les
ordres du duc; il fit ouvrir le champ à Bidos, qui entra
accompagné de ses conseillers, de son pleige et de son grand
avocat.
A la tête de ses conseillers marchait, témoignage honorable pour
Bidos, le premier personnage de toute la cour par son rang, sa
naissance et sa valeur, le maréchal de Lorraine, comte de Salm,
« nostre cousin Jean, comte de Saulme; » les trois autres
étaient: le sieur de Citain, messire Achille de Beauveau, le
grand Bertrand ; puis messire Henri de Ligniville, sa seureté ou
pleige. Deux de ces conseillers, le maréchal de Lorraine et le
sieur de Citain, s'étaient signalés à la bataille de Nancy.
Pendant que Bidos faisait prisonnier le grand bâtard Antoine de
Bourgogne, le sieur de Citain avait pris, de son côté, Baudoin,
frère d'Antoine. Quant à son pleige ou garant, c'était, comme
nous l'avons vu, Henri de Ligniville, seigneur de Haroué, que la
Chronique cite souvent avec son frère, sous le nom des enfants
de Tantonville. Auquel des seigneurs de la cour Bidos aurait-il
pu mieux s'adresser, pour choisir son pleige, qu'à Ligniville,
le vieux compagnon d'armes de nos Béarnais, avec lesquels il
avait souvent marché à des combats plus sérieux ? Comme les d'Aguerre
et Bidos, Ligniville avait fait partie de l'expédition d'Espagne
; il avait été ensuite l'un des sept qui, partis de Vaudémont,
avaient reconquis tant de places après la prise de Nancy par
Charles le Téméraire. Enfin, avec les d'Aguerre, il avait
combattu à deux des sièges de Nancy, et notamment au dernier, où
nous avons vu qu'il s'était jeté dans la place lors de la
malheureuse affaire du bon maistre d'hostel Chiffron.
Bidos se trouvait donc ainsi dans le champ de bataille avec ses
quatre conseillers et son pleige, et il déclara être venu pour
faire son devoir à l'encontre de Baptiste de Roquelor; mais il
n'y rencontra point son champion. « Après lesquelles choses
ainsi faites et avenues, dit le duc René dans son jugement, en
attendant la venue et présentation dudit Roquelor, comme faire
se devait, attendimes et demeurames en notre siège environ
l'espace d'une heure. » Après quoi « fut ledit Roquelor, cité et
proclamé pour la première fois, à haute voix, par ledit
Lorraine, notre héraut, en trois parties dudit champ ; scavoir
sur les deux portes d'icelui et au milieu, s'il était point
illec pour satisfaire à la journée à lui assignée. » Et comme
Roquelaure n'avait eu garde de se trouver ïllec, on attendit une
autre heure, puis le hérault proclama de nouveau Roquelaure par
trois fois. « Lequel semblablement ne vint, ne comparut; et
derechef attendîmes icelui Roquelor par une autre heure,
espérant qu'il viendrait. » L'heure expirée, vinrent encore
comme ci-dessus de nouvelles criées et proclamations, mais
toujours Roquelaure ne vint ni ne comparut.
Alors Bidos se présenta au duc avec ses conseillers, son pleige
et son grand avocat, et requit que défaut lui fut octroyé contre
Roquelor; or, le souleil était sur le point de se coucher, et il
y avait déjà huit heures que les membres de cette illustre
assemblée « attendaient et demeuraient sur leurs sièges. »
Attendant derechef et toujours « icelui Roquelor par une autre
heure, espérant qu'il viendrait. » Enfin, le duc René prononça
son jugement, déclarant Roquelaure « récréant et déchu de sa
demande,» et condamnant Thierry de Lenoncourt, son pleige, à
satisfaire Bidos, pour tous les dommages par lui encourus à
l'occasion de cette poursuite.
Ainsi se termina cette insigne machination ourdie par Roquelaure
contre Bidos; ainsi se trouvèrent justifiées les paroles de
Bidos lorsque, se couvrant en face du prince et de sa cour, il
dit et déclara à Roquelaure qu'il avait agi « faussement et
comme lâche gentilhomme. »
La famille de Roquelaure était illustre et eut assez de titres
de gloire, puisque le petit neveu de Roquelaure fut maréchal de
France. Aussi, sommes-nous étonnés de voir leur généalogie
imprimée signaler Baptiste comme étant « celui qui fit ce combat
fameux contre Janot de Budos. »
Jugement du duc René, donné par dom Calmet, Histoire de
Lorraine, t. VI. Preuves, p. 280. Moreri, au mot Roquelaure.
CHAPITRE XII.
Dernières années de Jeannot de Bidos.
1483 à 1508.
Gratien d'Aguerre avait,
ainsi que nous l'avons dit, des droits du chef de sa femme,
Madelaine de Castres, dont la mère était dame de Vienne le
Chastel, tant sur la ville de ce nom que sur Pont-Saint-Vincent.
Vienne avait été concédé par le duc René à Ménaut d'Aguerre qui
le rétrocéda à Gratien. Quant à Pont-Saint-Vincent, cette
seigneurie ne se trouvait plus du tout à la convenance de
Gratien, désormais étranger à la Lorraine et fixé en Champagne;
aussi fut-elle concédée par le duc René, et sans nul doute,
grâce à l'intervention de Gratien, à Jeannot de Bidos qui
abandonna Remicourt et fut seigneur de Pont-Saint-Vincent et de
Lorey.
Pont-Saint-Vincent, qui s'est aussi appelé Saint-Vincent,
Port-Saint-Vincent, Pont-à-Saint-Vincent, avait une assez grande
importance due à sa situation, à son commerce et à ses lombards.
A côté de la ville principale, celle de Saint-Vincent, Villa
Sancti Vincentii, ainsi nommée parce qu'elle appartenait à
l'abbaye de Saint-Vincent de Metz, s'élevait celle de Conflans,
au confluent du Madon et de la Moselle, appartenant au comte de
Vaudémont, Villa de Sancto Vincentio et de Conflans. Bien
qu'elle fût alors déchue de son importance commerciale, cette
ville restait toujours un lieu de passage très fréquenté, et
d'un grand intérêt stratégique, comme commandant au loin la
Moselle. Aussi, comme à Mousson, le pont finit par absorber le
nom de la ville qu'il desservait.
Nous devons remarquer à cette occasion que l'historien
Symphorien Champier appelle fort à tort Jeannot de Bidos
monseigneur du Pont, nommé Scamot de Bides.
Jeannot était bien seigneur du Pont-à-Saint-Vincent, comme on
disait alors; mais ni Jeannot, ni son fils ne se qualifièrent
jamais de seigneurs du Pont, appellation réservée au
Pont-à-Mousson, lieu beaucoup plus important. Le titre de
monseigneur du Pont ne se donnait jamais qu'aux princes de
Lorraine, marquis du Pont, qui étaient seigneurs de
Pont-à-Mousson. Aussi les Bidos, loin de porter le nom de sieurs
du Pont, ce qui eût pu faire croire qu'ils cherchaient à se
confondre avec les seigneurs connus sous ce nom, évitèrent au
contraire soigneusement cette appellation pour porter seulement
le nom de Saint-Vincent (1).
Peu après avoir acquis cette seigneurie, Jeannot semble avoir
pris part aux guerres soutenues, en 1489, par Gratien d'Aguerre.
Les circonstances qui portent à le penser sont qu'en cette même
année, Bidos fit à Barbe de Fénétrange un emprunt pour lequel il
engagea Pont-Saint-Vincent, et nous voyons en même temps qu'il
était aussi à cette date remplacé par le comte de Blâmont dans
son office de pannetier au baptême du fils du duc René. Enfin,
on voit qu'en 1489 également, Ménaut, alors gouverneur d'une
place au fond de la Provence pour le roi de France, vint se
joindre à son frère qui paraît avoir eu besoin à cette occasion
de faire appel à tous les siens. Il serait étonnant que Bidos
n'ait point suivi cet exemple, lui qui avait si souvent combattu
avec les d'Aguerre, et dont son fils et ses petits-fils ne
devaient point se séparer. Toutefois, aucune preuve formelle et
directe ne confirme cette supposition, si vraisemblable qu'elle
soit.
Quoi qu'il en soit à cette égard, nous retrouvons encore
aujourd'hui à Pont-Saint-Vincent des souvenirs des dernières
années de Bidos. En 1496, Bidos et sa première femme, Madeleine
de Parspagaire, construisirent dans l'église de
Pont-Saint-Vincent la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié. Dans le
vitrail du milieu, on lit le millésime de 1496; à gauche est le
portrait fort bien conservé de Madeleine de Parspagaire et
au-dessous se trouvent ces mots : J'ay fait ceste chapelle. Dans
le vitrail de gauche, on voit le portrait de Jeannot avec celui
de sa seconde femme, Eusseline de Montjoie, qu'on croit de la
famille de Thuillères, car les Thuillères étaient les seuls en
Lorraine qui portassent le nom de Montjoie.
C'est encore Jeannot qui construisit à la même époque un
ermitage qu'il appela l'ermitage Saint-Vincent ; cette chapelle
est située sur la montagne qui domine Pont-Saint-Vincent, point
duquel on jouit d'une vue aussi gracieuse qu'étendue. Cet
ermitage existe encore aujourd'hui, et il est connu sous le nom
de Sainte-Barbe.
Sans doute que le vieux soldat vint souvent là rêver à sa belle
vallée d'Aspe, à ses montagnes des environs d'Agnos et de Bidos,
à ses souvenirs de guerre, à Ménaut et à Gratien, avec lesquels
il avait si souvent combattu en divers pays, et maintenant
séparés de lui pour toujours.
Par lettres du 27 décembre 1498, Bidos et sa femme, Madelaine
de Parspagaire, fondèrent des offices journaliers et dotèrent
trois chapelains pour le service de la chapelle et de l'ermitage
qu'ils avaient construits.
Jeannot mourut en 1508. On a retrouvé, en 1864, sa pierre
tumulaire brisée en trois fragments remaniés et encastrés dans
le pavé de l'église, à une certaine distance l'un de l'autre.
(Bulletin de la Société d'Archéologie, année 1864.) Ce n'est pas
sans une certaine émotion que l'on peut revoir encore ce
respectable débris d'un passé glorieux et lointain. En effet, le
tombeau du duc René dans l'église des Cordeliers, la pierre
tumulaire de Jeannot à Pont-Saint-Vincent, et dans le vitrail
au-dessus le portrait qui le représente priant à genoux ; tels
sont à peu près les seuls souvenirs qui restent aujourd'hui des
braves combattants de la bataille de Nancy.
Jeannot ne laissa qu'un fils, Jeannot II, dit de Saint-Vincent,
que nous allons retrouver avec Gratien d'Aguerre.
Dom Calmet, Histoire de Lorraine, p. 390. - Notice de la
Lorraine, t. If, p. 182, 186, 234. - Lepage, Communes, t. 1, p.
613; t. II, p. 33. - Mémoires de la Société d'archéologie, 1861,
p. 196. Nancy.
(1) C'est ainsi qu'on disait en
Lorraine Jacques de Saint-Oüen pour Jacques de Parey-Saint-Ouen,
Claude de la Tour pour Claude de Ménil-la-Tour.
CHAPITRE XIII.
Gratien d'Aguerre au siège d'Ivoi. - Seconde guerre de Gratien
contre la ville de Metz. - Campagnes d'Italie.
1489 à 1507.
Nous avons vu qu'en 1481, à
l'occasion de la tenue des Etats, Gratien d'Aguerre avait quitté
la Lorraine. Il vint fixer sa résidence à Rumigny, près de
Rocroi, et devint étranger aux affaires de notre province; aussi
son histoire nous est beaucoup moins connue à partir de cette
époque. Nous savons toutefois qu'en 1486 il assiégea la ville
d'Ivoi, aujourd'hui Carignan, de concert avec Robert de
Florenges (Robert de la Marck), duc de Bouillon et souverain de
Sedan. Leur armée se montait à cinq mille hommes ; Florenges fut
tué à ce siège, ce qui contraignit à abandonner l'entreprise. D'Aguerre
recueillit le corps de son compagnon d'armes et le fit inhumer à
Mouzon, dans l'église de l'abbaye.
Quelques mois après, les Messins se crurent menacés d'une
nouvelle guerre avec Gratien, par suite d'un incident qui est
ainsi raconté par un historien de la cité. « Item, dit le
journal de Jehan Aubrion, le xxer jour de novembre, advint que
sieur François le Gornais et a Jehan de Villers s'en allaient
aux champs ; et quand ils vinrent assis près de la Halte Belvoix,
vindrent gens à chevalx, qui estoient des gens Gracia de Guerre
et cuidait le dit sieur François que ce fuissent ennemis ; par
coy il approchont et se bontont tellement emssamble qu'il y olt
ung des hommes dudit Gracia qui fut tués, et le valet dudit
Jehan de Villers qui fut fort blessiez. Lequel homme mort fut
aportés à Metz, et le lendemain fut enssevelis bien
honnorablement aux Courdeliers sus les murs ; et y vinrent ses
compaignons ausquels on fit très bonne chère ; et s'en rallant
au chiefz de iij jours. Et incontinent après, vindrent nouvelles
que le dit Gracia faisait grant assemblée de gens, par quoi on
doubtoit fort, et fit on fuir lez gens du pays et les
embastonner pour eulx deffendre, se mestier estoit. » (Journal
de Jehan Aubrion.) Il paraît cependant qu'on parvint à arranger
cette affaire, car Gratien resta encore près de deux ans en paix
avec les Messins.
Cependant, en 1489, le duc René ayant déclaré la guerre à la
ville de Metz, Gratien la lui déclara aussi de son côté ; mais
il tint à se conserver dans cette guerre une situation,
indépendante, et ses lettres de défi à la cité, du 16 mars 1489,
portent fièrement qu'il agit pour son fait en chef. Il est
plusieurs fois dénommé dans le traité qui eut lieu entre la
Lorraine et Metz, en 1490, traité dans lequel on lui réserve son
action séparée. Pour le récompenser des services considérables
rendus par lui dans cette guerre, René lui donna les seigneuries
de Valleroy, Moyenville et Bonvillez.
En 1492, au mois de mai, Gratien alla à la tête de cinq cents
piétons et de trois cents cavaliers faire une expédition contre
les impériaux dans le duché de Luxembourg.
En 1495, nous le trouvons conseiller et chambellan du roi de
France, commandant d'une de ses compagnies d'ordonnance.
En 1497, il envoya en Sicile le capitaine Symon, chargé par lui
d'une mission pour le service du roi.
En 1500, les officiers du roi de France, toujours en quête de
domaines à réunir à la Couronne, et dont on put disposer,
contestèrent au duc de Lorraine la propriété de
Vienne-le-Châtel. Mais Gratien, qui avait souvent affaire à
Reims, à cause de sa baronnie de Rumigny, vassale de l'église de
Reims, déterra dans cette ville un certain vieillard, âgé de
quatre-vingt-six ans, Aubert Drouyn, dont il fit recueillir la
déposition. « Le pénultième d'avril 1500; » celui-ci déclara
que, né à Vienne et y ayant demeuré l'espace de soixante-quatre
ans, « il a vu ladite seigneurie de Vienne appartenir au roi de
Sicile, nommé le bon roi René; » suit la nomenclature des
donataires successifs du bon roi René, à la fin desquels
figurent les d'Aguerre. Il est à présumer que si décisifs que
fussent les souvenirs de ce bon vieillard, Aubert Drouyn,
l'influence de Gratien à la cour de France n'aida pas moins à
assoupir ce différend, qui se termina à l'avantage de la
Lorraine et à celui de Gratien.
En 1504, Gratien vit se tenir à Mouzon, dont il était
gouverneur, des conférences pour la paix entre les envoyés de la
France et ceux de l'empereur, sous la présidence du cardinal
d'Amboise, légat du pape, intermédiaire entre les parties. Ces
illustres personnages furent reçus et défrayés avec magnificence
pendant quatre mois dans l'abbaye de Mouzon.
En 1506 et 1507, Gratien prit pour la dernière fois les armes et
fit les campagnes d'Italie au service de la France.
Journal de Jehan Aubrion, bourgeois de Metz, p. 192, 298. -
Histoire de Metz, t. VI, p. 390. - Dom Calmet, Histoire de
Lorraine, t. VI. Preuves, p, 290. - Manuscrits de la
Bibliothèque impériale. - Annales d'Yvois-Carignan et de Mouzon,
par Delahout, 1489 à 1504.- Histoire de Gascogne, par l'abbé
Montlezun, t. VI, p. 148.
CHAPITRE XIV.
Dernières années de Gratien d'Aguerre.
1508 à 1512.
Après quarante ans de
combats, Gratien se décida enfin à goûter pendant le peu de
temps qui lui restait à vivre un repos si chèrement acheté. A la
fois plus habile et plus audacieux que son frère Ménaut et que
Jeannot de Bidos, seul de ces trois combattants partis ensemble
du Béarn, il s'était fait une position considérable. Il était
gouverneur de Mouzon, conseiller et chambellan du roi de France,
commandant d'une de ses compagnies d'ordonnance, baron de
Rumigny, seigneur d'Aubenton, etc. Sa principale résidence était
depuis longtemps à Rumigny, près de Rocroy.
Cependant les fils de ces vieux soldats avaient grandi et
s'étaient mariés Louise d'Aguerre, fille unique de Ménaut, avait
épousé Claude Strousse, qui s'appelait aussi Saint-Beaussant, du
nom de cette seigneurie. Saint-Beaussant, trop éloigné de Ménaut
fixé en Provence, s'était rattaché à la fortune de Gratien. Le
fils de Jeannot de Bidos, qui était connu sous le nom de Jeannot
de Pont-Saint-Vincent ou de Saint-Vincent, avait fait de même,
et était allé se fixer à Rumigny. Ce fut là qu'il épousa Marie
d'Aguerre, fille de Gratien ; ce mariage consolida ainsi l'union
des deux familles, entre lesquelles existaient déjà depuis si
longtemps les liens les plus étroits.
Mais il importait surtout à Gratien de trouver pour son fils
Jean un parti considérable, et mettant celui-ci à même de
continuer et d'augmenter la brillante fortune de son père. Nous
avons dit que, comme baron de Rumigny, Gratien était le vassal
de l'Eglise de Reims; or, Robert de Lenoncourt était abbé de
Saint-Remy, à Reims, et on n'ignorait point ses vues sur
l'archevêché. Cette perspective donna à Gratien l'idée d'une
alliance qui pouvait devenir avantageuse, et il parvint à marier
son fils à Jacquette de Lenoncourt, nièce de Robert.
Après ce mariage, qui alliait son fils à une famille
considérable en Lorraine, Gratien songea un instant à le
rattacher aux affaires de ce pays, auxquelles lui-même tenait
encore par sa seigneurie de Vienne-le-Châtel. Il envoya donc
Jean d'Aguerre aux États de Lorraine du 3 février 1509 (1), qui
proclamèrent la majorité du duc Antoine.
C'était pour la première fois que l'on voyait un d'Aguerre à
Nancy depuis que, trente ans auparavant, les mêmes États avaient
été l'occasion du départ des deux frères d'Aguerre.
Jean est ainsi cité au procès-verbal de la séaace : « Nobles
hommes, Jean de Haracourt, Hardy Tillon et Jean d'Aguerre,
escuyer avec plusieurs autres tant d'église comme séculiers. »
Toutefois, ce ne fut qu'une simple apparition, car il se passa
aussitôt un événement qui changea les perspectives d'ambition de
Gratien, et qui déplaça le centre d'activité de sa maison.
Peu après la tenue des États, Robert de Lenoncourt fut nommé
archevêque de Reims. Il fit son entrée dans cette ville le 21
juillet 1509, accompagné de Robert de la Mark, souverain de
Sedan, de Gratien d'Aguerre, de Jean d'Aguerre, son fils, et de
Henry de Lenoncourt, bailli de Vitry, beau-frère de Jean d'Aguerre.
Gratien n'avait pas perdu de temps pour les agrandissements de
sa famille qu'il avait en vue ; car, lors de cette entrée, Jean
d'Aguerre se trouvait déjà capitaine de la ville de Fismes,
auprès de Reims ; bientôt il allait y amener les siens, comme
son oncle l'archevêque l'y avait amené lui-même, et donner ainsi
à l'Eglise de Reims les défenseurs braves et fidèles dont, à
cette époque de trouble et de désordres, elle avait grand
besoin.
Claude de Saint-Beaussant, qui avait épousé Louise d'Aguerre, se
fixa à Berlize, non loin de Fismes. Jeannot de
Pont-Saint-Vincent, beau-frère de Jean d'Aguerre, se rapprocha
encore plus de lui, et fut baron de Monthassin. Monthassin est
situé entre Fismes et Reims, à une lieue et demie de chacune de
ces deux villes. Jeannot de Monthassin eut deux fils, Bernard et
François de Saint-Vincent, qui furent, le premier, baron de
Monthassin, et le second, seigneur du même lieu.
Trois mois après l'entrée de l'archevêque à Reims, Gratien se
trouve à l'assemblée tenue à Vitry pour la rédaction de la
coutume. C'est le dernier acte connu de lui. Il vivait encore en
1512, mais il était mort en 1515, lorsque Claude de Lorraine
racheta à Jean d'Aguerre la baronnie de Rumigny. Gratien fut
inhumé à Vienne-leChâtel, dans la chapelle de Saint-Thiébault,
ainsi que sa femme Madelaine de Castres. Sur sa tombe, qui est
depuis longtemps détruite, se trouvait une inscription dont
l'histoire de Sainte-Menehould ne nous a conservé que ces mots
qui y étaient gravés : Le bon chevalier sans reproche.
Ainsi s'éteignit Gratien d'Aguerre, qui avait pris ou défendu
tant de villes, livré tant de combats en Espagne, en Lorraine,
au Luxembourg et en Italie. Ambitieux, adroit, et en même temps
audacieux jusqu'à la témérité, toujours fidèle dans un temps où
un grand nombre changeaient aussi souvent que la fortune, il fut
presque toujours heureux, et, parmi tant de luttes souvent
beaucoup trop inégales qu'il entreprit, on ne lui connaît qu'un
seul revers, la levée du siège d'Ivoi. Il laissa après lui plus
d'un titre de gloire, dont -le moindre n'est pas d'avoir son nom
inscrit près de celui de son frère Ménaut pour la défense de
Nancy contre Charles le Téméraire.
Manuscrits de la Bibliothèque impériale.- Dom Calmet, Histoire
de Lorraine, t, Iil, Préface, p. 63; t. V, p. 472; t. VI,
Preuves, p. 356. - Dom Calmet, Notice de la Lorraine, l. I,
supplément, p. 65. - Lepage, Commentaires de la Meurthe, t. II,
p. 447. - Recherches de la noblesse de Champagne en 1668, v.
Ambly et procès-verbal, p. 172. - Histoire de Reims, par Marlot,
t. IV, p. 246. - Procès-verbal de la coutume de Vitry. - Annales
d'Yvoi, par Dehahaut. - Histoire de Sainte-Ménehould, par
Burette, p. 90.
(1) C'est à tort que dom Calmet
donne la date de 1508 au procès-verbal des Etats, t. VI,
Preuves, p. 356, et celle du 13 février au tome V, p. 472.
CHAPITRE XV.
Jean d'Aguerre sous le duc Antoine.
1525 à 1544
Les familles des d'Aguerre
et de Bidos, après être venues ensemble du Béarn en Lorraine, et
avoir quitté la Lorraine presque en même temps, semblaient être
de nouveau réunies et fixées pour toujours en Champagne,
lorsqu'un événement imprévu les rappela en Lorraine, où elles
jouèrent un rôle important.
Le paysans luthériens arrivaient d'Alsace en Lorraine, ravageant
tout sur leur passage, et faisant dans tous les villages
allemands de l'Alsace et de la Lorraine de nouvelles recrues. Le
danger ne pouvait être ni plus grave ni plus pressant; le duc de
Lorraine, Antoine, écrivit, le 3 mai 1525, à son frère le duc de
Guise, gouverneur de la Champagne, le priant devenir en toute
hâte à son secours. Le duc de Guise déféra aussitôt à cette
demande et, le 12, il arriva à Dieuze avec urne armée de huit
mille hommes. Jean d'Aguerre s'y trouvait déjà avec son neveu,
alors très jeune, Bernard de Saint-Vincent, fils de Jeannot de
Monthassin et de Marie d'Aguerre. Jean d'Aguerre commandait une
partie des troupes de Lamark, souverain de Sedan.
La guerre ayant été terminée en quinze jours par la défaite et
la fuite des paysans, Jean d'Aguerre entra au service du duc
Antoine, et il n'eut pas de peine à obtenir que son neveu
Bernard de Saint-Vincent entrât en qualité de page dans la
maison du prince.
D'Aguerre ne tarda pas à jouir de la confiance entière du duc,
confiance qu'il conserva toujours et dont il reçut bientôt une
marque signalée.
Vers 1532, Antoine, qui avait été lui-même élevé à la cour de
France, envoya son fils François, marquis du Pont, alors âgé de
quinze ans, pour plusieurs années, à la cour du roi François
Ier, proche parent et parrain du jeune prince, qui fut «
accompagné d'un bon nombre de gentilshommes et d'officiers pour
le servir. Il (Antoine) lui donna pour gouverneur et
surintendant de sa maison Jean Daguerre, baron de
Vienne-le-Château, fils de Gratien d'Aguerre. » (Dom Calmet, t.
V., p. 633.)
L'élève fit honneur à celui qui était chargé de son éducation,
et François Ier aimait à dire « que son filleul serait un jour
un des plus sages princes de son temps. » Le roi donna une
compagnie de cent hommes d'armes de ses ordonnances au jeune
prince et une autre de cinquante à son gouverneur. De retour en
Lorraine, Jean d'Aguerre fut représenté dans cette compagnie par
son neveu François de Saint-Vincent, qui était resté en
Champagne, et n'avait pas, comme son frère Bernard, suivi Jean
d'Aguerre lors de la guerre des paysans.
François était seigneur de Monthassin, de Lestanne et de
plusieurs autres terres dans la baronnie de Rumigny.
L'éducation du jeune prince étant terminée, il revint à Nancy
avec son gouverneur, en 1539, après avoir passé sept années à la
cour de France. Ce retour fut suivi de promptes faveurs pour d'Aguerre
et pour son neveu Bernard de Saint-Vincent; ils furent faits
tous deux grands officiers de la cour de Lorraine, d'Aguerre
devînt grand chambellan, et Bernard fut presque aussitôt nommé
grand fauconnier de Lorraine. « Bernard de Saint-Vincent, baron
de Monthassin, était grand fauconnier en 1540 (1).» Cette charge
que Bernard remplit pendant trente années lui procurait un accès
facile près du duc Antoine, qui « aimait la chasse et
entretenait une aussi belle vénerie et fauconnerie que prince de
son temps. » (Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. V, p. 548.)
Jacques de Saint-Vincent, petit-fils de Bernard, semble avoir
hérité des goûts cynégétiques de son aïeul, car il devint, au
siècle suivant, grand veneur de l'empereur.
Jean d'Aguerre ne cessa de jouir de la confiance du duc Antoine,
et il eut une influence considérable sur les affaires de la
Lorraine. En 1540, eut lieu le mariage d'Anne de Lorraine avec
le prince d'Orange ; « le duc Antoine nomma pour commissaires à
la passation du contrat Jean, comte de Salm, sieur de Viviers,
maréchal du Barrois, Jean d'Aguerre, baron de Vienne, grand
chambellan, bailly et capitaine de Clermont, etc. » (Dom Calmet,
Histoire de Lorraine, t. V, p. 531.)
Peu après ce mariage, Antoine conclut celui de son fils François
avec Christine de Danemark, nièce de l'empereur Charles-Quint.
Les pouvoirs donnés à ce sujet par le duc sont contresignés : «
Par monseigneur le duc, le baron de Vienne, son grand chambellan
et bailly de Clermont. » (Dom Calmet, Preuves, t. VI, p. 388.)
Le roi François Ier fut mécontent de ce mariage et porta
aussitôt son attention sur un point de la Lorraine qui paraît, à
cette époque, avoir préoccupé beaucoup l'empereur Charles-Quint
et le roi de France, la ville de Stenay. La Lorraine possédait
Stenay, mais sous la mouvance et la suzeraineté de l'empereur;
comme duc de Luxembourg. François Ier, craignant qu'après une
alliance aussi intime du duc Antoine avec l'empereur, celui-ci
n'abusât contre la France de ses droits de suzeraineté sur
Stenay, exigea d'Antoine la cession de cette ville.
Cette cession était pour la Lorraine un pénible sacrifice; d'Aguerre
y était, en outre, personnellement intéressé, puisque Stenay
était également à portée de son bailliage du Clermontois et de
son importante seigneurie de Vienne. Néanmoins, comme il n'y
avait aucun moyen de lutter contre un adversaire aussi
redoutable, force fut bien de se résigner; la cession exigée fut
donc consentie le 25 novembre 1541, et la France se hâta
d'augmenter les fortifications de la place. On fut cependant
heureux d'obtenir que François de Saint-Vincent, neveu de d'Aguerre,
fût nommé, par le roi, gouverneur de Stenay, car cette
nomination assurait le traitement le plus favorable aux
habitants d'une ville dont le duc de Lorraine ne cessa de
poursuivre la restitution qu'il obtint peu d'années après.
Cependant l'influence de Jean d'Aguerre continuait à grandir à
la cour de Lorraine, et l'année 1543 fut l'époque de nouvelles
faveurs, tant pour lui que pour son autre neveu, Bernard de
Saint-Vincent. D'Aguerre devint grand-maître de l'hôtel et
gouverneur de Châtel+sur-Moselle.
D'un autre côté, les domaines de tous deux, en Champagne,
n'étaient nullement à la convenance de leur résidence à la cour
de Nancy; ils songèrent donc à se former dans la même contrée
des domaines composés de terres limitrophes.
Bernard était alors capitaine de Mandres; son mariage fut
convenu avec Marguerite de Saulxure, fille de Mengin de Saulxure
(Mengin Schouel). Peu de jours avant ce mariage, les biens du
sieur de Sampigny, qui avaient fait retour au domaine et qui
étaient situés auprès de Mandres, furent donnés par le duc,
savoir : Sampigny à d'Aguerre, et Jouy à Bernard. Il ne
s'agissait plus que de relier et d'agrandir ces possessions,
c'est ce qui fut fait rapidement. D'Aguerre et Bernard
achetèrent Boncourt et la Petite-Mandres, dont ils furent
coseigneurs; en outre, d'Aguerre acquit Pont-sur-Meuse, et
Bernard acheta de son côté Sorcy, Aulnoy, Vertusey, Fréméréville,
Pargny, Saint-Julien, Broussey, Raulecourt, Rambucourt et partie
d'Apremont, de sorte qu'ils possédaient ainsi entre eux deux une
grande partie du vaste comté d'Apremont.
D'Aguerre occupait alors la première place à la cour : à la fois
grand maître, grand chambellan, bailli et capitaine de Clermont,
gouverneur de Châtel-sur-Moselle et de Hattonchatel, il est, en
outre, désigné dans les lettres du duc Antoine, du 28 novembre
1540, avec la qualité de président de Lorraine; il avait enfin
une compagnie d'ordonnances du roi de France. Il parvint à
établir solidement sa fortune et n'oublia point non plus celle
de ses neveux Bernard et François de Saint-Vincent. Bien
qu'ayant rendu à la Lorraine des services beaucoup moindres que
ceux de Gratien et de Ménaut, il en avait été cependant
récompensé par une bien autre reconnaissance, et se trouvait
depuis longues années dominer dans cette cour, d'où son père et
son oncle avaient dû se bannir. Cependant, le moment approchait
qui allait séparer le prince et celui qui l'avait utilement
servi pendant vingt années.
Le 11 janvier i544, le duc Antoine, malade à Bar-le-Duc et
sentant sa fin prochaine, prit congé des siens et fit son
testament. Dans ce dernier acte, il n'oublia pas celui qu'il
avait toujours honoré de sa confiance. « Nous eslisons et
nommons pour nos bons et loyaux exécuteurs de ce présent notre
testament nos très chers et très améz frères messieurs les
cardinal de Lorraine et duc de Guyse nosdicts enfans, et avec
eulx nos très chers et féaulx conseilliers messires Jehan
Daguerre chevalier baron de Vienne le Chastel, notre grand
maistre et chambellan. » (Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t.
VI ; Preuves, p. 387.) Ce fut avec ce prince, appelé à juste
titre le bon duc Antoine, que finirent les jours de paix et de
prospérité dont la Lorraine avait si longtemps joui sous son
règne.
Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. V, p. 500 à 548, 633. -
Recherches de la noblesse de Champagne, par Caumartin. - Digot,
Histoire de Lorraine, t. IV, p. 88.- Dom Calmet, Histoire de
Lorraine, t. V, Préface, p. 196; tome VI, Preuves, p. 388, 398;
tome VII, Preuves, p. 394. - Notice de la Lorraine, t. II, p.
210, et Supplément, p. 78, 180. - Dénombrement du 20 mai 1626. -
Lepage, Commentaires sur la chronique de la Lorraine, p. 87. -
Nobiliaire de Lorraine au mot Saulxures. - Décret du duc Léopold
du 14 août 1724.
(1) Berman, Dissertation sur
l'ancienne chevalerie. Nancy, 1763.
CHAPITRE XVI.
Jean d'Aguerre sous les ducs François et Charles.
1544 à 1549.
Le nouveau règne s'ouvrait
sous de funèbres auspices. Un mois après la mort de son père, le
duc François perdait son beau-frère, le prince d'Orange,
commandant de l'armée de l'empereur; il fut tué au siège de
Saint-Dizier, sur la frontière même de la Lorraine. Divers
autres contre-temps avaient fait ajourner la pompe solennelle de
l'enterrement du duc Antoine, elle eut enfin lieu le 14 juin
1545, à Nancy.
Lors de cette funèbre cérémonie, lorsque Lorraine, roi d'armes,
après avoir crié par trois fois le duc est mort, appela à haute
voix l'un après l'autre tous les grands officiers de Lorraine, à
commencer par le grand maître, en leur ordonnant de venir faire
leur debvoir, on ne vit point à leur tête s'avancer Jean d'Aguerre
pour « descendre les degrés en grande révérence, et meltre son
bàton dedans la fosse. » Ce fut, au lieu de lui, « Claude
deBeauvau, officiant pour le grand maître à cause que M. le
baron de Vienne, qui estait le grand maître, n'y peut être. »
Ainsi, d'Aguerre avait déserté les restes mortels et la pompe de
son ancien souverain, de son ami non moins que son maître, le
bon duc Antoine, et celui-là seul manquait qui devait tenir la
première place.
Mais, c'est que ce jour même et à cette même heure Jean d'Aguerre
était loin de là et près d'une autre tombe non moins douloureuse
pour lui. Deux jours avant cette cérémonie était mort, à
Remiremont, l'ancien élève de d'Aguerre et son nouveau
souverain, le duc François ; ainsi ce prince avait cessé de
régner et de vivre avant même que la tombe se fût refermée sur
son père.
Et, de plus, le jour même de la mort du duc, il s'était passé
une scène qui dut impressionner d'Aguerre, et aussi avoir une
certaine influence tant sur sa position dans la nouvelle cour
que sur son désir d'y séjourner.
Le 11 juin 1544 avait été fait le testament du duc Antoine, acte
contre-signé par d'Aguerre, nommé l'un des exécuteurs
testamentaires. Et un an après, jour pour jour, le 11 juin 1545,
avait lieu à Remiremont une sorte de testament du duc François,
acte auquel d'Aguerre resta cette fois complètement étranger.
Ce jour-là, à dix heures du matin, alors que le duc, qui mourut
le lendemain, n'avait pas encore reçu l'extrême-onction, la
porte de la chambre, dans laquelle gisait le moribond, s'ouvrit,
et le prince Nicolas, son frère, alors évêque de Metz, entra
accompagné du comte de Salm, maréchal de Lorraine, d'un notaire
apostolique et d'un cortège d'une vingtaine de personnes.
Nicolas, prince qui fut toujours vigilant et avisé pour ses
intérêts, voyait que peu de temps restait à perdre, car il
s'agissait pour lui de s'assurer la régence de la Lorraine qui
revenait de droit à la duchesse, mère du jeune prince encore
enfant. Le maréchal de Lorraine adressa donc au souverain, ainsi
que le constate le procès-verbal du notaire apostolique, « tels
et pareils propos : Monseigneur, s'il plaisait à Dieu vous
appeller, vous entendez que M. de Metz, votre frère, se mesle et
entremette des affaires de messieurs vos enfants et de vos pays
avec madame votre femme, en ratifiant ce que desja en avez dict
et passé en présence de madite dame. »
Le moment n'était pas à de longues harangues entre les deux
frères, aussi la conférence fut courte et laconique : « Sur quoy
ledit seigneur duc a répondu : Ouy ; présent mondit seigneur de
Metz qui a accepté la charge et promis s'en acquitter. » Tout
étant ainsi brièvement terminé par cette seule et unique
syllabe, le notaire continue : « Dont et desquelles choses et
chacune d'icelles dessusdites et proférées respectivement, ledit
sieur comte en a requis et demandé à moi ledit notaire publique,
ung ou plusieurs instruments que lui ay ouctroyé en ceste forme.
»
Peu d'heures après, à une heure de l'après-midi, cette illustre
assemblée, composée desdits prince, maréchal, notaire
apostolique, seigneurs et témoins, se transporta près de la
duchesse, et ce fut cette fois le notaire apostolique qui fut
chargé de la harangue : « Je Nicolas Brisson le jeune, ay leu
intelligiblement de mot en mot l'instrument cy-dessus écrit, à
très haulte, très puissante princesse et dame Mme Chrestienne de
Danne march, et duchesse de Calabre, Lorraine, Bar, etc »
La lecture de l'acte qui la dépouillait de la plus grande partie
de la régence, bien que faite intelligiblement de mot en mot par
ledict Nicolas Brisson le jeune, notaire juré, était une
médiocre consolation en un pareil moment pour cette malheureuse
princesse qui se trouvait perdre dans la même année son mari,
son beau-père et son beau-frère. Elle protesta vivement contre
ce testament assez particulier et qui fut l'occasion de grands
débats. L'envoyé de l'empereur, qui était alors à la cour de
Lorraine, s'explique ainsi sur cette pièce dans sa
correspondance : « certains actes passés assez suspectement.» Il
recommande de faire entendre « audit sieur roy très chrétien le
tort que l'on prétendait à ladite dame par moyens et façons
estranges. »
Trois jours après ces testament, lecture et notification, toute
cette honorable assemblée avait délaissé à Remiremont le corps
du duc qui venait de rendre le dernier soupir, et se trouvait à
Nancy, officiant chacun selon son propre cérémonial à.la pompe
funèbre de l'avant-dernier prince, le duc Antoine. Mais d'Aguerre
ne comparut ni à l'acte testamentaire, ni à sa notification à la
duchesse, ni même, ainsi que nous l'avons déjà dit, à la pompe
funèbre du duc Antoine, car son devoir le retenait près d'une
douleur moins solennelle et pourtant plus profonde.
Peu après cette cérémonie, il y eut nécessité de statuer sur la
régence, affaire qui souleva bien des difficultés. On crut
devoir consulter la noblesse, et la duchesse finit par céder.
Il y eut donc à la fois une régente et un régent. En ce qui
concernait la personne du jeune duc, on s'en tira par un
compromis équivalent ; au lieu de nommer comme toujours un seul
gouverneur, on en nomma quatre, et d'Aguerre fut du nombre. Ce
fut là, sans doute, un simple témoignage d'estime et de respect
pour l'ancien gouverneur du père du jeune duc, car, depuis le
jour de la mort du duc François, d'Aguerre ne prit plus aucune
part aux affaires. On ne le voit pas même à la pompe funèbre du
duc François qui eut lieu un an après la mort du prince, et on
dut le remplacer dans ses offices à cette cérémonie. Mais on y
trouve son neveu, Bernard de Saint-Vincent, qu'on y reconnaît,
bien que déguisé sous ces appellations officielles : « M. le
grand fauconnier, capitaine de Mandres. »
Jean d'Aguerre mourut en 1549, après avoir constamment justifié,
dans les fonctions les plus importantes et les plus variées, la
haute confiance qui lui fut si longtemps accordée.
Il avait eu deux fils : Bertrand d'Aguerre, mort avant son père,
ne laissant qu'une fille, Madeleine, laquelle épousa son cousin
Pierre de Saint-Vincent, à qui elle apporta en dot Grimansart,
acquis en 1486 par Gratien d'Aguerre. L'autre fils de Jean fut
Claude d'Aguerre, dont nous allons parler.
Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. III, p. 543, 639 à 646, et
t. VI, Preuves, p. 403 à 408. - Bulletin de la Société
d'archéologie. Nancy, 1851, p. 143 à 169. - Dénombrement du 11
juillet 1549. - Recherches de la noblesse de Champagne, 1668.
CHAPITRE XVII.
Claude d'Aguerre.
1549 à 1559.
Nous avons eu plaisir à
redire les actes mémorables de Gratien et de Jean d'Aguerre;
mais ici notre tâche devient différente en passant à Claude,
leur fils et petit- fils. On dirait qu'on pressent que ce nom
illustre va bientôt s'éteindre, et son éclat semble baissera
l'avance, peu à peu avant de disparaître en entier.
Claude, gâté par la fortune et par la dissipation qui régnait à
la cour de France, ne fut point pareil à ceux qui l'avaient
précédé. Il venait à peine de perdre son père, qu'étant au
palais du Louvre, il se prit de querelle avec Fendille (Jacques
de Fontaines), d'où une provocation à un combat singulier. Nous
désirons peu nous étendre sur ce duel, et pourtant, cet
événement eut beaucoup trop d'éclat pour pouvoir être simplement
indiqué.
Le roi Henry II « renvoya le différend à Robert de la Marck,
maréchal de France et seigneur souverain de Sedan, qui était
alors à Paris; et le pria d'accorder à Daguerre et à Fendille un
champ de bataille sûr et libre, dans la ville de Sedan, où ils
pussent vuider leur différend par la voye des armes et par un
combat d'homme à homme. » (Don Calmet, t. V, p. 659.) Fendille
s'étant ensuite pourvu au conseil du roi, le jour du combat fut
fixé au 28 mars 1549, « et cet arrêt du conseil privé du roi fut
signifié par un roi d'armes aux parrains des deux champions. »
(Id.) D'Aguerre avait choisi pour son parrain le duc de
Nivernois, et Fendille François de Vendôme, vidame de Chartres.
C'était déjà beaucoup trop que deux souverains, ceux de France
et de Sedan, se trouvassent dans cette querelle, et pourtant un
troisième ne tarda pas à y venir aussi prendre sa part. La
duchesse Christine et le prince Nicolas, régents de Lorraine,
envoyèrent à Sedan une ambassade pour réclamer le jugement du
duel; « le duc de Lorraine, en sa qualité de marchis qu'il a
reprise de l'empereur et de l'empire, ayant de tout tems ce
droit, que tous combats entre la Meuse et le Rhin se doivent
faire par devant lui, et non ailleurs. » (Id.)
Le seigneur de Sedan répondit qu'il avait accepté cette
assignation du champ de bataille « à la prière du roi, qui
depuis lui avait encore écrit une ou deux lettres à ce sujet
qu'il voulait bien leur montrer et non à d'autres ; qu'il était
résolu de soutenir les droits de sa souveraineté, comme avaient
fait ses prédécesseurs, » Sur cela, l'un des envoyés lorrains
protesta contre tout ce qui s'était passé et tout ce qui se
pourrait faire à l'avenir ; « à quoy le seigneur de Sedan
répondit : A qui touche, ce fasse. » Heureusement la duchesse de
Lorraine n'insista pas, car il eût été assez étrange qu'une
guerre éclatât entre ces deux souverains pour savoir où et
comment se battraient d'Aguerre et Fendille.
Le 28 août, au lever du soleil, Daguerre arriva, « conduit par
son parrain et par plusieurs de ses parents et amis, au nombre
de plus de deux cens. Ses habits étaient de ses couleurs, blanc
et incarnat, et il était précédé de trompettes et de tambours
battans... Il envoya l'écusson de ses armes (d'or à trois pies
de sable), qui fut porté par ses gens autour du champ par
dehors, puis le héraut d'armes le planta à la droite de la tente
dudit sieur Daguerre. » Vers sept heures du matin, Fendille se
présenta; « sa compagnie était d'environ trente personnes, et
lui et son parrain étaient vêtus des couleurs de Fendille, qui
était le blanc et le verd. »
A l'extrémité du champ de bataille, on avait préparé un autel, «
couvert de velours violet, bordé de franges d'or, et pendant
jusqu'à terre, sur lequel était un carreau de velours où étaient
posés le livre des Evangiles et la vraie croix, sur lesquelles
les combattants devaient faire le serment. »
Le duc de Nevers, tenant par la main Daguerre armé de toutes
pièces, le conduisit, au son des tambours et des trompettes,
dans le champ de bataille pour y faire son serment.
Après les deux serments et les intimations du héraut d'armes aux
assistants sous la peine de la vie, « le trompette commença à
sonner, et le héraut d'armes cria par trois fois : Laissez-les
aller, laissez-les aller, laissez-les aller les bons combatans.
En même temps les deux champions se levèrent, et, portant les
yeux au ciel, et faisant la révérence en s'inclinant, baisèrent
la croisée de leur épée, puis commencèrent à marcher à grands
pas l'un vers l'autre, portant leur épée de la main gauche. »
Le combat commença aussitôt, et d'Aguerre fut vainqueur, bien
qu'il eût affaire à un adversaire aussi redouté et aussi brave
que lui; « Daguerre lui cria plusieurs fois : Rends-moi mon
honneur, rends-moi mon honneur, Fendille répondit : Je te le
rends de bon coeur, et te tiens pour homme de bien, tel que tu
es. » (Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. V, p, 658 à 664.)
Après ce duel, on n'entend plus parler de Claude, jusqu'au 25
novembre 1558; à cette date, il fut nommé maréchal de la
Lorraine et du Barrois. Il dut nécessairement prendre une part
active et signalée aux guerres nombreuses qui eurent lieu à
cette époque, pour avoir pu conquérir cette haute dignité, dont
l'honneur ne fut point réservé à son père et à son grand-père,
Jean et Gratien, lesquels. pourtant en semblaient plus dignes.
Toutefois les historiens ne nous ont conservé de Claude que le
récit de ses combats singuliers.
Son histoire, ouverte par un duel, était malheureusement
destinée à finir de même.
En 1559, au mois de juillet, le duc de Lorraine accompagnait
dans son voyage de Reims à Paris le roi François II, qui venait
de se faire sacrer. Le cortège traversait le bois de
Villers-Cotterets, lorsque « deux gentilshommes de la cour
prirent querelle, et se battirent en duel. Ces gentilshommes
étaient Claude d'Aguerre, baron de Vienne et maréchal du
Barrois; l'autre était Antoine de Luzelbourg, gentilhomme de la
chambre du duc. Daguerre fut tué, et son corps était encore
étendu a le long du chemin, lorsque le roi passa. Le duc Charles
en demanda vengeance ; mais le roi intervint pour Luzelbourg et
lui accorda grâce. » (Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. V, p.
727.) Il est malheureux pour Claude d'Aguerre d'avoir ainsi deux
fois occupé de ses duels le roi de France et le duc de Lorraine,
et de n'avoir laissé que ces souvenirs dans l'histoire, tandis
que ses pères n'étaient connus de leurs souverains que par les
services qu'ils leur avaient rendus. Cependant, s'il est triste
de voir un maréchal de Lorraine périr sur un tel champ de
bataille, il est juste, néanmoins, de faire la part des temps ;
car nous voyons le comte de Salm, qui remplaça d'Aguerre comme
maréchal de la Lorraine et du Barrois, tuer quelques années
après, en duel, le chevalier des Salles. C'est ainsi qu'il était
dans la destinée de Jean, comte de Salm, et de Gratien d'Aguerre,
qui s'étaient signalés entre tous dans la guerre contre Charles
le Téméraire, que leurs petits-fils à tous deux seraient, l'un
après l'autre, maréchaux de Lorraine, et ne se distingueraient
en cette qualité que par des exploits si dissemblables de ceux
de leurs pères.
Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. I. Préface, p. 267; t. V,
p. 658 à 664, 727 ; t. VII, Préface, p. 194.
CHAPITRE XVIII
Charles et Chrétienne d'Aguerre.
1559 à 1590.
De sa femme, Jeanne de
Hangest, Claude d'Aguerre laissa deux enfants, Charles et
Chrétienne.
Gratien et Jean d'Aguerre avaient fondé l'établissement de leur
maison par les nombreux services qu'ils rendirent à leurs
princes. Mais Chrétienne, qui épousa, en 1572, Antoine de
Blanchefort, devait voir la fortune de son fils Charles
surpasser de beaucoup celle des d'Aguerre, par suite des
nombreux héritages que le hasard accumula sur sa tète.
D'abord, Chrétienne hérita bientôt de son frère, qui mourut
jeune et sans avoir été marié. Ensuite le cardinal de Créquy,
après avoir lui-même recueilli la succession de ses deux frères,
légua tous ses biens à son neveu Antoine de Blanchefort, mari de
Chrétienne, à charge de porter le nom et les armes de Créquy.
Enfin, Chrétienne, après avoir perdu ce premier mari, se remaria
au comte de Sault, qu'elle perdit également, ainsi que le fils
qui était né de ce mariage ; celui-ci légua tous ses biens à sa
mère, et Chrétienne se trouva ainsi transmettre à Charles de
Créquy, son fils du premier lit, l'opulente succession de la
famille de Sault.
Le fils de Chrétienne parvint, tant par suite de tous ces
héritages que par son mérite personnel, à occuper une position
considérable. Il était « sire de Créqui, prince de Poix, duc de
Lesdiguières, pair et maréchal de France, comte de Sault,
lieutenant général des armées du roi et gouverneur du Dauphiné;
il a été l'un des plus célèbres capitaines de son temps. » (Moreri,
v° Gréqui.) De son côté, Chrétienne d'Aguerre conserva toute
l'énergie et toute l'activité de sa race. Elle fut l'un des
partisans les plus dévoués de la Ligue, et le duc de Mayenne lui
adressa plusieurs lettres pour s'entendre avec elle sur les
affaires politiques du temps. Nous lisons dans celle du 22
novembre 1590, à l'occasion de la convocation qu'il venait de
faire des États généraux : « A madame la comtesse de Sault. -
Madame, je sais que vous pouvez et voulez tant pour le bien de
ceste saincte cause au lieu où vous estes. je n'ay vollu fallir
de vous en escrire particulièrement,... vous soyez moyen, comme
je vous en supplie bien humblement, de faire a en la plus grande
diligence qu'il se pourra, députer des personnages dignes et
capables de bonnes affaires pour assister en ceste assemblée et
en tirer moyennant la grace de Dieu, le fruict que nous en
désirons,... ne ferai ceste plus longue que pour vous asseurer
de plus en plus de ma dévotion à vous honorer et servir. Sur
ceste vérité, je vous baise bien humblement les mains, et prie
Dieu, etc. »
Chrétienne continua « à servir activement, en Provence, les
intérêts de la Ligue, et elle appela à son aide « le duc de
Savoie; plus tard, elle se rapprocha de Henry IV. » Nous
ignorons la date de sa mort, car elle disparaît et se trouve
complètement éclipsée par la gloire de son fils Charles de
Créquy.
Nous allons terminer dans les chapitres suivants ce qui concerne
les autres descendants de Gratien d'Aguerre.
Dom Calmet, Notice de Lorraine, t. II, p. 849. - Correspondance
du duc de Mayenne, publiée par MM. Henry et Loriquet.
CHAPITRE XIX.
Descendants de Gratien d'Aguerre par Chrétienne et Madeleine d'Aguerre.
Gratien d'Aguerre laissa
deux enfants : 1° Jean d'Aguerre; 2° Marie d'Aguerre, femme de
Jeannot de Pont-Saint-Vincent, baron de Monthassin.
Nous nous occuperons, dans le présent chapitre, des descendants
de Jean d'Aguerre, et, dans le chapitre suivant, de ceux de sa
soeur Marie d'Aguerre, dame de Saint-Vincent.
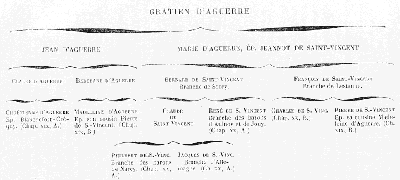
Jean d'Aguerre ne laissa de ses
deux fils, Claude et Bertrand, que deux petites-filles,
Chrétienne d'Aguerre, dame de Blanchefort-Créquy, et Madeleine
d'Aguerre, dame de Saint-Vincent.
Nous parlerons successivement de la descendance de chacune
d'elles.
A. Descendants de Chrétienne d'Aguerre, épouse d'Antoine de
Blanchefort-Créquy.
Nous avons parlé longuement de Chrétienne d'Aguerre; nous avons
vu à quel degré de splendeur fut portée la fortune de son fils,
Charles de Créquy, par suite des héritages inespérés de Charles
d'Aguerre, du cardinal de Créquy et du comte de Sault.
En ce qui concerne la descendance de Chrétienne d'Aguerre, nous
nous bornerons à transcrire ce que dit à ce sujet M. Henri
Lepage, archiviste, etc. (Commentaires sur la Chronique de
Lorraine, p. 88.)
« Chrétienne épousa Antoine de Blanchefort, duc de Créquy, et,
par suite des alliances que leur fils et ses descendants
contractèrent, le roi actuel de Sardaigne, Victor Emmanuel, se
trouve rattaché à la famille du hardi capitaine de René II.
« Cette généalogie m'a semblé assez intéressante pour que j'aie
cru devoir la donner.
« 1° Gratien d'Aguerre, marié à Madelaine de Castres; de ce
mariage :
« 2° Jean d'Aguerre, baron de Vienne, marié à Jacqueline (ou
Jacquette) de Lénoncourt (Moreri, vis Brichanteau, Hangest); de
ce mariage :
« 3° Claude d'Aguerre, baron de Vienne, marié à Jeanne de
Hangest, veuve de Philippe de Maillé- Bresé (Moreri, vis Hangest,
Maillé); de ce mariage :
« 4° Chrétienne d'Aguerre, mariée en novembre 1572 à Antoine de
Blanchefort, sire de Créquy (Moreri, v° Créquy); de ce mariage :
« 5° Charles de Créquy, prince de Poix, duc de Lesdiguières,
pair et maréchal de France, mort le 17 mars 1638, marié, en mars
1595, à Madelaine de Bonne (Moreri, v° Créquy); de ce mariage :
« 6° Madelaine de Créquy, morte le 31 janvier 1675, mariée, en
juillet 1617, à Nicolas de Neufville, duc de Villeroi, pair et
maréchal de France (Moreri, vis Créquy, Neufville); de ce
mariage :
« 7° Catherine de Neufville, mariée, le 7 octobre 1660, à Louis
de Lorraine, comte d'Armagnac, grand écuyer de France (Moreri,
vis Neufville, Lorraine et Atlas historique de Lascases, pl.
22); de ce mariage sont nés quatorze enfants, dont :
« 8° Henri de Lorraine, comte de Brionne, né le 15 novembre
1661, mort le 3 avril 1712, marié, le 23 décembre 1689, à
Marie-Madeleine d'Espinay (Moreri, v° Lorraine, Atlas de
Lascases); de ce mariage :
« 9° Louis de Lorraine, prince de Lambesc, né le 13 février
1692, marié, le 22 mai 1709. à Jeanne-Henriette-Marguerite de
Durfort (Moreri, v° Lorraine, Atlas de Lascases); de ce mariage
:
« 10° Louis-Charles de Lorraine, comte de Brionne, né le 10
septembre 1725, marié à Louise de Rohan-Montauban, mort en 1761
(Atlas de Lascases).
« Il est à remarquer que les enfants de ce prince sont les
derniers princes de la maison de Guise, et les seuls qui aient
conservé le nom de princes de Lorraine, la branche aînée ne
comptant plus que des archiducs d'Autriche. Ces enfants ont été
au nombre de trois, savoir :
« 11° Charles, prince de Lambesc, né en 1754, mort sans
postérité en 1825 (Dictionnaire de Bouillet); - Joseph, prince
de Vaudémont, né en 1759; - Anne de Lorraine-Brionne, mariée à
Victor-Amédée, prince de Savoie-Carignan, mort en 1780 (Atlas de
Lascases); de ce mariage :
« 12° Charles Emmanuel, prince de Carignan, né en 1770, mort en
1800, marié à Marie de Saxe (Atlas de Lascases); de ce mariage :
« 13° Charles-Albert, roi de Sardaigne, né en 1798, marié à
Marie-Thérèse d'Autriche, mort en 1849 (Atlas de Lascases,
Dictionnaire de Bouillet); de ce mariage :
« 14° Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne, né le 14 mars 1820. »
Nous compléterons cette citation en ajoutant que cinq des
archiducs d'Autriche actuellement existants se trouvent
descendre également de Gratien d'A guerre par leur mère,
Marie-Elisabeth, soeur du roi Charles-Albert, cité ci-dessus au
n° 13, et femme de l'archiduc Rénier (Bouillet, Atlas d'histoire
et de géographie).
B. Descendants de Madeleine d'Aguerre, épouse de Pierre de
Saint-Vincent.
Madeleine d'Aguerre épousa son cousin Pierre de Saint-Vincent
(de la branche de Lestanne), déjà lui-même descendant de Gratien
par la fille de ce dernier, comme nous le verrons ci-dessous.
Elle lui apporta en dot la terre de Grimansart. Le 16 décembre
1486, Jean de Custines avait fait vente à « honoré seigneur
messire Gratian Daguerre, chevalier, baron de Rumigny, seigneur
d'Aubenton et de Martigny, gouverneur de Mouzon, de la place
forte, maison, terre et seigneurie de Grimansart, ensemble les
bois, rivières, etc. »
Pierre de Saint-Vincent était gouverneur du marquisat de
Montcornet, gruyer du duché de Rethel; seigneur de Bogny,
Rogissart, Grimansart et du Baila (Ardennes). Son fils François
et son petit-fil Louis lui succédèrent dans sa charge de
gouverneur de Montcornet et dans ses seigneuries. Son
arrière-petit-fils Ferdinand-Louis fut tué, en 1646, au siège de
Dunkerque.
Avec Ferdinand-Louis finit ce rameau de la branche de Lestanne,
branche que nous donnerons plus bas et qui subsiste encore ;
avec lui sortit aussi de la famille la terre de Grimansart, qui
y était restée cent soixante ans.
Recherches de la noblesse de Champagne par devant l'intendant
Callmartin, en 1668. - Titre de la collection Mecquemem.
CHAPITRE XX
Descendants de Gratien d'Aguerre par Marie d'Aguerre et Jeannot
de Saint-Vincent.
Nous avons dit au chapitre
précédent que Jeannot II de Saint-Vincent ou Pont-Saint-Vincent,
fils de Jeannot Ier de Bidos, seigneur de Pont-Saint-Vincent,
épousa Marie d'Aguerre, fille de Gratien, et qu'il en eut deux
fils, Bernard, seigneur de Sorcy, et François, seigneur de
Lestanne. (V. le tableau page 77.) Ces derniers furent les chefs
de deux lignes perpétuées pendant plusieurs siècles.
Nous nous occuperons, dans ce chapitre, d'abord des descendants
de Bernard, et nous parlerons ensuite de ceux de François.
A. Descendants de Bernard de Saint-Vincent, seigneur de Sorcy,
grand fauconnier de Lorraine.
Les descendants de Bernard se divisent en trois branches :
1° Branche des barons de Narcy;
2° Branche d'Allemagne ;
3° Branche des barons d'Aulnois et de Jouy.
Il est à remarquer que, lors des productions faites, en 1668,
par devant l'intendant de Champagne, Caumartin, la branche de
Narcy et celle d'Aulnois firent chacune leur production. Ces
pièces ne sont pas entièrement conformes et servent à se
compléter l'une l'autre. Cette explication est indispensable à
donner, chaque exemplaire de Caumartin ne donnant que l'une des
deux productions, parce qu'on a cru à tort qu'elles faisaient
double emploi comme entièrement identiques.
I.- Branche de Saint-Vincent de Narcy.
1° Jeannot Ier, des seigneurs d'Agnos et de Bidos, seigneur de
Pont-Saint-Vincent, épouse Madeleine de Parspagaire.
2° Jeannot II de Saint-Vincent ou Pont-Saint-Vincent, baron de
Monthassin, épouse Marie d'Aguerre.
3° Bernard de Saint-Vincent, grand fauconnier de Lorraine,
épouse, le 6 août 1543, Marguerite de Saulxures (Marguerite
Shouel) ; meurt en 1570.
Seigneuries : Monthassin (Marne), Sorcy, Aulnois, Jouy,
Fréméréville, etc. (Meuse).
Ces trois premiers degrés sont déjà connusparles détails que
nous en avons donnés dans les chapitres précédents.
4° Claude de Saint-Vincent, mort à Sorcy, le 1er juillet 1609,
épouse, le 7 septembre 1577, Catherine de Toulongeon, morte à
Sorcy, le 13 décembre 1591.
Seigneuries : Sorcy, Goussaincourt (Meuse).
Claude fut gentilhomme de la chambre de Charles II, duc de
Lorraine. Son épitaphe et celle de sa femme se voient dans
l'église de Saint-Martin de Sorcy. Au-dessus de l'épitaphe se
trouvaient les armes des quatre quartiers de Claude, savoir :
D'or, à une vache de gueules, accolée et clarinée de sable; au
canton senestre d'azur chargé d'une croix potencée d'or,
écartelé d'or, à une cloche de gueules, qui est de
Saint-Vincent;
D'or, à trois pies de sable, qui est de d'Aguerre;
Parti en barre, bandé, contrebandé d'or et de sable, de six
pièces, qui est de Saulxures ;
D'azur, au chef de gueules, chargé d'une aigle d'or, qui est de
Clémery.
L'inscription subsiste encore pour la plus grande partie, mais
les armoiries ont été mutilées pendant la Révolution. Elle est
transcrite dans le manuscrit Collot de Saulx telle qu'elle a été
recueillie dans son entier avant la Révolution; elle est aussi
visée dans Caumartin et dans le décret du duc Léopold de 1724.
5° Philbert Ier épouse, le 20 juillet 1603, Claude de Clerget
dame de Narcy.
Seigneuries : Sorcy (Meuse), Narcy (Haute-Marne).
6° Maximilien épouse : 1°, le 15 mars 1626, Antoinette
d'Anglure; 2°, le 28 décembre 1628, Charlotte de Karendeffez.
Seigneuries : Narcy (Haute-Marne), Colombey et Arentières
(Aube).
Cette branche cesse d'être lorraine, et Maximilien passe au
service de la France.
« Lettres patentes de l'année 1635, où le roi donne à Maximilien
le titre de baron de Narcy et le nomme capitaine d'une compagnie
de chevau-légers composée de 90 hommes. » (Décret du duc
Léopold, du 14 août 1724).
« Commission du 11 avril 1636, octroyée à Maximilien de
Saint-Vincent, escuyer, baron de Narcy, commandant une compagnie
de chevau-Iégers pour arrester des cavalliers de sa compagnie
qui l'avaient abandonné. »
7° Philbert II, né de 1626 à 1628, épouse, le 2 juillet 1610,
Elisabeth de Pérignon.
Seigneuries : Narcy, Seigneville (Haute-Marne).
Un acte de tutelle de Charlotte de Saint-Vincent (branche d'Aulnois),
du 5 mars 1672, mentionne parmi les parents, et sans indiquer
les prénoms, « le sieur de Saint-Vincent, baron de Narcy. » Cet
acte doit se référer à Philbert, et non à son fils François, qui
n'avait alors que 21 ans, ni à son père, qui était mort à cette
époque, car on lit dans des titres des 6 février 1657 et 6 juin
1660 : « Défunt Maximilien de Saint-Vincent, baron de Narcy. »
8° François, né en 1651, épouse, en 1696, Marguerite de Rang.
Seigneuries : Narcy (Haute-Marne), Bisping et Gogney (Meurthe).
François revint au service des ducs de Lorraine, que ses pères
avaient abandonné pour prendre celui du roi de France; car le
décret du duc Léopold, du 14 août 1724, le qualifie « François
de Saint-Vincent, baron de Saint-Vincent, lieutenant-colonel au
régiment de Forsal et sous-lieutenant des chevau-Iégers de nos
gardes demeurant à Blâmont. »
Il conservait encore ces dernières fonctions à l'âge de 70 ans,
comme on le voit par les lettres patentes du 12 mars 1720 :
« Léopold. veu par nostre chambre des comptes de Lorraine la
requeste à elle présentée par le sieur François de
Saint-Vincent, baron de Narcisse, sous-lieutenant des
chevau-légers de nostre garde. »
9° Jacques-François, né le 27 août 1699, à Blâmont, épouse Barbe
de Beurges; il vivait encore en 1773, et mourut peu après à
Bar-le-Duc.
Il ne laissa point de postérité.
II. - Branche d'Allemagne.
1° Jeannot Ier.
2° Jeannot Il.
3° Bernard.
4° Claude.
Ces quatre premiers degrés sont communs avec la branche de Narcy,
dont nous venons de parler, et ils y sont détaillés.
5° Jacques épouse Marie-Barbe de Léonroden.
Seigneurie : Sorcy (Meuse).
Jacques prit du service en Allemagne, où il devint « grand
veneur de l'Estat de S. M. Impérialle et de l'archiduc Léopold,
» ainsi que l'indique un dénombrement du 20 mai 1626, pour Sorcy
et Saint-Martin.
6° François épouse Marie-Françoise de Remchingen.
Seigneuries : Sorcy (Meuse), Pâlmershausen sur le Danube.
Dénombre pour Sorcy en 1666.
7° Charles Joseph, ainsi dénommé dans le décret du duc Léopold :
« Léopold, duc de Lorraine, etc., savoir faisons que sur la
requeste présentée en notre Conseil par messire Joseph, baron de
Saint-Vincent, trésorier de l'Électeur Palatin, conseiller
d'État de l'Ordre teutonique et gouverneur de Thannbourg. »
On n'a plus de documents authentiques sur cette branche qui
paraît s'être éteinte vers 1780.
III. - Branche des barons d'Aulnoy et de Jouy.
La production de 1668 de la branche de Narcy ne donne pas cette
branche, mais la production de la branche d'Aulnoy la détaille
sous cette rubrique : « Barons d'Aunoy et de Jouy. »
1° Jeannot Ier.
2° Jeannot II.
3° Bernard.
Ces trois premiers degrés sont communs avec la branche de Narcy
et ils y ont été détaillés.
4° René Ier épouse, en 1579, Madelène de Roucy.
Seigneuries : Aulnoy, Vertusey, Jouy (Meuse)..
5° Daniel épouse, en 1609, Anne de Ficquelmont.
Seigneuries : Jouy (Meuse).
Son frère, René II, seigneur d'Aulnoy, chambellan d'Henry, duc
de Lorraine, meurt sans enfant de Gabrielle de Stainville, son
épouse.
6° Charles, lieutenant-colonel du régiment du Chastelet, marié,
en 1655, à Elisabeth de Cicon, ne laisse qu'une fille, Charlotte
de Saint-Vincent, dite Mlle de Jouy, comme seule héritière du
baron de Jouy.
Seigneuries : Jouy (Meuse).
Claude, son frère, épouse, en 1649, Catherine-Philiberte de
Joyeuse, et meurt, à Aulnoy, en août 1653.
Seigneuries : Aulnoy, Vertusey (Meuse).
Moreri et le père Anselme le mentionnent en ces termes : «
Catherine-Philiberte, alliée à Claude de Saint-Vincent, baron d'Aulnois.
» Et on y voit que Catherine était soeur du marquis de Joyeuse,
maréchal de France, gouverneur de Nancy et des trois évêchés.
Son cousin, Anne de Joyeuse, était beau-frère du roi de France
Henri III.
Dans la généalogie de la famille de Joyeuse, on relate le titre
suivant : « Partage du 14 avril 1655 entre haut et puissant
seigneur Charles-François de Joyeuse, chevalier, comte de
Grandpré, etc., et CatherinePhiliberte de Joyeuse, veuve de haut
et puissant sei neur Claude de Saint-Vincent, chevalier et baron
« d'Aulnois, ses frère et soeur. »
7° Charles II, fils de Claude et de Catherine de Joyeuse,
semblait appelé par le crédit de sa famille maternelle à un
brillant avenir, mais il mourut à Aulnoy, le 17 mai 1662, encore
jeune et non marié.
Charles ne nous est connu que par son épitaphe que sa mère avait
fait faire au-dessous de celle de son mari, en ces termes : «
Mme Catherine de Joyeuse, sa veuve, lui a fait dresser cette
épitaphe : Pleurez, passants, et priez avec elle et ne vous fiez
pas à la mort, et le 17 mai de l'an 1662 est arrivé la mort à
Charles de Saint- Vincent, baron et seigneur desdits lieux, fils
audit défunt. Priez Dieu pour leurs âmes. »
Avec Charles s'éteignit cette branche qui avait duré
quatre-vingt-douze ans, en quatre générations, depuis la mort de
Bernard, le grand fauconnier.
B. Descendants de François de Saint-Vincent, seigneur de
Lestanne. (Voir le tableau, p. 77.)
1° Jeannot Ier.
2° Jeannot II.
Ces deux premiers degrés antérieurs à François sont communs avec
les descendants de Bernard et ont été détaillés ci-dessus.
3° François, dont nous avons parlé au chapitre XV, épouse
Jacquette de Vaillant.
Seigneuries : Monthassin (Marne), Lestanne, Clavy, Watephall,
Baulgny et la Folye (Ardennes).
Son fils puîné, Pierre de Saint-Vincent, gouverneur de
Montcornet, épousa sa cousine Madeleine d'Aguerre, et nous en
avons parlé au chapitre précédent par suite de cette alliance.
L'aîné des fils de François de Saint-Vincent et de Jacquette de
Vaillant fut :
4° Charles, marié à Nicole de La Fontaine.
Seigneuries : Monthassin (Marne), Lestanne, Vincy, Neufvisy
(Ardennes).
Neufvisy resta dans la famille pendant plusieurs générations. On
doit remarquer, comme singularité historique, que les seigneurs
de Neufvisy étaient au nombre des quatre barons de la
Sainte-Ampoule.
5° Hubert, marié à Guillemette des Laires.
Seigneuries : Lestanne, Vincy, Neufvisy (Ardennes).
Son frère puîné, Jean Ier, alla en Allemagne et y devint colonel
au service de l'empereur; il fut tué dans une bataille contre
les Turcs. A la même époque, son proche parent, Jacques de
Saint-Vincent, de la branche de Sorcy, dont nous avons parlé
ci-dessus, était grand veneur de l'empereur.
Robert, frère des deux précédents, fut tué au siège de
Montbelliard.
6° Jean II, lieutenant-colonel du régiment de Hauregard, premier
capitaine et commandant dans Stenay, né à Lestanne, en 1594, fut
marié quatre fois : 1° à Jeanne de Vïllelongue, le 28 avril
1625; 2° à Antoinette de Mouzay; 3° à Marguerite d'Assy; 4° à
Marguerite de Bigony; il mourut à Lestanne, le 1er septembre
1664.
Seigneuries : Lestanne, Vincy, Neufvisy (Ardennes).
7° Jean III, issu du premier mariage de Jean Ier, épouse
Marguerite de Maucourt.
Seigneuries : Lestanne, Vincy, Neufvisy (Ardennes) et Murvaux
(Meuse).
8° Jean IV, né en 1651, épouse 7 le 23 mai 1684, à Stenay,
Jeanne-Marguerite de Tassigny; meurt à Murvaux, le 5 août 1735.
Seigneurie : Murvaux (Meuse).
9° Gabriel, né à Murvaux, en 1685, mort à Murvaux, le 7 décembre
1748; il épousa Geneviève Lefaucheux, morte à Murvaux, le 24
juin 1756.
Seigneurie : Murvaux (Meuse).
Il laissa deux fils, Antoine et Jacques-François, lesquels
forment deux branches.
10° Branche aînée : Antoine-Charles, né à Murvaux, le 30
novembre 1731, épouse Anne-Catherine de Granfèvre, morte à
Luxembourg, le 7 juillet 1794.
Il eut deux fils :
11° Charles-Louis, né à Murvaux, mort à Lachalade.
Le baron Charles-Louis de Saint-Vincent a été maire de Lachalade
; il y est mort sans postérité.
Il eut pour frère :
Jacques-François-Xavier, qui épousa la baronne de Beyerwelk.
Pendant l'émigration, il prit du service en Autriche, et il est
ainsi mentionné au Moniteur du 22 mars 1806 : « M. le baron de
Saint-Vincent, général-major au service d'Autriche, a été
présenté à l'empereur et lui a remis une lettre de son
souverain, » Il avait été, en même temps que l'empereur
Napoléon, élève de l'école de Brienne ; c'est ce qui explique
cette mission, malgré sa qualité d'émigré. Aux offres
bienveillantes que lui fit Napoléon de prendre du service en
France, il témoigna son vif regret de ne pouvoir accepter, ne
voulant point abandonner le service d'un souverain qui l'avait
accueilli dans l'infortune.
Il ne laissa que deux filles : 1° Marie-Joséphine, née à
Troeplitz, le 21 juillet 1805, d'abord chanoinesse titulaire de
Munich, puis mariée au comte de Mirbach; 2° Rose-Marie, née à
Troeplitz, le 18 mai 1808, d'abord chanoinesse titulaire de
Prague, qui épousa le général comte Kaminski, chambellan de
l'empereur.
Cette branche n'a plus ainsi de représentant mâle.
10° Branche puînée.
Jacques-François, né à Murvaux, le 8 juillet 1740, mort à Nancy
en 1821, épouse, le 13 février 1770, à Aubreville,
Magdeleine-Jeanne de Lisle de Moncel, morte à Nancy, le 16
décembre 1815.
Seigneuries : Courcelles, Moncel, Parois, Aubreville (Meuse), la
Caussade (Gironde).
Nous nous étendrons quelque peu sur lui, parce qu'il fut le
dernier des siens qui mena cette existence simple et
patriarcale, laquelle avait été constamment celle de ses pères
pendant plusieurs siècles. Comme eux, entièrement étranger à la
cour et au séjour des villes, il se partageait entre la
profession des armes, qui fut la sienne comme celle de tous les
siens, et la culture de ses domaines, le commerce de sa famille
et les devoirs d'une vive et sincère piété.
A la Révolution, il émigra, et toutes ses terres furent
confisquées. Le roi Louis XVIII lui accorda, pendant
l'émigration, plusieurs distinctions, et le nomma notamment
colonel à Mittau. Sous la Restauration, le roi n'oublia pas le
vieux serviteur qu'il avait distingué pendant l'exil et lui
donna, outre une pension de retraite et diverses grâces pour ses
proches, une pension sur la liste civile et une autre sur la
caisse des chevaliers de Saint-Louis.
Ses fils, François et Philippe, périrent tous deux à l'âge de
vingt-cinq ans dans les guerres de l'Empire; François fut tué à
la bataille d'Austerlitz, et Philippe, dont nous allons parler,
en Italie.
Au retour de l'émigration, le baron François de Saint-Vincent
vint demeurer à Nancy, et il supporta avec un rare courage les
afflictions profondes que la fortune accumula sur sa tête. Quant
à la perte de son ancienne opulence, soit fierté permise au
malheur, soit par l'effet d'une piété qui fut exemplaire dans
tout le cours de sa vie, ce désastre ne sembla point compter au
nombre de ses malheurs. Pendant de longues années, personne ne
surprit de lui, à ce sujet, une seule plainte, un seul regret.
Sa branche avait toujours habité Lestanne ou Murvaux, et, par un
jeu de la fortune, ce descendant de Gratien d'Aguerre et de
Bidos s'en revint, après la ruine de sa race, mourir pauvre et
ignoré à Nancy, dans la ville que les siens avaient sauvée.
11° Philippe Ier, Marie-Louis, né à Parois, le 30 juin 1783,
mort le 11 octobre 1808, épousa Anne-Charlotte de Romécourt.
Il était lieutenant au régiment d'Isembourg et fut tué, ainsi
que nous l'avons dit, à l'âge de vingt-cinq ans, à la prise
d'assaut du fort de Capri.
Cette place passait pour imprenable, et ce hardi fait d'armes
fit le plus grand honneur au général Lamarque.
L'île était défendue par sir Hudson Lowe, depuis si tristement
célèbre comme gouverneur de Sainte-Hélène pendant la captivité
de Napoléon.
La mort de Marie-Philippe 1er de Saint-Vincent est citée au
Moniteur du 22 novembre 1808.
Il eut pour fils :
12° Philippe II, Hyacinthe, né à Bar-le-Duc, le 16 juin 1807,
marié à Anna de Villers.
Et pour petit-fils :
13° Philippe III, Eugène-Savina, né à Metz, le 1er octobre 1843.
Caumartin, Recherches sur la noblesse de Champagne en 1668 (Vis
Ambly Joyeuse, Minette, etc.). - Manuscrit Collot de Sault. -
Décret du duc Léopold, du 14 août 1724. - Arrêt de la chambre
des comptes de Lorraine, du 12 mars 1720. - Actes de l'état
civil de : Blâmont, 1699; Lestanne, 1664; Murvaux, 1730 à 1756;
Aubreville, 1770; Parois, 1783; Bar-le-Duc, 1807; Nancy, 1815,
1821; Metz, 1843. - Archives de Lorraine, Moreri, t. III, p.
692. - Moniteur du 22 mars 1806 - Idem, année 1808, page 1237. |













