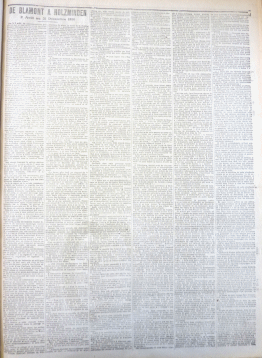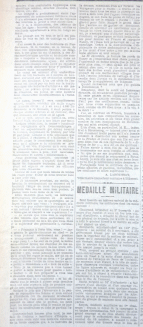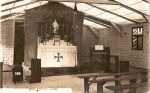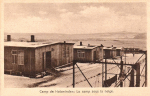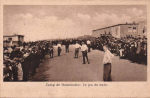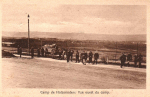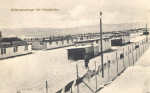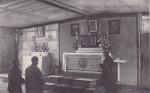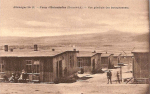|
DE BLAMONT A HOLZMINDEN
2 août au 31 décembre 1914
Dès le 2 août, les
communications postales et par voie ferrée ayant été
interrompue, Blâmont fut à peu près complètement isolé du reste
de la France.
Jusqu'au 4 nous ne vîmes que quelques patrouilles françaises
venant explorer la frontière et demander des renseignements aux
douaniers qui, seuls, la surveillaient.
Le 4,au coin d'une rue, je me trouvais brusquement en face d'un
petit détachement de uhlans dont l'un me salua d'un joyeux : «
Bonjour monsieur le vétérinaire » tandis que le sous-officier
m'interpellait d'un « Ca va bien ? » narquois. Je reconnu dans
le premier un mitron qui avait travaillé pendant plus d'un an
chez l'un de nos boulangers blâmontais ; le second était
cultivateur à Landange; ils interpellèrent ainsi tous ceux de
mes concitoyens qu'ils rencontrèrent dans les rues de Blâmont,
et nous sûmes qu'ils appartenaient au 10e régiment de uhlans de
Sarrebourg, lequel formait avec le 11e un corps spécial
d'éclaireurs connaissant à fond tous les coins de notre région
frontière et parlant couramment le français. Cette patrouille,
arrivée par la vieille route de Sarrebourg, repartant sans avoir
tiré un seul coup de feu et sans avoir molesté aucun des
habitants.
Le lendemain, nouvelle apparition de cinq uhlans du 11e
régiment, qui, surprirent en montant derrière le cimetière deux
de nos chasseurs à cheval postés en vedette à la bordure du bois
de Trion. Ils tuèrent le brigadier non sans avoir essuyé le feu
de celui-ci qui, d'un coup de carabine, leur foudroya un homme ;
puis ils dévalèrent au grand galop vers la ville, poursuivis par
notre intrépide chasseur, qui, les rejoignant, abattit à son
tour un uhlan et avança sur l'officier. Au moment où il allait
embrocher celui-ci, notre brave, désarçonné par une brusque
glissade de son cheval sur les pavés, tomba sur le sol et fut
aussi blessé lui-même par un des allemands qui s'était retourné
au fracas de la chute. A ce moment, le bruit d'une chevauchée
s'étant fait entendre, le détachement ennemi s'enfuit à toute
vitesse, croyant à une arrivée de nouveaux cavaliers français.
En réalité, il ne s'agissait que d'un seul cheval : celui du
brigadier tué qui revenait, d'instinct, rejoindre les chevaux au
peloton. Et, ce jour-là, nous eûmes à Blâmont l'écoeurant
spectacle d'une patrouille allemande fuyant éperdue devant un
seul et unique coursier sans cavalier.
Les deux héroïques chasseurs à cheval appartenaient au 4e
régiment, d'Epinal. Par une douloureuse coïncidence, le
brigadier était Gérômois et fils d'une famille amie de la mienne
: il se nommait Simon.
Le sang ayant ainsi coulé à Blâmont, dans ce premier combat
entre Français et Allemands, nous vîmes chaque jour, jusqu'au 8,
semblables escarmouches et pareils faits d'héroïsme soit dans
les rues de notre ville, soit dans les jardins et nos vergers
des alentours. Les blessés commencèrent à affluer à l'hôpital
municipal et à l'ambulance de la Croix-Rouge où tout était
préparé avec le matériel nécessaire.
Seul chargé d'assurer le service médical à ce moment - puisque
dès le 1er août nos deux médecins et le pharmacien avaient été
mobilisés, - je considère comme un devoir de rendre un éclatant
hommage à Mme René Florentin, présidente de la Croix-Rouge à
Blâmont.
Par son zèle, par son dévouement, par son activité, elle fut
l'âme de nos ambulances en cette période tragique des trois
semaines d'août.
Le 8, le régime de terreur commença à régner sur Blâmont. Ce
jour-là, les hordes teutonnes firent irruption et nous vîmes
passer dans les rues des milliers et des milliers d'hommes,
infanterie, cavalerie, artillerie, ils défilaient en rangs
compacts, coude à coude, hurlant à pleine voix le « Wacht am
Rheim » et deux autres refrains dont l'un rengainait sans cesse
: « Nous irons manger la soupe à Paris ! ».
Une demi-heure après l'apparition de la première tête de
colonne, un groupe de cavaliers se précipite sur M. et Mlle
Cuny, qui moissonnaient à la montée de Barbas.
Sans mot dire, le sous-officier qui tenait la tête déchargea à
bout portant sa carabine dans la poitrine de la jeune fille
qu'il étendit à ses pieds : « un Français de moins ! » cria
l'assassin en tournant bride avec ses hommes.
Le 9 août, toutes les maisons étaient envahies et les habitants
submergés durent se plier à toutes les exigences et toutes les
brutalités : les brutes qui venaient d'arriver avaient fourni
une étape forcée de 70 kilomètres, par une chaleur caniculaire
et c'est le pistolet ou le fusil contre la tempe qu'ils nous
sommèrent d'ouvrir nos caves et nos garde-manger ; c'est à coup
de crosse dans les reins qu'ils se firent montrer tous les coins
et recoins de nos habitation pour s'assurer qu'aucune arme,
qu'aucun piège, qu'aucun soldat français n'y étaient dissimulés.
Les rares Blâmontais qui osèrent encore circuler dans les rues
purent voir les cafés mis au pillage par des ivrognes casqués
qui buvaient « à la régalade » les litres d'eau-de-vie,
d'apéritifs, de liqueurs et d'absinthe.
Le résultat de ces beuveries ne se fit pas attendre : le soir
venu, un coup de feu éclata qui fut suivi jusqu'à une hure assez
avancée d'une fusillade terrifiante.
Tous les soirs, à la tombée du jour, les mêmes scènes se
renouvelèrent : un coup de feu partait d'un coin quelconque,
suivi de feux de salve qui faisaient voler les vitres en éclats,
brisaient les volets et écaillaient les murailles.
Terrifiés, mais ne comprenant rien à ce gaspillage de
cartouches, tous nos concitoyens se demandaient à quels mobiles
pouvaient bien obéir ces sauvages ; nous fîmes fixés dès le
matin du 10 par les menaces qui nous furent adressées : « Les
habitants de Blâmont, tous francs-tireurs, tous brigands. Ils
tirent sur nous, nous les punirons s'ils continuent » nous
criaient officiers et soldats.
Dans la soirée du 8, en allant constater l'état du cadavre de la
pauvre petite Cuny, je fus saisis par une bande de cinq
officiers supérieurs qui, m'appliquant le canon de leurs
pistolets automatiques sur la figure, me conduisirent chez notre
honorable maire M. Bentz, qu'ils sommèrent de les suivre ;
encadrés de nos gardes du corps, nous dûmes parcourir les rue en
criant aux habitants : « Il est ordonné d'ouvrir les portes,
d'éclairer les fenêtres sous peine de mort ! ».
Cette mesure et cette menace furent maintenues pendant toute la
période de première occupation.
Et soutenus par leurs chefs, les soldats teutons continuèrent
leur déprédations et leurs libations, devenant d'heures en
heures plus furieux et plus menaçants.
Le prince de Bavière, commandant en chef du 1er corps bavarois,
s'était installé au château de l'industriel Burrhus - fabricant
de chocolat et sujet suisse - dont il vidait consciencieusement
la cave avec son état-major.
Afin d'éviter le pillage et la destruction de son usine, M.
Burrhus avait mis à la disposition du général pour être
distribués aux troupes, plusieurs milliers de kilogrammes de
sucre, de cacao et de chocolat fabriqué. Le « gentilhomme »
bavarois sut reconnaître cette libéralité en laissant saccager
et incendier la chocolaterie à laquelle ses soldats mirent le
feu le 12 août. Son hôte ayant véhémentement protesté, le «
brave » général le menaça du peloton d'exécution. La menace
n'intimida en aucune façon M. Burrhus : invoquant le respect du
droit des gens, proclamant sa nationalité il riposta en menaçant
son interlocuteur princier d'une plainte au gouvernement
helvétique et en l'informant qu'il allait hisser le drapeau
fédéral sur sa propriété. Il est à supposer que l'opinion des
Suisses préoccupe les « intellectuels » allemands, car le prince
baissa le ton et ne renouvela pas ses menaces envers M. Burrhus.
A l'heure où flambait la chocolaterie, les sauvages ivres
recommencèrent leur fusillade dans toutes les rues.
M. François, négociant en vin, rue des Capucins, ayant à loger
deux officiers supérieurs, ceux-ci ne trouvèrent rien de mieux
pour se distraire ce soit là que d'inviter une demi-douzaine de
leurs « kamarades » à venir vider la cave de M. François.
Celui-ci, obligé de leur servir d'amphitryon, remplissait leurs
verres de vins variés lorsque dans la rue, commença la fusillade
quotidienne. Un carreau ayant volé en éclats à l'une des
fenêtres, le maître de la maison se précipita d'instinct dehors
: la porte s'ouvrait à peine qu'il était empoigné et entraîné à
coups de crosse.
« C'est toi qui a tiré - lui crièrent ses agresseurs - tu vas
être fusillé ! »
Mme François qui s'était jetée à la suite de son mari pour
l'empêcher de sortir, terrorisée qu'elle était par les
détonations, revint pour supplier les officiers attablés dans la
salle à manger d'intervenir : l'un deux se leva, alla
parlementer un instant et ramena M. François.
Celui-ci était à peine rentré que les bandits assis à sa table
se précipitant sur lui en riant aux éclats, le poussèrent bien
en vue dans l'encadrement de la fenêtre éclairée, puis se
collant au mur, bien abrités à droite et à gauche de la baie
lumineuse, ils se mirent à tirer des coups de pistolet en
allongeant le bars en dehors. Mme François ayant poussé un cri
d'épouvante et tenté de tirer son mari en arrière, les bandits
la placèrent brutalement à ses côtés et recommencèrent leur tir.
Des coups de feu ne tardèrent pas à répondre du dehors et
plusieurs projectiles vinrent crever le plafond, les tentures et
briser le lustre allumé.
M. et Mme François n'échappèrent que par miracle à cette atroce
tentative d'assassinat d'un genre spécial.
Le même soir, une mère dont les soudards violentaient la fille,
ayant supplié un officier d'intervenir, reçut de ce dernier la
réponse suivante : « Ce n'est sur pour cela que vous me dérangez
? Si vous recommencez... » et sans achever la phrase, il dit le
geste de la mettre en joue.
Le 13 août, la nuit étant venue, l'honorable M. Barthélemy,
ancien maire âgé de 86 ans, venait de poser sur une fenêtre la
lumière prescrite lorsqu'il fut massacré par un groupe de
Bavarois qui, en passant, avaient aperçu la silhouette derrière
les vitres closes ; Mme Barthélemy assista, impuissante et
terrorisée au supplice de son mari.
Une heure plus tard, au moment de la fusillade quotidienne, M.
Louis Foël, attendant sur le seuil de sa porte, avant d'aller
s'étendre sur son lit, la rentrée d'un officier supérieur qu'il
avait à loger, fut brusquement empoigné et entraîné. Collé au
mur de l'hôtel de ville, contre une affiche de mobilisation, à
quelques centimètres de la boîte aux lettres, il tombait fusillé
moins de cinq minutes après son arrestation : son cadavre, monté
au cimetière par ses assassins, fut jeté en travers d'une tombe
où il resta, loque pitoyable et sanglante, jusqu'à la fuite des
barbares - ceux-ci ayant fait défense à la famille de
l'ensevelir.
J'ai lu et j'ai entendu raconter, depuis mon retour de l'exil,
le récit de la mort de Louis Foël. Personne n'en a su ni vu les
véritables péripéties et il faut que tout le monde les
connaisse. Louis Foël n'a ni provoqué, ni menacé ses agresseurs
d'un revolver. Il avait subi sans révolte et sans rébellion le
sac de sa maison, et il fut saisi comme je viens de le dire, au
seuil de son logis par la meute hurlante et furieuse. Fort comme
Hercule, il secoua ses agresseurs à plusieurs reprises et
arriva, poussé plutôt que traîné, gardant ses bras libres,
contre le mur d'exécution.
Debout, les bras croisés, les dominant de sa haute stature, le
vieil Alsacien septuagénaire regarda ses bourreaux sans
sourciller, en les narguant de l'ironique sourire que nous lui
connaissions tous et il s'abattit sous la rafale de Mauser comme
s'abat le chêne sapé par la hache.
C'est un gendarme allemand qui m'a raconté la scène du meurtre à
laquelle il assista. Par extraordinaire, ce gendarme teuton
n'avait pas une âme de bête féroce et il m'avoua que l'exécution
du vieillard l'avait bouleversé et indigné. Je dois à la mémoire
du martyr - dont j'étais l'ami personnel - de faire connaître ce
témoignage d'un soldat ennemi est de proclamer que son nom
mérite de rester dans l'histoire à côté de celui des héros.
- Aux plaintes douloureuses ou indignées qui leur étaient
adressées sans relâche par le maire et par les habitants, les
chefs répondaient en excusant leurs hommes.
A l'accusation d'ivresse, ils répondaient : « Il est défendu à
nos soldats de s'enivrer et ils ne s'enivrent pas... S'ils tirent
sur les habitants, c'est pour répondre aux coups de feu que
ceux-ci tirent les premiers. Et puis... c'est la guerre ! ».
Cette exclamation : « C'est la guerre ! » était leur argument
définitif et péremptoire. « C'est la guerre ! » répondait le
prince de Bavière, commandant en chef, à son hôte, M. Burrhus,
quand celui-ci lui montrait d'un geste indigné, sa chocolaterie
qui flambait.
- « Nous nous sommes trompés : nous savons maintenant que votre
mari n'avait pas tiré de coups de feu ce soir là sur la place ;
mais c'est la guerre !... » répondirent les bourreaux à la veuve
de l'infortuné Foël, deux heures après le supplice de son mari.
S'il était inutile et superflu de discuter cet argument avec les
têtes carrées, j'eus tout de même l'occasion d'acquérir et de
placer sous les yeux de leurs médecins-majors une preuve
matérielle que leur fameux argument des coups de feu tirés par
les habitants n'était qu'un mensonge indigne.
Le 13 août au matin, un sous-officier m'amena un blessé qui
avait l'épaule fortement endommagée : « En voici un que nous
avons trouvé dans la rue au petit jour ; c'est encore un
franc-tireur de la ville qui a tiré avec son fusil de chasse »,
me certifia d'un ton furieux le sous-officier.
Sans lui répondre, j'examinai l'homme et, dès la première
palpation, je sentis sous mon doigt une balle de Mauser à peu
près intacte.
« Allez me chercher immédiatement votre major en chef, -
ordonnai-je au sous-officier qui, resté debout auprès de moi,
m'examinait curieusement -vous lui direz qu'il s'agit d'une
affaire extrêmement grave et urgente ».
Un quart d'heure plus tard arrivait un des majors principaux.
Comme la plupart des médecins allemands avec lesquels je me suis
trouvé presque nuit et jour en contact à partir du 8 août, il
était correct, poli et calme. Je le priai de procéder à
l'extraction du projectile logé dans l'épaule du blessé.
« Vos hommes, lui dis-je, affirment que ce blessé à reçu du
plomb de chasse ; il est indispensable que vous vous assuriez du
fait pour témoigner vous-mêmes. »
Un instant après, le chirurgien examinait avec un véritable
ébahissement la balle à chemise de nickel qu'il avait retirée du
bout de la pince.
« S'agit-il d'une chevrotine ou d'une balle de Mauser ? » lui
demandais-je.
- « Ceci, me répondit-il, est évidemment une balle de Mauser.
- « Voudriez-vous bien le certifier par écrit dans un
procès-verbal que nous signerions tous les deux ? »
- « Non, je ne puis signer une pièce écrite semblable »
- « Peu importe - conclus-je. - En ce qui me concerne, je vous
avertis que j'affirmerai ce fait, sous la foi du serment. Tous
les soirs, vos hommes, ivres et fous, tirent des feux de salve
dans nos rues et contre nos demeures, prétendant qu'ils se
défendent ainsi, légitimement, contre les attaques de nos
concitoyens armés de fusils de chasse.
« Or, les habitants ont tous déposés leurs armes à la mairie et
l'autorité militaire allemande a proclamé la peine de mort
immédiate pour tout civil qui garderait par devers lui un fusil
ou un revolver. Vos pionniers de l'équipe de pillage ont visité
nos demeures suivant une technique savante, percutant les murs,
sondant les plafonds, soulevant les lames de parquets,
bousculant la literie.
« J'ai vu des jardins et des caves défoncées à la profondeur de
deux fers de bêche. Par conséquent, à mois d'admettre sur vous
avez distribué des Mausers à nos concitoyens, vous devez
déclarer à votre commandant en chef que ce sont vos soldats qui
s'entretuent en voulant chaque soir, terroriser notre paisible
ville. »
Je ne reçus aucune réponse du médecin allemand qui se retira
avec un salut raide.
Le 13 août, à 11 heures et demie du soir, je venais de
m'étendre, tout vêtu, pour me reposer un peu, lorsque je m'entendis appeler dans la rue.
C'était M. Bentz, notre dévoué maire, qui, entouré de soldats,
venait me chercher. Il était accompagné de plusieurs notables
blâmontais. Je me joignis à eux et l'escorte armée nous
conduisit à l'hôtel de ville. Là nous attendaient plusieurs
officiers qui nous intimèrent l'ordre de reproduire à la main
une note prévenant les habitants que deux hommes et trois
chevaux ayant été tués par la population, l'autorité militaire
avait résolu de fusiller plusieurs notables et de bombarder la
ville.
MM. Bentz, Florentin, Diot, Ignard, Crouzier, Hertz et moi nous
ne pûmes sortir qu'après avoir copié plus de deux cents
exemplaires de cet avis. Une fois dehors, nous résolûmes de nous
rendre, séance tenante, en délégation, au logis du général en
chef, pour demander l'autorisation de faire évacuer les
habitants. Introduits à 5 heures du matin, nous fûmes informés
par un officier que réponse ne nous serait donnée qu'à 11
heures.
Confiants dans cette promesse tacite qu'aucune violence ne
serait commise avant notre entrevue, nous nous séparâmes.
Entrant à l'ambulance, je constatai qu'on y procédait à
l'enlèvement méthodique des blessés. Aux majors qui
surveillaient ce déménagement, je demandai : « Pourquoi
faîtes-vous déplacer les malades ? Où les conduit-on ?
- « Parce que - me répondirent-ils - nous ne devons pas laisser
les dans la ville qui sera bombardée et détruite aujourd'hui
même, par mesure de représailles.
« Comme vous avez soigné nos blessés avec le même dévouement que
les blessés français - ajoutèrent-ils - nous vous rendons le
service de vous prévenir et nous vous conseillons de partir au
plus vite. Nous tenons du comte von Malsheim, commandant la
place, que ceux des habitants qui le demanderont, pourront se
retirer en Suisse, sauf un certain nombre de notables qui seront
fusillés, le maire en tête. »
Ledit commandant von Malsheim était l'hôte de M. Louis François.
Je me rendis immédiatement chez celui-ci pour lui faire part de
l'avertissement qui venait de m'être donné.
Il fut immédiatement confirmé à M. Louis François par von
Malsheim lui-même.
Je rentrai chez moi avec l'intention de préparer, jusqu'à 11
heures du matin, moment fixé pour l'audience chez le général en
chef, les affaires indispensables ou précieuses que je comptais
emporter si j'évacuais Blâmont. A 8 h 45, un feldwebel se
présentait et me remettait un papier dont voici la traduction :
« Ordre de faveur, au sieur Lahoussay, vétérinaire, de quitter
aujourd'hui avant neuf heures du matin, le territoire d'Empire,
pour se rendre en Suisse. Devra se présenter eu chef de poste de
la gare de Sarrebourg avec le présent ordre pour « acheter » les
billets de voyage. »
Malgré la gravité des heures que nous traversions depuis le 8
août, j'avoue que je fus pris d'une envie de rire irrésistible à
la lecture des deux mots « territoire d'Empire », dont
l'outrecuidance teutonne étiquetait déjà le sol français une
semaine tout au plus après le commencement des hostilités.
A 9 heures, ayant rassemble à la hâte le linge et les hardes
indispensables dans deux valises et un sac de touriste, je
quittai Blâmont avec ma femme et mon enfant de cinq ans.
Devant l'hôtel de ville, des soldats rassemblaient tous les
hommes valides qu'ils trouvaient.
Le maire Bentz, son adjoint Florentin et le curé de Blâmont
arrêtés et ligotés - malgré l'audience promise pour 11 heures
par le commandant en chef - étaient gardés à vue par le peloton
évidemment destiné à les fusiller ;
Résolus dans une admirable dignité, la tête haute et le regard
ferme, ils nous saluèrent amicalement et M. Bentz nous dit : «
Je vous souhaite bon voyage et bonne chance. Nous, vous voyez,
nous allons partir probablement pour un autre voyage dont nous
ne reviendrons plus ! »
Je n'ai su que deux mois plus tard comment M.Bentz et ses
compagnons d'infortune avaient échappé au poteau d'exécution
grâce à l'arrivée foudroyante des troupes françaises quelques
heures après notre départ.
C'est au milieu d'un véritable troupeau humain, composé d'une
trentaine de familles blâmontaises et d'un grand nombre
d'habitants des villages voisins que nous atteignons Gogney, en
nous faufilant à travers d'innombrables convois, au milieu d'une
poussière tellement dense que nous n'apercevions rien à quelques
pas devant nous.
Grâce à la complaisance de mes clients de Gogney, je pus trouver
un cheval et une charrette sur laquelle je fis monter les
bagages et autant de femmes et d'enfants qu'elle en put
contenir.
M. Pretoy, propriétaire à Blâmont, conduisait le cheval ; M.
Crousier, notaire, surveillait les bagages et les enfants ;
moi-même je faisais fonctionner à l'arrière la mécanique de
serrage et j'exhibais les papiers aux soldats qui nous
arrêtaient à chaque instant pour nous interroger.
Tous ses arrêts se terminaient invariablement par la question
suivante, dont nous fûmes harcelés pendant plusieurs jours :
« Blâmont est-il brûlé ? à Blâmont, francs-tireurs tous tués,
n'est-ce pas ?
- Non, non, Blâmont, n'est pas brûlé », rétorquions-nous.
- « Doch ! Doch ! » (si,si), affirmaient nos interlocuteurs en
montrant de la main les épaisses colonnes de fumées qui,
derrière nous, marquaient le travail criminel auquel procédaient
dans nos villages frontières les brutes de l'armée allemande.
Nous espérions pouvoir nous reposer suffisamment à Sarrebourg,
après la dure épreuve de 30 kilomètres que nous avions fournie
pour atteindre et y prendre, le lendemain matin, nos billets
pour Constance.
Mais à l'entrée de la ville, nous fûmes immédiatement arrêtés et
conduits en prison, dans poste en armes, dont le chef après deux
secondes à peine d'examen, confisqua nos papiers en disant
qu'ils n'étaient pas en règle.
Après une nuit passée en cellule, on me restitua, crayonné de
rouge et de bleu « l'ordre de faveur » qui m'avait été remis à
Blâmont, - (de la part du médecin en chef, j'avais omis de le
dire plus haut) - en m'informant que cette pièce était désormais
valable sans conteste et qu'elle me permettrait de voyager avec
ma femme et mon enfant jusqu'à la frontière suisse.
Des billets pour Constance me furent en effet délivrés à la
gare, mais l'employé qui me les délivra me prévint que nous
n'aurions un train « pour civils » qu'à deux heures du matin,
c'est à dire dix-huit heures plus tard.
Pendant la journée, nous vîmes défiler dans les rues de
Sarrebourg plusieurs cortèges d'hommes de toutes conditions
expulsés, nous dit-on, de Pexonne et des environs. Ces
malheureux, ruisselants de sueur paraissaient extenués :
plusieurs, en sabots et n'ayant pour vêtement que leur pantalon
et leur chemise, nous dirent en passant qu'ils avaient été «
ramassés » pendant qu'ils étaient occupés dans leurs champs et
entraînés par les uhlans sans avoir pu repasser devant leurs
habitations.
A une heure du matin, un gendarme vint nous cherche à l'hôtel où
nous étions campés et où nous avions déclaré vouloir attendre
l'heure du départ : il nous conduisit à la gare où il nous
surveilla jusqu'au départ du convoi qui, enfin nous emporte vers
Strasbourg.
Nous espérions pouvoir repartir de Strasbourg sans y subir un
arrêt prolongé ; mais au débarcadère, après examen de nos
papiers et la persistante interrogation « Est-ce que Blâmont est
détruit ? », on nous conduisit à Kehl avec une escorte de
fantassins armés.
La présence de cette escorte qui nous encadrait attira vite
l'attention sur nous et, quand le mot de « Blâmont » eut été
prononcé par les soldats, la foule devint hostile et nous montra
les poings en criant « Capout Franzozes !... francs-tireurs
Blâmont capout : »
Parqués près de la voie ferrée de Kehl nous attendîmes pendant
de longues heures un « convoi pour civils » qui ne vint pas et
nous fumes ramenés à Strasbourg, après avoir assisté à
d'innombrables défilés de convois d'artillerie lourde.
Après une nuit passée à Strasbourg, je pus me faire indiquer un
loueur de voitures qui consentit à nous conduire à Oppenweier où
nous eûmes la chance d'avoir un train.
A Offenbourg, nouvel arrêt de cinq heures, nouvelle arrestation
et interrogatoire chez le Bezircksant qui nous laisse aller
après un estampillage de nos tickets de chemin de fer et de nos
« ordres de faveur ».
Pendant quatre heures consécutives nous vîmes défiler, comme à
Kehl et à Strasbourg, des trains militaires, se succédant de
trois en trois minutes, qu'une foule de badauds saluait de
furieux « hourrahs ! Hoch ! Hoch ! »
A Trilberg, où nous arrivâmes à deux heures du matin, éreintés
et à moitié endormis, nous fûmes brutalement jetés hors des
compartiments et enfermés à double tour dans une salle de la
gare. Un officier, qui survint et qui nous interrogea, l'un
après l'autre, me déclara que j'étais Alsacien et espion. Il me
fallut longuement discuter pour démontrer que mon livret
militaire, mon sauf-conduit signé du maire de Blâmont et mon
brevet d'automobiliste n'étaient pas des faux et que je n'étais
pas né en Alsace, mais à Dijon.
Enfin, nous pûmes remonter en wagon, sous l'oeil méfiant des
soldats boches et reprendre notre trajet ver Donaueschingen où,
à la descente du train, nous fûmes dépouillés de nos tickets
pour Constance. Comme nous refusions de nous en dessaisir,
l'officier qui surveillait notre débarquement nous invita à lui
présenter nos papiers et nous déclara, d'un ton cassant : «
Aucun étranger ennemi ne passe pas en Suisse ; vous êtes
prisonniers de guerre », et il empocha les ordres d'évacuation
qui nous avaient été remis pour la Suisse à Blâmont. Il nous fut
impossible de parlementer : baïonnette au canon, des fantassins
nous entraînèrent à travers une double rangée d'indigènes qui se
mirent à nous apostropher et à nous lancer de furibonds : «
Franzozes capout ! ... Blâmont, francs-tireurs, capout ! ...
Rauss ! ... »
Le camp où l'on nous conduisit comptait à ce moment 300 détenus
civils, Français, Anglais, Russes, Serbes, Alsaciens-Lorrains et
même Japonais. parmi eux nous rencontrâmes dix-sept de nos
concitoyens de Blâmont dont nous avions été séparés par les
diverses péripéties de notre exténuant voyage. Nous eûmes par
eux l'explication de l'aubade hostile qui nous avait accueillie
à notre arrivée dans le pays en même temps que celle de
l'insistance avec laquelle
on nous avait si souvent demandé si Blâmont était brûlé. Les
journaux avaient dès le 10 ou le 12 août, annoncé que notre cité
avait accueilli les soldats du kayser à coups de fusil, et que,
pour nous punir, le commandant en chef, prince de Bavière, avait
résolu de nous bombarder « pour l'exemple ». L'arrivée d'un
groupe de Blâmontais avait été également annoncée par les mêmes
journaux et c'est pourquoi les « braves » habitants de
Donaueschingen donnèrent un charivari menaçant à nos femmes et à
nos pauvres gosses exténués et épouvantés.
Je ne parle que pour mémoire des bagages qui nous furent «
égarés » ; un de nos compagnons d'exil, notaire, ne put
retrouver un sac contenant pour plus de cent mille francs de
titre. J'étais pour ma part, allégé d'une valise noire contenant
d'indispensables vêtements et que j'avais eu un mal infini à «
coltiner » sur mon dos.
Notre colonie était composée, à Donaueschingen, d'individus de
toutes conditions : les millionnaires y côtoyaient
fraternellement de malheureux paysans, qui n'avaient même pas
une blouse à mettre sur leur chemise.
Dès leur arrivée, et quelle que fut leur éducation, toutes les
femmes furent contraintes de procéder à l'épluchage des pommes
de terre qui devaient faire partie de la pitance commune. Elles
s'y employèrent avec activité et entrain et si les officiers
garde-chiourmes préposés à notre surveillance crurent les
humilier en leur prescrivant grossièrement cette besogne
ménagère, il durent être singulièrement déçus par la bonne grâce
à la fois narquoise et charmante avec laquelle leurs
prisonnières s'acquittèrent de la « corvée de patates ».
Les baraquements où nous étions casernés à Donaueschingen,
étaient propres. Mais la nourriture qu'on nous distribuait était
ignoble : cinq jours par semaine, le menu se composait d'un
liquide répugnant dans lequel nageaient quelques pommes de terre
- souvent avariées - mélangées avec des pois secs et à de l'orge
insuffisamment cuits et durs comme des cailloux. Deux jours par
semaine, en guise de viande, une rondelle de saucisse « au sang
» était ajoutée à la soupe.
Ce menu était le seul « substantiel » (?) de la journée. Le
matin et le soir, ceux qui avaient le coeur assez solide pour
l'avaler recevaient une tasse de « caf é » d'orge et de glands
torréfiés.
Chaque personne touchait chaque jour un pain blanc d'environ 500
grammes ; je dois reconnaître que ce pain était d'excellente
qualité, blanc et fort bien cuit.
Après vingt jours de cette détention à Donaueschingen, nous
fumes, un matin, tous invités à faire la déclaration exacte des
ressources pécuniaires que chacun de nous possédait. Ceux dont
l'avoir en numéraire fut jugé suffisant furent invités à partir
dans l'une des villes dont on nous présenta la liste.
Nous choisîmes presque tous Baden-Baden, mais le jour du départ,
on nous obligea à verser, pour l'abominable pitance à laquelle
nous avions été astreints, une addition d'un mark par jour et
par personne ; les bébés de l'âge du mien furent taxés au même
tarif.
Baden-Baden est une ville cosmopolite, comme toutes les grandes
stations balnéaires. Habituée aux touristes, la population leur
doit sa prospérité et ses ressources : à de rares exceptions
près, elle fut correcte et même hospitalière envers les internés
étrangers et nous vécûmes sans une tranquillité relative à
Baden-Baden, pendant près de trois mois, astreints seulement à
un appel hebdomadaire de la police.
Pour ma part, j'eus l'heureuse chance de trouver un petit
logement agréable chez une excellente et respectable dame dont
le fils est l'un des éminents professeurs de l'Ecole
Polytechnique de Zurich : grâce à l'obligeante entremise de mon
hôtesse et de son fils, je pus, après deux mois d'exil, faire
parvenir des nouvelles en France, à ma famille angoissée et en
recevoir d'elle dans une lettre qui nous inonda l'âme d'un chaud
rayon d'espérance à mes compagnons d'exil et à moi. A ce moment,
nous étions tous tristes et démoralisés de ne rien savoir de ce
qui se passait hors d'Allemagne. Les « extra-blatt » répandus à
profusion à Baden ne parlaient que de victoires teutonnes :
plusieurs fois par semaine, les cloches retentissaient, tandis
que les habitants arboraient - du lever au coucher du soleil -
des drapeaux qui pendaient - kolossaux - d'un étage à l'autre
(car en Allemagne les drapeaux ont l'envergure d'un drap de
lit).
Nous vîmes ainsi célébrer « la Victoire de Nancy », celle de
Lunéville, celles de Liège, de Namur, de Bruxelles, d'Anvers, de
Reims, etc. Les Badois faisaient déjà des préparatifs pour
glorifier « la prise » de Paris, lorsqu'enfin la première lettre
de France me parvint. Elle était forcément brève sur les
évènements, puisque j'avais prévenu mes parents que la
correspondance des pays neutres devaient circuler ouverte.
Néanmoins, datée de Dombasle-sur-Meurthe-, me parlant de gens
toujours en bonne santé et « tranquilles » à Nancy, à Lunéville
et ailleurs, elle nous a donné la certitude que les
réjouissances dont nous étions si souvent assourdis et attristés
n'étaient qu'un vaste bluff destiné à « monter le coup » à toute
la population de l'Allemagne. D'ailleurs, le thermomètre ne
tarda pas à baisser et maintenant les figures allemandes
s'allongent à la lecture des listes immenses sur lesquelles
s'inscrivent les morts, les blessés et les disparus.
J'ai dit avec quel sans-gêne brutal nous avaient été enlevés, au
saut du train - à Donaueschingen - mes tickets pour Constance et
l'ordre d'évacuation qui nous enjoignait d'évacuer en Suisse.
Nos protestations n'ayant pas été écoutées par l'officier qui
commandait le camp de Daonaueschingen et n'ayant pu obtenir la
restitution de ces documents, nous nous étions entendus pour
renouveler notre protestation à Baden-Baden et pour demander la
continuation de notre voyage jusqu'à Constance.
Personnellement, je protestai contre mon maintien en Allemagne,
en invoquant le cas pour lequel j'avais été réformé du service
militaire et en invoquant également les règles de la Convention
internationale de la Croix-Rouge de Genève.
Je n'étais pas combattant puisque réformé : j'avais en outre
assuré le service des ambulances et de l'hôpital de Blâmont, du
2 au 14 août, comme seul chef des services de la Croix-Rouge à
ce moment ; mon maintien forcé en Allemagne était donc
arbitraire et contraire au droit des gens.
Je fus d'abord invité à me présenter devant une commission
médicale militaire qui après un sévère examen, me délivra une
pièce établissant que par suite d'une fracture grave de la
cheville droite, j'étais impropre au service militaire. Cette
commission militaire fut courtoise avec moi.
Je fus ensuite invité à déposer chez le besirksamt une demande
de libération accompagnée de mon livret militaire et du
laissez-passer qui m'avait été délivré le 2 août par le maire de
Blâmont pour me permettre d'assurer le service de la
Croix-Rouge. Ledit laissez-passer avait été accepté, visé et
signé le 9 août au matin par le médecin en chef du corps
bavarois, lorsqu'il s'était présenté à l'hôpital.
Le besirksamt de Baden-Baden ayant jeté un coup d'oeil sur cette
pièce me déclara : « Je la crois indiscutable et je crois que
l'autorité militaire à laquelle je transmets votre dossier, ne
fera aucune objection à votre renvoi en Suisse. »
Partageant l'optimisme du fonctionnaire badois, je m'empressai
de faire parvenir aux êtres chers qui m'attendaient en France la
bonne nouvelle de mon arrivée probable.
Mais hélas ! avec les civilisés allemands, il faut toujours
penser à la fable : « La proie pour l'ombre ».
D'abord informé officieusement par le police que les bureaux du
corps d'armée avariant donné un avis favorable à ma demande, je
reçus plusieurs jours après la notification que « Berlin »
refusait de la prendre en considération parce que la pièce
attestant de mes services à la Croix-Rouge de Blâmont et
estampillée par le médecin en chef allemand ne portait aucun
sceau militaire. « Procurez-vous - me dit le fonctionnaire qui
me notifiait la décision de Berlin - une pièce portant les
cachets officiels de la Croix-Rouge et de l'autorité militaire
de votre région et je crois que vous aboutirez à un résultat
favorable. »
Ecrire d'Allemagne en France est long, difficile, même avec
l'aide d'un intermédiaire en pays neutre, puisque toutes les
lettres de ou pour ce pays ne doivent circuler qu'ouvertes et
puisqu'elles sont soumises à la censure des « cabinets noirs »
allemands.
Il me fallut donc plusieurs longues semaines pour demander et
recevoir la pièce libératrice qui fut rédigée par Mme René
Florentin (présidente de la Section de la Croix-Rouge de
Blâmont) et apostillée par M. le délégué officiel du ministère
de la Guerre Lépine, ainsi que par le commandant de la place de
Nancy.
Cette pièce me parvint le 20 novembre au moment où, après trois
mois de tranquilité relative à Baden, la police teutonne
commençait un régime de rigueur contre les étrangers retenus en
Allemagne. Dans la deuxième quinzaine de ce mois, nous étant un
jour présentés à l'appel hebdomadaire prescrit, nous fûmes
accueillis pas ces mots : « les Anglais et les Français
maltraitent nos blessés et nos prisonniers, vous êtes avertis
que si cela continue, vous serez emprisonnés ».
Deux jours plus tard, nous étions invités à quitter Baden-Baden
dans les vingt-quatre heures et à nous rendre dans une autre
ville, à choisir dans une liste qui nous fut présentée.
A notre question : « Pourquoi cette mesure », il fut répondu : «
Parce que vous êtes trop près d'Oas où nous avons une station de
dirigeables. Dorénavant, aucun prisonnier étranger ne pourra
rester à moins de vingt kilomètres des ouvrages militaires,
dépôt de munitions, hangars de ballons, etc... »
D'accord avec un certain nombre d'autres internés civils, je me
rendis à Pforzheim, grande ville du duché de Bade, qui, avant la
guerre, était paraît-il, le plus grand centre de production du
monde entier pour la bijouterie en « toc ».
Dès notre arrivée, la police nous intima l'ordre d'avoir à nous
présenter chaque jour à un appel individuel, sous peine d'une
amende de cinq marck pour la première infraction et de prison
pour les suivantes.
« Pourquoi cette sévérité alors que bous étions beaucoup plus
libres à Baden ? » demandai-je.
- « Parce que, me répondit l'argousin boche à qui j'adressais
cette question, parce que nous ne vous traiterons jamais comme
vous traitez les prisonniers allemands en France. Votre tribunal
de Versailles vient de condamner pour vol nos médecins
militaires. Vous subirez les conséquences de cette injuste
condamnation. »
Dès mon arrivée à Pforzheim, je présentai au Bezirksamt une
nouvelle demande de départ pour la Suisse. Ce fonctionnaire qui
me reçut avec une correction guindée, visa mes pièces sans
soulever d'objection et me remit un mot pour le médecin-chef des
ambulances de Pforzheim, par lequel je devais faire également
viser mon dossier.
Je trouvai le médecin dans le principal hôpital. Il
m'accueillit, lui, avec beaucoup d'affabilité, lut avec
attention les pièces que je lui tendis, et, après avoir rédiger
une note qu'il épingla à ma pièce officielle de la Croix-Rouge
de Nancy, il m'offrit de visiter son « lazaret » (où tout, entre
parenthèse me parut admirablement aménagé). Par une délicate
attention, je fus conduit dans une salle où quarante de nos
soldats français étaient soignés. Ils appartenaient au 13e corps
et il me déclarèrent tous, l'un après l'autre, qu'ils étaient
soignés avec beaucoup d'attention et traités exactement sur le
même pied que les blessés allemands. La plupart étaient
d'ailleurs en excellente voie de guérison. En me reconduisant,
le médecin en chef m'informa qu'il autorisait à revenir voir mes
compatriotes aussi souvent que je le désirerais. Je n'ai pu,
malheureusement, profiter jusqu'à la fin de mon exil, de cette
faveur accordée spontanément par un ennemi aux sentiments
généreux.
En effet, dès le surlendemain, m'étant présenté à l'appel des
internés civils avec quelques minutes de retard, je fus puni
d'une amende cinq mark qu'il me fallu payer séance tenante : en
guise de reçu, une note me fut remise qui précisait qu'à la
première récidive l'amende serait triplée et accompagnée de huit
jours de prison.
Vingt-quatre heures après cet incident, le chef de la police
nous prévint, après nous avoir mandés tous dans une cour gardée
par des agents, qu'en raison des attentats commis par des avions
sur Fribourg-en-Brigsau, contrairement aux lois de la guerre
(sic), des mesures sévères étaient imminentes contre nous.
La mise à exécution de cette révoltante menace ne se fit pas
attendre : le 16 décembre, tous mes compagnons français et moi
nous étions arrêtés et mis en cellule à la maison d'arrêt de
Pforzheim ; en même temps, nous apprenions que le même
traitement était infligé à tous les étrangers retenus en
Allemagne.
En nous voyant arriver en son édifice, le gardien-directeur de
la prison déclara, en nous bouclant, « qu'il aurait »,nos os de
« Franzozen ! » Et de fait, la canaille nous fit endurer toutes
les vexations possibles. Pour mon compte, je fus bousculé,
fouillé, dépouillé de tout ce que contenaient mes poches - y
compris un petit peigne à moustaches. On nous mit au régime des
condamnés à mort : une assiette de soupe à l'eau dans la
journée. La cellule ne contenait rien autre chose qu'un lit et
baquet, et le lit se redressait contre le mur où il restait
cadenassé du lever au coucher, de façon à ce qu'il fut
impossible de s'y asseoir pendant la journée.
Une promenade dans la cour intérieure, me permettait de revoir
chaque jour mes compagnons pendant deux heures ; nous tournions
en cercle, à cinq pas l'un de l'autre, avec défense d'échanger
une parole, sous peine de cachot.
Le 20, nous fûmes livrés à l'autorité militaire et, sans savoir
le sort qui nous était réservé, nous considérâmes notre sortie
de la geôle de Pforzheim comme une délivrance.
Conduits à la gare entre une double haie de baïonnettes, nous
fûmes pourtant autorisés, avant le départ, à embrasser nos
femmes et nos enfants, qu'on avait consenti à prévenir et à
rassembler pour ces adieux et auxquels on fit connaître séance
tenante qu'ils seraient expulsés d'Allemagne le 31 décembre au
plus tard.
Enfermés dans de vieux wagons délabrés, dont les rampes et
mains-courantes en cuivre avaient été enlevées, sous la
surveillance de sous-officiers armés - sans doute parce qu'on
n'avait pas une confiance suffisante dans l'incorruptibilité des
simples fusiliers -, nous fûmes transportés à 800 km de
Pforzheim, après un voyage qui dura vingt-huit heures et pendant
lequel il ne nous fut permis de descendre des guimbardes que
deux fois, à l'une pour recevoir un verre de « café impérial »
aux glands doux - l'autre pour toucher un pain noir accompagné
d'un morceau de « wurst ».
Le terme de notre voyage était Holzminden, dans le duché de
Brunswick, au milieu du massif du Hans.
A quatre kilomètres et demi de cette petite ville s'étend un
camp qui doit être désormais le centre militaire de détention
pour les internés civils retenus en Allemagne.
Erigée en plein champs, dans un vrai cloaque de boue liquide,
cette cité de malheur est composée de baraques en planches plus
ou moins jointes, à l'achèvement desquelles 40 soldats français
et environ 350 soldats belges travaillaient quand j'y arrivai
avec mes compagnons.
Cinquante personnes auraient de la peine à s'y loger à l'aise ;
aussi la chiourme militaire prussienne y place cent vingt
individus ; comme literie, des sacs contenant de petits copeaux
d'emballage trempés par un long séjour sur le sol et par les
gouttières ruisselant entre les planches mal assemblées et
disjointes par l'humidité ; comme confortable moderne :
l'électricité.
Je précise les conditions d'aménagement parce que j'ai appris
qu'un délégué plus ou moins officiel de je ne sais quelle
administration a affirmé l'existence à Holzminden d'un
confortable hygiénique avec chauffage central, douches chaudes,
électricité, etc, etc.
Ce délégué a probablement visité l'appartement du comandant
militaire ; mais il n'a sûrement pas couché sur les copeaux des
internés ni goûté à leur nourriture.
Il y a à Holzminden, des détenus de tous les âges : femmes,
enfants, adultes et vieillards appartenant à tous les rangs
sociaux.
La plupart ont vu tout ce qu'il est possible de voir en fait de
carnage et d'horreurs.
J'ai causé là avec des habitants du Pas-de-Calais, de la Somme,
de la Meuse, de tous les départements envahis, de Belgique, à
des gens de ma clientèle, à des Alsaciens-Lorrains arrêtés et
brutalisés comme « suspects ». Beaucoup sont dans un dénuement
lamentable, ayant été arrêtés dans leur champ sans avoir pu
repasser devant leurs demeures pour y prendre le moindre objet
indispensable.
Le camp entouré d'un enchevêtrement de fils barbelés et de 3
mètres de hauteur, surveillé par des sentinelles apostées dans
des blockhaus.L'un des côtés de l'enceinte est limité par un
bois sur la bordure duquel une batterie d'artillerie a été
installée ; on prévoit qu'en cas d'émeute ou de rébellion, les
pièces de cette batterie nous réduiraient immédiatement à
l'obéissance.
Ce camp, lorsqu'il sera complètement achevé, pourra contenir dix
mille otages et internés civils ; il y en avait 4.600 fin
décembre. A ce moment, il était permis à chaque détenu d'écrire
et de recevoir, chaque semaine, une lettre de 32 lignes.
J'ai su que, depuis ma libération, cette faculté était réduite à
une lettre par mois.
Comme nourriture, la même « ratatouille » répugnante qu'à
Donaueschingen ; c'est un adjudicataire qui devait nourrir la
colonie, moyennant 65 pfennigs par tête et par jour. Comme il
n'en dépensait que 20 à peine, il réalisera d' « honnêtes »
bénéfices avant le licenciement des malheureux qu'il affame si
la situation se prolonge. Il est vrai d'ajouter qu'à ceux dont
les ressources sont suffisantes, ce mercanti allemand vend à
prix d'or saucisses, charcuterie et autres « delicatessen ».
Nous pouvions circuler, converser et jouer (sans enjeux
d'argent) dans les limites de l'enceinte barbelée. Et il nous
avait été enjoint de saluer les officiers que nous croisions.
Inutile de dire que nous usions de toutes les ruses pour éviter
de nous trouver face à face avec eux.
Le 21 décembre pourtant, au matin, je heurtai le commandant au
moment où il tournait l'angle de mon baraquement ; gardant mes
mains dans mes poches, je passai sans faire mine de le voir.
Deux minutes plus tard, un feldwebel m'enjoignit brutalement de
le suivre chez son officier qui m'apostropha de la façon aimable
que voici : « Pourquoi n'avez-vous pas salué « une personne » il
y a un instant ! Est-ce ainsi qu'en France on témoigne le
respect à ses supérieurs ? »
- Je savais que vous étiez le supérieur des soldats qui nous
surveillaient ici ; mais personne ne m'a dit que vous étiez le
supérieur des prisonniers », ripostai-je.
- « Français à forte tête, vous ! - jargonna le garde-chiourme
en chef - Je vous punirai sévèrement au premier manquement ;
retirez-vous de mes yeux !... ». Le soir ce de jour, le même
sous-officier revint me chercher en me saluant comme ils saluent
là-bas leurs officiers et me reconduisant chez le même «
supérieur » qui, aussi aimable à ce moment qu'il avait été rogue
le matin, me dit en se casant plusieurs fois en deux : « Le
général m'envoie l'ordre de vous mettre en liberté « immédiate »
et « tout de suite ». Mais je ne consens pas à vous laisser
partir à cette heure pour quatre « kilometter ». Je fais
préparer à vous une chambre dans mon bâtiment. »
Je remerciai le « supérieur » et lui déclarai que je tenais à
passer cette dernière nuit sur mes copeaux afin de prendre congé
de mes compagnons d'internement.
Malgré la joie que j'éprouvais à la pensée de reprendre ma femme
et mon enfant à Pforzheim (où ils devaient m'attendre jusqu'au
31), c'est avec un douloureux serrement de coeur que je quittai,
au petit jour, les braves gens dont je venais de partager les
souffrances et dont je gardais l'amitié.
Quarante huit heures plus tard, je sortais de l'odieux «
territoire d'Empire », non sans avoir subi une dernière vexation
de la brute casquée qui, à la barrière de la douane, examinait
d'un air furieux les voyageurs pour la Suisse : il tourna et
retourna dans tous les sens le passeport délivré à mon nom par
l'agent consulaire espagnol, le mit dans sa poche et refusa
rudement de me le rendre. « Rauss » ! meugla-t-il pour finir.
Malgré le grand désir que j'aurais eu de garder ce document,
preuve et souvenir du cauchemar que je venais de vivre durant
quatre mois et demi, je n'essayai pas d'insister davantage.
Pourtant, ce passeport m'était indispensable pour rentrer en
France et regagner Nancy, et j'étais fort préoccupé de son
escamotage. Grâce à la bienveillante complaisance de notre
ambassadeur à Berne, je fus muni d'une autre pièce qui m'évita
toute entrave et tout retard.
Le 30 décembre, je foulais les pavés de Nancy et j'embrassais
mes chers parents. J'apprenais en même temps que je ne possède
plus rien. - tout ayant été pillé et détruit chez moi, - et que
la horde barbare des boches avait parachevé dans la plupart de
nos malheureux villages frontière l'oeuvre infernale de carnage
et d'incendie dont j'avais vu le commencement lorsqu'ils
m'expulsèrent de Blâmont.
Quand reviendront ceux que j'ai quitté à Holzminden ?
Beaucoup, dont la santé est fortement ébranlée, ne reviendront
peut-être jamais ! Et cette pensée m'est infiniment douloureuse,
car les amitiés scellées sur la terre d'exil par des souffrances
comme celles que nous avons supportées en commun sont, comme on
dit chez nous : « à la vie, à la mort ! »
J'ai, en rentrant en France, transmis à beaucoup de mes
compatriotes les souvenirs, les nouvelles et le voeux d'un grand
nombre de mes compagnons d'Holzminden qui m'en avaient chargé.
L'un deux, en particulier, M. E... de Strasbourg, - interné avec
nous et très durement traité parce qu'il n'a jamais consenti à
dissimuler son ardent amour de la France et parce que son fils
est sergent dans l'un de nos régiments de la « division de fer »
- m'a dit en me quittant : « Faîtes savoir à mon fils de ne pas
se tourmenter sur mon compte et affirmez-lui que je ne me
tourmente pas, moi, parce que quand je retournerai à Strasbourg,
je suis sûr que c'est en terre française et que je retrouverai
notre demeure. »
Partageons tous la certitude de ce patriote alsacien et gardons,
invincibles, notre confiance et notre espérance !...
A. LAHOUSSAY
Vétérinaire-inspecteur sanitaire à Blâmont.
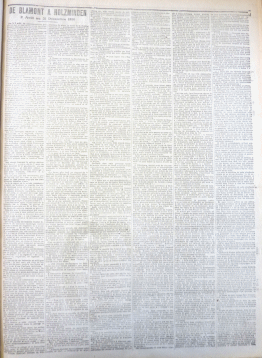 |
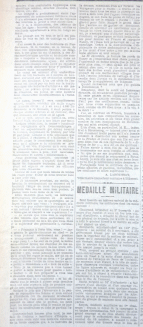 |
| |
|
|
NDLR :
concernant la relation de la mort du
brigadier Simon et
la poursuite qui s'en suivit il est possible que A. Lahoussay ait été témoin oculaire de la scène vu que sa
maison était située dans la "rue de Barbas"
(actuellement Foch), en face de l'église :
 |
|